![]()
Présentation
Textes et documents
Articles de journaux
Le Ménestrel 10 et 17 octobre
1886
Programme des Concerts Colonne 18
mars 1894
Revue d’Art
Dramatique janvier
1900
Le Monde
Musical 30 novembre 1903
Le Ménestrel
8 mai 1909
Lettres
Lettre de Berlioz à Georges de
Massougnes
Lettres de Georges de Massougnes
Lettres de Henri Chapot et d’Édouard
Colonne
Lettres de Jean de Massougnes
Illustrations
Cette page est disponible aussi en anglais
Avertissement: Tous droits de publication et de reproduction des textes, photos, images, et partitions musicales sur l’ensemble de ce site, y compris leur utilisation sur l’Internet, sont réservés pour tous pays. Toute mise en réseau, toute rediffusion, sous quelque forme, même partielle, est donc interdite.
![]()
‘Chronologiquement et sans conteste’, Georges de Massougnes a été ‘le premier champion’ de Berlioz: tel est le titre que revendique pour lui son fils Jean de Massougnes dans une lettre datée du 9 mai 1941, dont on trouvera le texte intégral reproduit sur cette page. La lettre, adressée au Président de la ‘Société des Amis de Berlioz’ à La Côte-Saint-André, Joseph Charbonnel (lui-même descendant d’Antoine Charbonnel, ami de Berlioz des années 1820), traite de l’œuvre de son père pour défendre la gloire de Berlioz et de son intention de léguer à la ‘Société des Amis de Berlioz’ nombre de documents se rapportant à Berlioz qui avaient appartenu à son père. La lettre fait partie d’un ensemble de lettres inédites de Georges de Massougnes ou le concernant qui se trouvent au Musée Hector-Berlioz, et qui sont publiées ici pour la première fois. Nous exprimons notre vive reconnaissance au Musée de nous avoir permis de transcrire ces textes, d’en avoir fourni nombre d’images, et de nous avoir accordé la permission de les reproduire sur ce site.
Ce titre pourrait certes être revendiqué par d’autres, notamment Ernest Reyer, ami de Berlioz, ou encore Adolphe Jullien. Mais les titres berlioziens de Georges de Massougnes sont réels. Descendant d’une famille noble, les Massougnes des Fontaines dont la lignée remonte à plusieurs siècles et qui existe encore, Georges de Massougnes tient une place à part parmi les premiers partisans de Berlioz en France. Aristocrate d’esprit et non seulement par la naissance, il est un des plus convaincus et perspicaces admirateurs du compositeur, qui est pour lui tout simplement ‘le plus grand musicien du siècle’, et Massougnes lui-même est selon certains ‘par tempérament, très proche parent de Berlioz’ et ‘son héritier moral’. Mais il n’a pas le relief des grands chefs d’orchestre de l’époque tels que Jules Pasdeloup, Édouard Colonne, ou Charles Lamoureux, et parmi les écrivains et critiques de profession qui s’expriment régulièrement dans la presse de Paris, tels Reyer et plus tard Jullien au Journal des Débats, ou Hippolyte Barbedette, Amédée Boutarel et d’autres au Ménestrel, il a sans doute fait figure de marginal (dans ses nombreux articles sur Berlioz Julien Tiersot ne semble jamais le mentionner, mais par contre Reyer le cite dans un de ses feuilletons). Massougnes n’a publié qu’un seul livre sur Berlioz, de dimensions modestes (en 1870) et ne semble pas avoir cherché à réunir ses articles ultérieurs sous forme de livre (à l’encontre de Reyer, par exemple). Discret semble-t-il et un peu effacé en tant que personne (voir par exemple sa lettre de 1898 à J.-G. Prod’homme), les renseignements biographiques sur lui sont peu abondants et doivent souvent être déduits de ses propres écrits. Ce n’est peut-être pas par hasard qu’on trouve difficilement des portraits de lui, qui ont pourtant existé (il est question par exemple d’un portrait exposé au Grand Palais en 1909, et dans la lettre de son fils évoquée ci-dessus son fils promettait de donner au Musée Berlioz une photographie de son père).
Selon son fils, Massougnes avait 26 ans en 1868 et est donc né en 1842; il meurt le 23 janvier 1919. Il a à peine atteint la vingtaine qu’il se passionne déjà pour la musique de Berlioz, comme on peut le déduire de son livre. Il dit avoir assisté aux représentations des Troyens à Carthage au Théâtre Lyrique en novembre et décembre 1863, mais manque la première le 4 novembre; il s’abstient donc d’émettre une opinion sur la Chasse royale et orage, puisqu’elle est supprimée après la première représentation et que la grande partition n’a pas été publiée (visiblement Massougnes se met vite à étudier toutes les partitions de Berlioz alors disponibles). On ne sait si les représentations de 1863 sont le premier contact de Massougnes avec la musique de Berlioz, mais — malgré toutes les coupures dont il n’est conscient qu’en partie — Les Troyens font d’emblée une profonde impression sur lui: par la suite Berlioz sera presque toujours pour lui ‘l’auteur des Troyens’, plutôt que l’auteur, par exemple de la Damnation de Faust ou de la Symphonie fantastique, ce qu’il est pour beaucoup à l’époque (voir la lettre de 1881, la notice du programme de 1894 sur Felix Mottl, son article de 1900 sur Berlioz et Wagner, et celui de 1903 sur Berlioz [p. 108, 119, 137]). Son fils, élevé dans le culte de Berlioz, partage ce point de vue (voir les lettres de 1919 et 1941). Massougnes laisse aussi entendre qu’il a assisté à plusieurs exécutions de la 2ème partie de l’Enfance du Christ au Conservatoire (en avril 1864 et 1866) et déplore qu’on n’y entende jamais le reste de l’ouvrage. Il dit aussi avoir entendu des fragments de Roméo et Juliette aux Concerts populaires de Pasdeloup (ceci se passe en 1868): il critique sévèrement l’interprétation, tant de la part des instrumentistes que du chef d’orchestre. Mais vers la fin de son livre il évoque aussi un moment enchanteur: c’est l’exécution du Septuor du 4ème acte des Troyens le 7 mars 1866 aux Concerts populaires, en présence du compositeur; Massougnes est assis pas loin, et Berlioz reçoit une ovation enthousiaste quand l’auditoire le reconnaît.
De telles occasions d’entendre la musique de Berlioz sont rares à Paris dans les années 1860, mais elles suffisent pour enflammer Massougnes et de faire de lui le partisan convaincu de Berlioz qu’il restera tout au long de sa vie. En 1868 il écrit deux articles enthousiastes sur son idole dans le Redressement (la matière en sera reprise dans le livre de 1870) et il s’enhardit à envoyer un exemplaire à Berlioz: Berlioz, à peine de retour de son dernier et épuisant voyage en Russie, lui répond chaleureusement dans une lettre datée du 25 février et déclare vouloir le rencontrer (CG no. 3344). L’autographe de la lettre est pour Massougnes un document sans prix: il en reproduit un facsimilé en tête du livre sur Berlioz qu’il publie en 1870, seulement quelques mois après la mort du compositeur et avant la publication tant attendue des Mémoires. Livre remarquable, en avance sur son temps, malgré toutes les lacunes que l’auteur est le premier à admettre, et qui mérite d’être mieux connu (le texte intégral est reproduit sur ce site, avec une image de la lettre de Berlioz et l’important Avant-propos ajouté par Jean de Massougnes lors de la réédition du livre en 1919). Massougnes ne fait aucun commentaire sur la lettre de Berlioz dans son livre et on ne sait au juste si les deux hommes se sont rencontrés ou non. Berlioz part pour Nice et Monaco le 1er mars, quatre jours après avoir écrit la lettre (1868 est une année bissextile), et quand il revient à Paris plus tard en mars il souffre des effets d’une chute et d’une congestion cérébrale, et mettra du temps à se remettre. Il n’est plus question de Massougnes dans ce qui reste de la correspondance de Berlioz. Tant dans son livre que dans ses articles ultérieurs Massougnes n’affirme jamais avoir rencontré Berlioz en personne, mais c’est peut-être aussi par discrétion. Une expression de Jean de Massougnes dans son Avant-propos de 1919 pourrait laisser entendre que la rencontre a bien eu lieu: la réception de la lettre procure ‘à son destinataire la tardive et douloureuse satisfaction d’entrer dans l’intimité du plus grand génie musical de la France’, mais l’expression n’est sans doute pas probante.
Selon Jean de Massougnes (fin de sa lettre de 1941), la brochure de son père de 1870 ‘a été suivie de maint article’. Cette page n’en reproduit que quelques-uns, tous importants en soi, mais ces articles ne peuvent donner qu’une vue partielle de l’œuvre de Massougnes pour Berlioz, et d’autres seront sans doute ajoutés en temps voulu. On remarquera que Massougnes s’est intéressé en premier lieu aux œuvres de Berlioz et à son esprit, et non à sa biographie.
Il n’y a pas lieu de s’étendre ici sur les textes reproduits ci-dessous: le lecteur pourra juger. En premier lieu vient un texte qui sort de l’ordinaire, publié dans Le Ménestrel en octobre 1886. La date est en soi significative: le texte est visiblement publié pour coïncider avec l’inauguration de la statue du compositeur au Square Vintimille à Paris le 17 octobre 1886, projet auquel on sait que Massougnes a été intimement lié pendant plusieurs années (voir ci-dessous). Il s’agit d’une nouvelle, tout à fait dans l’esprit de l’auteur des Soirées de l’orchestre, intitulé ‘La Revanche de Berlioz’ et qui pourrait avoir pour sous-titre ‘Le Suicide par désespoir’ — le suicide étant en l’occurrence celui du critique Pierre Scudo, ennemi acharné de Berlioz de son vivant et bête noire de Massougnes (voir le chapitre sur Scudo de son livre de 1870). Scudo, forcé malgré lui de reconnaître enfin le génie de Berlioz, ne voit d’autre issue que la mort… Suit un article de 1900 intitulé ‘Berlioz et Wagner’ qui permet de mesurer le chemin parcouru par Massougnes depuis 1870 dans son estimation de Wagner. Alors que 30 ans plus tôt, Wagner ‘a, quand il lui plaît, la douce médiocrité qu’il faut à la foule’, et Massougnes s’élève contre la ‘prédilection’ d’un critique (Gasperini) pour ‘la grosse artillerie’ de Wagner, en 1900 Wagner est maintenant pour Massougnes l’égal de Berlioz et l’un des quatre dieux de son panthéon, en compagnie de Gluck et Beethoven (mais pas Bach ou Mozart) (voir aussi la lettre à Prod’homme du 17 avril 1898, p. 4). Massougnes souligne aussi l’admiration de Wagner pour Berlioz et cite ici un document intéressant qu’il tient de la main de Felix Mottl, l’esquisse d’un article de Wagner de 1840 ou 1841 où Berlioz est comparé à Beethoven et à Napoléon… Finalement un article de 1903, l’année du centenaire de Berlioz — remarquons au passage que Massougnes n’a pas contribué au Livre d’or du centenaire d’Hector Berlioz — article qui, comme celui de 1900 auquel il fait souvent écho, permet de mesurer à la fois la cohérence de la vision de Berlioz qu’a Massougnes et la distance parcourue depuis le livre de 1870. En 1870 Massougnes n’étudie en détail que trois œuvres, l’Enfance du Christ, Roméo et Juliette et les Troyens (ou plutôt les Troyens à Carthage) et se voit forcé de faire l’aveu désarmant qu’il connaît ‘à peine’ Harold en Italie et le Requiem, et qu’il n’a ‘absolument aucune idée’ de la Symphonie fantastique, du Te Deum, et de la Symphonie funèbre et triomphale, parce qu’à l’époque on ne pouvait les entendre à Paris. Ceci se passait avant le renouveau des années 1870 qui changeront radicalement la position de Berlioz en France, mouvement auquel Massougnes lui-même a apporté sa contribution. Massougnes rend hommage à Édouard Colonne pour avoir fait connaître l’œuvre de Berlioz à Paris, en France et à l’étranger. Mais il critique aussi la carence des théâtres lyriques qui, à l’encontre de l’Allemagne, n’ont pas fait justice aux opéras de Berlioz (la question est examinée plus longuement ailleurs sur ce site). Quant au public, il reste pour Massougnes tout aussi superficiel dans ses goûts, et seule une élite artistique est capable d’apprécier à sa juste valeur Berlioz, ‘le plus grand, le plus extraordinaire, le plus glorieux de nos musiciens, celui qui égale les illustres maîtres de l’Allemagne et fait tenir à la France le rang de « grande puissance » musicale.’
Dans sa lettre de 1941 Jean de Massougnes réaffirme son intention de léguer à la ‘Société des Amis de Berlioz’ et au Musée de La Côte Saint-André les documents de la collection de son père qui se rapportent à Berlioz, et il cite en particulier sa correspondance avec Édouard Colonne et Felix Mottl. La guerre a sans doute empêché la réalisation de ce vœu. Ce que le Musée possède à l’heure actuelle ne représente évidemment qu’un petit fragment de la collection de Massougnes. Il possède l’exemplaire du livre de 1870 donné par Massougnes (on ne sait quand) avec l’inscription autographe ‘Hommage à la maison natale de Berlioz’. La perte — pour l’instant du moins — de la correspondance avec Colonne et Mottl est particulièrement regrettable. Il est difficile d’estimer l’influence qu’aurait pu avoir Massougnes sur la programmation des Concerts Colonne. Massougnes a certainement joué un rôle dans l’invitation de Felix Mottl de se produire au Châtelet le 18 mars 1894 (voir ci-dessous), mais sauf pour cette occasion spéciale, le nom de Massougnes semble absent par la suite des notes des programmes du Châtelet. À partir de 1897 environ elles font régulièrement appel, pour la musique de Berlioz ainsi que d’autres compositeurs, à Charles Malherbe, moins totalement acquis à Berlioz que ne l’était Massougnes. Par contre on voit des extraits du livre de Massougnes concernant Roméo et Juliette reproduits sur quelques programmes des Concerts Lamoureux (le Musée Hector-Berlioz possède des exemplaires des programmes du 7 décembre 1902 et du 6 décembre 1903). À l’heure actuelle le Musée n’a qu’une seule lettre de Colonne à Massougnes datant de 1896, concernant une représentation éventuelle des Troyens sur une scène parisienne: le texte en est reproduit ci-dessous avec une lettre des héritiers de Berlioz qui explique le contexte. Les héritiers accordaient à Colonne pour un an le droit de représenter les Troyens à Paris en deux soirées consécutives (comme à Carlsruhe en 1890), mais seulement à condition que Colonne obtienne la direction du futur Théâtre Lyrique… Le projet n’aboutit pas.
Malgré la perte de la correspondance entre Massougnes et Mottl, les articles de 1900 et de 1903 laissent entrevoir l’étroitesse des rapports entre les deux hommes, et la notice biographique du concert du 18 mars 1894 (voir ci-dessous la transcription de ce texte ainsi que les images du programme) fournit un témoignage qui leur est antérieur. Cette notice semble faire date aux Concerts Colonne: elle dresse un portrait complet de Felix Mottl et donne une esquisse de sa carrière. Dès le début de sa carrière Mottl, très lié avec Bayreuth, est un partisan convaincu de Wagner; mais Massougnes souligne qu’en même temps le chef viennois s’enthousiasme pour la musique française, et tout particulièrement pour Berlioz. Il évoque une visite faite par lui au domicile de Mottl à Carlsruhe (elle doit remonter à l’année précédente), au cours de laquelle il voit dans un salon le masque de Berlioz affiché entre des bustes de Beethoven et de Wagner. Des allusions dans l’article de 1900 laissent entendre que Massougnes a joué un rôle important dans l’invitation de Mottl à Paris en 1894, évènement marquant dans l’histoire des concerts symphoniques à Paris: c’est Massougnes qui accueille Mottl à son arrivée et lui fait visiter la ville, et à sa demande lui fait voir les tombes de Berlioz et de Napoléon. On ne sait si les rapports entre les deux hommes remontent encore plus loin — Mottl œuvre pour Berlioz presque dès le début de sa nomination à Carlsruhe en 1880. Mais leurs rapports restent étroits au long des années 1890 et au delà: Massougnes relate plusieurs anecdotes concernant l’admiration de Wagner pour Berlioz qu’il tient de la bouche de Mottl, et c’est Mottl lui-même qui fournit à Massougnes en 1898 une transcription de l’ébauche d’un article de Wagner sur Berlioz évoqué ci-dessus.
Les lettres de Massougnes conservées au Musée Hector-Berlioz, qui sont reproduites ici pour la première fois, datent avec deux exceptions, l’une de 1898 et l’autre d’environ 1900, d’une période antérieure (1881-1890). Elles font partie d’un dossier plus important de lettres inédites qui concernent le projet d’ériger une statue en l’honneur de Berlioz à La Côte Saint-André. Ce dossier fait ressortir un fait souvent négligé, à savoir que c’est la ville natale du compositeur, et non Paris, qui la première a eu l’idée d’une statue en l’honneur du compositeur. Paris par la suite récupère le projet pour son propre compte, prend les devants et érige une statue en octobre 1886, alors que le projet de La Côte n’aboutira finalement qu’en septembre 1890. La ville doit se contenter d’une copie de la statue de Paris, et non d’une statue originale comme il avait été d’abord envisagé, mais pour finir le résultat ne manque pas de justice: l’original à Paris de la belle statue par Alfred Lenoir n’existe plus mais survit dans la copie faite, à partir de l’original, pour La Côte Saint-André, où on peut toujours l’admirer sur la Place Hector Berlioz.
On peut reconstituer en partie l’évolution des deux projets d’après le dossier de lettres. Vers la fin de 1880 on constitue un comité à La Côte pour gérer le projet, mais comme il manque de ressources on propose la création d’un comité à Paris pour l’appuyer. Le projet est d’abord bien reçu, et plusieurs lettres dans le dossier témoignent de l’empressement de diverses personnalités d’apporter leur soutien, entre autres Édouard Colonne, le vicomte Delaborde qui devient le président du comité de Paris, Victor Massé, Jules Massenet, Henri Litolff et Ernest Reyer. Massougnes lui-même ne fait pas partie du comité de Paris mais du comité dauphinois, comme le montre sa lettre du 7 février 1881 adressée sans doute à Victor Moureton, vice-président du comité dauphinois, dans laquelle il le met au courant longuement des délibérations du comité parisien. Au départ tout s’annonce bien; nous reproduisons sur une page séparée une lettre inédite du 23 juin 1881 au Musée Hector-Berlioz, de la plume d’un amateur de Berlioz peu inconnu, Ernest Rollin, dans laquelle il exprime en termes émouvants sa joie à la nouvelle et son ardeur de contribuer au projet en l’honneur du ‘plus grand musicien du siècle’.
Mais le projet se heurte bientôt à des difficultés, comme le révèle déjà la lettre de Massougnes de 1881, et à Paris certains s’intéressent à l’idée de détourner le projet pour le compte de la capitale. Plusieurs lettres dans le dossier (non reproduites ici) le laissent entrevoir. Deux lettres d’Edmond Hippeau, directeur du journal La Renaissance Musicale, datant de février 1882 [numéros d’inventaire R96.1081.1 et 2] le montrent poussant l’idée d’un monument Berlioz à Paris (au cimetière Montmartre), que les comités régionaux sont appelés à soutenir, avec l’intention avouée de sa part d’en garder personnellement tout le mérite. La deuxième lettre suggère que Hippeau s’attend à ce que Massougnes s’oppose à son projet et tient à le rallier à son point de vue (la correspondance de Massougnes montre qu’il a toujours appuyé le projet de La Côte). Une autre lettre, de la plume d’Édouard Alexandre et datant du 20 mars 1893 est adressée à Victor Moureton [numéro d’inventaire R96.1063.2]: Alexandre insiste longuement sur les mérites de projet de Paris, ironise sur la faiblesse du projet de La Côte tout en déclarant l’approuver, et signe la lettre, non sans emphase, ‘Exécuteur testamentaire de Berlioz’… Le projet de La Côte ne pouvait faire face à la ‘grosse artillerie’ de Paris, et pour finir c’est Paris qui récolte le mérite d’avoir érigé la première statue de Berlioz. Elle est inaugurée en grande pompe au Square Vintimille le 17 octobre 1886, et le nom de Massougnes figure parmi ceux présents à la cérémonie (Le Ménestrel, 24 octobre 1886, p. 374).
Le projet côtois n’est cependant pas abandonné, et le comité dauphinois est finalement relancé en 1889, cette fois avec succès; de Paris Massougnes lui donne son appui, comme le montre une série de lettres de sa plume. Elles datent de 1889 et 1890 et sont toutes adressées au vénérable Maire de la ville, M. Marcel Paret, intimement lié au projet depuis plusieurs années. Le lecteur pourra lire le détail des lettres transcrites ci-dessous. Pour finir Massougnes, empêché sans doute au dernier moment par un deuil, ne pourra se rendre à la cérémonie du 28 septembre 1890 à La Côte, et son nom est par conséquent absent du rapport de Julien Tiersot sur l’inauguration.
Deux autres lettres publiées ici sont de Jean de Massougnes, son fils. La première date de septembre 1919, quelques mois après la mort de son père et à un moment ou la vieille maison de Berlioz à Montmartre était menacée de démolition. La lettre existe dans deux exemplaires dactylographiés sans signature. Il s’agit sans doute d’une circulaire adressée à divers correspondants, où il est question d’un projet de sauver la maison en la faisant acquérir par l’État pour en faire un Musée Berlioz (le projet avait déjà été évoqué par d’autres plusieurs années auparavant). L’auteur souligne que sauf pour un embryon de musée à La Côte il n’existe encore pas de Musée Berlioz en France, alors qu’en Allemagne un Musée Berlioz a déjà été créé en 1900 à Francfort par l’initiative d’un particulier (voir là-dessus Le Ménestrel 3 février 1901, p. 38). Jean de Massougnes fait la proposition au nom de son père, récemment décédé (le 23 janvier 1919). Le projet n’eut pas de suite et la maison fut démolie en 1925. La deuxième lettre (autographe) date du 9 mai 1914 et fut écrite dans les circonstances difficiles de l’occupation allemande au début de la second guerre mondiale (images de cette lettre ci-dessous). Sur l’objet de cette lettre voir ci-dessus.
![]()
Le Ménestrel, 10 et 17 octobre 1886, p. 357-60 et 365-8
La Revanche de Berlioz
I
Un dimanche du mois de mars 1878, j’étais avec mon ami Henri G. au concert du Châtelet, où, pour la troisième fois, nous étions venus entendre le Requiem de Berlioz. Quinze jours auparavant, la première exécution avait été pour nous une révélation foudroyante, de celles qui ouvrent dans le ciel de l’art des échappées si lointaines, si lumineuses, que toutes les vieilles admirations s’effacent et que l’esprit, comme aveuglé par tant d’éclat, ne distingue plus rien en dehors du rayonnement qui l’éblouit. Ceux qui ont le don de l’enthousiasme connaissent cette sensation puissante, pour l’avoir éprouvée en présence de quelques œuvres rares, exceptionnelles, qui les ont subjugués d’une façon despotique jusqu’à ce que le temps ait ramené en eux le sang-froid et l’équilibre. A cette époque, nous étions bien loin, G. et moi, d’avoir retrouvé notre sang-froid musical, gravement compromis par le chef-d’œuvre de Berlioz. Admirateurs passionnés du maître depuis de longues années, alors que le public français l’accablait de ridicules dédains, nous ne connaissions cependant pas son Requiem, et la découverte que nous venions d’en faire, en nous montrant une nouvelle face de ce génie si extraordinairement varié, nous avait terrassés sous une des plus violentes émotions de notre vie. Cette grande œuvre s’était emparée de nous jusqu’à absorber toutes nos pensées. Comme, dès la première fois, nous l’avions entendue ensemble, que nous avions frémi et pleuré côte à côte et que pas un désaccord n’existait dans notre commun enthousiasme, depuis ce moment-là nous ne nous quittions plus, nos journées se passaient à dévorer la partition et à demander soit au piano, soit à nos malheureuses voix, de nous rendre quelque chose de ces formidables mêlées instrumentales ; rien n’existait pour nous en dehors du Requiem, tout autre sujet de conversation nous était impossible : nous avions retrouvé ce fanatisme d’admiration qu’on perd d’habitude avec la vingtième année.
Il était peut-être utile à ce qui va suivre de faire connaître cet état aigu de nos esprits au moment où, comme je viens de le dire, nous assistions à la troisième exécution de l’œuvre. C’était pendant un repos de l’orchestre ; la scène du Jugement dernier venait de s’achever avec le Lacrymosa et son prodigieux déchaînement de toutes les menaces célestes. Anéantis par l’émotion, nous n’échangions pas une parole ; G., accoudé sur le rebord de la loge, la tête dans ses deux mains, regardait machinalement vers l’estrade des musiciens, sans rien voir. Tout à coup, cependant, il tressaillit, et je compris qu’un fait imprévu venait de l’arracher à son extase intérieure, car je le vis fixer longuement un point de l’orchestre ; puis, sans se retourner, il me frappa sur le bras : « Vois là-bas ! » dit-il vivement. — « Où ? — Le second flûtiste, à la droite du chef d’orchestre. — Eh ! bien ?... — Regarde-le. — Je le vois. Eh ! bien ?... — Regarde-le ! — Ah !... mais c’est Scudo !... Quelle ressemblance !... »
A ce moment, G. se retourna et me regarda bien en face : « Tu trouves là une ressemblance ? » dit-il. — « Certes, répondis-je, et la plus extraordinaire que j’aie jamais vue. Cet homme ressemble à Scudo d’une manière effrayante. N’est-ce donc pas là ce que tu voulais dire ? — Si, et la ressemblance est effrayante, en effet. » Sur ces mots, dits d’un ton singulier, G. retourna la tête vers l’orchestre et se remit à examiner le flûtiste.
II
Ici, une digression est absolument nécessaire pour l’intelligence des faits que j’ai à raconter. « Scudo ! qui est Scudo ?... Où prenez-vous Scudo ? » On se rappelle vaguement ce nom-là, mais qui était-ce donc ?... L’un croit l’avoir connu basse chantante aux Italiens, l’autre affirme qu’il était maître d’armes rue Poissonnière... et ce n’est pas du tout cela. Il n’y a que les musiciens (pourvu, toutefois, qu’ils dépassent la trentaine) qui ne s’y trompent point et soient capables de vous dire sans hésiter que Scudo était un critique musical.
Comme ce récit s’adresse à tout le monde et non aux seuls musiciens, il est donc indispensable de profiler ici cette physionomie disparue. Cet homme dont on ne sait plus le nom, il n’y a guère plus de quinze ans qu’il était presque un personnage : il occupait à la Revue des Deux Mondes la chaire de critique musicale, ce qui est fort considérable. Pendant de longues années il régenta, du haut de ce poste en évidence, les hommes et les choses de la musique ; mais il était, à la vérité, très petit compagnon parmi les écrivains illustres qui collaboraient alors à ce recueil, et la trace qu’il a laissée est légère, auprès de celles de ses confrères. En deux mots, Scudo fut une erreur de M. Buloz, qui, d’ordinaire, se connaissait en hommes, mais dont le remarquable instinct s’est trouvé en défaut dans la question musicale.
Né à Venise, élevé quelque temps en Allemagne, puis à Paris, où il fréquenta assidûment l’école de chant de Choron, Scudo avait conservé en musique, malgré ses prétentions contraires, le tempérament exclusivement italien. Ses études, tournées surtout vers l’art du chant, n’avaient pu que rétrécir encore ses points de vue, et le disposaient mal à comprendre la savante complexité, l’expression serrée, la vie intense de ces grandes écoles allemande et française à qui la prédominance était assurée par la supériorité de l’intelligence sur la sensation pure. Toutefois, n’étant pas de taille à résister à un mouvement artistique dont Beethoven était l’axe, il avait pris le parti d’accepter les gloires reconnues et de se présenter comme un éclectique. C’est ainsi qu’il sacrifiait systématiquement Verdi, alors contesté, pour exalter avec plus d’autorité Rossini, Bellini, Cimarosa, et toute la vénérable série de musiciens qui va de Palestrina à Paisiello ; mais son coup de maître, en ce sens, avait été de choisir un Allemand pour son maître favori : sentant bien, malgré lui, l’impossibilité de remonter le cours de l’opinion au point de dresser contre ses rivales l’école purement italienne, il avait cru trouver dans l’œuvre de Mozart un juste milieu, un moyen terme qui résumait les tendances des trois écoles, et, le jour où il eut fait cette découverte, Mozart devint son fétiche. Je reconnais qu’on pouvait plus mal choisir ; mais la déification de Mozart par cet esprit étroit et fermé, loin de rien ajouter à la gloire de l’auteur de Don Juan, risquait plutôt de la compromettre par des gaucheries d’ami maladroit. C’est ce que je montrerais par quelques exemples curieux, si cela n’était absolument en dehors de mon sujet.
Frotté d’une littérature douteuse, empruntée sans discernement autour de lui, bardé de solennité, estompant son maigre style d’un nuage de philosophie anodine et prudhommesque, Scudo était à peu près parvenu à s’assimiler ce qu’on a appelé « l’esprit de la Revue » : il s’agit de cette imposante livrée du style sous laquelle les médiocrités font figure, et que, dans cette maison bien tenue, on a su faire endosser même aux écrivains de talent, pour assurer l’harmonie de l’ensemble. Mais la livrée de Scudo n’était pas des mieux façonnées, et dissimulait mal ses imperfections naturelles. La pauvreté de ses appréciations, de ses théories artistiques, était désolante : chanteur de romances et amoureux de vocalises, cet Italien en exil chez les Allemands était, au fond, incapable de discerner, parmi les effets musicaux, autre chose que le contour mélodique ; tout en protestant de sa haute admiration pour Beethoven, il restait entièrement sourd à cette merveilleuse langue orchestrale si riche, si souple, si variée, avec laquelle l’auteur de la Symphonie en La a égalé tous les poètes. Aussi échappait-il parfois à la contrainte de son rôle et, s’il rencontrait en son chemin quelque moderne sans gloire acquise, fulminait-il à ses dépens sur « les abus de l’instrumentation, les effets grossiers de sonorité, l’accouplement monstrueux de timbres qui hurlent de se trouver ensemble, etc.... » Et il se couvrait de cendres : « On entasse dissonance sur dissonance, on cache la pauvreté des idées sous le nombre des instruments et on se donne les airs d’un homme de génie en faisant exécuter par trois ou quatre cents musiciens des œuvres misérables... Et le chant, c’est-à-dire l’expression la plus exquise des sentiments de l’âme, qu’est-il devenu, au milieu de ce fracas de sons dont l’acidité corrosive a vicié nos organes ? On ne chante plus, on crie, on lutte, à force de poumons, avec les clameurs d’un orchestre assourdissant ; ON NE SAIT PLUS VOCALISER ! ! ! »
Arrêtons-nous sur ce cri de détresse. On reconnaît ces antiques rengaines, rééditées, depuis plus d’un siècle, à chaque progrès des formes musicales : c’est la lutte de la chanson contre la musique, c’est la guerre faite à Rameau par les maîtres à chanter de l’époque, à Gluck par les Piccinnistes qui le logeaient « rue du Grand-Hurleur », à Beethoven, à Spontini, par les savants critiques de leur temps, et à Mozart lui-même, aujourd’hui considéré comme si limpide, que Grétry accusait de « placer la statue dans l’orchestre et le piédestal sur la scène. » Ahuri par ces formes nouvelles, par les richesses d’expression contenues dans l’instrumentation et l’harmonie, le pauvre Scudo, qui avait fait le grand effort d’adopter le système de Mozart, entendait bien s’en tenir là ; aussi fourbissait-il toutes ces vieilles armes avec une implacable rancune, et, s’il n’osait les employer contre Beethoven, s’il en piquait timidement Meyerbeer protégé par le succès, sa vaillance était héroïque pour en pourfendre Berlioz, Wagner, Schumann, tous ceux que le public lui abandonnait sans défense.
Tel était ce médiocre pontife qui fixait la religion musicale des échappés de philosophie, des universitaires en quête de convictions artistiques, enfin de ce public spécial qui fréquente les cours de la Sorbonne et du Collège de France et qui lit dévotement, chaque quinzaine, les deux cent quarante pages de la Revue des Deux Mondes, depuis le sommaire de la première feuille jaune jusqu’aux notes bibliographiques de la dernière. Dans le petit cercle d’amis très préoccupés d’art dont G. et moi faisions partie, Scudo jouissait d’une considération moins grande, et nous ne le lisions que pour nous amuser de ses fréquentes bévues. Voici, entre mille autres, un trait de sa haute critique qu’il est utile de rapporter ici, et qui était resté parmi nous un intarissable sujet de plaisanteries :
Il posait en principe, dans un de ses articles, cette hérésie absurde qui avait cours encore, de son temps, parmi les amateurs de province, à savoir que la valeur intrinsèque d’une œuvre musicale se juge d’après sa réduction au piano. Une partition qui ne résiste pas à cette épreuve ne pouvait, d’après lui, « survivre aux caprices de la mode et à toutes les révolutions de l’art. » Mais il ne s’en tenait pas là. Après avoir, suivant la règle invariable, cité à l’appui de sa thèse Mozart et son Don Juan, il ajoutait : « Nous étions chez un éditeur de musique lorsqu’un amateur vint demander la Symphonie Pastorale arrangée pour la flûte. L’éditeur se mit à rire et ne comprit pas que l’amateur faisait, sans s’en douter, le plus grand éloge du génie de Beethoven. » LA SYMPHONIE PASTORALE ARRANGÉE POUR LA FLÛTE !... et cette gigantesque ânerie solennellement présentée comme la pierre de touche du génie de Beethoven !... O prince de la critique ! !...
Je me contente de cet exemple. Il suffit à montrer ce que valait le pauvre homme, et s’il méritait d’être pris au sérieux. Mais, tout en nous égayant journellement à son sujet, nous avions un peu trop de naïveté juvénile pour que notre dédain ne tournât pas souvent en colère. Nous ne pardonnions pas à Scudo son admiration menteuse et convenue pour Beethoven, ni ses façons protectrices envers Gluck, notre dieu, qu’il classait poliment parmi les ancêtres et dont il faisait le précurseur de Mozart et de Rossini ! Nous ne lui pardonnions pas davantage d’être plus franc envers les vivants que nous aimions et de faire à Wagner, à Berlioz surtout, une guerre acharnée, haineuse. On aura de la peine à croire aujourd’hui, on ne croira pas dans vingt ans que les lignes suivantes aient pu être écrites sur Berlioz dans cette même Revue où Gustave Planche jugeait les peintres et Sainte-Beuve les écrivains : « Non seulement M. Berlioz n’a pas d’idées mélodiques, mais, lorsqu’une idée lui arrive, il ne sait pas la traiter, car il ne sait pas écrire. — Le Chinois qui charme ses loisirs par le bruit du tam-tam, le sauvage que le frottement de deux pierres met en fureur font de la musique dans le genre de celle que compose M. Berlioz, etc., etc. »
J’ai choisi presque au hasard parmi d’innombrables invectives, car, pendant toute la carrière de Scudo, Berlioz fut le point de mire constant de ses attaques furibondes : ce n’était plus de la critique, c’était une véritable rage, ou mieux, comme l’a dit Berlioz lui-même, une monomanie (et l’événement justifia bien cette expression, car Scudo finit par mourir dans une maison de fous). Pour nous, qui avions alors de 20 à 25 ans et qui admirions Berlioz comme on admire à cet âge les génies contestés, c’est-à-dire avec frénésie, on comprendra si nous rendions au critique les sentiments qu’il avait pour notre maître préféré. Scudo était notre bête noire, et, lorsque nous le rencontrions dans la rue, dans les couloirs de quelque théâtre, nous lui lancions des regards chargés de haine.
Pour reconstituer en entier le personnage, il est utile d’ajouter que Scudo avait composé un certain nombre de romances, parmi lesquelles le Fil de la Vierge et l’Hirondelle et le Prisonnier, qui eurent en leur temps une certaine vogue. Je connais trop peu ces productions pour me permettre de les juger, mais l’auteur, heureusement, nous en a donné lui-même une appréciation qui ne peut manquer d’être exacte. C’est d’ailleurs un modèle de style, en même temps que de modestie. La voici : « ... Qu’on nous permette seulement de constater un fait : c’est que plusieurs de ces compositions ont une réputation européenne, et que toutes ont été remarquées par une certaine élévation de style et comme l’expression d’un idéal où le sentiment religieux se combine avec celui de l’amour et avec cette mélancolie sans objet qu’on peut appeler le pressentiment de l’infini (1). »
Maintenant, il est encore indispensable de bien établir qu’au moment où commence ce récit, Scudo était mort depuis plusieurs années, officiellement mort, et son décès constaté par les registres de l’état civil. J’ai lieu de m’entourer des plus grandes précautions pour que ce point soit admis sans conteste ; il ne doit subsister aucun doute sur le fait, sans quoi cette histoire n’aurait plus rien d’extraordinaire : or, elle n’a que le mérite d’être extraordinaire, après celui d’être authentique.
(1) Absolument
textuel. Voir : Critique et littérature musicales, 1re série, 3e
édition ; page 354. Paris, Hachette et Cie, éditeurs.![]()
III
Pendant le reste du concert, G. fut distrait, préoccupé, et il ne fallut rien moins que la poésie céleste, l’adoration extatique, l’angélique douceur du Sanctus pour ramener sa pensée vers l’art. Mais, au milieu du dernier morceau, mon regard étant tombé sur lui, je le retrouvai les yeux fixés sur le vieux flûtiste, et il était manifeste que cette contemplation lui faisait oublier la grande œuvre passionnément aimée, avec laquelle, depuis quinze jours, son esprit avait vécu sans partage. Il se passait donc quelque chose de tout à fait anormal et j’avais hâte d’en avoir l’explication.
« Qu’as-tu ? », lui dis-je, pendant que nous descendions l’escalier du théâtre ; « tu parais préoccupé. » Il répondit sur un ton dégagé dont l’affectation était visible : « Préoccupé !... oui, j’en conviens ; ce musicien qui ressemble à Scudo, comme tu dis, lui ressemble, en effet, d’une telle façon que je ne puis croire à un simple jeu du hasard. Est-ce un frère ?... un parent ?... Cela seul ôterait à la chose son caractère extraordinaire ; mais je serais curieux de le savoir. Si tu voulais, nous irions attendre à la sortie des artistes un premier violon que je connais et lui demander le nom de ce bonhomme. — Volontiers, répondis-je en souriant, si tu y tiens autant que cela. — Eh ! mon Dieu ! peut-être, dans un moment, t’intéresseras-tu toi-même à cette niaiserie », reprit G. redevenu mystérieux. Je pris le parti d’attendre l’éclaircissement, et je me tus.
Un instant après, G. arrêtait au passage l’artiste que nous attendions. « Mon cher, dit-il, faites-moi gagner un pari ; mon ami, que voici, ne veut pas que notre vieux flûtiste à moustaches blanches ait rien de commun avec feu Scudo, et moi je soutiens qu’il est au moins son frère. — Ah ! vous avez remarqué la ressemblance, dit le musicien en riant. Le fait est qu’elle est prodigieuse... Mais vous avez perdu, car le bonhomme répudie toute parenté avec le critique... et si vous saviez avec quelle énergie !... D’ailleurs il est allemand ; c’est le vieux Schild. »
— « Schild !!! »
Je ne saurais rendre l’accent avec lequel G. répéta brusquement ce nom dès qu’il eut frappé son oreille ; ce fut comme un cri involontaire qui tenait de la stupeur et de l’effroi. Le musicien le regarda avec étonnement et ouvrait la bouche pour questionner, quand, surmontant le trouble qui venait de l’envahir, mon ami alla au devant de la demande et s’en tira par une explication banale.
Je n’avais pas été dupe de cette manœuvre ; aussi, dès que nous fûmes seuls, je voulus avoir enfin le mot de ces façons mystérieuses, de ces allures bizarres auxquelles G. ne m’avait pas habitué jusque-là. Il marchait sans rien dire, d’un pas précipité, fiévreux, que j’avais peine à suivre. Je me hasardai à l’interroger, mais, dès les premiers mots, il m’interrompit, et, s’arrêtant tout court : « Connais-tu l’allemand ? » me dit-il. — « Non. — Et l’italien ? — L’italien d’opéra... oui, à peu près. — Sais-tu quel est, en italien, le sens du mot scudo ? — Il me semble que cela veut dire écu, bouclier. — C’est cela. Eh bien ! schild, en allemand, a exactement la même signification ! » G. prononça ces derniers mots avec une gravité emphatique et un certain accent de triomphe, que je discernais très bien sans pouvoir me l’expliquer. Il me regardait fixement, semblant s’attendre de ma part à quelque commotion violente. « La coïncidence est bien curieuse », dis-je simplement.
La physionomie de G. exprima un violent dépit. — « Ah ! les coïncidences ! s’écria-t-il au bout d’un moment, d’un ton plein d’amertume et de pitié ; ah ! les coïncidences ! Voilà bien leur grand mot, mot absurde, odieux, qui couvre tous les escamotages philosophiques ! C’est aussi, n’est-ce pas ? une série de coïncidences qui a créé le monde et toute l’échelle des êtres ?.. » Comme je protestais : « Non ; je sais, reprit-il, que tu ne donnes pas dans ces imbécillités-là ; mais alors pourquoi n’être pas également sérieux et réfléchi devant tous les phénomènes qui se présentent à toi, et abdiquer ainsi ta raison dans certains cas, quand tu te refuses à l’abdiquer dans d’autres ?.. Écoute-moi bien, ajouta-t-il après une pose, me regardant en face et saisissant mon bras : il n’y a là ni ressemblance ni coïncidence, mais Schild et Scudo sont la même personne ! — Il n’y a qu’une difficulté, c’est que Scudo est mort depuis dix ans. Tu ne le savais donc pas ? — Je le sais parfaitement, et c’est bien parce qu’il est mort qu’il peut se trouver aujourd’hui dans la peau du vieux Schild. »
Stupéfait de la réponse, je jetai les yeux sur mon ami avec une inquiétude mal dissimulée et l’examinai longuement sans trouver un seul mot à dire. Son excitation semblait apaisée : il était presque calme, et me regardait même avec un sourire. — « Eh ! bien, dit-il, rompant le premier le silence, tu cherches des indices de folie ? Je vois cela. Ne t’en défends pas; tu penses bien que je m’y attendais. Non, mon ami, je ne suis pas fou : le fou est celui qui prend pour des réalités les imaginations de son cerveau, mais non celui qui voit des réalités inaperçues de la plupart. Tu sais que je n’ai guère l’esprit nuageux, ni même tourné vers la fantaisie ; j’aime par-dessus tout la précision et la clarté, et n’ai, en dehors de l’art, aucun goût pour les rêveries : mais c’est précisément pour cela que j’attache aux faits une grande importance, et ne me crois pas le droit de les négliger quand ils m’embarrassent. Or, j’ai été à même d’observer plusieurs fois des faits qui ne s’expliquent que par la réincarnation des esprits et la démontrent même d’une manière indéniable. » Je me souvins que, dans diverses circonstances, G. m’avait parlé, en effet, avec une conviction qui m’avait surpris, de quelques phénomènes de spiritisme ; il y avait, d’ailleurs, peu insisté, me voyant de faibles dispositions à les prendre au sérieux. « Ah ! il s’agit donc de spiritisme ! » fis-je en riant.
— « Voyons ! reprit G. qui recommença à s’animer, tu me connais d’assez longue date pour savoir que je ne suis ni un illuminé ni un imbécile ; de mon côté, j’apprécie comme tu sais les qualités de ton esprit : aussi, laisse-moi te dire que je souffre de te voir prendre les questions sérieuses comme le premier danseur de cotillon venu et les trancher sommairement sans les connaître. On ne combat pas une idée en lui appliquant une étiquette, et le rire n’est pas un argument. Cela n’est pas digne de toi, mon cher ami. »
Je laissai passer sans rien dire cette bourrasque d’indignation et, voyant qu’il s’agissait d’une conviction sincère, désireux, d’ailleurs, de ne froisser en rien un ami que j’aimais infiniment, je m’empressai de reconnaître mon tort et feignîs de m’intéresser aux questions spirites. G., en possession d’un auditeur bénévole, m’expliqua alors comme quoi les esprits des hommes, dégagés par la mort de leur enveloppe corporelle, étaient généralement incarnés dans de nouveaux corps, afin d’expier sur la terre les fautes qu’ils y avaient commises pendant la précédente existence ; que cette expiation n’avait point le caractère étroit d’une pénitence, mais servait toujours à faire progresser l’âme, en la mettant à même de pratiquer les vertus qu’elle avait le plus négligées, d’apprécier les vérités qu’elle avait le plus méconnues ; enfin, appliquant ces principes au fait qui le préoccupait en ce moment, il me dit que l’esprit de feu Scudo avait certainement passé dans le corps de ce musicien allemand, afin que l’influence d’un milieu nouveau lui permît de comprendre ses anciennes erreurs et d’arriver à la vérité musicale.
Sans discuter, je me contentai de répondre que si le système paraissait intelligible et même vraisemblable (j’allai jusque-là), au cas de la réincarnation d’un esprit dans le corps d’un nouveau-né, il devenait plus difficile de comprendre comment une âme venait en déloger une autre et comment un corps d’un âge mûr pouvait tout à coup, sans l’action de la mort, se séparer de l’esprit qu’il avait abrité jusque-là pour donner asile à un nouveau. G. reconnut que l’objection était fondée et que le cas se présentait rarement ; cependant, il en connaissait d’autres exemples, qu’il me raconta. Il entreprit même de m’expliquer l’opération par l’exposé d’une métaphysique spéciale que je me garderai bien de reproduire ici, ayant le désir d’être lu jusqu’au bout. La ressemblance de Scudo avec l’Allemand ne l’embarrassait pas non plus ; bien au contraire : elle n’était point l’effet du hasard, et venait de l’influence naturelle de l’esprit sur l’enveloppe matérielle, qu’il façonne à son image ; le vieux musicien avait dû changer graduellement de physionomie depuis que l’esprit de Scudo s’était substitué à celui qu’il avait reçu en naissant ; le nom de Schild était l’indice d’une prédestination fatale, etc., etc…
Bref, le fait était certain pour G. ; mais il s’agissait de me convaincre. Il fut convenu que nous ferions la connaissance du vieux Schild, de façon à pouvoir surprendre dans sa manière d’être ou dans ses conversations les preuves dont mon incrédulité avait besoin. Comme prétexte à notre première visite, nous demanderions au bonhomme de vouloir bien donner des leçons de flûte à un enfant, neveu de G. Je me prêtai à tout cela pour ne pas désobliger mon ami, qui y attachait une extrême importance, et, quelques jours après, G. s’étant procuré l’adresse du musicien, nous nous mîmes en route, un matin, pour la rue de l’Éperon, où il habitait.
La maison, vieille construction assez solennelle qui avait dû être, au siècle dernier, l’hôtel de quelque conseiller au Parlement, ne gardait de cette splendeur lointaine que la mélancolie des choses déchues ; envahie aujourd’hui par de petits métiers qui s’annonçaient sur des écriteaux accrochés de chaque côté de la porte cochère, affligée du désagrément d’un serrurier au rez-de-chaussée, de la tare d’un bureau de placement au premier étage, cette ancienne demeure de haute bourgeoisie était condamnée sans remède à l’avilissement de la malpropreté.
Au regard étonné que nous jeta la concierge lorsque nous demandâmes M. Schild, il nous fut aisé de comprendre que le vieillard recevait de rares visites. — « Au second, la porte en face ! Frappez si vous voulez, mais il ne vous répondra pas ; si vous tenez à le voir, entrez quand même. » Ce renseignement bourru pouvait avoir son utilité ; nous remerciâmes, et nous nous mîmes à monter un large escalier de pierre aux marches humides. A peine y étions-nous engagés, que des sons extraordinaires vinrent frapper nos oreilles ; à mesure que nous montions ils devenaient plus distincts, et nous discernions le timbre d’une flûte mêlé au brouhaha incohérent d’un piano ; c’étaient des bruits informes, une cacophonie déchirante, et la même idée nous vint à tous les deux : si, comme la direction semblait l’indiquer, ce vacarme venait de chez le vieux Schild, le bonhomme devait avoir des petits-enfants à qui sa faiblesse de grand-père abandonnait ses instruments. Nous arrivâmes au palier du second étage : le bruit partait bien de l’appartement qui nous avait été désigné, mais aucune voix d’enfant ne se faisait entendre ; nous écoutions, stupéfaits. — « Scudo est mort fou, dis-je à mon compagnon ; si c’est lui qui est ici, il a donc retrouvé la folie dans sa nouvelle existence ? — C’est à quoi je pensais, répondit G. très gravement ; mais c’est tout à fait improbable : il ne doit pas être fou. Il y a sans doute une autre explication ; nous verrons bien !.. » Et il frappa à la porte. Rien n’indiqua qu’on eût entendu de l’intérieur, ce qui, d’ailleurs, n’était pas surprenant, car, plus que jamais, la flûte et le piano faisaient rage ; à deux ou trois reprises, G. recommença à frapper, et de manière à dominer le tapage instrumental, mais sans aucun résultat : l’affreux charivari continuait imperturbablement. —« Allons, dit-il, la concierge connaît bien son locataire : il n’y a qu’à suivre son conseil ; » et il ouvrit.
Devant un piano droit placé contre le mur qui faisait face a la porte, le vieillard se tenait debout, tantôt soufflant dans sa flûte, tantôt frappant le clavier à coups redoublés ; il nous tournait le dos et ne s’aperçut en rien de notre entrée, ce qui nous permit d’examiner à loisir la pièce où nous venions de pénétrer avec tant de sans-gêne. C’était une chambre assez vaste, au plafond élevé, qui n’offrait au premier coup d’œil qu’un aspect misérable et désordonné : le mobilier se composait du piano, d’un petit lit de fer, d’une table en bois blanc et de trois chaises. Des piles de partitions encombraient de tous côtés le parquet, formant des tours branlantes ou déjà écroulées ; on en voyait d’autres sur la table, sur les chaises, et jusque sur le lit encore défait, mêlées à de grands cahiers de musique manuscrite. Les murs, affreusement délabrés, étalaient les lambeaux d’un papier à ramages jaunâtres, noirci et déchiqueté dans la partie inférieure par le passage de quatre ou cinq générations de locataires.
Mais, au milieu de ce désordre et de cette nudité, un détail éclatait aux yeux par la violence du contraste : le panneau formant l’entre-deux des fenêtres et devant lequel se trouvait le piano était entièrement tendu d’une belle draperie rouge van Dyck, bordée d’une frange en fils d’or et de soie ; au centre de ce panneau, trois portraits magnifiquement encadrés et représentant Gluck, Beethoven et Berlioz, étaient environnés d’une masse incroyable d’instruments de musique accrochés au mur et groupés, enchevêtrés les uns dans les autres, avec un goût et une habileté sans pareils. Tous les instruments de l’orchestre étaient là au complet, ceux-ci entourant les trois portraits comme d’une couronne, ceux-là retombant en guirlande, d’autres se dressant comme des armes de combat, et la disposition donnée à chacun d’eux semblait toujours offrir une analogie avec le caractère de son timbre. Les grands cuivres eux-mêmes, trombones, ophicléïdes, tubas, campés fièrement aux flancs du trophée, y figuraient sans disparate, et les monstres de l’orchestre, les contrebasses, les violoncelles, la grosse caisse, les timbales, reposant sur le parquet ou debout en cariatides de chaque côté du piano, formaient la base de cette décoration grandiose. Autant les autres parties de la chambre étaient repoussantes de malpropreté, de désordre et d’abandon, autant ce pan de mur témoignait d’un soin poussé jusqu’à la minutie : pas un grain de poussière ne s’apercevait sur ces grappes d’instruments, qu’une main attentive devait déplacer et épousseter chaque jour, ni sur les trois portraits, au-dessous desquels étaient disposées trois petites consoles chargées de vases de fleurs. Cet arrangement fantastique, allié à des démonstrations de piété naïve, donnait l’impression d’une sorte de sanctuaire étrange, entretenu avec autant d’amour que l’autel de la Vierge dans un couvent de religieuses.
L’étonnement que nous causait la vue de cet intérieur bizarre et saisissant n’était cependant pas capable de détourner notre attention du maître du logis, toujours aussi absorbé par sa singulière besogne musicale, et qui paraissait même s’y échauffer de plus en plus. Les yeux attachés sur une grande partition appuyée contre un pupitre mobile qui surmontait le piano, on voyait qu’il s’efforçait en vain de reproduire avec son instrument les effets complexes d’une œuvre d’orchestre ; son regard courait du haut en bas de la page, laissant à chaque instant une ligne pour une autre, revenant à celle-ci, l’abandonnant aussitôt, escaladant cinq ou six portées pour redescendre brusquement à la plus basse, et comme le pauvre homme cherchait, en même temps, à rendre sur sa flûte les quelques notes qu’il glanait ainsi à chaque ligne, il en tirait des sons haletants et sans suite, tantôt suraigus, déchirants, tantôt risiblement caverneux, et presque toujours antipathiques au timbre normal de l’instrument. Par moments, pour remédier à la trop grande insuffisance de la flûte, il la lâchait d’une main, continuait à souffler sans se soucier de l’effroyable discordance qui en résultait, et, s’inclinant sur le clavier, y frappait furieusement quelques fragments d’accords.
Aucune apparence de mélodie ne se dégageait, évidemment, de ce chaos informe ; et pourtant, la persistance d’un rythme caractéristique y surnageait, de manière à évoquer dans mon esprit le souvenir d’une chose déjà entendue. Je m’avançai doucement d’un pas ou deux, pour tâcher de voir par-dessus l’épaule du vieillard quelle était l’œuvre sur laquelle il s’acharnait ainsi, mais je n’eus pas besoin d’approcher de bien près pour la reconnaître, car sa physionomie m’était des plus familières : c’était la partition d’orchestre du Requiem de Berlioz, ouverte à la première page du Tuba mirum ; et le passage que le vieux musicien s’efforçait de rendre avec sa flûte, c’était cette formidable fanfare du Jugement dernier lancée par quatre orchestres de cuivre, les trompettes des archanges s’appelant, se répondant, s’entremêlant des quatre coins du ciel !
J’éprouvai, je l’avoue, une sensation de saisissement et de vertige, et me tournai instinctivement vers G., que j’appelai du regard, lui indiquant la partition. Il la reconnut aussitôt, mais se contenta de sourire, et, à son tour, me montra du doigt une large feuille manuscrite étalée sur la table, où il venait de l’examiner. Je m’approchai et vis une composition d’un aspect extrêmement compliqué, écrite pour un double chœur, et déployant toutes les ressources d’un immense orchestre ; ma première idée, devant une pareille mise en œuvre, fut que le vieil artiste, hanté par le Requiem de Berlioz, avait, à son tour, essayé de peindre un tableau musical du dernier jugement, et, me penchant sur la table, je cherchai à voir les paroles et la mélodie du chœur... Mais je faillis jeter un cri en y reconnaissant textuellement la romance du Fil de la Vierge, de Scudo :
Pauvre fil, qu’autrefois ma jeune rêverie,
Naïve enfant,
Croyait abandonné par la Vierge Marie
Au gré du vent...
L’air était scrupuleusement conservé, comme les paroles, mais confié à d’énormes masses vocales, et renforcé par une orchestration gigantesque qui produisait avec ce chant douceâtre la plus extraordinaire antithèse. Sur les mots : « Au gré du vent, » toutes les forces instrumentales se déchaînaient, les traits chromatiques des petites flûtes sifflaient au-dessus du roulement de douze paires de timbales, des coups profonds des grosses caisses et du mugissement effaré de trente ou quarante bouches de cuivre : c’était toute une tempête, bien autrement violente que celle de la Pastorale... G. me regardait et semblait jouir de ma stupéfaction ; enfin, s’approchant de moi : « Il est temps d’en finir, me dit-il, je vais rompre le charme en adressant tout simplement la parole à ce pauvre homme ; ce sera lui rendre service. » Il s’y disposait en effet, mais, en ce moment, l’horrible concert était arrivé à son paroxysme, et le vieillard était devenu si effrayant que nous restâmes cloués sur place : cet acharnement désespéré dans l’impuissance contractait douloureusement tous ses muscles, congestionnait son cou rougi et gonflé et lui agitait les membres dans un tremblement de fièvre ; par instants, des gémissements de rage entrecoupaient les sons de plus en plus invraisemblables de la flûte, et les pieds battaient le parquet d’un trépignement furieux... « C’est une souffrance de damné ! » me dit Henri d’une voix émue.
A ce moment, le musicien jeta un effroyable cri de colère et, lançant violemment sa flûte à travers la chambre, se laissa tomber sur l’escabeau du piano. Il s’était retourné dans ce mouvement, et nous voyions son visage empourpré où le sang semblait prêt à jaillir par chaque pore, ses dents serrées comme par une crise nerveuse, ses yeux égarés et roulant dans les orbites agrandies... Mais déjà une réaction s’opérait, cette prodigieuse excitation se tournait en affaissement : l’homme était vaincu, écrasé par sa défaite, et nous vîmes de grosses larmes couler le long de ses joues.
Nous étions devant lui, immobiles, à deux ou trois pas de distance, et il ne nous voyait pas : ses yeux obscurcis par les larmes restaient maintenant attachés sur un point du parquet, avec cette fixité qui semble anéantir la vision. Cependant, l’un de nous fit un mouvement qui attira son attention, et il dirigea de notre côté un regard vague, à peine étonné. Il fallait entrer en matière : G. s’excusa en quelques mots et expliqua le but prétendu de sa visite. Le pauvre vieillard, qui rentrait progressivement en possession de lui-même, parut comprendre tout à coup, et sa physionomie exprima alors une certaine surprise. « Apprendre la flûte à un enfant ! » dit-il avec un accent tudesque des plus prononcés et d’une voix pénible, étouffée, encore brisée par la crise dont il sortait. « Vous vous intéressez à lui ? — Oui, certes, répondit Henri. — Eh bien ! monsieur, abandonnez ce projet ; il est presque coupable. Ne cherchez pas à faire le malheur de cet enfant. » Sur un geste d’étonnement de mon ami : « Vous n’étiez pas là, tout à l’heure ? » demanda-t-il. G. murmura une dénégation ambiguë. — « Tout à l’heure, reprit l’artiste, j’ai souffert tout ce qu’une créature humaine peut souffrir et, depuis dix ans, j’endure chaque jour le même supplice. Savez-vous pourquoi ? Parce qu’on m’a appris à jouer de la flûte ; parce que j’ai excellé sur cet instrument maudit ; parce que j’ai cru posséder un art, et que j’ai usé ma vie, je le vois maintenant, à une plate besogne indigne d’un homme. »
— « Vous n’aimez donc plus la musique ? » interrompit G. en feignant de ne pas comprendre. — « Je n’aime plus la musique ! » s’exclama le vieil Allemand dont le visage eut un triste sourire, en jetant sur les trois portraits un regard de tendresse exaltée. « J’aime la musique, monsieur, avant d’aimer mes semblables et moi-même et je ne crois pas qu’il existe autre chose au monde, ni famille, ni patrie, qui mérite d’être aimé. Mais c’est pour cela que je hais ce qui la rapetisse et la ravale ; c’est pour cela que j’ai tant d’horreur pour ces misérables joujoux qui en font la caricature. Croyez-moi, si l’enfant que vous affectionnez promet d’avoir une âme d’artiste, ne condamnez pas sa vie au désespoir en lui faisant espérer qu’il pourra trouver les joies de la musique dans la pratique de la flûte, de la clarinette ou du violon. Il n’y a qu’un instrument, monsieur, c’est l’orchestre ! » dit le vieillard en élevant la voix d’une façon solennelle et en étendant le bras vers son immense panoplie musicale. « Et ne me dites pas, au nom du ciel ! que le piano le résume », accentua-t-il avec autant de mépris que de colère ; « arrière le piano comme tous les autres, arrière cette grotesque boîte à musique qui prétend, avec son clapotement sec et son timbre uniforme, rendre l’ampleur, la variété, les accents multiples, les nuances infinies, les chaudes sonorités de l’instrument-roi !... Si cet enfant est bien doué, faites-en un musicien véritable : apprenez-lui à lire avec les yeux et le cœur les partitions d’orchestre, et il pourra suppléer aux exécutions ridicules de nos théâtres et de nos concerts, il pourra vivre avec les chefs-d’œuvre qu’on délaisse, il entendra Gluck qu’on ne joue plus, il trouvera le ciel sur la terre, au lieu de l’enfer où nous vivons. Car nous sommes dans l’enfer ici-bas, monsieur, nous sommes dans l’enfer, nous tous qui comprenons ce que doit être la musique et qui sommes condamnés par notre éducation, par notre métier, à n’en connaître ou en faire entendre que la parodie ! »
Tout cela avait été débité avec une animation croissante, et je ne saurais exprimer le ton d’angoisse sur lequel le malheureux avait jeté ces mots : « Nous sommes dans l’enfer, ici-bas ! » G., dont l’émotion était visible, m’avait paru frissonner à ce moment. Il voulut toutefois faire quelques objections, plutôt par contenance que par résistance d’esprit, car, sauf des exagérations de forme et de détail, ces théories se rapprochaient beaucoup des nôtres. Une courte discussion s’ensuivit : impitoyable pour nos théâtres lyriques, qu’il appelait, d’après Berlioz, « les mauvais lieux de la musique », Schild fulmina contre les habitudes routinières des directions théâtrales, contre l’indigence grotesque des répertoires, contre les questions d’argent primant toute préoccupation d’art, contre l’interprétation misérable des quelques rares chefs-d’œuvre qu’on pouvait entendre sur nos scènes subventionnées. Où en était le théâtre depuis ces admirables soirées d’Orphée et d’Alceste où Mme Viardot ajoutait son génie à celui de Gluck pour rendre ce que l’art a de plus noble et de plus grand ?... On n’entendait plus rien, aujourd’hui. Les concerts du dimanche entretenaient seuls quelque étincelle du feu céleste, et il cita les exécutions du Requiem avec une exaltation qui ramena des larmes dans ses yeux. Quant à l’art individuel du virtuose, il l’écrasait de son mépris avec une telle violence de conviction, qu’il eût été imprudent de le contredire sur ce point. Il reconnut qu’il fallait bien former des instrumentistes pour créer l’orchestre, mais il persista à soutenir que l’artiste isolé était voué au malheur s’il croyait à la puissance propre de son instrument et qu’il eût, en même temps, l’intuition du véritable art musical.
« La musique, s’écriait-il, est nécessairement complexe, polyphonique, et n’existe que par les masses. Est-ce que l’oiseau chante sans accompagnement, dans la nature ? Est-ce que vous entendez sa voix indépendamment du bruit du vent, du murmure du feuillage, du bourdonnement des mille insectes invisibles qui fourmillent autour de lui ? Supprimez cette symphonie naturelle qui est l’atmosphère musicale, et le chant qui vous ravissait devient sans charme, parce qu’il s’éloigne du vrai : c’est la plate et désolante ritournelle de l’oiseau en cage. Le rossignol, le plus musicien de tous, semble avoir conscience de cette loi, et, quand vous le séparez de son orchestre, il ne chante plus. Messieurs, il n’y a pas de musique en dehors de la polyphonie ! » Ce dernier mot, qu’il prononçait avec une complaisance où perçait le pédantisme germanique, revenait sans cesse dans son discours et semblait résumer tout son système. Rien d’ailleurs de moins factice que ces théories, rien qui ressemblât moins à une thèse à effet ou à un jeu d’esprit : on sentait dans toutes ses paroles cette sincérité d’exaltation, cette conscience de la vérité possédée qui font les apôtres et qui expliquent les martyrs. Cet homme aurait certainement enduré le martyre pour sa foi musicale…..
Il ne nous restait pas de prétexte suffisant pour prolonger notre visite ; d’ailleurs, le pauvre vieillard semblait épuisé : il retombait peu à peu dans cet affaissement égaré qui avait succédé à sa terrible crise, et dont nos questions l’avaient tiré pour un moment. Nous prîmes congé de lui. Après quelques pas faits dans la rue, G. rompit le premier le silence triste que nous gardions : « Quelle expiation ! s’écria-t-il, quelle souffrance !... Mais je crains qu’il n’ait pas la force de la supporter. » Emu par tout ce que je venais de voir et d’entendre, très frappé, même, par certains rapprochements étranges, je n’étais cependant pas disposé à en déduire aussi vite les conclusions que mon ami semblait attendre. Je l’indiquai par quelques paroles évasives et G. comprit. « Je sais ce qui se passe en toi, dit-il : tu luttes contre le témoignage de tes yeux, de tes oreilles et de ton esprit ; mais déjà tu ne ris plus, et tu réfléchiras. J’ai vu que tu remarquais bien des choses... mais, as-tu relevé ce détail dans la conversation du vieux Schild : c’est depuis dix ans qu’il a commencé à endurer les souffrances morales auxquelles nous l’avons vu en proie ?... A cette époque, il s’est donc fait une révolution dans ses idées et dans sa manière d’être. Enfin !... il faudra revoir ce curieux sujet et l’observer de nouveau ; je trouverai d’autres occasions ou d’autres prétextes, par l’entremise de son camarade de l’orchestre. L’enquête te paraît-elle assez intéressante pour vouloir la continuer avec moi ? » Je répondis affirmativement, et nous nous séparâmes.
V
A quelques jours de là, un matin, G. entra chez moi, très pâle, la figure bouleversée. « Lis ! » me dit-il simplement, en m’indiquant quelques lignes d’un journal qu’il tenait à la main. C’était un fait divers ainsi conçu :
« Un triste drame vient d’émouvoir les habitants du n° ... de la rue de l’Éperon. Un vieux musicien allemand, nommé Schild, attaché comme flûtiste à l’orchestre du concert Colonne, habitait depuis plusieurs années dans cette maison, où sa vie retirée, ses allures bizarres et surtout les sons discordants qu’on lui entendait tirer tout le jour des instruments les plus divers avaient fait concevoir des doutes sur l’état de ses facultés mentales. Hier, la concierge, étonnée du silence inusité qui régnait depuis près de deux jours chez son locataire, alla frapper et, n’obtenant pas de réponse, se décida à ouvrir la porte, qui n’offrit pas de résistance. Un spectacle affreux la fit reculer en poussant un cri : le vieillard était pendu au milieu de la chambre, accroché par une longue corde à l’anneau du plafond destiné au lustre. A l’appel de la concierge, plusieurs voisins accoururent, mais ils virent au premier coup d’œil que tout secours était inutile. Le malheureux, en effet, avait tout combiné pour que la mort fût immédiate : il avait dû monter sur une table et là s’attacher aux pieds deux lourdes piles de partitions, puis, après avoir engagé son cou dans le nœud coulant, repousser la table au moyen d’une longue canne, de manière que le poids des livres rendit la strangulation infaillible. La légère table de bois blanc renversée, la canne tombée tout auprès, le corps étiré par les pesants volumes attachés aux pieds, permettaient de reconstituer aisément la lugubre scène. Détails singuliers : au-dessous d’un trophée colossal d’instruments de toute sorte accrochés au mur, gisaient les débris d’un piano qui semblait avoir été broyé par une main furieuse, ainsi qu’une flûte d’argent tordue et brisée en deux morceaux, et c’était des cordes arrachées à un violoncelle qui avaient servi à accomplir le fatal dessein de l’artiste. Autre détail non moins étrange, peut-être : toutes les partitions que l’infortuné avait ainsi suspendues à ses pieds pour assurer sa mort étaient, sans exception, des œuvres de Berlioz. »
Étourdi par cette lecture, je rendis le journal à mon ami sans pouvoir, tout d’abord, dire une parole. — « C’est affreux !.. » murmurai-je au bout d’un instant. — « Oui, répliqua G., mais vois-tu bien ce qu’il y a de plus terrible, en tout cela ?.. C’est que le malheureux n’a pas su accepter l’épreuve, ni la subir jusqu’au bout... et qu’il devra la recommencer. »
L’identité de Schild et de Scudo était, pour Henri G., définitivement démontrée, et jamais le plus léger doute ne lui a paru possible à ce sujet. Pour moi, je ne juge pas, je ne conclus pas..., j’ai raconté.
GEORGES DE MASSOUGNES.
![]()
Programme des Concerts Colonne, 18 mars 1894 (voir l’image de ce programme ci-dessous)
FÉLIX MOTTL
Pendant que M. Colonne se trouve en Russie pour y faire entendre notre musique, de divers points de l’Europe, les plus illustres d’entre ses confrères viennent à Paris le remplacer dans la direction des Concerts du Châtelet : ce sont MM. Félix Mottl, le chef d’orchestre de Carlsruhe, Hermann Lévi, le chef d’orchestre de Munich, et Grieg, le célèbre compositeur norvégien. La musique seule, par l’universalité de son langage, pouvait rendre possible cet acte de confraternité internationale qui a pour nous un vif intérêt de curiosité artistique, car il nous permettra de voir comment des œuvres qui nous sont déjà connues, allemandes, norvégiennes ou françaises, sont comprises et interprétées par les musiciens étrangers, et de comparer cette interprétation avec celle qui nous est familière.
M. Félix Mottl, que nous devons voir le premier, est né à Vienne, le 24 août 1856. Il fit ses études musicales au Conservatoire de Vienne.
A vingt ans, en 1876, il était répétiteur-adjoint aux études de l’Anneau des Niebelungen, à Bayreuth, et, deux ans après, on le voit chargé, à Weimar, des répétitions de cette même tétralogie, sous la direction de Listz. [sic]
En 1879, il prit la direction de l’orchestre à l’Opéra-Comique de Vienne, et, en 1880, il fut appelé au poste (qu’il occupe encore aujourd’hui) de chef d’orchestre à l’Opéra de Carlsruhe.
C’est en 1886 qu’il dirigea pour la premièr fois l’orchestre à Bayreuth, et depuis cette époque, il y a conduit Tristan et Yseult, Tannhauser, les Maîtres Chanteurs et Parsifal. C’est lui qui est chargé, cette année, de la direction de Lohengrin, qui, comme on le sait, n’a pas encore été représenté sur le théâtre de Bayreuth.
Ces détails nous montrent la place qu’occupe M. Mottl dans le monde musical allemand, mais ce qui me paraît le plus considérable dans la carrière déjà si remplie de ce jeune artiste, c’est son rôle de chef d’orchestre-directeur de l’Opéra de Carlsruhe. Depuis 14 ans qu’elle lui est confiée, il a donné à cette scène une importance artistique qui semble surprenante, quand on songe aux ressources relativement restreintes dont peut disposer le théâtre d’une petite capitale. C’est qu’il a su prendre la question de haut et, s’il a, sans trop de regrets, renoncé à rivaliser, par le luxe des décors et de la figuration, avec les grandes scènes qui sacrifient tant à ces accessoires, il s’est exclusivement préoccupé de donner au répertoire de la sienne une richesse, une variété, une nouveauté, une audace, et à l’interprétation des œuvres un scrupule d’exactitude, un souci de la perfection qui sont choses inconnues en plus d’un lieu réputé.
Il serait impossible d’énumérer ici tous les ouvrages que M. Mottl a fait se succéder sur le théâtre de Carlsruhe ; je ne parlerai même pas de ceux qu’il a coutume d’emprunter au répertoire habituel de nos scènes françaises, mais je veux montrer qu’il semble aimer notre musique nationale plus que nous-mêmes, en indiquant les œuvres de nos compositeurs qu’il a représentées, alors qu’elles étaient ou sont encore inconnues en France. Il a, par exemple, fait entendre le Noé d’Halévy et Bizet, dont beaucoup d’entre nous ignorent même le titre ; dès 1889, il a donné la Gwendoline de Chabrier, que Paris n’a pu connaître qu’en décembre dernier ; enfin, et surtout, et c’est à quoi il a voué tout ce qui est en lui de talent, d’ardeur et de conscience artistique, il a illustré le répertoire de son théâtre par l’œuvre dramatique entière de notre grand Berlioz. Il donna d’abord Benvenuto Cellini, qu’on joue à peu près partout en Allemagne, avec un énorme succès, et qui n’a pas été entendu en France depuis 1838, et puis Béatrice et Bénédict, ce chef-d’œuvre de grâce tendre et de poésie qu’on a cru nous faire connaître, ici, il y a quatre ans, en le jouant cinq ou six fois sans le comprendre. Enfin, il put aborder les Troyens ! Mais, quelle que fût son impatience de mettre au jour cette grande œuvre qui n’avait jamais été représentée nulle part, M. Mottl ne consentit pas à la faire entendre incomplète ; cet immense drame étant composé de deux opéras distincts mais inséparables (la Prise de Troie et les Troyens à Carthage), il ne se décida à le produire que lorsqu’il eut achevé les études des deux opéras, de manière à pouvoir les représenter ensemble, en deux soirées successives, et jamais il ne les a fait entendre autrement ! Le pauvre Berlioz n’aurait jamais osé espérer cela de nos directeurs de théâtres….
On ne connaît, à Paris, la Prise de Troie que par les excellentes exécutions de concert qui en ont été données, en 1879, au Châtelet, et aussi au Cirque d’hiver, mais on ne l’a jamais vue à la scène. Quant aux Troyens à Carthage, mutilés, jadis, au Théâtre-Lyrique, en la présence même de Berlioz, impuissant et écœuré, et défigurés, récemment, à l’Opéra-Comique, d’une façon si désolante, on les connaît bien moins encore, et ceux d’entre nous qui ont pu les entendre à Carlsruhe savent seuls quels sont ces deux chefs-d’œuvre. C’est que M. Félix Mottl a apporté à leur interprétation plus encore que son intelligence et son talent ; il y a donné toute son âme d’artiste. Il ne se contente pas, en effet, d’admirer notre grand maître français ; il l’aime, et, en matière d’art, c’est la seule manière de comprendre.
Il a encore affirmé son culte pour l’auteur des Troyens, au mois de novembre dernier, en organisant cet admirable « Cycle dramatique de Berlioz » qui, pendant une semaine, nous a fait trouver, en Allemagne, la plus belle et la plus touchante des fêtes françaises. Aux quatre opéras qui forment cette œuvre dramatique, M. Mottl avait ajouté, dans une cinquième soirée, une exécution superbe de la Symphonie Fantastique, de fragments d’Harold, etc., car il ne se borne pas à jouer les opéras du maître, mais exécute habituellement ses œuvres symphoniques dans les grands concerts qu’il dirige, et l’on ne pourrait citer un seul ouvrage de Berlioz qu’il n’ait fait entendre.
A côté de cette manifestation éclatante qui amena à Carlsruhe, pour célébrer Berlioz, des auditeurs venus non seulement de l’Allemagne et de la France, mais de l’Angleterre et de la Russie, je ne puis résister au désir d’ajouter ici un détail d’ordre plus intime, mais qui a bien sa portée et dont je ne saurais évoquer le souvenir sans une réelle émotion : chez M. Mottl, dans un angle de son salon, l’œil est attiré par une décoration solennelle qui tranche sur le caractère d’élégance sans apprêt de l’appartement et fait que cette encoignure donne invinciblement l’impression d’une sorte de sanctuaire artistique ; entourées de grandes palmes qui s’inclinent, trois riches consoles fixées au mur supportent : l’une, le buste de Beethoven, l’autre le buste de Wagner, la troisième, placée entre les deux autres, le masque de Berlioz (le moulage pris sur nature après sa mort), reposant sur des couronnes de laurier ! N’ayant pu se procurer un buste de notre maître français (il n’en existe pas de passable, du moins dans le commerce), M. Mottl, pour compléter les images de la trinité musicale qu’il adore, s’est contenté de cette face morte, mais en l’auréolant des emblèmes de l’immortalité.
Nous connaissons, maintenant, M. Mottl dans son talent et jusque dans son cœur, et nous saurons, en le voyant, quel ami de notre art est venu à nous. Le programme de concert qu’il va diriger est, d’ailleurs, assez significatif par lui-même, puisqu’il nous montre le partage égal de son admiration entre les deux personnes modernes de la trinité dont je parlais tout à l’heure, ceux d’entre tous les musiciens à qui il a consacré les plus grands efforts de sa vie artistique.
Mais ce partage ne va-t-il pas grandement étonner bon nombre de nos wagnériens de Paris, que Lohengrin et la Valkyrie consolent si aisément de n’entendre pas Benvenuto et les Troyens ?…. Voici l’un des trois chefs d’orchestre de Bayreuth, pour qui Wagner est un dieu, sans doute, mais qui n’en a pas moins fait, de son théâtre de Carlsruhe, comme le Bayreuth de Berlioz. Voici Hermann Levi, qui dirige à Bayreuth, depuis la création de ce théâtre et qui prit la bâton de chef d’orchestre des mains mêmes de Wagner…. Il a donné, sur son théâtre de Munich, d’admirables représentations des Troyens à Carthage et ne s’en tiendra pas là. C’est bien étrange, en vérité. Mais si nos wagnériens sont étonnés, qu’ils sachent que de l’autre côté du Rhin, les fervents de Wagner, ses disciples immédiats, les dépositaires les plus autorisés de sa doctrine et de sa pensée sont plus étonnés encore ; ils sont littéralement stupéfaits de cette aberration monstrueuse qui fait dédaigner par des Français les œuvres du seul musicien de grand génie qui nous puissions opposer aux leurs. Je voudrais que ces Français dont je parle puissent s’en rendre compte et réfléchir là-dessus quelque peu ; j’aurais voulu surtout qu’ils eussent été à même de constater le sentiment de véritable et touchante tristesse qui se mêlait, chez Félix Mottl, à son profond étonnement, en nous voyant obligés de venir à lui, de Paris, pour entendre les opéras de Berlioz !….
Georges de MASSOUGNES.
![]()
Revue d’art dramatique, janvier 1900, pp. 5-22
Berlioz et Wagner
 Voilà vingt ans que la guerre est ouverte
entre Berlioz et Wagner, et la représentation de La Prise de Troie à l’Opéra,
n’est que le plus récent engagement, le plus important peut-être, de cette
longue campagne. Il ne sera pas le dernier, car rien ne permet encore d’entrevoir
la fin de ce rude conflit aux chances inégales. Jusqu’ici le maître
français a le dessous en toutes rencontres, les combats futurs semblent, pour
lui, perdus d’avance, et la foi de ses fidèles a besoin d’être profonde
pour qu’ils puissent, malgré tout, attendre le revirement du sort des
batailles.
Voilà vingt ans que la guerre est ouverte
entre Berlioz et Wagner, et la représentation de La Prise de Troie à l’Opéra,
n’est que le plus récent engagement, le plus important peut-être, de cette
longue campagne. Il ne sera pas le dernier, car rien ne permet encore d’entrevoir
la fin de ce rude conflit aux chances inégales. Jusqu’ici le maître
français a le dessous en toutes rencontres, les combats futurs semblent, pour
lui, perdus d’avance, et la foi de ses fidèles a besoin d’être profonde
pour qu’ils puissent, malgré tout, attendre le revirement du sort des
batailles.
La lutte dont il s’agit est celle des deux œuvres et des tendances qu’elles représentent. Elle est indépendante des dissentiments qui, à un certain moment de leur existence, se produisirent entre les deux hommes ; ces différends-là, dont je dirai plus tard quelques mots, étant, en tout cas, de bien moindre importance. Du vivant de Berlioz et de Wagner, leurs noms étaient invariablement réunis par leurs amis comme par leurs adversaires ; ils passaient pour combattre le même combat. En fait, tous les deux, et c’était leur principal point de contact, étaient également méconnus, critiqués, bafoués par leurs contemporains. Rien de plus naturel, puisque l’un et l’autre étaient des génies de la plus haute envolée, de ceux que la foule ne comprend jamais et dont les œuvres ne s’adressent qu’au petit groupe infiniment restreint des artistes, lesquels ne parviennent qu’à la longue, sinon à faire partager leur sentiment à la masse, du moins à le lui imposer.
Il est nécessaire, avant d’aller plus loin, de s’entendre sur ce que sont les « artistes » dont je parle. Je désigne ainsi les personnes qui possèdent le sens spécial de tel ou tel art, instinct inné, susceptible de se développer mais nullement de s’acquérir, et sans lequel les intelligences sont irrémédiablement fermées aux manifestations de cet art. L’habitude qu’on a d’appliquer ce mot aux seuls professionnels est d’autant plus vicieuse, qu’un très grand nombre de professionnels ne sont artistes en aucune façon, ce qu’il serait facile de développer et de démontrer, ne fût-ce que par des exemples ; mais cette dissertation prendrait ici trop de place. Je me borne donc, en vue d’être compris, à préciser le sens dans lequel, à tort ou à raison, j’entends un mot qui reviendra souvent sous ma plume, et à bien spécifier que je suis loin de comprendre sous ce vocable tous les musiciens de profession, encore moins tous les savants dialecticiens et tous les professeurs d’esthétique qui, dans la presse et ailleurs, nous enseignent pourquoi et comment nous devons être émus par la musique.
Donc, le très petit groupe d’artistes, qui, de leur vivant, comprenaient Berlioz et Wagner, se trouvant impuissant à vaincre les résistances du public, les deux maîtres furent également poursuivis par les critiques des pédants (qui ne sont jamais artistes), et les moqueries de la foule. Berlioz resta dans cette situation jusqu’à sa mort et peu s’en fallut qu’il en fût de même pour Wagner, qui, vraisemblablement, serait mort aussi méconnu, sans un concours extraordinaire de circonstances, et sans l’appui inattendu, presque miraculeux, que lui apporta le roi de Bavière.
La destinée de Wagner fut, en cela, exceptionnelle. Sans avoir connu la gloire universelle et incontestée qui entoure aujourd’hui son nom, il vit, dans les dernières années de son existence, et surtout dans son pays, le nombre de ses admirateurs s’accroître d’une façon considérable ; par-dessus tout, il eut la joie inespérée de réaliser le rêve invraisemblable de Bayreuth…. Quant à Berlioz, selon une loi plus commune, ce fut seulement quelques années après sa mort que l’admiration de ceux qui savaient le comprendre put avoir un retentissement jusqu’à la foule. La Damnation de Faust, interprétée par Colonne avec tant d’intelligence et de passion, fut une révélation foudroyante, et l’enthousiasme des artistes, unanime, irrésistible, se communiqua presque instantanément au public déconcerté, mais docile. La postérité avait commencé à parler.
Dès lors, la gloire de Berlioz était incontestée et rien, semblait-il, ne pouvait plus faire obstacle à l’universelle acclamation de son génie. Son œuvre entière allait passionner la génération présente, car la Damnation n’est certainement pas son plus bel ouvrage, et il suffirait de faire entendre le Requiem, Roméo et Juliette, la Symphonie fantastique, etc., etc…, puis le merveilleux théâtre, pour soulever autant de fois les mêmes enthousiasmes. Ce n’était pas seulement probable, c’était logiquement nécessaire….. Mais c’est précisément alors que surgit une circonstance extraordinaire, peut-être sans exemple dans l’histoire de l’art, et dont les conséquences pèsent encore, après vingt ans, sur l’un des plus beaux génies de la musique….. A ce moment même, le mouvement qui, depuis quelques années déjà, entraînait vers Wagner les artistes allemands, commença à se propager parmi ceux de notre pays ; on rapportait de Munich, de Bayreuth même, dont les représentations, quelque temps interrompues, n’allaient pas tarder à reprendre un cours triomphal, des impressions vivaces, d’ardentes admirations et, par-dessus tout, l’évangile d’un art nouveau. Cet attrait de la nouveauté, toujours si puissant parmi les artistes, eût pu suffire, à lui seul, pour les subjuguer, mais, à la vérité, les œuvres qui se présentaient sous cette forme inconnue étaient si belles et si grandes qu’on s’explique le saisissement de surprise et jusqu’à l’affolement qu’elles produisirent. L’art wagnérien arrivait comme une tempête formidable et ceux que grisaient son fracas et ses splendeurs pouvaient difficilement avoir des oreilles pour d’autres bruits….. Dans de telles conditions, aucun chef-d’œuvre, en dehors des nouveaux, n’était capable d’attirer l’attention ; c’est ainsi que Roméo et Juliette, que le Requiem lui-même furent écoutés d’une manière distraite et que Berlioz cessa tout à coup d’intéresser les artistes français.
Si grossière et si révoltante que soit, en elle-même, cette erreur, je conviens qu’en de semblables circonstances, elle était peut-être excusable. L’infirmité de notre nature est telle que, dans le domaine de l’art, où l’acuité des sensations joue un si grand rôle, les meilleurs d’entre nous ne sont pas susceptibles d’éprouver concurremment des impressions également vives dans des ordres d’idées différents. Peu à peu, cependant, l’équilibre doit se faire dans les esprits de quelque valeur, et ceux-ci y arrivent, en effet ; mais chez les autres, plus débiles, la commotion reçue paraît avoir laissé une lésion fâcheuse.
Pour achever l’exposé de la situation actuelle de Berlioz dans notre monde musical, il convient encore de mentionner, sans y attacher, d’ailleurs, plus d’importance que de raison, l’attitude prise par certains des disciples et des admirateurs de César Franck, lequel, vraisemblablement, ne l’eût point approuvée. Il ne s’agit plus, chez ceux-là, d’indifférence ou d’oubli, mais bien d’une hostilité déclarée. Ne trouvant, dans Berlioz, rien de conforme aux beaux « modèles d’écriture » que leur fournissent les œuvres du très noble auteur des Béatitudes, ils ont décidé que Berlioz écrivait mal. La plaisante formule qu’ils ont mise en cours : « Berlioz a une mauvaise écriture », et qui a le double avantage d’allier le jargon ultra-moderne à l’allure doctrinale, était précieuse pour donner sans effort, aux gens les plus étrangers à l’art d’écrire la musique, un joli air de compétence raffinée et on l’a vue couramment employée par ceux-là mêmes qui reprochaient jadis à Berlioz de n’être qu’un savant. Elle a encore quelque succès dans les salons à prétentions musicales et dans les cercles artistiques de province. — En fait, cette mauvaise guerre, entreprise seulement après le ralentissement du triomphe de la Damnation de Faust, n’est autre chose qu’un retour offensif de l’esprit scolastique, qui n’est jamais brave et cependant ne désarme jamais. Silencieux et prudent devant le succès, il guette attentivement la moindre défaillance de la faveur publique pour sortir ses armes rouillées, et, à qui sait observer, plus d’un indice déjà permet de voir avec quelle impatience il attend le moment de pouvoir se ruer sur Wagner. Ce n’est ni l’école de Cherubini, ni celle de Franck, c’est l’immortelle école de Beckmesser.
Ceci peut paraître négligeable, mais il reste à Berlioz un bien autre adversaire….. Son conflit avec Wagner a-t-il des causes plus profondes que les circonstances historiques dont nous venons de parler ? Doit-il se perpétuer, et les désastreux résultats qu’il a produits jusqu’ici peuvent-ils être considérés comme définitifs ? C’est impossible, tout simplement, parce que ce serait absurde. Piccini, en guerre avec Gluck, devait être écrasé et disparaître ; mais, dans la lutte entre Corneille et Racine, ni l’un ni l’autre ne pouvait, en fin de compte, rester vaincu. Le génie ne peut rien contre le génie.
Berlioz marche de pair avec Gluck, Beethoven et Wagner, au rang des plus hauts génies de l’expression musicale, et ces quatre grands expressifs apparaissent divisés, par leurs tendances, en deux groupes distincts : d’un côté les mélodistes, Gluck et Berlioz; de l’autre les symphonistes, Beethoven et Wagner. — Il ne s’agit pas, par cette distinction, de dénier aux premiers la science des ressources harmoniques et des effets de l’orchestre, ni aux autres le don de la mélodie, ce qui serait purement ridicule, mais de constater, dans le tempérament de ces grands musiciens, la prédominance de telle ou telle faculté. — Que Wagner fût avant tout symphoniste, bien qu’il n’ait pas écrit de symphonies, je ne perdrai pas de temps à le démontrer. S’il n’a pas fait de symphonies, c’est que son génie expressif, essentiellement, impérieusement dramatique, avait besoin du théâtre pour préciser ses conceptions. Mais ses facultés mélodiques, si belles dans le développement symphonique, ne s’adaptaient point aux formes du drame lyrique telles que les avait employées Mozart et dont Gluck avait su se contenter en les modifiant et les ennoblissant. Rienzi, Le Vaisseau-Fantôme, Tannhäuser et Lohengrin montrent, à de rares exceptions près, que le développement purement mélodique d’une idée n’était pas son fait et qu’il se serait vainement obstiné à vouloir réaliser sa pensée par la ligne de chant unie aux paroles. S’il n’avait produit que ces quatre premières œuvres, il ne serait pas Wagner ; — les poèmes, vraiment admirables, ne sont pas ici en question ; — l’ouverture de Tannhäuser, le prélude et la marche des fiançailles de Lohengrin et plusieurs autres passages seraient apparus comme des signes de la plus haute prédestination, mais l’antithèse entre ces inspirations merveilleuses et la quasi-médiocrité de l’ensemble n’eût laissé dans l’histoire de l’art que l’impression d’une énigme troublante. Le monde n’aurait pas connu le colosse qui lui fut révélé peu de temps après.
Ce désastre pouvait se produire, il semble même qu’il fût inévitable ; mais la façon dont il fut écarté fait voir un des côtés les plus extraordinaires de la puissante organisation de Wagner. En présence de cette situation tragique qui menaçait d’étouffer son génie, il trouva en lui la force d’invention nécessaire pour créer de toutes pièces la forme d’art indispensable à son tempérament spécial : à la fois symphoniste et poète dramatique et ne trouvant pas, dans l’art existant, la possibilité de concilier ces deux tendances qui étaient tout lui-même, il se joua du dilemme en apparence insoluble et imagina la symphonie théâtrale. Ceci est proprement merveilleux et peut encore s’appeler du génie. Dès lors, sa pensée était affranchie et s’épanouissait en autant de chefs-d’œuvre qu’il lui plaisait d’en concevoir.
L’action, dans son système, se déroule sous les yeux du spectateur, les sentiments des personnages sont précisés par la parole en un dialogue d’expression juste, mais c’est l’orchestre seul, c’est la prestigieuse symphonie qui développe musicalement toute la poésie, toute la psychologie du drame. En soi que vaut le système ? Est-il autre chose qu’un hardi et très ingénieux élargissement de celui de la symphonie à programme, le programme étant débité et mis en scène au lieu d’être distribué à l’auditeur sur un morceau de papier ?.. Je ne m’en soucie pas, en écoutant Parsifal, Tristan ou Les Maîtres-Chanteurs, car mon émotion est trop grande pour s’embarrasser de théories ; mais quand j’entends Orphée, Iphigénie en Tauride ou Les Troyens, mon émotion étant la même, je vois clairement que le génie est tout et que le reste est indifférent. En deux mots, l’art de Wagner est le sien, tout simplement, celui dont il avait besoin pour manifester son génie et que, par une audace aussi heureuse pour nous que pour lui, il a su façonner à sa mesure ; je crois encore que, dans ses grandes lignes, il constitue une forme nouvelle pouvant être utilisée par les artistes d’un tempérament analogue à celui de l’auteur de Tristan, mais c’est tout : l’imposer aux autres serait une monstrueuse aberration, une pure conception de pédagogues, infaillible pour étouffer tout don personnel, toute spontanéité géniale et pour empêcher quelque autre Wagner de jamais pouvoir se produire. Les wagnériens purs ne se rendent pas compte qu’ils sont en train de jouer le rôle des pédants de tous les temps.
Berlioz, lui, n’avait nul besoin, pour réaliser à la scène ses aspirations dramatiques, de chercher un nouveau moule théâtral ; sa pensée qui, jusque dans la symphonie, se traduit toujours en phrases mélodiques sous lesquelles, parfois, on s’étonne presque de ne pas entendre des paroles, s’accommodait à merveille du mode d’expression analytique et précise contenu dans le chant de l’opéra ancien, et la langue dont s’étaient servis Gluck, Spontini et Weber devait nécessairement lui paraître excellente, puisqu’elle trouvait directement le chemin de son cœur. C’est seulement dans la symphonie qu’il lui fallut innover, car il entendait, lui aussi, la rendre dramatique ; mais il ne visa point, comme Wagner, à la fusion du genre symphonique et du genre théâtral, les préférant distincts, pour pouvoir profiter de leurs effets spéciaux. Berlioz n’eut donc pas de système exclusif : il usa d’une souveraine liberté dans le choix de ses modes d’expression, selon les sujets donnés et la manière dont il les concevait, innovant quand cela lui était nécessaire (La Symphonie fantastique, Harold, Roméo et Juliette, La Damnation de Faust, etc…) ; élargissant simplement, quand cela lui suffisait, les moyens employés par ses devanciers (le Requiem, le Te Deum, L’Enfance du Christ, etc…) ; s’en tenant de plus près encore, mais sans jamais s’y asservir, aux formes consacrées par le génie de certains maîtres et par la raison artistique (son théâtre, en général). A telle conception d’art il a, délibérément et d’une volonté très réfléchie, appliqué toujours telle forme qui lui semblait le mieux appropriée, faisant voir par là la souplesse, la variété, l’universalité de son génie expressif et démontrant, en même temps, cette vérité essentielle que les formes n’ont aucune valeur en elles-mêmes, mais seulement par les ressources qu’elles apportent à l’expression de l’idée.
Tout cela comporterait de bien plus longs développements et, s’il s’agissait d’établir, entre Berlioz et Wagner, un parallèle rigoureux et complet, le cadre de cet article serait vingt fois insuffisant. Je ne vise ici qu’une partie de la question, l’antagonisme actuellement existant entre les deux œuvres, l’étroitesse du point de vue qui l’a créé et les conséquences qui en devaient fatalement résulter pour Berlioz, en particulier pour son théâtre. Si la formule théâtrale de Wagner est considérée comme la seule légitime et possible, celle de Gluck et de Berlioz est donc sans valeur ; si l’admirable conception qui a permis au maître de Bayreuth de manifester son génie devient la routine exclusive où doivent se traîner tous les musiciens, quels que soient leur idéal et leur tempérament propres, toute autre voie est donc condamnée, dans le passé comme dans l’avenir ; si le public cent fois plus routinier que les artistes, a fini par faire sienne cette formule qu’ils lui ont imposée, il la défendra avec son acharnement coutumier, il la défendrait même longtemps encore après que les artistes l’auraient abandonnée ; et, dans de telles conditions, si l’on présente à ce public, en cette même salle énorme de l’Opéra qu’emplit si généreusement la symphonie wagnérienne, des œuvres comme Alceste ou Les Troyens, elles lui apparaîtront maigres, grelottantes, sans sonorité, sans éclat, et, de la meilleure foi du monde, il ne discernera pas, n’entendra même pas la mélodie vocale (d’ailleurs perdue dans l’immensité du vaisseau), n’ayant plus l’habitude d’en prendre souci. Pense-t-on que ce soit la condamnation de telles œuvres ?.. La conclusion serait quelque peu téméraire et, en tout cas, il serait hasardeux d’en induire la supériorité du genre préféré. Le public prend ses habitudes où il peut, et, il y a quelque quarante ans, c’est l’art de Meyerbeer qui fermait ses oreilles à tout autre. Gluck, Berlioz et aussi Wagner s’en sont alors aperçus.
Il est bien curieux à observer, ce bon public, aux représentations de La Prise de Troie. Il sait vaguement qu’il est en présence d’une grande chose et, d’instinct, il la respecte, mais on ne l’a pas prévenu nettement qu’il fallait admirer et il est embarrassé de sa contenance. En fait, il s’ennuie comme à La Walkyrie, ni plus, ni moins, mais il le laisse voir davantage, n’ayant pas reçu de mot d’ordre pour transformer son ennui en enthousiasme. De plus, exerçant de lui-même la seule faculté de critique dont il soit susceptible, il compare ce qu’il voit et entend là avec ce qu’on lui a appris à admirer depuis une dizaine d’années, et constate sans peine que rien n’est conforme au modèle : il ne reconnaît ni la mythologie, ni l’ethnique, ni la forme des casques, ni celle du langage musical, et comme on lui a enseigné que telles divinités, telle sorte de peuples, tels costumes et telles formes d’art étaient seuls capables d’incarner ou de traduire la pensée moderne, il conclut volontiers, avec quelques-uns de ses directeurs de conscience, que l’œuvre qu’on lui présente est d’un genre « périmé », et qu’il n’a pas besoin de se faire violence pour la comprendre, puisqu’elle n’est pas selon la formule. Il n’en rit pas, cependant, ou très peu, et cela est remarquable. C’est qu’il n’est plus le public d’il y a vingt ou trente ans, qu’il ne s’abandonne plus du tout à son instinct, qu’il reçoit docilement les instructions de ceux qui lui paraissent des « artistes », et que, pour le moment, encore mal assuré dans la nouvelle esthétique qu’on lui a inculquée, il procède avec une certaine prudence, craignant de ne pas s’y reconnaître et de commettre des bévues.
Pendant ce temps, quelques-uns, bien rares, dispersés dans l’invraisemblable immensité de cette salle absurde, notamment vers les hauteurs, là où les hasards de l’acoustique leur permettent d’entendre quelque chose, ouvrent leurs esprits et leurs cœurs et connaissent la joie divine de se sentir en communion avec le génie. Indignés d’abord de voir interpréter dans de pareilles conditions une œuvre qui leur était sacrée, ils avaient juré de ne pas revenir, mais, malgré eux, l’amour les a rappelés ; suppléant à l’insuffisante réalisation par l’œuvre même, vivante en eux depuis si longtemps, et par le souvenir des admirables interprétations du Châtelet et de Carlsruhe, ils oublient les contingences et, pour quelques heures, se laissent vivre dans l’idéal. Pour eux, les efforts dispersés des interprètes se concentrent et l’ensemble apparaît, le drame retrouve sa vie intense, son ordonnance grandiose, sa puissante et incomparable expression. Ils ont cette étrange disposition d’esprit de penser qu’une épopée peut être dramatique et de s’émouvoir aux péripéties d’une œuvre dont la donnée repose sur l’existence d’un peuple, sur les catastrophes qui l’accablent, sur l’effondrement où, après dix ans de guerre, s’écroulent sa puissance et sa gloire. Il leur paraît que les sentiments de la foule guerrière, et ceux de la prophétesse en qui s’incarne la patrie, et l’héroïsme des femmes qui se poignardent ou s’étranglent au milieu de leur ville en feu contiennent autant d’émotion tragique que les habituelles convulsions de deux amants. Et ils s’intéressent à la destinée de cette ville, à la joie enfantine de la foule qui, au début, se croyant délivrée, se répand dans la plaine avec des cris de fête, à l’effroyable prescience de Cassandre, à son désespoir de ne pouvoir arracher son peuple à la confiance qui va le perdre. L’âme de la prophétesse est en eux et ils gardent, comme elle, une constante angoisse au milieu de la pompe et de l’éclat des réjouissances publiques ; ils pleurent, avec le peuple attendri, à la douloureuse apparition de la veuve d’Hector, symbole du deuil immense qui plane sur la patrie ; ils frémissent d’horreur, ils restent, avec les chefs troyens, frappés d’une stupeur impuissante au récit de la mort du grand-prêtre, prodige inouï qui anéantit un instant les courages en manifestant la colère des dieux. Enfin la catastrophe depuis si longtemps pressentie se précipite et leurs cœurs se serrent quand, autour du palais où dort le grand Enée, retentissent les bruits terribles des combats déjà engagés ; ils frissonnent à la vue de l’ombre livide d’Hector, aux lugubres harmonies qui enveloppent sa voix spectrale et dont ils sont bien les seuls à sentir les émouvantes nuances ; ils s’enflamment, avec les héros de Troie, dans l’élan de désespoir qui les pousse vers la mêlée, et, pendant la grande scène finale, pendant ce dialogue sublime entre Cassandre et les vierges troyennes dont rien ne parvient aux autres auditeurs, ils sont loin, très loin de tout ce qui les entoure et se rendent à peine compte de ce qu’ils éprouvent : c’est comme une souffrance qui ressemblerait à de la joie et qui, pour être surhumaine, les accable et les anéantit.
Ceux-là sont des artistes, n’en doutez pas ; seulement, j’ai dit qu’ils n’étaient que « quelques-uns ». Un jour ou l’autre ils seront plus nombreux, c’est fatal et nécessaire, et, dès à présent, leur petite troupe se serait accrue si l’œuvre eût été présentée dans d’autres conditions; mais, pour le moment, il est incontestable que la majorité des artistes se tient à peu près au même niveau que le public et se montre également incapable d’élargir son point de vue. Ce n’est pas le cas des plus distingués d’entre eux et je le montrerais facilement en citant certains noms ; mais, même dans les élites, la véritable intelligence et la liberté d’esprit sont le lot du petit nombre ; les autres sont plus lents à penser, à comprendre, surtout à évoluer, et ce sont précisément ceux-là qui, étant plus médiocres, exercent une influence plus directe sur la foule. — Malgré tout, le revirement aura lieu et plus tôt, peut-être, qu’on ne pense, car c’est parmi les jeunes que le mouvement s’accentue, et la jeunesse entraîne tout avec elle. Ceux qui étaient jeunes il y a quinze ou vingt ans ont subi, alors, une crise qui les a quelque peu déséquilibrés et dont il leur est difficile de se remettre ; ceux qui les remplacent aujourd’hui n’auront pas à traverser les mêmes circonstances que leurs aînés et tout semble indiquer qu’ils ne contracteront point leur maladie.
Le plus curieux, en tout ceci, c’est que cette attitude des artistes à l’égard de Berlioz est loin d’être la même en Allemagne qu’en France. Sans parler de la légende de la « mauvaise écriture », totalement inconnue au pays de Bach et de Beethoven, et qui y fait sourire, sans rappeler l’admiration de Schumann et de tant d’autres, ce sont, chez nos voisins, les plus ardents wagnériens qui sont les plus chauds partisans de Berlioz. Et il n’est pas seulement admiré, je puis dire qu’il est profondément aimé, ce qui vaut mieux. On sait avec quelle ardeur Liszt lutta pour lui, pendant toute sa vie, en même temps que pour Wagner ; Hans de Bülow avait créé un mot pour exprimer sa tendresse et aimait à parler de son « hectorophilie » ; Félix Mottl, qui a mis au répertoire du théâtre de Carlsruhe, avec le talent et le succès que l’on sait, les quatre opéras de Berlioz, n’a pas de plus grande joie que de diriger une œuvre de l’auteur des Troyens, pour qui son culte touche à l’adoration. « Quand j’entends le moindre lambeau d’une mélodie de Berlioz, quand j’y songe, seulement, ça me prend là !…. » me disait-il un jour, crispant ses deux mains sur son cœur avec une énergie et une exaltation singulières. Je n’en finirais pas, si je devais rapporter tous les traits de ce genre que j’ai pu recueillir, au cours de mes entretiens, (toujours pleins de Berlioz), avec ce grand et charmant artiste, si passionné et si vivant. Alfred Ernst en a raconté un, particulièrement touchant, que je ne résiste pas au plaisir de citer, pour ceux qui ne le connaissent pas encore : le jour où Félix Mottl vint à Paris pour la première fois, comme je me mettais à sa disposition, quelques heures après son arrivée, pour le guider à travers la ville : « Avant tout, me dit-il vivement, mais d’un ton grave, ce que je désire voir, c’est le tombeau de Berlioz et celui de Napoléon ! »
Quant à Wagner, dont l’opinion est, ici, particulièrement intéressante, les uns ignorent, les autres feignent d’ignorer à quel point le génie de Berlioz le passionna et quelle influence profonde il exerça sur lui (1). Plus jeune de dix ans que le maître français, il put connaître et apprécier l’œuvre de son devancier mieux que celui-ci ne connut et n’apprécia la sienne. Il faut se rendre compte, pour bien juger le triste malentendu qui, à un moment donné, divisa ces deux grands hommes, que si Berlioz eut les premiers et les plus grands torts, il n’était certainement pas, alors, en situation de comprendre le véritable Wagner. Quand un accès d’irritation personnelle le fit rompre avec son ancien ami, il ne connaissait, en somme, de celui-ci, que ses premières œuvres et n’avait entendu, en dehors de quelques fragments symphoniques, que Tannhäuser et Lohengrin. Il avait lu, il est vrai, la partition de Tristan, mais, même pour un tel musicien, la lecture, en pareil cas, n’était pas suffisante et il eût fallu l’audition pour révéler une forme d’art si nouvelle….. Berlioz peut donc être excusé d’avoir méconnu Wagner, puisqu’il ne connaissait de lui que les œuvres où on le trouve à peine, les autres, à part Tristan, n’existant pas encore.
Wagner, lui, qui connaissait à merveille l’œuvre entière de Berlioz, ne l’a jamais méconnue, — bien loin de là, — et ce n’est qu’à partir de la fâcheuse dispute, qu’on peut citer de lui, soit dans sa correspondance, soit dans ses conversations, quelques phrases amères contre l’auteur de la Damnation de Faust. Son admiration pour Berlioz est bien connue et s’est manifestée en maintes circonstances souvent rapportées, mais je ne crois pas qu’il en existe un plus éclatant et plus saisissant témoignage que celui dont je dois la connaissance à Félix Mottl. Il s’agit d’un document qui fit une sensation extraordinaire lorsqu’il circula dans le monde musical allemand, il y a plusieurs années, et qui, pourtant, est encore absolument inconnu en France : c’est un projet d’article écrit par Wagner en 1840 ou 1841, pendant un de ses séjours à Paris ; je le reproduis ici purement et simplement, car le moindre commentaire ne pourrait qu’en affaiblir la portée et l’émouvante signification :
« Si j’étais Beethoven, je dirais : « Si je n’étais Beethoven et si j’étais Français, je voudrais être Berlioz. » Parlerais-je ainsi dans l’espoir d’être plus heureux ? Je ne le sais au juste, mais je le dirais cependant. — Chez ce Berlioz flamboie la jeunesse d’un grand homme ; ses symphonies sont les batailles et les victoires de Bonaparte en Italie. — Il vient d’être fait consul, — il va devenir empereur, — il va conquérir l’Allemagne et le monde. — Mais l’enverra-t-on à Sainte-Hélène ? Je l’ignore. — Je sais bien, toutefois, que, dans ce cas, on l’en ramènerait triomphalement. Berlioz est un grand général. De même que je ne puis me figurer les victoires de Bonaparte qu’en me représentant clairement devant les yeux l’image du héros et en le mettant à la tête de la monstrueuse mêlée, versant à travers la masse mille pensées fulgurantes qui la dirigent, — de même je ne puis imaginer une symphonie de Berlioz sans le voir lui-même à la tête des exécutants. Ces créations gigantesques, enfants des orages juvéniles d’un génie débordant, continueront de vivre lorsqu’un jour la France reconnaissante aura dressé un marbre fier sur la tombe de leur auteur ; mais seule la tradition pourra leur donner, aux yeux de la postérité, la signification qu’elles avaient, pour les contemporains, sous la direction personnelle du héros génial. Le père doit en transmettre le souvenir au fils et celui-ci au petit-fils, autrement il arrivera peut-être que l’on ne croira plus à ces réalités étonnantes et qu’on les prendra pour des contes des « Mille et Une Nuits (2). »
A qui fera-t-on croire qu’un pareil enthousiasme ait pu se transformer, pour des raisons quelconques, en animosité ou en dédain ?… La vérité est que, sous l’empire de l’irritation très explicable qu’avait provoquée en lui l’attitude de Berlioz, Wagner, depuis 1860, a pu lancer contre son ancien ami, à titre de représailles, quelques boutades et quelques vives critiques, mais qu’au fond de lui-même il conserva toujours son immense admiration pour celui qu’il nommait « le cher et grand auteur de Roméo et Juliette ». J’en ai recueilli les preuves les plus certaines de la bouche de Félix Mottl, qui a vécu près de Wagner après la rupture des deux grands musiciens. Je me contenterai de citer le trait suivant : « Un jour, raconte Mottl (et ceci se passait bien après 1860), Wagner m’avait donné à étudier la partition d’orchestre de Roméo et Juliette, qu’il aimait entre toutes. Quand je la rapportai et qu’il m’interrogea sur ma lecture, j’exprimai avec chaleur toute mon admiration pour cette grande œuvre et, au sujet de la scène du tombeau, voulant montrer combien elle me paraissait musicalement belle, je dis que je ne m’expliquais pas pourquoi Berlioz, dans une note, déclarait qu’on ne pouvait comprendre ce morceau sans connaître le dénouement substitué par Garrick à celui de Shakespeare. Wagner ne me laissa pas aller plus loin. Il entra dans une fureur épouvantable, criant que je n’avais pas le droit de parler ainsi, que lorsqu’un « génie de cette taille » disait une chose, on n’avait qu’à l’accepter, sans demander ni pourquoi ni comment. Et il continua longtemps de la sorte, avec une telle violence d’indignation que je ne savais quelle contenance tenir et dus renoncer à excuser ou expliquer ma remarque. »
On voit à quoi se réduit la légende qui veut que ces deux grands hommes se soient mutuellement méconnus. Cela vaut mieux ainsi et la réalité est moins troublante pour l’esprit. Il est consolant de constater que celui des deux qui connaissait l’œuvre de l’autre l’aimait et l’admirait profondément, tandis que celui qui ne rendait pas justice au génie de son rival avait manqué des éléments d’appréciation nécessaires.
Il n’en est pas moins vrai qu’après leur mort les voilà en guerre, que Wagner, « se vengeant », à son tour, opprime et étouffe Berlioz à faire croire qu’il va l’anéantir. Mais les deux hommes n’y sont pour rien, ni même, à bien considérer, les deux œuvres, qui sont faites pour resplendir côte à côte. C’est l’étroit fanatisme de leurs partisans qui crée ce conflit. Pour être exact, il faut dire que ce fanatisme est, presque exclusivement, le fait des vainquèurs de l’heure actuelle, car les autres ne portent pas la guerre sur le terrain de leurs ennemis. A part de rares exceptions, les plus anciens et les plus ardents berliozistes sont ouverts à l’art de Wagner, tandis que la plupart des wagnériens (en France), sont fermés à celui de Berlioz ; d’où l’on peut tirer, ce me semble, une forte présomption en faveur du sens artistique des premiers.
Quoi qu’il en soit, cette situation est nécessairement passagère. En art, les œuvres du génie sont impérissables et, soit qu’on les méconnaisse à leur apparition, ce qui est l’usage, soit qu’elles subissent, au cours du temps, des éclipses plus ou moins longues, elles demeurent dans leur beauté et leur grandeur oubliées, pour rayonner tout à coup et éblouir des générations lointaines à qui les gens de courte vue ne les croyaient pas destinées. Le « jugement de la postérité », pour être une expression d’apparence banale, n’est pas, bien loin de là, une vaine formule ; c’est une réalité absolue, incontestable, vérifiée mille et mille fois depuis qu’il existe une civilisation et des arts. C’est le critérium infaillible, et le seul, de la souveraine beauté, parce que ce jugement, étranger aux engouements de la mode, aux instincts plus ou moins bas d’une foule capricieuse, est celui des élites accumulées d’âge en âge. Il exprime le sentiment des âmes artistes, qui, à toute époque donnée, sont une minorité infime, mais qui, groupées par le temps, deviennent légion et font la loi aux foules passagères, isolées chacune dans leur court moment d’existence, car elles n’ont aucun héritage d’idées à se transmettre.
Cette vérité est une des plus claires dont l’esprit humain soit assuré et je ne puis m’empêcher de dire combien j’ai été surpris de la voir méconnaître ici même, tout récemment, dans une étude d’autant plus remarquable qu’elle avait le mérite infiniment rare de contenir des idées personnelles. Après avoir exprimé avec une ardeur passionnée son admiration et son amour pour l’art de Wagner et constaté, toutefois, les inévitables imperfections qui s’y rencontrent comme en toute conception humaine, M. Romain Rolland lançait à l’auteur de Tristan cette apostrophe douloureuse : « Tu passeras, toi aussi ; tu iras rejoindre Gluck, Bach, Monteverde, Palestrina, toutes les grandes âmes dont le nom persiste parmi les hommes, mais dont les hommes ne sentent plus les pensées, sauf une poignée d’initiés qui s’efforcent en vain de ressusciter le passé. Toi aussi tu es déjà du passé….. » Non ; les grandes âmes dont le nom persiste parmi les hommes ne passent pas ; leur nom ne persisterait pas si leur pensée était abolie ; non, Gluck n’est pas passé et Wagner ne passera pas ; leurs formes seront remplacées par d’autres, mais ceci n’est rien ; l’essence de leur génie restera la « source puissante de vie » où les générations successives continueront à « puiser leur énergie morale et leur résistance au monde ». Les génies supérieurs sont proprement immortels, ils vivent indéfiniment dans les cœurs de ces élites qui constituent la postérité. Berlioz, enfant, fondait en larmes en traduisant le quatrième livre de l’Enéide. Nous avons vu, de nos jours, l’Œdipe-Roi de Sophocle, malgré le masque de la traduction, malgré la répulsion de nos esprits modernes pour certaines idées d’ordre philosophique comme celle de la fatalité païenne, émouvoir profondément, après plus de deux mille ans, des spectateurs français, par ce qu’ils y retrouvaient de vivante humanité. Dans deux mille ans encore, un autre public sentira de même.
L’avenir est toujours juste pour les œuvres du génie et les plus longues injustices, loin d’infirmer cette vérité, semblent la rendre plus éclatante. L’art ogival, la plus étonnante, peut-être, des créations du génie français, après trois siècles de moqueries et de dédains, devait nécessairement s’imposer de nouveau à l’admiration de l’humanité, et ce revirement a eu lieu. Il a fallu deux cents ans pour que la gloire de Shakespeare fût acceptée par la France ; elle y rayonne, cependant. C’est que, pendant ces longues périodes d’inconscience des majorités, les humbles petits groupes des âmes artistes, jouissant silencieusement de leurs joies, se transmettant leur foi de l’un à l’autre, accomplissaient, malgré les beaux-esprits du temps, malgré les « arbitres du goût », malgré Voltaire, le lent travail de la postérité.
Nous paraissons loin de Berlioz, pour lequel, dira-t-on peut-être, il n’est pas temps encore d’invoquer la postérité. Si vraiment, car des signes certains le marquent comme un de ceux qui sont faits pour elle. Il a, dès à présent, cette gloire hautaine d’être resté pur de tout contact avec les foules et apparaît comme un de ces génies d’élection qui ne peuvent avoir accès qu’auprès des petits groupes successifs des amants de l’idéal. Sa gloire, on en parlait dès le début de sa carrière, au milieu de l’indifférence ou du dédain du public ; à ce moment même, Paganini, après s’être agenouillé devant lui sur la scène du Conservatoire, déclarait qu’il « faisait revivre Beethoven » et nous venons de voir que Wagner le comparait à la fois à Beethoven et à Bonaparte. L’année de sa mort, signalant ces significatives anomalies, je montrais cette gloire confiée à la garde de « la petite église invisible d’élus » dont, selon le mot de Diderot, « les apôtres clandestins opèrent peu à peu la conversion des sots ». Très peu de temps après, les sots commencèrent à se convertir ; ils se sont repris, depuis, et résistent encore. Qu’importe cela et quel besoin ont les « élus » d’une telle compagnie ? A quoi bon cet envahissement brutal de leur « petite église » ? Pour moi, je le redoute plus que je ne le désire et laisse à d’autres l’apostolat. J’ai entendu les premiers pèlerins de Bayreuth parler du charme infini de leur petit cénacle d’alors, disparu sans retour depuis l’intrusion des foules cosmopolites. Mieux que personne, les pèlerins de Carlsruhe peuvent comprendre cette douceur, car ils se trouvaient là dans une intimité encore plus étroite et plus chaude, et le bruyant enthousiasme d’une foule plus ou moins sincère ne vaudra jamais, pour eux, cette exquise communion de leurs quelques âmes dans le recueillement et dans l’amour.
Car il faut aimer, en art, il faut aimer avant de comprendre et l’on ne peut comprendre sans aimer. Quand, grâce à nous, les froids pédants auront enfin compris, qu’ajouteront-ils, par leurs gloses, à notre joie d’aimer ? Ils ne pourront que la troubler et l’amoindrir.
GEORGES DE MASSOUGNES.
1. Les traces
de cette influence, dans l’œuvre de Wagner, sont nombreuses et infiniment intéressantes
à rechercher, mais une telle étude dépasserait les limites de cet article. Je
me borne à rappeler les remarques le plus souvent faites à ce sujet : l’idée
première du leit-motif procédant de la Symphonie fantastique ;
la parenté de conception entre le final du deuxième acte des Maîtres-Chanteurs
et la grande scène du Carnaval, de Benvenuto Cellini ; le rapport
de certains détails d’instrumentation, tels que le dessin persistant des
violons à la fin de l’ouverture de Tannhäuser et celui qui se trouve
dans la scène finale de Roméo et Juliette, ainsi que certaines
réminiscences mélodiques des plus frappantes.![]()
2. L’article s’arrête là. Il ne fut pas continué, ni par conséquent publié, pour des raisons restées inconnues. C’est une pièce autographe, d’une authenticité indiscutable et indiscutée, appartenant à M. Alfred Bovet, qui, jusqu’ici, avait préféré ne pas la voir publier, mais qui vient, à la prière de Mottl, de m’accorder très gracieusement l’autorisation désirée. En voici le texte allemand, d’après la copie (de la main de Félix Mottl) que je possède depuis deux ans :
« Wenn ich Beethoven wäre, so
würde ich sagen : Wäre ich nicht Beethoven und Franzose, so möchte ich
Berlioz sein. Würde ich das sagen, um glücklicher zu sein ? Das weiss ich
nicht klar, aber ich möchte es dennoch sagen — in diesem Berlioz flammt die
Jugend eines grossen Mannes ; seine Symphonien sind die Schlachten und
Siege Buonaparte’s in Italien ; er ist letzthin zum Consul gemacht worden
— er wird noch Kaiser werden ; — Deutschland und die Welt erobern ;
— wird man ihn aber nach St Helena schicken ? Ich weiss es nicht, —
wohl weiss ich aber, dass man ihn in diesem Falle in Triumph wieder holen würde.
Berlioz ist ein grosser Feldherr ; so wie ich mir Buonaparte’s Schlachten
im Geiste nicht anders vorstellen kann, als wenn ich mir die Gestalt des Heroen
klar vor meine Augen versetze, und sie an die Spitze des ungeheuren Gewühles
stelle, wie von ihr aus tausend leitende feurige Gedanken durch das Ganze
hinstromen — so kann ich mir eine Berlioz’sche Symphonie nicht anders denken,
als mit ihm selbst an der Spitze der Execution. Die gigantischen Schöpfungen,
erzeugt in den jugendlichen Stürmen eines in Fülle überstromenden Genius
werden fortleben, wenn einst das dankbare Frankreich einen stolzen Marmor über
ihren Schöpfer hin wälzte ; aber nur durch Tradition kann es gelingen,
sie den Sinnen der Nachwelt in der Bedeutung wieder vorzuführen, in der sie der
Mitwelt unter der personlichen Aufführung des genialen Helden erschienen. Der
Vater muss es dem Sohne, der Sohn dem Enkel überliefern, sonst könnte es
dereinst kommen, dass man an jene wunderbaren Wahrheiten nicht mehr glaubte, und
sie für Märchen aus « Tausend und eine Nacht » halte. »![]()
![]()
Le Monde Musical, 30 novembre 1903 (numéro spécial consacré au centenaire de la naissance de Berlioz) [article reproduit aux pages 107-43 de la réédition de 1919 du livre de Georges de Massougnes, Berlioz. Son Œuvre, publié pour la première fois en 1870]
BERLIOZ
et les Artistes d’aujourd’hui
(1)
On célèbre cette année le centenaire de Berlioz ; c’est fort bien, mais il s’agirait de savoir si cet hommage, aujourd’hui un peu prodigué, a bien le caractère qu’il devrait comporter, si les manifestations qui sont ou seront faites en l’honneur de ce grand homme témoignent, de notre part, une pleine conscience de son génie et de son rang parmi les illustrations de la France.
Il est grandement permis d’en douter, car le nombre paraît restreint de ceux qui, à l’heure actuelle, connaissent ou savent apprécier l’œuvre de ce maître dans toute sa puissance, sa richesse, sa profondeur, sa tendresse, sa variété prodigieuse, son incomparable splendeur. Certes, le temps est loin où l’immense majorité du public français ignorait le nom de Berlioz, où le reste ne l’accueillait que par des quolibets, où Scudo et tant d’autres grands juges — que cette seule sottise sauve de l’oubli — enseignaient à la foule à le dédaigner. On prend aujourd’hui en pitié tant d’incompréhension et d’ineptie ; les citations de ces pauvres critiques font journellement la joie de leurs successeurs ; mais ceux-ci sont-ils certains d’être beaucoup plus clairvoyants que leurs aînés et de bien saisir toute l’énormité de ces jugements du passé?… J’en doute, pour ma part, et quand je vois, par exemple, nos modernes justiciers montrer une égale indignation pour les détracteurs de l’auteur des Troyens et ceux de l’auteur de Carmen, j’estime que la perspicacité de nos contemporains n’est pas encore très considérable et que, décidément, la question n’est pas au point.
Où en est-elle, exactement ? C’est ce qu’il me semble utile de préciser ici, car les publications du genre de celle-ci auront sans doute, plus tard, une valeur documentaire et les critiques de l’avenir y chercheront l’état de l’opinion sur Berlioz à l’époque de son premier centenaire. Il est donc de notre devoir de les renseigner et c’est ce que je prétends faire. A vrai dire, le sujet est complexe et comporte l’examen de beaucoup de causes et d’effets, mais j’abrégerai le plus possible et me bornerai aux constatations les plus indispensables.
L’opinion dont je m’occupe est celle des artistes, car les conceptions d’une certaine portée ne s’adressent directement qu’à ceux-là, et d’ailleurs le public, aujourd’hui, se laisse volontiers guider par eux (2). Or, cette opinion des artistes n’est pas, quant à présent, unanime au sujet de Berlioz. Quelques-uns l’adorent et le placent au premier rang parmi les plus grands et les plus rares génies qu’ait produits l’humanité ; d’autres, en très grand nombre, l’admirent avec une certaine réserve, mais, en somme, le connaissent peu, ne cherchent pas à le mieux connaître et s’intéressent à peine à lui ; d’autres le discutent théoriquement avec une certaine âpreté et, sans pouvoir nier son génie, lui reprochant l’insuffisance de sa technique, vont presque jusqu’à le dédaigner.
Ceux qui composent la première de ces catégories sont, il faut le dire, les moins nombreux, mais ils ont pour eux l’ardeur enthousiaste, la foi sans limites — faite d’amour et de certitude — des églises naissantes. Pour eux, Berlioz n’est pas seulement, et sans comparaison possible, le plus grand musicien de la France (ils ne s’attardent pas à ce truisme), c’est l’égal des quelques géants de la musique, qui dominent de leur haute stature la pléiade des génies de second plan ; c’est un des cinq ou six souverains du royaume musical. Les classifications artistiques sont, je le sais, chose hasardeuse et, le plus souvent, stériles et pédantesques, mais pourtant certaines suprématies s’imposent et, si l’on envisage, par exemple, le domaine de l’expression, il est évident que le génie de Berlioz y règne avec le même éclat que celui de Gluck, de Beethoven et de Wagner et que ces quatre grands expressifs n’ont pas eu d’égaux, jusqu’ici. (On se rend compte, sans doute, que Mozart ne peut être compris parmi les maîtres de l’expression pure, car il se partage entre les deux grandes tendances qui semblent faire de la musique deux arts différents : l’art expressif et l’art ornemental, l’art de Gluck et l’art de Bach.)
Les artistes qui pensent ainsi de Berlioz sont, sans aucun doute, ceux qui connaissent le mieux son œuvre et, par suite, les mieux autorisés à la juger. Seuls, ils savent que le maître a fait d’autres chefs-d’œuvre que la Damnation de Faust, et quelques-uns plus grands. Ils considèrent que les Troyens, le Requiem, Roméo et Juliette suffiraient à la gloire musicale de la France, et constatent que Berlioz ne nous en a pas moins donné bien d’autres merveilles, éclatantes de génie, débordantes de passion, de vie, de tendresse, de poésie, dont la moindre eût pu l’immortaliser : la Symphonie Fantastique, le Te Deum, l’Enfance du Christ, Benvenuto Cellini, Béatrice et Bénédict, la Symphonie funèbre et triomphale, Harold en Italie…
Cette liste, à vrai dire, est formidable, si l’on songe qu’elle ne comprend que des chefs-d’œuvre. — Gluck ne nous en a pas laissé plus de six ! — Peut-être les trois que j’ai cités en premier lieu sont-ils les plus étonnants et les plus grands, mais il serait hardi de donner trop d’importance à cette distinction et, à coup sûr, la distance entre ceux-là et les autres n’est pas telle qu’on ne puisse hésiter dans ses préférences. Car ce qu’il y a de plus extraordinaire, peut-être, dans l’ensemble de l’œuvre de Berlioz, c’est la constante qualité de l’inspiration, l’extrême rareté des passages faibles ou médiocres (d’où vient, précisément, qu’il n’est guère à la portée du « plus grand nombre », à qui la médiocrité est nécessaire).
J’ai lu très souvent — surtout avant ces dix dernières années — que Berlioz était un « génie inégal » et c’est, assurément, une des plus fortes contre-vérités qui aient été dites sur son compte. Nul, peut-être, n’a été moins inégal, parmi les artistes de génie. Pas plus que les autres il n’est constamment sublime, mais on peut dire que l’inspiration ne l’abandonne presque jamais, et ce qui est plus singulier et plus rare encore, c’est le goût, la mesure, la distinction, la clarté, la logique d’un génie aussi ardent, aussi passionné, aussi fougueux. Ceci est à peu près sans exemple et, parmi les artistes ou les poètes dont le tempérament se rapproche du sien, on n’en rencontrerait pas d’autre, je crois, ayant possédé au même degré toutes ces qualités qui semblent incompatibles avec l’exaltation fiévreuse de l’esprit et la spontanéité de la conception. — Ici, je ne me préoccupe pas de défendre Berlioz contre une attaque injuste, je dis plutôt ma surprise qu’il ne l’ait pas méritée. Fut-il un poète plus grand, en fut-il un plus inégal que Shakespeare ?… Les exemples analogues n’abondent-ils pas et l’inégalité n’est-elle pas souvent en raison directe de la puissance du génie?… Aussi n’ai-je insisté sur ce point que parce que j’y vois une sorte d’anomalie, et pour pouvoir répondre à la critique dont il s’agit : « Berlioz avait tous les droits possibles d’être inégal, et cependant il ne l’est pas. »
Ce que personne ne lui conteste, parce que l’évidence est trop grande, c’est son entière originalité. Là-dessus tout le monde est d’accord, amis ou ennemis, et les analystes qui signalent, dans certaines de ses œuvres, la marque de diverses influences, tantôt celles de Beethoven et de Weber, tantôt celles de Gluck et de Spontini, n’appuient pas, généralement, sur cette remarque, semblant tous reconnaître qu’il y eut là affinité plutôt que dépendance, fraternité plutôt que filiation.
On a contesté davantage une autre de ses qualités les plus essentielles : l’incomparable richesse de son invention mélodique. Elle fut complètement niée, jadis, et, de son vivant, Berlioz était reconnu, par les pontifes de l’époque, comme un musicien « très savant », mais dénué de toute mélodie. Aujourd’hui (admirez l’accord de ces juges infaillibles), les pontifes en exercice lui dénient la science, l’accusent d’avoir « une mauvaise écriture » et affectent de ne voir en lui qu’un mélodiste. Sans m’arrêter à cette amusante et instructive contradiction, je me borne à constater que Berlioz, pour le moment, ne bénéficie guère de cette reconnaissance tardive de ses facultés mélodiques et il me paraît bon de dire pourquoi.
Diverses causes, dont la principale est le succès de la musique de Wagner et la mauvaise manière de l’écouter et de la comprendre ont produit, dans la génération musicale actuelle, une véritable perversion du sens mélodique. Aussi, quant à présent, est-ce perdre son temps que de parler des qualités propres à la mélodie : les mots mêmes ont perdu leur sens et il ne reste à peu près aucun moyen de se faire comprendre. Essayons, pourtant.
La mélodie a été, jusqu’ici, reste et restera la forme nécessaire sous laquelle se présente l’idée musicale ; elle n’a pas de règles, heureusement, mais elle vaut ce que vaut l’idée, et l’idée, en musique comme en poésie, n’a elle-même de valeur qu’autant qu’elle traduit les sentiments humains avec vérité, dans leurs manifestations essentielles. La mélodie italienne, qui ne se préoccupe que d’être agréable à l’oreille, ou qui se contente d’une expression superficielle, est donc certainement médiocre, car elle revêt une idée insuffisante ; mais, d’autre part, la pure déclamation lyrique, si juste qu’elle soit, n’est pas une véritable mélodie, parce qu’il y manque la forme définie et caractéristique nécessaire à tous les arts pour incarner et faire valoir les idées. Wagner, dont le génie excuse tout, mais dont le système est très discutable, ne confie généralement aux voix qu’une mélopée amorphe (qui est proprement le programme chanté de sa symphonie) et répand généreusement dans l’orchestre, avec toute son âme d’artiste, l’admirable et émouvante mélodie aux formes précises, à l’accent passionné, qui, amplifiée par le développement instrumental, exprime seule, musicalement, les situations et les sentiments exposés par l’action et le récit des chanteurs. Seulement, les bonnes gens qui l’écoutent, habitués à trouver la mélodie dans la partie vocale, ne s’avisent pas de la chercher où le maître l’a mise et, bien qu’ils en subissent inconsciemment l’effet, la méconnaissent, puisqu’ils attribuent tout autant d’importance à ce qu’ils entendent réciter sur la scène.
Il est résulté de ce malentendu ridicule qu’une simple déclamation — d’accent très juste, assurément, — a pu être acceptée comme faisant fonction de mélodie ; puis, peu à peu, s’implanta dans les pauvres cervelles du public l’idée que, du moment où c’était là « la mélodie de Wagner », c’était la bonne, celle de l’art nouveau, la seule sérieuse et expressive, tandis que la mélodie de Gluck, de Beethoven et de Berlioz n’était qu’une vieillerie, une forme « périmée ». Cette grossière confusion est certainement le fait du public plus que des artistes, mais nos modernes compositeurs avaient trop d’intérêt à l’accréditer pour ne pas lui faire bon accueil, et, délivrés du souci d’avoir des idées, ils se sont rués dans le système de Wagner, en en supprimant, toutefois, l’essentiel : la mélodie orchestrale. La tactique était commode ; elle n’a pas mal réussi, tout d’abord, près du public candide, mais tout a une fin et cette ingénieuse industrie paraît déjà un peu usée.
Il était nécessaire de faire cette constatation et d’analyser les principales causes de l’actuelle déformation de notre sens mélodique. Il n’est pas moins nécessaire de dire que la mélodie, qui est l’essence de la musique, emplit les œuvres de Wagner, comme celles de Gluck, de Beethoven, de Berlioz, et qu’elle ne diffère, en celui-ci ou celui-là, que selon la diversité de leurs tempéraments (car elle est l’homme même, comme Buffon l’a dit du style de l’écrivain). Signaler le caractère propre à la mélodie de chacun de nos grands génies et les comparer l’une à l’autre serait une étude fort intéressante, mais qui sortirait du cadre de cet article. C’est de la mélodie de Berlioz qu’il s’agit ici et le sujet est assez ample pour que je ne puisse songer à l’élargir.
L’inspiration mélodique est, en effet, la qualité dominante de sa musique et jamais inspiration, chez aucun maître, ne fut plus riche, plus constante, plus variée. Elle n’a rien de commun, bien entendu, avec la facilité rossinienne, avec le don qui consiste à trouver aisément des thèmes agréables, plus ou moins appropriés au sentiment à exprimer : l’invention mélodique de Berlioz est prodigieuse par son abondance, mais plus encore par sa qualité. Ses thèmes ont la forme indispensable à la beauté, mais cette forme, commandée par l’expression et comme moulée sur l’idée, n’est faite qu’accessoirement d’agrément et d’élégance ; elle sera infiniment élégante, parfois, ou suave, ou caressante pour l’oreille, si le sentiment qu’elle traduit le comporte ; elle pourra, tout aussi bien, être rude, tourmentée, sauvage, asymétrique, pour la même raison, et ne sera pas moins belle d’accent et de vérité humaine.
Tous les musiciens, évidemment, prétendent donner à leurs mélodies un caractère différent suivant les sentiments qu’elles expriment, mais beaucoup d’entre eux usent, pour cela, de formules convenues, comme préparées d’avance, ou, le plus souvent, se contentent des ressources que leur fournissent les différences de mouvement, les nuances de forte et de piano et autres indications prises à la terminologie des solfèges. Rien de tel chez Berlioz ; son sujet le possède et l’idée en jaillit d’elle-même avec une sincérité, je dirais presque une naïveté singulière ; jamais le mot d’Horace n’eut une plus saisissante application : il pleure, s’il veut nous faire pleurer, il est joyeux s’il veut nous égayer ; il aime, avec Juliette, de l’amour d’une vierge de quinze ans ; il rugit de la même passion furieuse que la malheureuse Didon ; il se désespère et délire avec Cassandre ; il s’enivre de vin et de sang avec Harold et les brigands des Abruzzes ; il s’attendrit et prie comme un saint avec les âmes croyantes implorant le ciel… De là l’accent si vrai, si pénétrant, si intense de sa mélodie, de là l’extrême diversité des formes qu’elle affecte et un égal bonheur dans l’expression des sentiments les plus dissemblables.
On s’étonnait, de son temps, que l’auteur de la Symphonie fantastique, du Tuba mirum, et du Lacrymosa de la Messe des Morts, que le Berlioz légendaire des passions violentes et tourmentées, des énormes architectures instrumentales, eût pu écrire la musique « naïve et douce » de l’Enfance du Christ, et l’on voyait là « un changement complet de son style et de sa manière ». Il protesta, déclarant qu’il n’avait fait que « changer de sujet ». Et ce n’était pas autre chose, en effet. Berlioz n’a pas de manière ; il n’a pas non plus de système, si ce n’est, selon ses propres paroles, la recherche de « l’expression, acharnée à reproduire le sens intime de son sujet ». C’est pourquoi on ne saurait découvrir dans son œuvre aucune formule habituelle, ainsi qu’il en existe chez tant d’autres, et chez les plus grands ; d’où la conséquence, si singulière au premier abord, que ce génie, original et personnel entre tous, n’a pas, dans son tour mélodique, de marque distinctive qui le fasse reconnaître à coup sûr.
C’est cette faculté de s’identifier complètement avec « le sens intime de son sujet » qui a produit l’exceptionnelle variété de l’œuvre de Berlioz. Si la tendresse et la mélancolie y dominent, si c’est dans l’expression de ces deux sentiments que l’auteur des Troyens est allé le plus haut (et plus haut, peut-être, qu’aucun autre), il n’en est pas moins vrai qu’aucun mouvement de l’âme humaine ne lui est étranger et qu’il les a tous traduits d’une manière incomparable. Georges Noufflard, un wagnérien, qui, tout en discutant Berlioz à certains points de vue, l’aimait, l’admirait et le comprenait comme savent le faire bien peu de wagnériens français, constate, dans un de ses ouvrages, cette étonnante supériorité « dans tous les genres » et la caractérise d’un mot heureux : l’œuvre de Berlioz, dit-il, « est un vrai musée de la musique (3) ». C’est fort bien dit et il n’est peut-être pas nécessaire, pour apprécier la justesse de cette expression, d’être familier avec l’œuvre entier du maître, car, à vrai dire, le mot pourrait très bien s’appliquer à la seule Damnation de Faust, que tout le monde connaît.
Je n’ai pas eu l’intention, dans tout ce qui précède, de donner un aperçu complet de la physionomie artistique de Berlioz ; j’y avais renoncé par avance, car un pareil sujet dépasse trop évidemment les limites d’un article de journal. On remarquera que je n’ai rien dit de l’instrumentation, ni des effets harmoniques et rythmiques qui fournirent à Berlioz de si puissants moyens d’expression (ce sacrifice, d’ailleurs, m’était assez facile, puisque l’auteur de la Symphonie fantastique n’est guère discuté à ce point de vue). D’autre part, je n’ai pas voulu parler de sa manière d’écrire, parce que je ne pouvais le faire sans engager une véritable polémique dont les développements eussent été beaucoup trop considérables. Je n’ai pas entrepris davantage d’esquisser l’ensemble de son œuvre, ni d’en essayer la synthèse, ni d’en préciser les tendances, ni d’indiquer tout ce que lui doit le monde musical moderne, sans qu’il paraisse s’en douter… La tâche exigerait un ou plusieurs volumes. J’ai prétendu simplement noter quelques aspects principaux de cette nature exceptionnelle, qui suffisent à eux seuls pour justifier l’amour et l’enthousiasme d’un petit nombre d’artistes, et pour faire douter de la clairvoyance des autres, quelle que puisse être leur majorité.
Mais l’erreur de ceux-ci n’est-elle pas évidente et n’en apportent-ils pas eux-mêmes la preuve ? Je vais le montrer par une simple constatation de faits et de circonstances, et je demande ici l’attention de ceux qui me lisent, car il s’agit de l’explication claire, incontestable, d’une des plus singulières anomalies de l’histoire musicale :
Berlioz était mort depuis huit ans, pendant lesquels les efforts de Pasdeloup et de M. Colonne n’avaient pu qu’amener lentement le public à l’écouter avec une attention grandissante, quand un jour, le 18 février 1877, ces deux chefs d’orchestre se rencontrèrent dans la même hardiesse d’initiative et osèrent tous les deux, l’un au Cirque d’Hiver, l’autre au Châtelet, donner dans son entier une œuvre considérable du maître, la Damnation de Faust, dont ils n’avaient fait entendre, jusque-là, que de rares fragments. Si l’exécution du pauvre Pasdeloup ne fut pas à la hauteur de sa bonne volonté et de son talent, celle du Châtelet eut une réussite foudroyante : la plus spontanée, la plus imprévue des acclamations salua cette œuvre inconnue la veille et grandit sans cesse au cours de six auditions successives.
Rien de pareil ne s’était vu dans les annales des concerts, et peut-être dans l’histoire de l’art. La presse entière chanta à l’unisson et reprit, sans pouvoir s’en lasser, un cantique de joie et d’amour, où la stupeur se laissait voir sous l’enthousiasme, et aussi quelque honte d’avoir pu ignorer pendant plus de trente ans l’existence d’une telle merveille. L’éclat d’une gloire subitement révélée rayonnait sur Paris et le secouait d’un frisson d’admiration. Que se passait-il donc ? Etait-ce le public qui, de lui-même et du premier coup, était arrivé à la compréhension d’une œuvre si complexe dans ses effets, dans sa richesse instrumentale, d’une œuvre dont la forme était toute nouvelle pour lui et le caractère tantôt si élevé, tantôt si profondément pathétique ?…
La question ne peut pas même être posée sérieusement. C’étaient les artistes seuls, dont l’organisation était susceptible de saisir instantanément une œuvre pareille, c’étaient les artistes qui avaient reçu le coup de foudre et que le génie avait terrassés. L’enthousiasme, parmi eux, fut unanime et si chaud, si débordant, si irrésistible, qu’il entraîna bientôt la foule docile : en quelques semaines, le snobisme berliozien était créé et il dure encore, à côté du prodigieux snobisme wagnérien, car la Damnation de Faust en est arrivée, aux seuls concerts du Châtelet, au chiffre invraisemblable, inouï, de 117 auditions, qui n’ont en rien lassé l’ardente admiration du public. Mais, chose étrange, ce snobisme est limité à la Damnation et ne fonctionne guère à l’égard des autres œuvres de Berlioz ; et c’est là le fait extraordinaire, l’anomalie déconcertante que je veux expliquer.
Le public acclame la Damnation de Faust, parce qu’on lui a crié que c’était un chef-d’œuvre ; il reste assez froid devant les autres ouvrages du même auteur, parce qu’il n’a reçu à leur sujet aucun mot d’ordre : c’est tout simple, et le public est là dans sa fonction habituelle. Mais pourquoi, comment n’a-t-il pas été prévenu que les Troyens, le Requiem, Roméo et Juliette étaient des œuvres au moins égales à celle qu’il admire ; que la Symphonie fantastique, le Te Deum, Benvenuto Cellini, l’Enfance du Christ, Béatrice et Bénédict, etc… rayonnaient du même génie ? Pourquoi ceux qui pouvaient le savoir ne le lui ont-ils pas dit ? Voici pourquoi :
Les artistes avaient été unanimement subjugués par la révélation inattendue de la Damnation de Faust, et l’éclatant génie qui en déborde s’imposait à eux avec trop d’évidence pour qu’un attrait irrésistible ne dût pas les entraîner vers les autres productions du maître. C’était logique et même nécessaire. Oui ; mais ceci se passait en 1877, et déjà grandissait, parmi eux, la préoccupation de l’œuvre wagnérienne. Le théâtre de Bayreuth venait d’être inauguré par les représentations de la Tétralogie et, bien qu’il ne dût se rouvrir que plusieurs années après, le retentissement que cette manifestation saisissante avait donné à l’œuvre de Wagner et à son système, loin de s’éteindre, s’élargissait sans cesse ; un évangile artistique était annoncé, que les initiés, de jour en jour plus nombreux, se communiquaient fiévreusement de l’un à l’autre, et l’on courait à Munich, on en revenait transporté, ébloui, proclamant la bonne parole, la mystérieuse et toute-puissante affirmation d’un « art nouveau » ! Le public restait encore étranger à tout cela, mais la petite église des artistes n’en était que plus ardente et plus enthousiaste, dans l’orgueil de son initiation privilégiée. Ce fut, il faut le dire, quelque chose d’émouvant et de superbe, comme toutes les grandes impulsions de foi qui emportent l’âme humaine vers un idéal, et, si l’exagération s’en mêla, si les plus médiocres (nécessairement les plus nombreux) des néophytes finirent par fausser l’idée et la faire tourner à l’absurde, on n’en doit pas moins reconnaître que le saisissement produit par ces œuvres admirables et aussi le puissant attrait de la nouveauté expliquaient un pareil affolement… Mais c’était bien de l’affolement et, par suite, la faculté critique, le sens juste de la vérité étaient abolis.
Tel était déjà l’état d’esprit de quelques artistes lors de l’apparition de la Damnation de Faust, mais, dans les deux ou trois années qui suivirent, il devint celui de presque tous. L’épidémie wagnérienne, qui n’atteignit le public qu’assez longtemps après, était dès lors à son apogée, parmi eux. Ils étaient malades, par suite irresponsables.
Leur mal ne consistait pas dans l’admiration d’œuvres si grandes et si belles, mais dans la déplorable idée que cette grandeur et cette beauté provenaient de l’application d’un système, et non du seul génie. De là, pour eux, l’impossibilité de s’intéresser à ce qui n’en procédait pas. Aussi ne purent-ils plus longtemps s’intéresser à Berlioz ; il représentait à leurs yeux un art vieilli, puisque cet art n’était pas conforme à la formule nouvelle, la seule vraie, la seule féconde, la seule capable de faire naître des chefs-d’œuvre. Aux grandes créations du passé, ainsi condamnées rétrospectivement, les plus intelligents d’entre eux consentaient bien à témoigner le respect dû aux ancêtres, mais ils étaient délivrés de toute contrainte à l’égard des productions nouvelles ou de celles que la gloire n’avait pas encore consacrées : c’étaient des œuvres mort-nées, que le génie même était impuissant à rendre viables ; et ils les écoutaient d’une oreille distraite, avec impatience et avec dédain.
Voilà donc, très exactement, quelles étaient les dispositions d’esprit de l’immense majorité des artistes dans les quelques années qui suivirent leur découverte de la Damnation de Faust. Si cette œuvre avait été donnée deux ans plus tard, le succès triomphal qui l’accueillit eût été impossible.
En 1877, une explosion de libre enthousiasme avait pu se produire, un irrésistible courant avait pu entraîner vers Berlioz, alors que celui de Wagner commençait à peine à se former ; mais peu de temps après, ce fut deux torrents qui se rencontrèrent, et le plus furieux fit dévier l’autre. C’est là le mot de l’énigme, l’explication positive d’un fait en apparence inexplicable.
Voilà comment, malgré la gloire que faisait rayonner la Damnation de Faust autour du nom de Berlioz, ses autres chefs-d’œuvre, présentés avec la même intelligence et le même talent par M. Colonne, passèrent inaperçus : les artistes ne s’y intéressaient plus, les écoutaient à peine, et le public, évidemment, ne pouvait, de lui-même, se dresser à leur hauteur. Voilà comment Roméo et Juliette n’eut qu’un succès relatif, comment le Requiem lui-même n’excita pas les transports d’admiration que doit nécessairement soulever cette prodigieuse conception musicale, lorsqu’elle est comprise. — L’effet fut énorme, il est vrai, lors de la première audition, et ceux qui en ont été témoins ne sauraient oublier la manifestation spontanée et grandiose à laquelle donna lieu le Tuba mirum dans la salle du Châtelet (je n’ai, quant à moi, jamais rien vu de comparable). Mais les artistes, émus malgré eux, ce jour-là, se reprirent bien vite ; dès le lendemain, les comptes rendus de la presse, sans nier d’ailleurs ni la grandeur ni le génie, évitaient de se faire l’écho de cet enthousiasme et relataient sommairement, admiraient sans ardeur, discutaient sans respect… La collection des articles par lesquels fut accueillie une pareille œuvre sera, plus tard, un témoignage historique dont notre monde musical n’aura pas à s’enorgueillir.
Plus tard, les Troyens à Carthage, à l’Opéra-Comique, la Prise de Troie, à l’Opéra, furent reçus avec la même froideur ; il est vrai que la façon dont ces grandes œuvres étaient présentées pourrait être une excuse, mais l’exécution de la Prise de Troie par M. Colonne, en 1879, avait été admirable, sans, pour cela, soulever les artistes. Ils ne furent pas plus émus, dans la suite, par le merveilleux Te Deum… Ils pensaient à autre chose.
Ainsi, l’influence exclusive du système wagnérien détourne de Berlioz la grande majorité des artistes français, qui le négligent plus encore qu’ils ne le méconnaissent. C’est là, depuis vingt-cinq ans, la raison principale de ce qui se passe. Un courant s’est formé, une mode s’est établie : il faut attendre un autre courant et une autre mode ; c’est une question de temps.
Mais il est encore un groupe d’artistes (ou prétendus tels) qui, pour être plus restreint, n’en a pas moins sa part de responsabilité dans cette situation si anormale et si ridicule : c’est la bande pédagogique, la ligue des gens de métier, des bons élèves de solfège ou de contrepoint, des pions et sous-maîtres d’école, c’est l’immortelle lignée de Beckmesser. Ceux-là ne subissent pas l’influence d’un courant d’idées passager ; leur manière de penser tient à leur nature, à leur race, et cette race est indestructible. Pour eux, l’idée, le sentiment, le mouvement, la vie, la passion, sont, dans l’art, de peu d’intérêt ; la seule chose importante, ce sont les procédés d’expression. Or, ils n’exercent pas même leur intelligence à la recherche de ces procédés, qui leur ont été enseignés et qu’ils se transmettent comme un dépôt sacré : le talent de chacun d’eux consiste uniquement dans le plus ou moins d’habileté avec lequel il les emploie.
Cette piteuse conception a sévi dans les arts et dans la littérature de tous les temps ; elle est celle de l’impuissance, mais elle fait illusion par son audace et arrive à la considération en ayant l’air de s’appuyer sur la science. En France, où nous avons un tel respect pour les connaissances acquises par l’effort et par le travail, pour les diplômes, pour les consécrations officielles, ces mandarins font figure et fixent la religion artistique de tous ceux (combien nombreux, hélas !) qui n’ont par eux-mêmes aucun sentiment de l’art et veulent quand même avoir une opinion.
Mais leur prétention est absurde et révoltante. L’idée, en art, n’est pas le sujet lui-même, c’est la façon dont l’artiste le conçoit, l’impression qu’il en a reçue. Aussi, est-ce en elle que consiste ce qu’on nomme communément l’inspiration, et c’est là, sans conteste, la partie la plus essentielle, la plus intellectuelle, la plus noble du travail d’esprit artistique. Elle peut rester stérile, évidemment, si l’artiste ne trouve pas les moyens de l’exprimer, mais il est le seul juge du choix de ces moyens, et les meilleurs seront toujours ceux qui lui serviront le mieux à traduire son impression, à se faire comprendre. Gluck, Beethoven, pensaient ainsi ; Wagner a délicieusement développé et concrété cette idée dans un de ces chefs-d’œuvre, et Beckmesser est devenu le type définitif de l’insupportable race des pédants. Berlioz, lui, dit excellemment : « Tout est bon ou tout est mauvais, l’effet produit par certaines combinaisons devant seul les faire condamner ou absoudre. »
Mais les pédants s’insurgent et paient d’audace. Que deviendraient-ils avec de pareilles théories ? Que feraient de leurs précieuses recettes, et ceux d’entre eux qui les enseignent, et ceux dont le seul mérite consiste à les employer ? Que ferait Beckmesser sans sa « tabulature », sans le « buisson fleuri », sans le « grain de fenouil », sans le « goinfre décédé », sans le « bon pélican ! »… Aussi tiennent-ils bon et, toutes les fois qu’ils le peuvent, proclament-ils leur doctrine avec une outrecuidance hautaine qui impressionne les timides et les inconscients. Ces pédagogues sont très habiles et savent tirer parti de tout pour conserver ou étendre le pouvoir de leur secte : sentant que leur action sur le grand public est incertaine (il suit plus volontiers l’impulsion généreuse des vrais artistes), ils ont entrepris, depuis une vingtaine d’années, la conquête des salons et y sont parvenus ; ils possèdent, aujourd’hui, la clientèle des amateurs mondains, chez qui règne, grâce à eux, un snobisme scientifique de la plus invraisemblable bouffonnerie. Ils ont fait mieux : comme il s’en trouve nécessairement, parmi eux, qui sont jeunes par le nombre des années, ils ont eu l’audace, eux, les représentants de la tradition la plus étroite, la plus servile et la plus caduque, de se poser en novateurs, en esprits libres et indépendants et de se dire « les jeunes » ! ! ! Et cette manœuvre-là leur a presque réussi !
Rien ne leur coûte, d’ailleurs ; ils n’ont pas l’âme fière. Spéculant sur la bêtise humaine, ils se sentent éternels et, par suite, peuvent être patients : quand un mauvais vent souffle sur eux, ils savent plier pour ne pas rompre. La caractéristique essentielle des pédagogues est et a toujours été l’horreur du génie, puisque le génie ne s’enseigne pas ; il n’en est pas moins vrai que lorsque, malgré leurs efforts, la gloire d’un homme de génie s’est imposée à l’admiration universelle, ils s’empressent de chanter la palinodie, de peur de compromettre leur crédit. Les exemples en sont innombrables et, pour ne citer que les plus récents, on sait que les choses se sont exactement passées ainsi pour Victor Hugo et pour Wagner. En ce qui concerne ce dernier, l’attitude de nos pédants fut et resta particulièrement curieuse. Il suffirait d’un faible effort de mémoire pour trouver, parmi les plus âgés d’entre eux, tels et tels personnages qui comptent, aujourd’hui, au rang des fervents admirateurs de Wagner après en avoir été les détracteurs acharnés.
Tous, d’ailleurs, qu’ils aient ou non derrière eux ces fâcheux antécédents, paient leur tribut d’admiration avec la même rage intérieure. Ils se sont enrôlés parmi les wagnériens, c’était leur intérêt, mais, dès la première heure, ils ne songeaient qu’à s’évader. Aussi, sans casser les vitres, sans paraître renier en rien le libre génie auquel ils continuent à se soumettre extérieurement, ils ont du moins voulu contre-balancer cette gloire qui les offusque par celle d’un autre maître dont la nature fût moins opposée à leur doctrine, et ils ont choisi César Franck pour remplir cet office. Certaines qualités, de l’auteur des Béatitudes leur parurent de celles qu’ils pouvaient exalter à leur propre bénéfice : pureté de la forme, savant emploi de toutes les ressources harmoniques, admirable solidité de la trame musicale, et surtout, avant tout, pas de génie ! En faveur de ces mérites, ils lui passaient l’élévation de son idéal. Le choix était heureux et habile, mais il reste à se demander ce que Franck, vivant, en eût pensé et si ce grand artiste, aux aspirations si nobles et si hautes, aurait été très fier de pareils suffrages. Quoi qu’il en soit, les pédagogues l’ont pris pour enseigne et, depuis plus de dix ans, travaillent avec une ardeur infatigable à édifier sa gloire, dont ils prétendent se parer. L’alliance avec les wagnériens subsiste provisoirement, mais tenez pour certain que, le jour où elle pourra être dénoncée sans danger, elle le sera. Franck n’a été adopté par les pédants de France, comme Brahms par ceux d’Allemagne, que pour faire échec à Wagner ; c’est le but secret, ardemment poursuivi. Il est, à vrai dire, bien ambitieux et sera difficile à atteindre.
Ces ennemis acharnés du génie n’ont pas eu autant de peine à prendre contre Berlioz. Ils avaient eu, un moment, une chaude alerte, lors du triomphe si subit et si éclatant de la Damnation de Faust. Sous une telle poussée, ils avaient courbé l’échine, la plupart avaient même voulu se montrer enthousiastes avec l’ensemble des artistes, et ils se préparaient tristement à jouer une comédie semblable à celle que leur imposa bientôt après le succès de Wagner ; mais, les choses ayant tourné comme on l’a vu, ils retrouvèrent le champ libre, et, tout émus encore de l’alarme qu’ils avaient eue, comprenant, par ce qui venait de se passer, que Berlioz pouvait être redoutable, ils lui déclarèrent une guerre sans merci. Wagner régnait et paraissait indestructible : c’était assez, c’était trop d’un homme de génie, il fallait étouffer l’autre qui était là, menaçant. Ils s’y sont employés de toutes leurs forces décuplées par la peur, ils s’y emploient encore avec une persistance haineuse, d’autant que les coups portés à Berlioz peuvent, ils l’espèrent bien, ricocher sur Wagner, puisqu’il s’agit, avant tout d’une guerre au génie. C’est ainsi qu’ils se servent de l’œuvre de Franck, ouvertement contre l’un, secrètement contre l’autre.
En voilà trop sur ce sujet. Il fallait bien signaler ici l’attitude de cette secte pédagogique, puisqu’elle joue un rôle dans la situation faite à Berlioz ; mais ce rôle est secondaire, et, si violente que soit l’attaque, elle ne peut être considérée comme très dangereuse : le génie a toujours raison, tôt ou tard, des entreprises de ce genre. Celle-ci, d’ailleurs n’affecte pas grandement les admirateurs de Berlioz, ils s’en réjouiraient plutôt comme d’une consécration que l’histoire de l’art leur permettait d’attendre, et ils ne sauraient trouver là rien qui les blesse au vif de leurs sentiments, parce que les pédagogues ne comptent pas dans la famille artistique. Ils sont infiniment plus sensibles à l’éloignement des wagnériens, car ceux-ci sont des frères dont ils s’affligent d’être séparés par des malentendus, par de stériles préoccupations de théories et de systèmes, alors qu’organisés de même sorte, doués du même instinct (qui est le sens artiste), ayant, au fond, le mêmes aspirations, ils devraient être unis ensemble dans le culte et l’amour du génie. Les berliozistes, en somme, ont le beau rôle dans cette dissension, car, sauf des exceptions bien rares, ils se montrent d’esprit plus ouvert que les autres, sachant admirer Wagner autant qu’il aiment Berlioz. Et ils attendent avec confiance ; ils sont certains qu’avant longtemps leurs « frères séparés » reprendront possession d’eux-mêmes, et, ne fût-ce que par dégoût des pédagogues, oublieront les discussions théoriques pour rentrer dans leur nature d’artistes, pour s’abandonner simplement à leur émotion.
Ils sont fondés à penser de la sorte, car, si la masse des wagnériens reste encore dans son état d’esprit exclusif, il est remarquable que les plus distingués d’entre eux, les plus notoirement intelligents, ont une toute autre attitude. Alfred Ernst, Georges Noufflard, trop tôt disparus, MM. Dukas, Bruneau, André Corneau, Gaston Carraud, combien d’autres encore !… ont toujours su comprendre et aimer Berlioz avec l’entière indépendance de leurs âmes d’artistes, et si quelques-uns d’entre eux font des réserves sur telles ou telles tendances, en raison de leurs théories, tous, du moins, se laissent émouvoir sans résistance par la poésie que verse en eux l’auteur des Troyens, bien qu’il ne leur parle pas le même langage que l’auteur de Parsifal. Ces exceptions sont significatives, et laissent voir que les deux génies rivaux ne sont pas nécessairement incompatibles.
D’ailleurs, c’est seulement parmi les artistes français qu’il en a jamais paru ainsi ; rien de pareil, on le sait, n’existe en Allemagne, où les principaux chefs d’orchestre de Bayreuth sont les plus ardents admirateurs de Berlioz. Et ce mot d’« admirateurs » serait faible en certains cas. Il l’est assurément en ce qui concerne Félix Mottl, chez qui l’amour de Berlioz est une tendresse passionnée ; toutes les œuvres symphoniques de l’auteur de Roméo et Juliette sont fréquemment exécutées par son magnifique orchestre, et voilà longtemps déjà qu’il a mis au répertoire du théâtre de Carlsruhe les quatre opéras du maître, que Paris ne veut ou ne peut entendre. Il n’est pas de fidèle exclusif de Berlioz (j’ai dit qu’il en existait quelques-uns) dont l’enthousiasme surpasse et peut-être égale le sien ; il s’indigne de la moindre critique, de la moindre réserve dans l’admiration, et je ne puis oublier son explosion d’intransigeance, un jour où je lui parlais avec sympathie d’un wagnérien français (ce n’est pas l’un de ceux que j’ai cités tout à l’heure) qui venait d’écrire un remarquable article sur les Troyens : « Oui, s’écria-t-il, les yeux flamboyants ; il admire, il croit comprendre, mais avec des si, avec des mais… Il ne faut pas de si ! Il ne faut pas de mais !… »
Ce culte de Berlioz n’a rien d’exceptionnel, je le répète, parmi les wagnériens allemands ; — nous venons de voir Weingartner, par exemple, accourir aux fêtes de Grenoble et porter pieusement une couronne à la maison natale de la Côte-Saint-André ; — mais s’il y a lieu, à cet égard, d’attacher aux sentiments de Félix Mottl une importance particulière, c’est que ce grand artiste, qui est peut-être le plus ardent de tous dans son berliozisme, fut formé et pour ainsi dire élevé par Wagner. J’ai dit ailleurs ce qu’on en pouvait conclure (4) et rapporté les témoignages formels par lesquels Mottl, au rebours de tout ce qu’on répète à ce sujet, nous fait connaître la profonde admiration de Wagner pour son rival ; j’ai même apporté une sorte de preuve, en publiant une page de Wagner inconnue jusque-là en France où, dans un langage débordant d’enthousiasme, il rapproche Berlioz de Beethoven et le compare à Napoléon ! Les quelques citations contraires qui ont été faites si souvent, les quelques accès de mauvaise humeur qu’explique la rivalité ne me paraissent pas tenir contre ces démonstrations.
Voilà pourquoi nous avons des raisons de croire que ce qui se passe actuellement en France est une anomalie qui ne saurait se perpétuer : si les wagnériens d’Allemagne, si les disciples directs de Wagner comprennent toute la grandeur de Berlioz, si Wagner lui-même l’a comprise, il est vraisemblable que les wagnériens français finiront par en faire autant. Un jour viendra où leur admiration pour l’un ne les empêchera plus d’admirer l’autre, et il en sera ainsi parce que c’est nécessaire, obligatoire, parce que le contraire est l’absurde, parce que le génie lui-même ne peut rien contre le génie.
Mais ce jour-là n’est pas venu encore et, en attendant, nous sommes bien dans le règne de l’absurde. Berlioz est discuté et la France ne se rend pas compte de la gloire qu’il répand sur elle. Que, dans les fêtes du centenaire, dans les discours quasi-officiels, on évite de faire cette humiliante constatation, que M. Reyer, que M. Massenet, en de telles circonstances, se contentent de célébrer la gloire éclatante dont leur vision de grands artistes leur montre l’évidence et la certitude ; qu’ils négligent ou rougissent d’avouer l’impiété, l’aveuglement de leurs contemporains, on ne saurait leur en faire un reproche, on peut même les en louer. Mais si, restant dans leur fonction d’artistes, ils ne se sont souciés que de la vérité absolue, indépendante du temps, le rôle plus ingrat de l’historien commande de montrer les vérités contingentes, la réalité du fait passager, les directions changeantes de l’esprit des hommes.
J’ai pris ce rôle sans plaisir, mais par amour de la justice et pour que cette déposition d’un contemporain puisse servir un jour à venger notre petite minorité actuelle de la brutale majorité qui l’écrase. A la honte de cette majorité, dont personne, bientôt, ne voudra plus avoir fait partie, il fallait dire nettement quel est, en France, l’état de l’opinion sur Berlioz, au moment du centenaire de sa naissance, trente-cinq ans après sa mort. Je l’ai dit; j’ai montré l’étrange aberration de la plupart des artistes, le déchaînement de l’esprit scolastique et, par suite, la froideur du public, insuffisamment averti ; d’où résulte cette situation qui doit être enregistrée : l’immense génie du maître acclamé dans une seule de ses œuvres, les autres, même le Requiem, même Roméo et Juliette, malgré la magnifique interprétation de Colonne, n’attirant aux concerts qu’un nombre restreint d’enthousiastes, et celles du théâtre (parmi lesquelles rayonnent les Troyens !) presque ignorés : les Troyens à Carthage, présentés sans intelligence et sans respect, disparaissent après un petit nombre de représentations ; la Prise de Troie, aussi peu comprise des interprètes que des auditeurs, et vite délaissée ; Béatrice et Bénédict, joué plusieurs fois de suite par occasion et malgré l’accueil chaleureux que lui fit spontanément le public (les dessous de cette histoire seraient curieux à raconter), n’ayant trouvé depuis l’accès d’aucun théâtre ; enfin Benvenuto Cellini, qu’on joue partout en Allemagne, totalement inconnu chez nous, où il n’a jamais été représenté depuis sa chute de 1838 (5).
Voilà la vérité toute nue, et si quelques-uns s’en affligent jusqu’à vouloir la dissimuler, je ne saurais être de ceux-là. Pourquoi, grand Dieu ! dissimulerions-nous ? Ne serait-ce pas laisser croire, peut-être, que nous rougissons de notre petit nombre ?… L’idée m’en paraîtrait plaisante, car nous ne sommes pas si modestes, tant s’en faut. Nous ne rougissons que de l’incompréhension des autres et nous avons, quant à nous, la fierté d’être peu nombreux, ne demandant qu’à le crier bien haut pour l’honneur qui nous en reviendra plus tard.
Il est facile, dira-t-on, de faire appel à l’avenir et de se proclamer le porte-parole de la postérité. J’ai répondu d’avance en déclarant n’avoir, ici, d’autre prétention que d’établir un document. Nous ne sommes que quelques-uns, mais nous prenons date. Insoucieux de notre minorité, nous saluons en Berlioz le plus grand, le plus extraordinaire, le plus glorieux de nos musiciens, celui qui égale les illustres maîtres de l’Allemagne et fait tenir à la France le rang de « grande puissance » musicale. Sans vouloir introduire le patriotisme dans une question d’art, nous croyons que les nations ont lieu de s’enorgueillir de leurs grands hommes et que, lorsqu’elles ne s’en enorgueillissent pas, elle se font honte à elles-mêmes. Que dirait-on de l’Angleterre si elle ne se montrait pas fière de Shakespeare, de l’Espagne si elle ne glorifiait pas Cervantes ?… Cela paraîtrait un inconcevable et stupide aveuglement, chacun de ces énormes génies suffisant, à lui seul, à la gloire littéraire de son pays. Or, Berlioz est exactement, dans la musique française, ce qu’est Shakespeare à la poésie anglaise et Cervantes à la littérature espagnole : l’astre incomparable, le soleil. — Il est vrai que les Anglais et les Espagnols ont mis longtemps avant d’apercevoir le soleil de Shakespeare et celui de Cervantes… Les Français d’aujourd’hui n’ont donc pas de meilleurs yeux que n’en avaient autrefois leurs voisins.
Mais il n’importe guère et Berlioz peut attendre.
(1) Extrait du
« Monde Musical » du 30 novembre 1903, numéro spécial consacré au
centenaire de la naissance de Berlioz (1803-1903).![]()
(2) Il est
utile de préciser l’acception dans laquelle est pris, ici, le mot
« artistes ». J’entends par là les natures artistes, tous
ceux qui ont le sens inné de l’art, qu’il soit ou non affiné et
développé par l’étude, tous ceux qui, instruits ou non des règles et des
techniques, sont doués de la sensibilité spéciale qui permet d’éprouver l’émotion
artistique. L’habitude qui consiste à appliquer le nom d’« artistes »
aux seuls professionnels est d’autant plus vicieuse qu’un grand nombre de
professionnels sont absolument dépourvus du sens que je viens de définir.![]()
(3) Berlioz
et le mouvement de l’art contemporain, p. 69.![]()
(4) Berlioz
et Wagner, dans la Revue d’Art dramatique de janvier 1900.![]() [voir
ci-dessus]
[voir
ci-dessus]
(5) Cette
lacune a été comblée depuis l’époque où ces lignes furent écrites. Le
Théâtre des Champs-Elysées inaugura son ouverture, en 1913, par l’exécution,
tout d’abord très soignée, de Benvenuto Cellini, sous la conduite de
Weingartner. Mais après quelques représentations, et le départ du chef d’orchestre
allemand, le souci de monter d’autres œuvres absorba l’attention de la
direction, et les interprètes de tout ordre, insuffisamment tenus en main, se
laissèrent aller à une débandade fatale à l’opéra de Berlioz, aimablement
persiflé, d’ailleurs, par quelques Beckmesser de la critique. — J. M. [Jean
de Massougnes]![]()
![]()
Le Ménestrel 8 mai 1909, p. 149 [extrait d’une série d’articles sur La Musique et le Théâtre aux Salons du Grand-Palais]: Mlle Renée de Massougnes a envoyé avenue d’Antin une des effigies les plus intéressantes et les plus vivantes de la série de la S. B. A. [Société des Beaux-Arts], le portrait de son père le comte Georges de Massougnes, l’auteur des belles études sur Berlioz, consacrées au maître français en un temps où la dévotion à l’auteur des Troyens n’était pas encore un culte banal. C’est une page de ferme exécution et d’un style vraiment expressif.
![]()
Sauf pour le premier texte, tous les documents suivants sont inédits et proviennent du Musée Hector-Berlioz à La Côte-Saint-André. Nous remercions bien vivement le Musée de nous avoir accordé la permission de transcrire ces textes et de les reproduire sur ce site. Nous le remercions également d’avoir fourni les images des originaux qui sont reproduites ci-dessous.
Lettre de Berlioz à Georges de Massougnes, 25 février 1868 (CG no. 3344; voir la reproduction de cette lettre en tête du livre de Massougnes de 1870, et le commentaire ci-dessus)
Monsieur,
Je viens de recevoir vos deux articles du Redressement. Je vous laisse à penser si ma joie a été grande en les lisant. Mais je veux vous voir et je vous connaître, et aussitôt que j’en aurai la force j’irai au bureau du journal : je suis si malade, si exténué que je ne puis pas sortir en ce moment.
Laissez-moi vous serrer la main.
Hector Berlioz
25 Février 1868
![]()
Lettres de Georges de Massougnes, 1881 - ca. 1900
Tous les textes ci-dessous sont présentés dans leur ordre chronologique, et sont précédés par le numéro d’inventaire du Musée Hector-Berlioz. Sur ce dossier dans son ensemble voir ci-dessus.
[R96.1091.2] Lettre à un ami (sans doute V. Moureton, vice-président du Comité Dauphinois pour l’érection d’un monument à Berlioz à La Côte-Saint-André), 7 février 1881; 5 pages.
Paris, 7 février 1881
Mon cher ami,
Le Comité parisien s’est de nouveau réuni Mercredi dernier mais il m’a été impossible de vous faire connaître plus tôt ses décisions.
Voici ce qui s’est passé.
Le Conseil était, cette fois, en nombre suffisant pour se constituer et, après avoir nommé son bureau, il m’a invité à lui faire connaître l’état de la question.
J’ai dit que le Comité Dauphinois ayant songé à faire élever une statue à Berlioz avait eu pour premier soin de rechercher un sculpteur capable de faire une œuvre digne de l’auteur des Troyens, qu’il s’était adressé à M. de Saint-Marceaux ; que celui-ci avait demandé une somme de 20.000 fr. indépendamment du bronze et de la fonte du bronze ainsi que des frais du socle et autres ; que les délégués du Comité Dauphinois, trouvant cette somme considérable, avaient manifesté à M. de St Marceaux leur crainte de ne pouvoir la recueillir, mais que celui-ci ayant déclaré que l’engagement serait annulé de part et d’autre au cas où la souscription serait insuffisante, les délégués n’avaient pu voir aucun inconvénient à traiter dans de pareilles conditions ; en conséquence qu’ils avaient consenti à un échange de lettres entre M. de St Marceaux et le Comité où l’engagement expliqué ci-dessous serait formulé de part et d’autre et que les choses avaient été faites ainsi.
J’ai ajouté qu’ayant fait connaître cette situation au Comité parisien lors de la première réunion, celui-ci, ou du moins les quelques personnes présentes (car on était en nombre insuffisant pour la constitution) avaient été d’avis que si la somme de 20.000 francs n’était assurément pas excessive par rapport au talent et à la situation artistique de M. de St Marceaux, elle était cependant trop considérable, réunie à celle des frais généraux, pour qu’on pût espérer l’atteindre au moyen de souscriptions et de concerts, et qu’en conséquence le Comité qui poursuivrait ce but courrait risque de perdre sa peine et ses efforts ; que, par suite de ces considérations, les membres présents du Comité parisien avaient cru indispensable que le Comité Dauphinois tentât une démarche auprès de M. de St Marceaux afin d’obtenir de lui une modification à des engagements qui rendraient l’entreprise impossible.
J’ai expliqué en outre qu’à l’issue de cette réunion, je vous avais écrit pour vous prier de transmettre au Comité Dauphinois l’idée [biffé: émise dans cette première réunion] que je viens d’exposer et de lui demander de ma part l’autorisation de faire auprès de M. de St Marceaux la démarche en question ; mais que la seconde réunion du Comité parisien étant fixée à huitaine, il vous avait été matériellement impossible de réunir celui de la Côte St André, et que, par suite, j’avais cru pouvoir faire de mon chef [biffé: auprès de] à M. de St Marceaux, la communication dont il s’agit ; que M. de St Marceaux, paraissant blessé de cette attitude du Comité parisien, n’avait voulu se prêter à aucun arrangement et avait déclaré d’une manière formelle vouloir s’en tenir strictement aux conventions passées entre lui et le Comité Dauphinois.
J’ai ajouté que pour vaincre la résistance de M. de St Marceaux je lui avais proposé de modifier les conditions établies de la manière suivante (bien entendu sauf ratification du Comité Dauphinois) : « M. de St Marceaux accepte en principe de faire gratuitement la statue de Berlioz, mais il est entendu que toutes les sommes recueillies dans ce but qui dépasseront celles nécessitées par les frais matériels du socle et autres lui seront attribuées jusqu’à concurrence de 20.000 fr. » J’ai terminé en disant que cette proposition n’avait pas été mieux accueillie que les autres et que nous nous trouvions par conséquent dans la même situation que j’avais exposée huit jours avant au Comité.
En présence de ces explications le Comité parisien a décidé à l’unanimité (je n’en fais pas partie et ne prends part à ses réunions que comme délégué du Comité Dauphinois) : qu’il ne pouvait prêter son concours à l’entreprise projetée dans les conditions où elle était engagée, et cela pour les raisons exposées dans la première réunion ; mais que, si le Comité Dauphinois pouvait, par une démarche officielle, obtenir de M. de St Marceaux une modification des conventions faites, et si les nouvelles bases du traité lui paraissaient favorables, il consentirait volontiers à aider le Dauphiné dans son œuvre. Dans cet ordre d’idées, le Comité parisien a déclaré que la dernière proposition faite par moi à M. de St Marceaux lui paraissait excellente et m’a chargé de prier le Comité Dauphinois de la transmettre à M. de St Marceaux d’une manière officielle, espérant que celui-ci serait amené par la réflexion à y faire un meilleur accueil. — Le Comité parisien, en me donnant cette mission, m’a chargé de provoquer sa convocation lorsque je serais en état de lui faire connaître le résultat de la démarche, à la suite de laquelle il prendra une résolution définitive ; laissant entendre que si nous obtenons une réponse négative il ne lui restera probablement qu’à se dissoudre.
Voilà, mon cher ami, le résumé exact de ce qui s’est dit et de ce qui a été décidé au sein du Comité parisien. Je vous prie donc de réunir au plus tôt le Comité Dauphinois, et, s’il y consent, d’adresser en son nom à M. de Saint-Marceaux une lettre dans le sens indiqué ci-dessus. Sans dire que ces conditions sont dictées par le Comité parisien, vous pouvez dire « que vous aviez voulu former à Paris un comité pour vous venir en aide, parceque vos ressources locales seraient évidemment insuffisantes pour atteindre votre but ; que le Comité ainsi formé, s’appuyant sur de nombreux précédents, a déclaré impossible de réunir une somme aussi forte et qu’il refuse de s’engager dans une entreprise où il n’entrevoit que des déboires et un échec assuré. En conséquence, considérant l’abstention du Comité parisien comme la ruine absolue de votre entreprise et voulant tâcher de concilier ses inquiétudes avec les engagements que vous avez pris, vous priez M. de St Marceaux de vouloir bien revenir sur les conventions qu’il a faites avec vous et de les modifier, par exemple, dans la forme suivante : M. de St Marceaux accepte en principe de faire gratuitement la statue de Berlioz… etc. comme ci-dessus. Vous ajouteriez que toutes les objections du Comité parisien tomberaient certainement si la question était ainsi posée et que, d’un autre côté, vous avez assez de confiance dans la popularité actuelle de Berlioz pour pouvoir espérer que l’élan de la souscription permettrait largement d’atteindre le chiffre primitivement promis. »
Vous voudriez bien m’adresser cette lettre, que je me chargerais de remettre à M. de Saint-Marceaux, à moins que vous ne préfériez la lui adresser directement. Dès que je serais en possession de la réponse, je la communiquerais au Comité Parisien, qui prendrait alors une résolution définitive.
Je ne crois pas qu’il y ait, pour le moment, de mieux à faire, et je pense que le Comité Dauphinois sera de cet avis lorsqu’il aura pris connaissance des faits.
Je n’ai, d’ailleurs, rien à changer aux appréciations que je vous ai communiquées précédemment. Toutefois, je dois dire que les dispositions du Comité Parisien paraissent changées en tant qu’elles l’eûssent porté, comme il y avait lieu de le craindre, à faire échouer votre entreprise pour y substituer l’idée nouvelle d’une statue à Paris. L’excellent président que s’est donné le Comité, M. le Vte Delaborde, a parlé samedi dans de si bons termes contre un pareil plan (lorsqu’il a été timidement mis en avant, comme je m’y attendais) que presque tous les esprits ont été retournés et que la question ne se posera plus, je l’espère.
Depuis la réunion du Comité, M. Alexandre, exécuteur testamentaire de Berlioz, m’a demandé une entrevue pour me communiquer un plan de conduite qui lui paraît excellent dans l’intérêt de tous et il a insisté pour que je la fasse connaître au Comité Dauphinois. Je le lui ai promis et vous transmettrai en effet, demain ou après-demain, une copie de la lettre qu’il m’a remise en la développant de vive voix. N’attendez point de l’avoir reçue pour convoquer le Comité Dauphinois. Comme je ne pense pas que vous vous réunissiez avant 4 ou 5 jours, vous aurez certainement cette lettre assez tôt pour pouvoir la mettre sous les yeux de vos collègues.
Agréez, mon cher ami, la nouvelle assurance de mes sentiments les plus dévoués
Georges de Massougnes
![]()
[R96.1091.4] Lettre au Maire de La Côte-Saint-André (M. Marcel Paret), 21 octobre 1889; 6 pages. Les allusions à A... renvoient sans doute à Édouard Alexandre.
Paris, 21 octobre 1889
Monsieur le Maire,
J’accepte avec plaisir et reconnaissance l’honneur que le Conseil Municipal de la Côte St André et vous-même voulez bien me faire, en m’offrant de faire partie du Comité institué pour l’érection de la statue de Berlioz dans sa ville natale. La distance ne me permettra malheureusement pas d’assister aux réunions de ce comité, mais si je puis lui être utile à Paris, comme j’ai cherché à l’être à l’ancien Comité aujourd’hui dissous, je serai heureux de faire tout ce qui dépendra de moi pour cela.
J’ai longtemps espéré que les souscriptions recueillies pour l’érection de la statue de Berlioz à Paris laisseraient un reliquat de quelque importance et j’avais obtenu du Comité qu’il serait intégralement réservé au Dauphiné. Ce reliquat a existé, en effet, mais deux circonstances malheureuses sont venues le faire disparaître totalement. — Vers le mois de Septembre 1887, M. Brandus, trésorier du Comité, mourait subitement, et sa mort révélait dans sa maison de commerce un passif considérable. Il devait lui rester, au compte du Comité, une somme de 15 à 1800 francs (j’ai oublié les chiffres exacts ;) mais, comme la souscription Berlioz était absolument indépendante des affaires de la maison, cette dette fut considérée comme personnelle à M. Brandus et n’entra pas même dans le compte de la liquidation. Le président du Comité, M. le Vicomte Delaborde, s’adressa bien aux héritiers, mais ceux-ci, qui avaient refusé la succession, ne voulurent pas se charger de cette dette plus que des autres.
Il restait encore, entre les mains d’un autre membre du Comité, M. A…, une somme assez importante (3.000 fr. environ) qu’il avait recueillie lui-même et dont le Comité lui avait laissé la garde, l’ayant chargé d’affecter cette somme à la restauration du tombeau de Berlioz. Dans le cours de 1888, les travaux du tombeau étant terminés et payés par M. A ….., il lui restait, au compte du Comité, un reliquat de 4 à 500 francs environ, lorsqu’il mourut, laissant une situation analogue à celle de M. Brandus ! Les 4 ou 500 fr. dûs par lui au Comité se trouvaient donc perdus comme le reste et M. le Vicomte Delaborde, d’après les renseignements qu’il recueillit, jugea qu’il n’était pas même utile de les réclamer à la famille. Le Comité avait couru là un assez grand danger, car M. A ….. n’avait payé la note du marbrier que peu de mois avant sa mort. S’il eût tardé davantage et si la mort l’avait surpris, sa succession eût certainement refusé d’effectuer le paiement, le Comité eût eu à tenir les engagements pris envers le marbrier et il se fût trouvé en déficit de 2500 francs environ.
Voilà, monsieur le Maire, par quel concours vraiment extraordinaire de circonstances fâcheuses, le Comité Parisien s’est trouvé dans l’impuissance de faire, pour la statue de Berlioz, ce qu’il avait résolu. Il n’aura pu lui témoigner de sympathie qu’en autorisant, comme vous le savez, le Comité Dauphinois à faire fondre une copie de la statue élevée à Paris et en mettant dans les conditions posées par lui au sculpteur qu’il ne pourrait, en cette circonstance, réclamer aucune rétribution pour la reproduction de son œuvre. La section de musique de l’Institut, comme nous avions fait, au Comité de Paris, ou, ce qui serait peut-être moins encombrant et moins banal, [devrait?] se borner à s’adresser à ceux qui sont connus pour aimer et admirer l’œuvre de Berlioz. A ce titre, il faudrait en premier lieu, et de toute nécessité, s’adresser à M. Reyer, puis à M. St Saëns que sa santé, toutefois, a beaucoup éloigné du Comité de Paris, enfin à M. Gounod …. peut-être. Quant à M. Ambroise Thomas, dont les tendances esthétiques sont tout à l’opposé de celles de Berlioz et qui appartient à une école presque ennemie, on ne s’expliquerait pas de le voir choisi pour rendre hommage à Berlioz, alors que M. Saint-Saëns, disciple et ami de votre grand compatriote, n’aurait pas le même honneur.
A vrai dire, Monsieur le Maire, tout cela n’a pas grande importance et je vous livre pour ce qu’elles valent ces petites considérations. Je me préoccupe fort peu, quant à moi, des questions de personnes et je crois qu’elles ont, ici, aussi peu d’importance que jamais. [en marge: sauf en ce qui concerne M. Colonne, bien entendu]. Peut-être aurais-je dû me borner à dire qu’il serait convenable d’ajouter le nom de M. Saint-Saëns à ceux que vous m’avez cités. Cela eût été suffisant et aurait le mérite d’être plus court.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, la nouvelle assurance de ma considération bien distinguée.
Georges de Massougnes
![]()
[R96.1091.5A] Lettre au Maire de La Côte-Saint-André (M. Marcel Paret), 6 novembre 1889; 4 pages, mais la fin manque (voir l’image de cette lettre ci-dessous).
Paris, 6 Novembre 1889
Monsieur le Maire,
Je vous remercie de tous les renseignements que vous avez bien voulu m’adresser.
J’ai vu M.Thiébaut et l’ai trouvé disposé à accepter le délai de paiement stipulé dans la convention que vous m’aviez adressée, mais non à prendre à sa charge les frais d’emballage et de transport. Après s’être rendu compte à peu près exactement de ce que répresenteraient ces frais et avoir constaté qu’ils s’élèveraient environ à 125 francs pour l’emballage et 100 francs pour le transport, il m’a fait remarquer qu’ayant déjà diminué de 500 francs le prix convenu, il ne pourrait prendre ces sommes à sa charge sans réduire son bénéfice dans de trop grandes proportions. J’ai fini, cependant, par obtenir qu’il se chargerait du transport, mais non de l’emballage.
En conséquence, si ces conditions étaient acceptées par le Comité, il n’y aurait qu’à rayer, sur le sous-seing que je vous retourne ci-inclus, le seul mot : emballage, toutes les autres conditions étant admises par M. Thiébaut.
M. Thiébaut préfère pouvoir conserver un double du contrat. Il y aurait donc lieu d’en établir un second. Il peut traiter en son nom personnel et il suffira, en conséquence, de le dénommer Thiébaut, Henri, ce qui évitera des formalités.
Je ferai tout mon possible pour récolter quelques souscriptions ; mais, à part celle d’un de mes parents, que je crois pouvoir vous envoyer prochainement, je n’ose vous promettre un résultat important, pour la raison que je vous exposais dans ma première lettre. Une personne sur laquelle je compte comme pouvant agir mieux que moi dans un certain milieu musical doit, malheureusement, passer l’hiver dans le Midi, ce qui retardera beaucoup les démarches que je veux lui faire faire. Il y aura, toutefois, avantage à attendre ces deux ou trois mois, plutôt qu’à agir moi-même.
C’est une excellente idée, que de prier M. Colonne de faire partie du Comité, car, à un moment donné, il pourra peut-être, si cela est nécessaire, apporter à notre œuvre un concours puissant. Une représentation de la Damnation de Faust au bénéfice du Comité pourrait lui rapporter plus de 2.000 francs, si je ne me trompe. Mais il me paraîtrait nécessaire de laisser le moins possible transparaître cette arrière-pensée dans la démarche qui sera faite auprès de M. Colonne, car, malgré tout son dévouement à l’œuvre de Berlioz, il pourrait considérer qu’il a fait assez de sacrifices de ce genre et se dérober à l’obligation d’en faire de nouveaux, en refusant de faire partie de notre Comité. Au contraire, une fois qu’il en fera partie, il se trouvera comme moralement obligé de nous soutenir. J’insiste sur l’importance de cette petite diplomatie.
Je crois aussi que, priant M. Colonne de faire partie du Comité, nous devons faire, en même temps, une semblable démarche auprès de nos premiers compositeurs, d’autant que, si nous ne le faisions pas, nous semblerions nous adresser à M. Colonne que par intérêt. Mais je ne m’explique pas bien la désignation qui a été faite de M.M. Ambroise Thomas, Gounod et Reyer. Il faudrait, à mon avis, ou inviter toutes (la fin de la lettre manque)
![]()
[R96.1091.6] Lettre au Maire de La Côte-Saint-André (M. Marcel Paret), 27 novembre 1889, 3 pages. On remarquera la différente orthographe du nom Thiébault dans cette lettre par rapport aux lettres R96.1091.5A et R96.1091.7.
Paris, 27 Novembre 1889
Monsieur le Maire,
Permettez-moi de vous faire part de ma préoccupation au sujet de l’expiration prochaine du délai accordé par l’administration pour l’enlèvement des objets exposés au Champ de Mars. Ce délai expire, si je ne me trompe, le 6 décembre, et je prévois des difficultés et des ennuis pour nous, si notre statue n’a pas encore été enlevée à cette date.
Je vous prie, Monsieur le Maire, de vouloir bien attirer sur cette situation l’attention du Comité. S’il a l’intention de signer le traité avec M. Thiébault dans les conditions acceptées par celui-ci, il serait utile qu’il le fît au plus tôt, et cela simplifierait toutes choses, car, en pareil cas, M. Thiébault fournit, du même coup, l’enlèvement et l’expédition. Dans le cas contraire, il y aurait lieu d’aviser d’une autre façon et de prendre sans retard les mesures nécessaires pour que la statue fût enlevée en temps utile et déposée dans un lieu désigné.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération la plus distinguée.
Georges de Massougnes
21 Avenue de Tourville
![]()
[R96.1091.7] Lettre au Maire de La Côte-Saint-André (M. Marcel Paret), 5 décembre 1889, 3 pages.
Paris, 5 Décembre 1889
Monsieur le Maire,
M. Thiébaut s’est décidé à accepter les conditions du traité que vouz aviez rédigé et il vient de m’en adresser un double, signé de lui, que j’ai l’honneur de vous transmettre sous ce pli.
Par ce même courrier, je lui écris pour le prier de faire les diligences nécessaires pour que la statue soit enlevée du Champ de Mars en temps utile.
Du moment où M. Ambroise Thomas fait partie de notre comité, il me paraît indispensable, conformément aux observations que contenait ma dernière lettre, que M. Reyer, disciple et ami de Berlioz, (et membre de l’Institut comme M. Thomas) soit aussi invité à en faire partie.
Pour d’autres raisons que j’ai également indiquées, il me semble qu’il serait bien de faire la même démarche auprès de M. Colonne.
Enfin, il y aurait à peu près les mêmes raisons que pour M. Reyer, de demander à M. Saint-Saëns d’être aussi des nôtres.
Si vous le désirez, Monsieur le Maire, je me chargerai d’adresser cette démarche à M.M. Reyer, St Saëns et Colonne, mais je ne pourrai le faire que si vous voulez bien m’en charger officiellement, au nom du Comité.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération bien distinguée.
Georges de Massougnes
![]()
[R96.1091.8] Lettre au Maire de La Côte-Saint-André (M. Marcel Paret), 13 août 1890, 4 pages.
Paris, 13 Août 1890
Monsieur le Maire,
Au moment de quitter Paris pour un mois, je tiens à vous rendre compte des diverses démarches que j’ai faites.
Toutes les lettres d’invitation que vous m’aviez envoyées ont été remises aux destinataires, soit en mains propres, soit par la poste.
Je vous ai déjà écrit que j’avais vu M.M. Reyer et Lenoir et vous ai communiqué leurs réponses.
Depuis, j’ai vu M. le Vicomte Delaborde, qui ne pourra pas se rendre à la cérémonie et m’a dit qu’il vous écrirait pour vous en exprimer ses regrets. Il doit l’avoir fait.
Je suis allé aussi chez M. Ambroise Thomas, mais c’était dans la période des Concours au Conservatoire. Je n’ai pu être reçu et j’ai compris qu’il serait indiscret de revenir à la charge en un pareil moment. Ces concours étant fort longs, pour ne pas perdre du temps à en attendre la fin, j’ai donc écrit à M. Ambroise Thomas, lui envoyant votre lettre, lui exprimant mon regret de n’avoir pu le rencontrer et insistant, au nom du Comité, et pour qu’il assiste à la Cérémonie et pour qu’il veuille bien y prendre la parole. D’après la très aimable réponse que j’ai reçue de lui, je pense qu’il doit vous avoir déjà fait connaître son acceptation.
Je suis allé deux fois chez M. Massenet sans pouvoir le rencontrer. La seconde fois, j’ai laissé votre lettre avec ma carte où j’ai mis quelques mots pour le prier de vous répondre directement. Je ne sais s’il l’a fait.
Le domicile de M. Saint-Saëns continuant à être difficile à découvrir, je me suis contenté, après ma première démarche, de lui envoyer votre lettre par la poste, à son ancienne adresse. Je m’étais assuré que, de la sorte, elle lui parviendrait certainement.
Comme je vous l’ai dit, je crois, j’ai simplement mis à la poste les lettres destinées à M.M. le général Février, le Directeur des Beaux-Arts, Gounod et Delibes.
Dans le cas, Monsieur le Maire, où je pourrais, quoique absent de Paris, vous être utile à quelque chose, voici mon adresse, du 15 Août au 15 Septembre: 32 rue Corderant, à Angoulême.
Je rentrerai à Paris le 15 Septembre.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, la nouvelle assurance de mes sentiments bien distingués et dévoués.
Georges de Massougnes
![]()
[R96.1091.3] Lettre au Maire de La Côte-Saint-André (M. Marcel Paret), sans date, mais probablement de septembre 1890, peu avant la cérémonie du 28 septembre. Le papier porte une bordure en noir: c’est donc sans doute un deuil qui a empêché Massougnes d’assister à la cérémonie.
[le début de la lettre manque]
Ces Messieurs sont les éditeurs des œuvres de Berlioz, comme M. Richault, déjà invité ! Toutes les œuvres de Berlioz sont éditées par ces trois maisons et je verrais quelque inconvénient à ce qu’un seul des trois fût invité par vous. Je regrette seulement de n’y avoir pas songé plus tôt.
M. Maquet, d’ailleurs, est le successeur de M. Brandus, aujourd’hui décédé, qui faisait partie du Comité Parisien.
Je vous serai obligé, Monsieur le Maire, de vouloir bien me dire, dans votre prochaine réponse, si vous avez cru pouvoir lancer ces deux invitations. Il sera bon, en effet, que j’en sois informé.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, avec l’expression de mon vif regret de ne pouvoir me réunir à vous le 28 septembre, la nouvelle assurance de mes sentiments bien distingués et dévoués.
Georges de Massougnes
21 Avenue de Tourville
![]()
[Acquisition 2017] Lettre à J.-G. Prod’homme, 17 avril 1898, 4 pages (voir l’image de cette lettre ci-dessous). Le destinataire de cette lettre, acquise par le Musée en 2017, n’est pas nommé mais ne peut être que le critique et musicologue Jacques-Gabriel Prod’homme (1871-1956), auteur de plusieurs travaux sur Berlioz, dont un livre sur la Damnation de Faust (1896), un autre sur l’Enfance du Christ (1898) et une étude d’ensemble sur Hector Berlioz (1904, 3ème édition 1927). La lettre de Massougnes fait allusion aux deux premiers titres, dont le second venait de paraître et avait incité Massougnes à écrire à Prod’homme pour lui en demander un exemplaire, ce dont Prod’homme s’acquitta gracieusement.
Paris, 17 Avril 1898
Monsieur
Je me serais certainement procuré votre volume sur l’Enfance du Christ comme j’avais fait pour celui de la Damnation de Faust, mais il m’est venu la curiosité de savoir comment serait accueillie la requête de « votre aîné en Berliozisme, » bien qu’il soit retiré sous sa tente et en sorte si peu ..... Je vous remercie de votre gracieuse façon de me répondre et je l’aurais fait tout de suite si je n’avais tenu à lire d’abord votre livre et si diverses circonstances ne m’avaient empêché pendant plusieurs jours.
Il est tel que je l’espérais, d’après le précédent. Le travail considérable que vous entreprenez avec tant de soin et d’intelligence est sérieux et utile et constituera une très belle contribution à la gloire de notre Berlioz, pour laquelle il reste beaucoup à faire.
Ne vous êtes-vous pas un peu mépris sur mon intention dans le passage de ma petite brochure auquel vous faites allusion ?... Il ne s’agissait pas pour moi d’établir une distinction de genres, (chose dont je ne me soucie guère) et d’attacher à telles parties de l’Enfance du Christ l’étiquette de « mystère, » à telle autre celle d’« oratorio. » Je voulais seulement signaler une notable différence d’inspiration et de tendance entre le Songe d’Hérode et le reste de l’œuvre. Je croyais et je crois encore que les deux dernières parties sont d’un sentiment religieux intense et exclusif qui, dans la première, ne se retrouve qu’au premier récit et dans la scène de l’étable (avec, pour cette dernière, une certaine nuance de naïveté en moins.) Dans les deux dernières parties, Berlioz a fait de la poésie chrétienne en musique ; dans la première, il a fait de très belle musique, expressive, dramatique, qui a pu le satisfaire lui-même davantage au point de vue technique, mais d’où la préoccupation religieuse est absente. Il y a là deux états d’esprit différents que je constatais en disant : « Je croirais volontiers que cette première partie a été écrite après les autres.... » Or, j’ignorais absolument, à cette époque, l’historique de l’œuvre, et ce que j’ai appris depuis, et que fixe définitivement votre ouvrage montre que j’avais deviné juste. N’y a-t-il pas là comme une preuve que j’appréciais bien le sens intime de l’œuvre.
En voilà bien long sur peu de chose, mais vous verrez, j’espère, Monsieur, dans le soin que je mets à justifier mes idées, le désir d’être bien jugé par vous. Je ne prendrais pas tant de peine avec beaucoup d’autres, mais il y a trop de rapports, il me semble, entre nos manières de comprrendre et de sentir, pour que je n’aie pas tenu à faire disparaître ce léger malentendu. Un passage de votre premier volume aurait suffi pour m’apprendre que nous comprenons tout-à-fait la musique de la même façon, c’est celui où vous associez dans une même admiration les quatre noms de Gluck, Beethoven, Berlioz et Wagner. Il ne m’en a pas fallu davantage pour voir que vous n’admiriez pas Berlioz au hasard et que vous étiez un fervent de la musique expressive. Oui, ce sont bien là les quatre grands expressifs (les quatre plus grands,) et quiconque pense autrement n’a pas le sens de l’expression qui, pour moi, est toute la musique.
Il m’arrive très rarement de me trouver avec quelqu’un en aussi parfaite communion d’idées ; aussi suis-je bien heureux de notre confraternité et, en vous renouvelant mes remerciements, je vous demande la permission de vous serrer la main.
G. de Massougnes
![]()
[R96.1091.5B] Lettre à un destinataire inconnu, après janvier 1900 (voir l’image de cette lettre ci-dessous). Cette lettre porte le même numéro d’inventaire que la lettre du 6 novembre 1889 ci-dessus, mais appartient évidemment à une lettre postérieure qui est à dater de 1900 ou plus tard d’après les allusions à l’article sur Berlioz et Wagner publié dans la Revue d’art dramatique de janvier 1900.
[le début de la lettre manque]
n’est pas le même, assurément, mais là encore une situation analogue a imposé à Wagner un mode d’expression analogue, par suite d’un souvenir inconscient.
4° Il y a encore ce que j’ai indiqué rapidement dans mon article de la Revue d’Art Dramatique : à la fin de l’ouverture de Tannhaüser, le dessin si persistant des violons accompagnant le thème du chœur des Pélerins : l’effet s’en retrouve d’une manière frappante dans le finale avec chœurs de Roméo et Juliette. Je crois que cela a frappé tout le monde (j’entends tous ceux qui connaissent bien ces deux œuvres) et je me rappelle, notamment, que Chausson me l’a signalé comme très évident.
Voilà, cher Monsieur, ce que je me rappelle pour le moment. Il y a, j’en suis à peu près sûr, d’autres exemples. Cela, d’ailleurs pourrait paraître insuffisant pour la thèse, car Wagner prenait son bien partout où il le trouvait et il a fait des empreints à bien d’autres qu’à Berlioz. L’influence que notre maître a certainement exercée sur lui peut, je crois, et même doit être démontrée autrement, par les témoignages de ceux qui ont connu la pensée intime de Wagner, par exemple par le témoignage de Mottl (voir mon article dans la Revue d’Art Dramatique,) et aussi par des écrits de Wagner non présentés au public, comme cette page étonnante (publiée dans le même article) où il compare Berlioz à Napoléon tout en le rapprochant de Beethoven !!
Bien amicalement à vous, cher Monsieur
G. de Massougnes
![]()
Lettres de Henri Chapot à Édouard Colonne, et d’Édouard Colonne à Georges de Massougnes (1896)
Voir ci-dessus.
[R96.950] Lettre de Henri Chapot à Édouard Colonne, 23 septembre 1896; une page.
Meylan, le 23 septembre 1896.
Les Héritiers d’Hector Berlioz, convaincus que Monsieur J.–Ed. Colonne est celui des chefs d’orchestre actuels français le plus capable de comprendre et d’interpréter les œuvres du Maître, lui accordent la priorité et l’exclusivité pour représenter l’œuvre entière des « Troyens », sans coupures et en deux soirées consécutives, (comme à Carlsruhe) une pour la « Prise de Troie », l’autre pour les « Troyens à Carthage ». Cette cession gratuite n’est faite que si Monsieur Colonne obtient la direction du futur Théâtre Lyrique municipal, et pour une année à partir de l’ouverture de ce théâtre ; elle pourra être renouvelée et étendue à d’autres œuvres de Berlioz, s’ils le jugent utile, par les Héritiers, qui entendent n’encourir aucune responsabilité d’aucune sorte au sujet de la présente cession.
Pour les Héritiers,
le mandataire :
H. Chapot.
[R96.951] Lettre d’Édouard Colonne à Georges de Massougnes, 30 septembre 1896; une page.
Mon cher Monsieur de Massougnes,
Il est entendu qu’en m’accordant l’autorisation de représenter Les Troyens avec priorité et exclusivité sur tous les autres chefs d’orchestre, les héritiers de Berlioz ne prétendent me conférer que le droit qu’ils peuvent posséder eux-mêmes, et que si, pour une cause quelconque, cette autorisation ne pouvait pas produire son effet, je n’aurais à exercer aucune revendication contre les dits héritiers.
Paris, le 30 septembre 1896
Ed. Colonne
![]()
Lettres de Jean de Massougnes (fils de Georges), 1919 et 1941
[R96.1091.1.1 et 2] Deux exemplaires identiques d’une lettre dactylographiée, sans nom de destinataire et sans signature; il s’agit donc sans doute d’une circulaire adressée à plusieurs personnes. Le contenu de la lettre indique qu’elle est du fils de Massougnes (Jean de Massougnes) et non de Georges de Massougnes lui-même, décédé peu avant. Septembre 1919; 3 pages. On remarquera que c’est précisément à ce moment-là que Jean de Massougnes fait publier une nouvelle édition du livre de son père paru en 1870 et y ajoute un avant-propos ainsi qu’une réimpression d’un article de 1903 qui donne une vue d’ensemble de Berlioz dans l’année de son centenaire. Sur la maison de Montmartre et le musée de Francfort voir ci-dessus.
Paris, Septembre 1919.
M.
Cinquante ans ont passé depuis la mort d’Hector BERLIOZ, cinquante années qui ont universellement consacré sa gloire. Le génie, aujourd’hui incontesté, du maître des “ Troyens ” participe, d’un éclat prodigieux, au génie collectif de la France éternelle. Ses œuvres et sa mémoire sont inséparables du patrimoine artistique de l’Humanité.
Est-il admissible qu’aucun effort ne soit tenté pour matérialiser, en quelque sorte, le souvenir de cette âme immense, qui vécut avec une foi intrépide la plus belle et la plus douloureuse existence d’artiste aux prises avec un injuste Destin ? Ne faut-il pas un sanctuaire où révérer, d’une piété particulière, cette grande Mémoire ?
Une occasion se présente d’associer à ce culte son temple. La maison de la rue du Mont-Cenis, à Montmartre, où Roméo vécut avec Juliette les heures les plus radieuses de sa vie tourmentée, cette humble maison qui n’offre au passant que l’insuffisant témoignage d’une plaque commémorative, cette maison sacrée est menacée de démolition. Le génie et la gloire sont de si peu de poids au prix de la spéculation que, si nous n’y mettons obstacle, quelque attristant immeuble de rapport grattera bientôt le ciel à la place où la modeste demeure élève son unique étage, si somptueux par les souvenirs.
Ne pensez-vous pas qu’une idée digne de la France, et à laquelle pourraient s’associer d’autres peuples, serait de conjurer la destruction en offrant à Paris, dans cette maison même, un musée nouveau, d’ailleurs merveilleusement situé ? Sans doute la maison natale du Maître, que nous ne perdons pas de vue, est dans l’Isère, à la Côte-Saint-André, où les premiers éléments d’un musée, naguère réunis par la piété éclairée de M. Celle, ont trouvé refuge à la Mairie… Mais l’heure est unique pour celle de Paris, et le MUSÉE BERLIOZ serait à sa place dans une ville qui s’enorgueillit d’être la capitale artistique de Monde.
La maison de Balzac, celle d’Hugo, nous sont des exemples et un encouragement. Le musicien qui va de pair avec ces géants des lettres est-il indigne des honneurs que Salzbourg a réservés à Mozart, Bonn à Beethoven ? Laisserons-nous l’Allemagne, au nom d’une sorte d’impérialisme musical, accaparer la mémoire de nos génies nationaux mal défendus ? Déjà, fait encore peu connu, un musée Berlioz existe à Francfort-sur-le-Mein, où une initiative privée a réalisé ce que personne n’a encore tenté de faire, chez nous, avec des moyens suffisants. Une âme française d’artiste ne peut-elle pas sentir, dans ce geste d’un étranger, une leçon légèrement humiliante, mais assez méritée ? Et pourtant, c’est vers sa patrie que l’auteur de la “ Damnation ” se tournait avec plus de tendresse douloureuse à chacun de ses triomphes au-delà des frontières, vers cette patrie qui ne pouvait le comprendre, intoxiquée par la médiocrité musicale et l’incompréhension de la critique du temps.
J’aurais aimé qu’une voix plus autorisée que la mienne prît l’initiative des propositions que je vous soumets. C’eût-été le rôle, pour ainsi dire naturel, de mon père, qui caressait depuis si longtemps ce rêve, si la mort n’était venue récemment l’arracher à cet apostolat berliozien auquel il avait voué sa vie. Des fervents de Berlioz, amis de Georges de Massougnes, ont affirmé à son fils qu’il lui appartenait de parler à sa place, comme étant le représentant de son nom et le dépositaire le plus fidèle de sa pensée. C’est à ce titre que je vous adresse cet appel, dans la pleine conscience de mon obscurité, mais avec toute l’ardeur et toute la piété du culte dans lequel j’ai été élevé.
J’ai l’honneur de solliciter, pour l’œuvre de rachat de la maison de la rue du Mont-Cenis, votre haut patronage et, pour la constitution d’un puissant “ Comité Berlioz ”, votre précieux concours. Nous ne bornons pas notre action à la France et comptons l’étendre à la Société des Nations, où l’Art a sa place marquée. Dans tous les pays qui la composent, les admirateurs d’Hector Berlioz sont trop nombreux et trop fervents pour qu’il ne faille pas leur réserver la possibilité de participer à l’œuvre par leurs souscriptions.
Dans l’espoir que vous accueillerez favorablement cette idée, je vous prie d’agréer, M , l’assurance de ma considération la plus distinguée.
[texte non signé]
P. S. — Je vous serais très reconnaissant de vouloir bien me signaler tous noms de personnes ou de groupements d’artistes à qui cet appel vous paraîtrait pouvoir être utilement envoyé.
[en bas de page]
Prière d’adresser votre réponse à
M. le Comte de MASSOUGNES des FONTAINES.
21, avenue de Tourville, PARIS (7e)
![]()
[R96.1092] Lettre du Comte Jean de Massougnes des Fontaines au Président de la Société des Amis de Berlioz (M. Charbonnel), 9 mai 1941; 2 pages (voir l’image de cette lettre ci-dessous).
Montaigu-de-Quercy, le 9 mai 1941
Monsieur le Président,
Je me demande comment vous avez pu vous procurer mon adresse actuelle, inconnue de presque tous mes amis : mais le libellé m’en donne à penser qu’elle est dûe à la Chancellerie du Ministère de la Justice, où mon nom est habituellement maltraité de telle façon qu’il ne paraît pas conforme à celui de mon père, ni à l’état-civil.
Je porte, — il me semble avoir eu déjà l’occasion de vous l’écrire il y a quelques années, — le plus vif intérêt à la Société des « Amis de Berlioz », au Musée de La Côte-Saint-André, et j’ose dire que pour être, par suite des circonstances de ma vie, moins actif et moins effectif, le culte pour le Maître, que j’ai hérité de mon père, n’est pas moins profond que le sien. Mais je ne réside ici qu’en « réfugié ». Le 14 juin dernier [1940], pour obéir, d’une part, à un « ordre de repli » m’enjoignant de rejoindre le Blanc (où je n’ai pu parvenir), et, d’autre part, pour mettre à l’abri ma femme et mes trois plus jeunes enfants (l’aîné nous avait quittés [sic], depuis trois jours, appelé par la conscription), j’ai dû fuir vers le Sud, et, après une randonnée de huit jours en auto, conduits par un enfant de 18 ans qui n’avait jamais tenu un volant sur plus de 200 mètres pendant laquelle nous avons été visiblement protégés par la Providence, nous avons échoué ici et n’en avons plus bougé, l’envahisseur ne nous ayant pas encore autorisés à retourner à Mirecourt, « zône interdite ».
Il m’est cependant permis de penser que j’y reviendrai, — tout au moins pour déménager, — et que je rentrerai en possession et de mon appartement, — qui n’a, paraît-il, jamais été occupé ni atteint par les bombardements, — et de ce qu’il contient qui, m’assure-t-on, est à peu près intact, pour l’instant. Ce jour-là seulement, il me sera possible de vous envoyer deux photographies de mon père, format 18 x 24, que j’ai faites moi-même et entre lesquelles vous choisirez. Mais en attendant, je vis ici dans un quasi-dénuement de toutes choses et suis dépossédé de tout ce qui fait l’intérêt de ma vie : mes bibliothèques, mes archives, mes collections de toutes sortes.
Je profite de l’occasion que me donne cette lettre pour vous rappeler, Monsieur le Président, ce que déjà je vous proposais dans une lettre il y a quelques années. J’ai l’intention de donner aux « Amis de Berlioz » une certaine quantité de documents concernant l’activité de mon père en faveur de la gloire de Berlioz, tels que, par exemple, ceux qui ont trait à l’exécution de certaines œuvres et à l’érection de la statue de Paris. Ils sont le témoignage assez douloureux, souvent, de la sorte d’hostilité latente qui, même chez les admirateurs les plus officiels du Maître, a si longtemps fait échec à une gloire qui éteignait la leur… Ces souvenirs, ces papiers, je comptais en faire un tri, les classer : une vie continuellement contrariée, aujourd’hui mon âge, ma santé même, ne me le permettront sans doute pas ; ce sera le travail d’un « ami » plus jeune, et matériellement plus indépendant que moi, — si du moins, comme je l’espère, ma proposition est acceptée.
Je compte aussi donner à la Bibliothèque de la Société ceux des livres concernant Berlioz, les partitions d’orchestre ou autres du Maître que je possède et qui pourraient lui faire défaut. Pour m’aider dans ce choix, le plus simple serait, me semble-t-il, de m’envoyer une liste de ces divers ouvrages manquants, que le bibliothécaire, sans doute, serait à même de dresser.
Pour terminer, Monsieur le Président, il me reste à vous remercier de l’intérêt que M. Henri Chapot et vous portez au rôle, tout de dévouement enthousiaste et désintéressé, qu’a joué mon père, pour la gloire de Berlioz, dont il a été, chronologiquement et sans conteste, le premier champion. La brochure qu’il a écrite, dans le feu de son admiration, — et qui a été suivie de maint article — date de 1870. On chercherait vainement une autre apologie de l’auteur des « Troyens » qui lui fût antérieure. Je crois que la collection complète des écrits — tous relatifs à Berlioz — du Comte de Massougnes des Fontaines, doit se trouver dans le fonds que je destine à La Côte-Saint-André, y compris la correspondance avec Colonne, avec Félix Mottl et bien d’autres.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de mes sentiments les plus distingués
Cte de Massougnes des Fontaines
![]()
Nous remercions bien vivement le Musée Hector-Berlioz de nous avoir fourni toutes les images ci-dessous et de nous avoir donné la permission de les reproduire ici.
|
|
Pour la transcription de ce texte voir ci-dessus. La première page du programme est reproduite sur la page sur Felix Mottl.
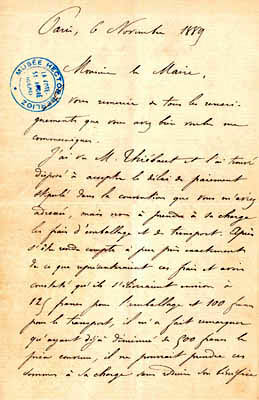
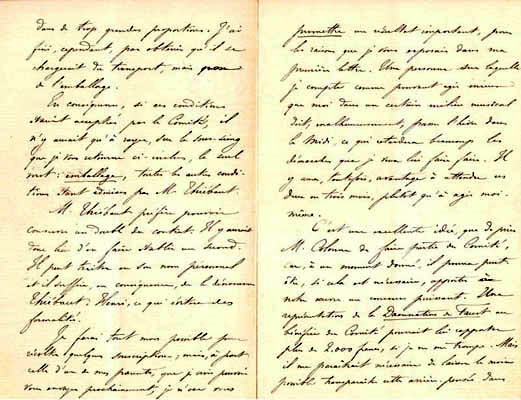

Pour la transcription de cette lettre, voir ci-dessus (la fin de la lettre manque)
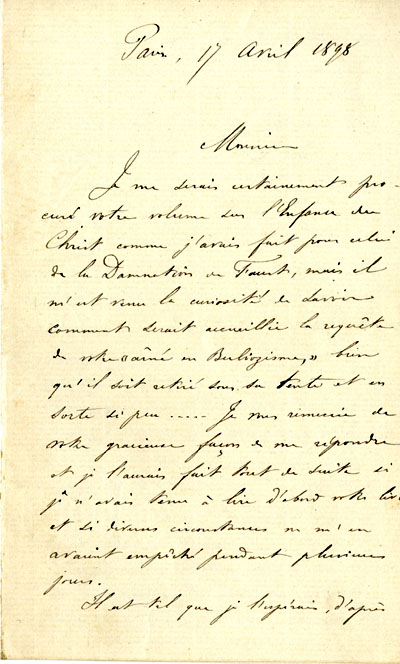
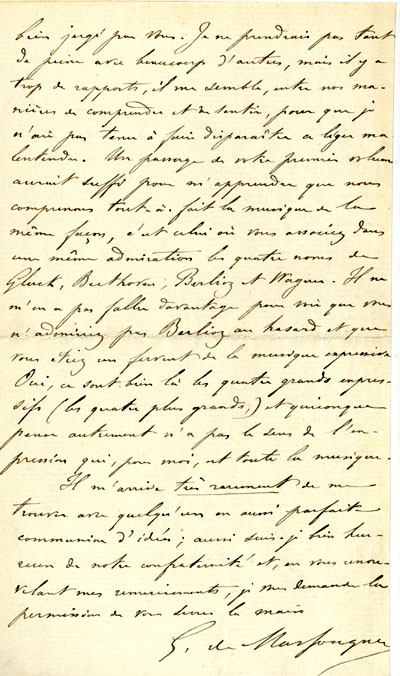
Pour la transcription de cette lettre, voir ci-dessus

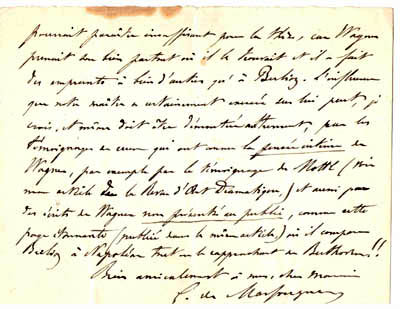
Pour la transcription de cette lettre, voir ci-dessus (le début de la lettre manque)
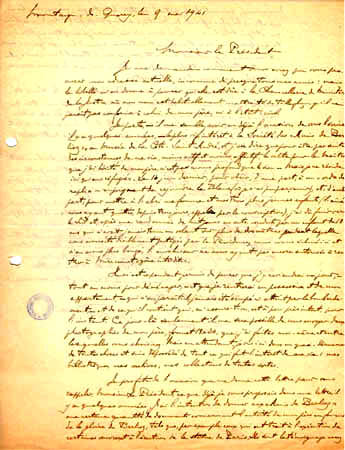
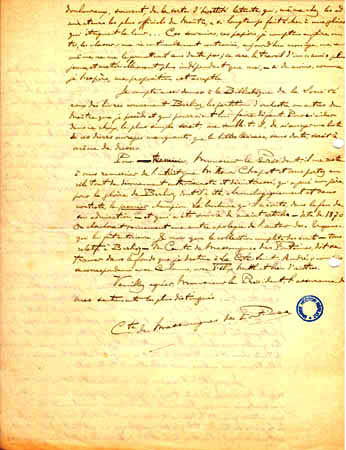
Pour la transcription de cette lettre, voir ci-dessus
![]()
Site Hector Berlioz crée par Monir
Tayeb et Michel Austin le 18 juillet 1997;
Page Berlioz: Pionniers et
Partisans créée le 15 mars 2012; cette page créée le
1er octobre 2013, mise à jour le 1er mai 2018.
© Michel Austin et Monir Tayeb. Tous droits de reproduction réservés.
![]() Retour à Berlioz: Pionniers et Partisans
Retour à Berlioz: Pionniers et Partisans
![]() Retour à la Page d’accueil
Retour à la Page d’accueil