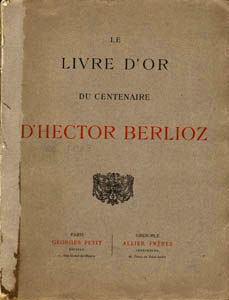
CONFÉRENCE
Faite aux fêtes du Centenaire de Berlioz, à Grenoble, le 17 août 1903
PAR M. JULIEN TIERSOT

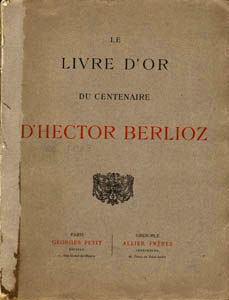 |
CONFÉRENCEFaite aux fêtes du Centenaire de Berlioz, à Grenoble, le 17 août 1903
PAR M. JULIEN TIERSOT |
 |
Cette page reproduit le texte de la conférence faite par Julien Tiersot à Grenoble en 1903, et repris par la suite dans Le Livre d’Or du Centenaire d’Hector Berlioz (pages 189-195), publié vers 1906, dont un exemplaire est dans notre collection. On a conservé la syntaxe et l’orthographe de l’original.
![]()
M. Ernest Reyer disait hier, en terminant son discours :
« Bonn a la statue de Beethoven. » Ce glorieux souvenir était chose naturelle, et ce n’est pas d’aujourd’hui qu’on a rapproché Beethoven et Berlioz. « On mettra peut-être plus de temps à glorifier Berlioz qu’on n’en a mis à glorifier Beethoven, mais on le glorifiera pourtant. » Ainsi parlait ce même Reyer au lendemain de la mort du maître, dont il fut l’ami fidèle, ayant, au milieu du deuil et des larmes, la vision bien nette de l’apothéose future. Longtemps auparavant Paganini, en lui offrant ce don magnifique qui lui permit de continuer à se consacrer à l’art, l’accompagnait de ces paroles : « Beethoven étant mort, il n’y a que Berlioz qui ait su le faire revivre. » Liszt, un jour, témoin de son émotion pendant qu’il lui entendait exécuter la sonate en ut dièze mineur, disait, en le désignant : « Voyez, il l’écoute en héritier présomptif. » Schumann, dès 1835, dans un article d’une admirable compréhension, analysa la Symphonie fantastique dans le même esprit qu’il eût mis à étudier l’Héroïque ou la Neuvième. Et Berlioz lui-même eut conscience de cette filiation, car Fétis a rapporté ce mot qu’il lui dit pendant les rares instants où ils se firent des confidences : « J’ai repris la musique au point où Beethoven l’a laissée. »
Glorieux héritage, Messieurs, et que nous devons être fiers d’avoir vu recueillir par un musicien français. Combien significatif est cet hommage rendu à Berlioz par des maîtres de la musique allemande, si justement jaloux de la supériorité du génie de leur race, mais trop souvent disposés, il faut bien l’avouer, à ne reconnaître aux Français d’autre mérite que celui d’avoir su cultiver avec succès le genre aimable. Certes, il serait injuste et maladroit de dédaigner ces succès, que l’on a peut-être une tendance excessive à déprécier aujourd’hui parmi nous. Conservons nos qualités natives de vivacité, de bonne grâce et d’esprit ; gardons-nous pourtant d’en exagérer l’importance au point de laisser croire que nous ne pouvons pas faire mieux, qu’il faut nous résigner à en rester là. C’est calomnier notre génie national que de lui refuser le mérite de s’élever au-dessus des manifestations d’un art charmant, mais futile. Nous aussi, nous sommes capables de puissance, de grandeur, de passion vibrante et profonde. En matiere de philosophie, de littérature et d’arts plastiques, assez de maîtres de génie nous en ont apporté la preuve : en matière musicale, cette preuve serait fournie surabondamment, dût-on ne citer qu’un nom seul, par 1’œuvre magnifique d’Hector Berlioz.
Français, personne, assurément, ne le fut davantage, quelles que puissent être les apparences, car, de notre génie national, il représente ce qu’il y a de meilleur. Il s’est manifestement trompé sur son propre compte le jour où il s’est qualifié lui-même « musicien aux trois quarts allemand ». Pourquoi donc serait-il Allemand ? Est-ce parce qu’il a écrit des symphonies ? Mais en quoi cette admirable forme de la symphonie est-elle le monopole exclusif de l’Allemagne ? Si Beethoven l’a portée à son apogée, plus d’un musicien français l’avait connue et pratiquée dès avant lui. Il leur avait manque le génie pour remplir dignement un cadre si grandiose. Mais Berlioz est venu, et il a montré, lui, que l’œuvre d’un Français était capable non seulement de tenir en ce cadre, mais encore de l’agrandir.
Oui, par sa nature, par sa tournure d’esprit, par son inspiration, Berlioz est Français : un Français du Midi, un Latin. Il l’est puisqu’il est Dauphinois ! Il est le digne fils de cette province qui a produit tant d’esprits supérieurs, — hommes d’action et hommes de pensée, hommes résolus, laborieux et forts, — des vaillants et des précurseurs. Il fut un héros dans son genre. Né au pays de Bayard, il fut l’artiste sans peur et sans reproche, luttant la vie entière pour le bon combat, âpre et rude, plein de périls et d’embûches, mais, malgré toutes les désillusions, ne renonçant jamais à sa foi. Il succomba, lui aussi, sur le champ de bataille, à une heure où l’action était encore indécise et semblait devoir s’achever en défaite : mais sa mort fut le signal de la victoire, et la postérité acclame le héros triomphant.
Si Berlioz fut grand, ce n’est pas seulement parce qu’il fut l’homme de son pays, c’est aussi qu’il fut l’homme de son temps. Il représente, dans 1’histoire de la musique, la génération de 1830, et cette époque, quoi qu’on en puisse penser, reste une des plus admirables que la France ait connue au point de vue de la production de la littérature et des arts. Les goûts de ce temps-là ne sont plus guère les nôtres ; les modes ont changé, et nous sourions volontiers de ce qui paraissait alors passionnant ou terrible. « Les cœurs enthousiastes auraient voulu des amours dramatiques, avec gondoles, masques noirs et grandes dames évanouies dans des chaises à porteurs au milieu des Calabres….. » C’est en ces termes, un peu ironiques, que Gustave Flaubert évoquait les souvenirs des impressions de son enfance. Mais il ajoutait : « On n’était pas seulement troubadour, insurrectionnel ou oriental, on était avant tout artiste. Quelle haine de toute platitude ! Quel élans vers la grandeur ! Quel respect des maîtres ! Comme on admirait Victor Hugo ! »
Ces belles ardeurs sont un des beaux côtés du romantisme, en même temps qu’un des traits qui distinguent cette époque de la nôtre, où règne le scepticisme, — et je ne sais trop si la comparaison est à notre avantage. Mais aussi quelles nobles causes d’enthousiasmes avaient les hommes de temps-là ! Queue pléiade incomparable de génies avait produite cette période de 1830 ! Hugo, Lamartine, Balzac, Musset, Georges Sand, Dumas, Delacroix, David d’Angers, pour ne parler que des plus illustres.
En leur compagnie glorieuse se place Hector Berlioz. Comme eux tous, il voyait grand. Il avait l’accent convaincu, entraînant, passionné. En lui, tout est puissance et tout est sincérité.
II y avait dans son âme quelque chose de l’âme populaire française. Vous l’auriez aperçu clairement s’il nous avait été possible de faire entendre à l’inauguration de sa statue ce chant triomphal qu’il composa en mémoire des héros de juillet. Il est vivement regrettable que les rigueurs du ciel en aient interdit l’exécution : il aurait été beau, avions-nous cru, de saluer la statue de Berlioz par le chant composé par lui-même pour les hommes de 1830, de faire entonner ce chant par ces masses populaires dont il aimait tant l’effet musical, et qui, ici, eussent mis tout leur cœur à l’accomplissement de cette tâche, car c’étaient les voix des enfants du Dauphiné chantant en l’honneur de leur génial compatriote.
Dans cette Symphonie funèbre et triomphale, la moins connue aujourd’hui peut-être des œuvres de Berlioz, et qui, en tant qu’œuvre d’art pur, a peut-être le tort de dater un peu trop, la forme magistrale de la symphonie s’unit à l’accent de l’épopée militaire. Quelques-uns peut-être l’eussent trouvé banal, ce motif empanaché, au rythme fier de marche guerrière, et seraient tentés de lui dénier les qualités nécessaires pour entrer dans la noble forme de la symphonie. Mais n’est-ce pas, au contraire, en remontant aux sources de l’inspiration populaire que notre art a le plus de chances de se revivifier ? Parfois les étrangers ont le sentiment plus juste que nous-mêmes de ce qui constitue l’originalité de notre nature, et des inspirations qui nous semblent trop familières leur apparaissent au contraire comme contenant la quintessence de notre génie national.
C’est ainsi que Wagner, le digne et puissant rival de Berlioz, en a bien jugé lorsqu’il a déclaré tenir cette symphonie de juillet pour une des plus belles œuvres de son auteur. « C’est, a-t-il-dit, une composition populaire au sens le plus idéal du mot. Un sublime enthousiasme patriotique, qui s’élève du ton de la déploration aux plus hauts sommets de l’apothéose, garde cette œuvre de toute exaltation malsaine. » Et l’auteur des Maîtres Chanteurs achève son éloge en exprimant « la conviction que cette symphonie durera et exaltera les courages tant que durera une nation portant le nom de France ». Ne croyez pas, Messieurs, que cet hommage soit méprisable, et que ce soit rabaisser l’œuvre d’art que de l’employer à exprimer le sentiment populaire. C’est le contraire qui est verité, et c’est un titre de Berlioz à notre admiration que de l’avoir si bien compris.
S’il n’a pas été possible de faire entendre cette œuvre dans son cadre et par ses interprètes naturels, du moins vient-il de vous être donné, par ces deux magnifiques concerts à l’exécution desquels ont présidé trois maîtres éminents, d’avoir un résumé fidèle et presque complet de l’œuvre de Berlioz.
Seule sa production théâtrale a dû être écartée des programmes, et c’est bien naturel, car les œuvres de théâtre ont leur place marquée au théâtre, non ailleurs. L’on n’a donc rien pu vous faire entendre, notamment, de ses admirables Troyens, l’œuvre de sa vie entière, dans laquelle, écrivant au seuil de la vieillesse, il a condensé les impressions virgiliennes ressenties dès l’enfance au pays natal, sur les collines et dans les prairies de La Côte-Saint-André, impressions ravivées plus tard par celles qu’il retrouva ici près, à Meylan, quand, en un pélerinage d’amour dont ses Mémoires ont laissé un récit d’un accent si ému, il évoqua les souvenirs de son idylle tendrement poétique de la douzième année. Si rien n’a pu vous être donné de cette œuvre, par laquelle son génie semble s’être rassénéré, du moins le duo de Béatrice et Bénédict, que viennent de vous faire entendre deux artistes dont vous avez bien su apprécier le haut mérite, vous a donné l’idée de cette pureté d’inspiration et de cette ravissante poésie qui caractérise la musique de sa dernière période de production.
Pour la même raison, — à savoir que toute chose doit rester dans son cadre, — vous n’avez rien entendu de sa musique religieuse, ni le superbe Te Deum, ni cet apocalyptique Requiem qu’il regardait comme son œuvre la plus puissante : encore l’occasion fut-elle bonne, pour une des meilleures sociétés chorales qu’aient attirées à Grenoble les fêtes de ces derniers jours, d’en faire entendre à la cathédrale un morceau pour chœur à voix mixtes.
Enfin les circonstances n’ont pas permis non plus, — car il était bien impossible de comprendre tout l’œuvre de Berlioz en deux programmes, — d’inscrire parmi les ouvrages exécutés à ce Centenaire l’Enfance du Christ, ce ravissant mystère où le génie fougueux du maître, capable de toutes les audaces, s’adoucit pour retrouver l’accent naïf et pur de l’inspiration primitive.
Mais combien sont apparues puissantes, en ces deux journées, les œuvres de sa jeunesse romantique, ardentes, fiévreuses, colorées, débordantes de génie ! Ce fut, hier soir, cette splendide Damnation de Faust, l’œuvre écrite définitivement dans la maturité de sa vie, en pleine force de production, mais dont l’inspiration première coïncide avec ses premiers pas dans la carrière ; cela est si vrai que la première œuvre qu’il ait fait paraître est une série de Huit scènes de Faust, qui toutes ont repris leur place dans la partition définitive, dont elles constituent plus qu’une ébauche. Il suffit de vous reporter au programme que vous avez entre les mains pour vous redire ce détail, intéressant en ce jour et en ce lieu, que la romance du Roi de Thulé fut composée tout près d’ici, pendant un voyage en voiture que Berlioz fit en 1828 pour aller de Grenoble à La Côte-Saint-André : peut-être la vue de vos Alpes hautaines et hérissées de pointes n’a-t-elle pas été étrangère à l’inspiration, souvent analogue, de votre grand musicien.
Et Roméo et Juliette, cette œuvre qui a reculé les limites de la symphonie vers des régions qu’elle n’avait pas encore atteintes, et qu’elle n’a pas dépassées, œuvre où Shakespeare fut l’inspirateur immédiat du musicien, mais pour laquelle celui-ci n’avait qu’à chercher en lui-même pour trouver les trésors d’inspiration passionnée, les splendeurs de coloris, dont les fragments que vous venez d’entendre ont pu vous donner une si heureuse idée !
Et la symphonie d’Harold, si pittoresque, dans laquelle Berlioz a évoqué les impressions de ses courses errantes dans les campagnes italiennes !
Et ses ouvertures, celle des Francs Juges, sa première composition d’orchestre, où se manifeste déjà sa tendance à faire grand, — celle du Corsaire, inspirée par Byron, — et ce tableau si vivant du Carnaval romain, dont les thèmes sont pris à Benvenuto Cellini, la seule œuvre de Berlioz dont la réhabilitation soit encore à venir !…
Enfin, il vous reste encore à entendre, — et je me reprocherais de vous en faire attendre trop longtemps la joie, — cette fulgurante Symphonie fantastique — que dirigera un jeune maître venu ici pour apporter l’hommage de l’Allemagne au plus grand des musiciens français, — œuvre type du génie romantique, où l’exubérance de l’imagination la plus violemment déchaînée s’allie aux formes magistrales de Ia symphonie beethovénienne, et en donne parfois une impression saisissante.
Donc, conformément à la prophétie que je rapportais en commençant, le pays de Berlioz l’a honoré comme, il y a un demi-siècle, avait honoré Beethoven la ville de Bonn, où s’étaient assemblés tous les plus grands musiciens de l’Europe. Berlioz en était, bien entendu. Sa gloire est aujourd’hui universelle : l’hommage que lui ont rendu à leur tour d’éminents artistes étrangers, accourus ici en son honneur, en est une preuve qui dispenserait d’en chercher d’autres. Il nous apparaît, aujourd’hui, en haut du ciel de l’art, en la compagnie des plus illustres maîtres : tels, aux Champs-Élysées, les poètes souverains faisaient accueil à Dante qu’accompagnait Virgile.
Parfois, conformément aux antiques traditions, toujours populaires, de la triade celtique, on a associé son nom à ceux de deux compagnons : en ces groupes ternaires, c’est toujours avec les plus grands qu’il s’est trouvé placé.
Parmi les Français représentant le génie de 1830, on a voulu choisir un poète, un peintre, un musicien ; les trois sont : Victor Hugo, Eugène Delacroix, Hector Berlioz.
Il compte parmi ceux qu’on appelait en leur temps les « musiciens de l’avenir », et qui eurent si grand tort de protester contre ce titre, lequel semblait ironique autrefois, mais que l’événement a montré être singulièrement prophétique ; et parmi ces trois musiciens, de génies divers, mais qui se rapprochaient par le fait qu’ils marchaient à la conquéte d’un idéal réputé inaccessible, il fut le plus ancien, celui qui fraya le premier la voie nouvelle. Leurs noms à tous trois sont illustres aujourd’hui ; ce sont : Hector Berlioz, Franz Liszt, Richard Wagner.
Enfin, suivant ce jeu de l’association par trois, l’on a, de façon plus artificielle, réuni en Allemagne trois maîtres dont les noms commencent par la lettre B, et l’on a nommé Bach, Beethoven, Brahms. Les deux premiers sont les maîtres incontestés de l’art ; pour le troisième ce n’est pas, je pense, diminuer les témoignages de l’admiration qui lui est due que d’avancer, malgré tous ses mérites, qu’il n’a vraiment pas droit au même rang. C’est le nôtre qui doit reprendre ce rang ; et conservant parmi les trois B les deux premiers cités, nous proclamerons la trinité toute-puissante de Bach, Beethoven et Berlioz.
Et, pour finir, j’exprimerai un vœu. Il est bien que le Dauphiné ait rendu à son enfant l’hommage qui lui était dû. Mais je voudrais plus encore. C’est un hommage vraiment national qu’il faut offrir à Berlioz. Aussi bien ne saurait-il lui manquer, j’en ai la ferme confiance. L’année de son Centenaire n’est pas encore écoulée, et c’est au mois de décembre prochain que tombe la date exacte de sa naissance. Nul doute que Paris, après Grenoble et La Côte-Saint-André, voudra donner la consécration dernière et définitive à la glorification de Berlioz.
Paris, il est vrai, fut la première ville qui lui ait érigé une statue. Mais est-il donc malaisé de trouver pour un tel homme un nouvel hommage digne de lui ?
Sans doute, le meilleur sera l’exécution de son œuvre, et pour celui-ci nous sommes tranquilles, il ne lui manquera pas.
Mais il me souvient qu’il fut fait naguère une proposition au Parlement, dont l’adoption donnerait à la mémoire de Berlioz la consécration suprême et définitive que nous demandons pour lui. Un député, M. Dujardin-Beaumetz, estimant que le Panthéon, asile suprême de ceux qui ont été l’honneur de la France, ne doit pas être fermé aux artistes, émanations directes de son génie, avait demandé que quelques-uns d’entre eux en reçussent les honneurs ; parmi ceux-ci, il avait désigné un musicien, et c’était Berlioz.
Nous souhaitons vivement qu’une proposition si heureuse reçoive enfin la solution qu’elle mérite, et qu’au 11 décembre prochain, Centenaire du jour de naissance d’Hector Berlioz, on célèbre, en présence des pouvoirs publics, son entrée triomphale dans le temple élevé aux grands hommes par la Patrie reconnaissante.
![]()
Voyez aussi sur ce site:
Berlioz: Pionniers et
Partisans: Julien Tiersot
Berlioz et Grenoble
Berlioz à Paris: le
Panthéon
![]()
Site Hector Berlioz créé le 18 juillet 1997 par Michel Austin et Monir Tayeb; cette page créée le 1er mai 2012, mise à jour le 11 décembre 2012.
© Michel Austin et Monir Tayeb. Tous droits de reproduction réservés..
![]() Retour à la page Berlioz: Pionniers et
Partisans
Retour à la page Berlioz: Pionniers et
Partisans
![]() Retour à la page Exécutions et articles contemporains
Retour à la page Exécutions et articles contemporains
![]() Retour à la Page d’accueil
Retour à la Page d’accueil
![]() Back to Berlioz: Pioneers and Champions
Back to Berlioz: Pioneers and Champions
![]() Back to Contemporary Performances and Articles page
Back to Contemporary Performances and Articles page
![]() Back to Home Page
Back to Home Page