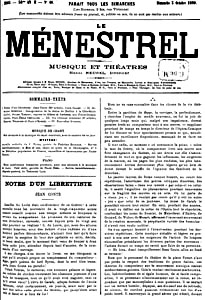
Inauguration de la statue de Berlioz à La Côte-Saint-André
par
Julien Tiersot
Le Ménestrel, 5 octobre 1890, p. 314-316
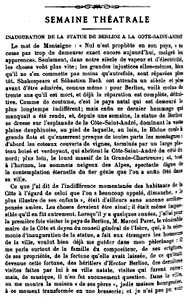
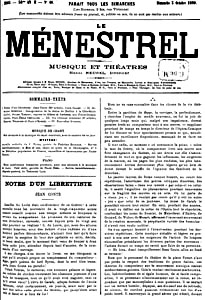 |
Inauguration de la statue de Berlioz à La Côte-Saint-Andrépar Julien TiersotLe Ménestrel, 5 octobre 1890, p. 314-316 |
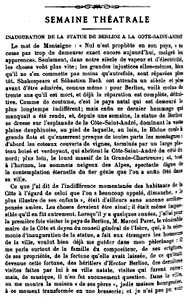 |
![]()
SEMAINE THÉATRALE
INAUGURATION DE LA STATUE DE BERLIOZ A LA COTE-SAINT-ANDRÉ
Le mot de Montaigne : « Nul n’est prophète en son pays, » ne cesse pas trop de demeurer exact encore aujourd’hui, malgré les apparences. Seulement, dans notre siècle de vapeur et d’électricité, les choses vont plus vite ; les grandes injustices elles-mêmes, bien qu’il ne s’en commette pas moins qu’autrefois, sont réparées plus tôt. Shakespeare et Sébastien Bach ont attendu un siècle et plus avant d’être admirés, connus même : pour Berlioz, voilà moins de trente ans qu’il est mort, et déjà la réparation est complète, définitive. Comme de coutume, c’est le pays natal qui est demeuré le plus longtemps indifférent ; mais enfin ce dernier hommage qui manquait a été rendu, et, depuis une semaine, la statue de Berlioz se dresse sur l’esplanade de la Côte-Saint-André, dominant la vaste plaine dauphinoise, au pied de laquelle, au loin, le Rhône coule à grands flots et qu’enserrent presque de toutes parts les montagnes : d’abord les coteaux couverts de vignes, terminés par un large plateau boisé et verdoyant, qui abritent la Côte-Saint-André du côté du nord ; plus loin, le lourd massif de la Grande-Chartreuse ; et, tout à l’horizon, les sommets neigeux des Alpes, spectacle digne de la contemplation éternelle du fier génie que l’on a enfin fêté dans sa ville.
Ce que j’ai dit de l’indifférence momentanée des habitants de la Côte à
l’égard de celui que l’on a beaucoup appelé, dimanche, « le plus
illustre de ses enfants », était d’ailleurs sans aucune arrière-pensée
amère. Les choses devaient être ainsi ; il était même impossible qu’il
en fût autrement. Lorsqu’il y a quelques années, j’allai pour la première
fois visiter le pays de Berlioz, M. Marcel Paret, le vénérable maire de la
Côte et doyen du conseil général de l’Isère, qui, à la cérémonie
d’inauguration de la statue, a fait aux étrangers les honneurs de la ville,
voulut bien déjà me guider dans mon pèlerinage : il me parla surtout de
la famille du compositeur, de ses origines, de
ses propriétés, de la fortune
qu’elle avait laissée, de ce qu’était devenue cette fortune, des héritiers
d’Hector Berlioz, des dernières visites faites par lui à sa ville natale,
visites qui furent rares ; mais, de musique, il n’en fut aucunement
question. Dans la ville, on me montra la maison « de ses pères »,
jadis maison bourgeoise, à ce moment transformée en une brasserie ; et
je n’ai pas pu voir la chambre où il est né, laquelle, servant à je ne sais quel usage idoine
à cette estimable exploitation, avait été à moitié détruite. Entre temps,
j’entendis répéter la fanfare du lieu, et ce qu’elle tentait d’exécuter ne
ressemblait aucunement à du Berlioz. Il est très clair que la musique de
l’auteur de la Damnation de Faust était, est encore complètement
inconnue de ses compatriotes, ceux-ci n’ayant aucun moyen de l’entendre, avec
les ressources musicales d’un simple chef-lieu de canton. Berlioz, dans ses Mémoires,
raconte que son père exprimait dans les dernières années de sa vie le plus
vif désir de connaître « ce terrible Tuba mirum » dont on
avait tant parlé : après cela il pourrait dire : « Nunc
dimitte servum tuum Domine »![]() ; mais il mourut avant que ce vœu eût
pu être accompli. La revanche prise de notre temps par le compositeur ne devait
donc venir en aucune façon de l’initiative de ses compatriotes : ceux-ci
ne pouvaient que suivre le mouvement venu des centres artistiques. J’imagine
même que quelques-uns doivent être un peu surpris de tant d’hommages rendus à
un homme qui, dans leur esprit, n’a rendu aucun service à son pays, puisqu’il
s’est borné à composer de la musique ; mais enfin on leur a dit que ce
musicien, parti de chez eux, y revenait grand homme : ils n’ont pas
demandé mieux que de le croire ; au fond même ils sont enchantés d’avoir
un grand homme à eux, et ils l’ont, après les autres, célébré de leur mieux.
; mais il mourut avant que ce vœu eût
pu être accompli. La revanche prise de notre temps par le compositeur ne devait
donc venir en aucune façon de l’initiative de ses compatriotes : ceux-ci
ne pouvaient que suivre le mouvement venu des centres artistiques. J’imagine
même que quelques-uns doivent être un peu surpris de tant d’hommages rendus à
un homme qui, dans leur esprit, n’a rendu aucun service à son pays, puisqu’il
s’est borné à composer de la musique ; mais enfin on leur a dit que ce
musicien, parti de chez eux, y revenait grand homme : ils n’ont pas
demandé mieux que de le croire ; au fond même ils sont enchantés d’avoir
un grand homme à eux, et ils l’ont, après les autres, célébré de leur mieux.
La cérémonie de l’inauguration de la statue d’Hector Berlioz à la Côte-Saint-André n’a ressemblé en rien à la fête similaire qui a eu lieu à Paris en 1886. Celle-ci affectait un caractère sévère, un peu triste — le temps brumeux qu’il faisait y contribuant — mais très digne, presque recueilli. Tout ce qui, à Paris, s’intéresse aux choses du grand art, était accouru pour rendre hommage à la mémoire du maître ; l’assistance se composait presque exclusivement de l’élite du monde artistique et musical. Qu’on me permette encore un souvenir : au square Vintimille, transformé pour un instant en une enceinte festivale, un assez grand nombre des meilleures places avaient été réservées, et les gardiens refusaient de les laisser occuper, assurant qu’elles étaient pour « MM. les membres du conseil municipal » ; mais il n’en vint pas un seul, et il fallut bien les abandonner aux simples mortels : la politique avait, pour une journée, entièrement cédé le pas à l’art. A la Côte, il en a été tout autrement. La cérémonie était présidée par M. Bourgeois, ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, qu’on ne saurait trop remercier, d’ailleurs, de s’être dérangé pour rendre hommage au grand musicien ; auprès de lui étaient M. Ribière, son chef de cabinet ; puis le préfet de l’Isère et ses sous-préfets ; les sénateurs et députés du département, le président du conseil général et de nombreux conseillers généraux ; des représentants de l’Université, de la magistrature, de l’armée, que sais-je encore ? Il n’y manquait que des musiciens : s’il n’était venu M. Reyer, qui ne saurait faire défaut dans une fête donnée en l’honneur du maître dont il fut un des premiers fidèles, ainsi que M. Colonne, à qui Berlioz doit une si grande part de sa gloire posthume, il ne s’en serait pas trouvé un seul à la Côte-Saint-André : je ne puis citer, après eux, que M. Salomon, l’ancien ténor de l’Opéra, venu là beaucoup plus comme Dauphinois que comme musicien (il a l’honneur, en effet, d’être le concitoyen de Berlioz). De compositeur, en dehors de l’auteur de Sigurd, pas un seul. Peut-être, après tout, les organisateurs de la fête de la Côte n’ont-ils pas cherché à en attirer beaucoup. Je me trompe, cependant, en disant que la musique n’était pas suffisamment représentée : elle l’était, au contraire, surabondamment, et ce par vingt-huit fanfares venues de tous les coins du pays, lesquelles, à un moment donné, se sont mises à jouer toutes à la fois.
Au reste, fête populaire très gaie et très animée. Il faisait un tenps splendide ; des arcs de triomphe s’élevaient à toutes les entrées de la ville ; les maisons étaient pavoisées, ornées de fleurs et de branchages ; toute la population et celle des pays environnants, étaient sur pied ; l’on se réjouissait de saluer le ministre, d’admirer son escorte de hussards et de gendarmes à cheval ; l’on a joué la Marseillaise, tant et plus ; et, quand toutes les autorités eurent pris place sur l’estrade, M. Bornais ne manqua pas de dire quelques phrases bien senties sur le spectacle imposant que présentaient les vingt-huit fanfares rangées autour de la statue, et de prononcer de sages réflexions sur la puissance du génie, qui finit toujours par triompher de la routine. — Mais pardon : je me croyais au comice agricole de Madame Bovary, et j’oubliais que nous étions en Dauphiné, et non dans la belle Normandie. La vue des Alpes aurait dû suffire à m’y faire penser.
Je n’ai pas à parler de la statue, qui n’est qu’une répétition de celle de la place Vintimille, à Paris, œuvre de M. Lenoir : elle est suffisamment connue et appréciée pour qu’il ne soit pas nécessaire de la décrire à nouveau.
Deux discours seulement ont été prononcés, ce qui est très bien. M. le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts a parlé le premier, et il a dit des choses excellentes : que « Berlioz est grand entre les plus grands ; nul n’a participé avec plus d’invention et de courage à ce grand mouvement de la pensée romantique par lequel notre siècle a marqué sa place originale dans le développement du génie national » ; qu’il a fait pour la musique « ce que Victor Hugo a fait pour la poésie, Delacroix pour la peinture, Rude et Barye pour la statuaire » ; que « plus que personne il a éprouvé ce que la légèreté et la routine des contemporains peuvent réserver de déboires aux génies créateurs » ; mais qu’aujourd’hui était achevée « la grande œuvre de justice et de réparation que notre temps a entreprise envers les grands hommes qui ont honoré ce siècle en ouvrant des voies nouvelles dans le domaine de la pensée et de l’art. » « Pour moi, a-t-il dit en terminant, en répondant à votre appel, j’ai voulu publiquement attester ce sentiment d’admiration universelle qui fait de la mémoire de Berlioz une gloire nationale ; j’ai voulu aussi saluer au nom de tous cette vaillante école française dont il fut le chef et dont les maîtres contemporains ont voulu mettre au service de votre œuvre, aujourd’hui réalisée, leur nom, leur illustration et leur dévoué concours. Au nom du gouvernement de la République, je vous félicite et je vous remercie. »
M. Ernest Reyer lui a succédé. Fidèle dans les bons comme dans les mauvais jours, il s’est toujours trouvé présent chaque fois que l’occasion est venue de manifester en faveur de son maître. Discours, articles, concerts ou festivals, il n’a rien négligé de ce qui pouvait assurer son triomphe. Je ne relis jamais sans émotion les lignes qu’il écrivit au lendemain de la mort de Berlioz, avec une douleur si sincère, si profonde, si communicative. Qui s’étonnerait de voir, sinon de tels sentiments s’émousser avec le temps, du moins leur expression s’atténuer en une certaine mesure ? Ce que M. Reyer était presque seul à écrire il y a trente ans, tout le monde l’a répété depuis : le redire encore est aujourd’hui manquer d’originalité ; mais peu importe, l’intention étant toujours excellente. Cela est pour dire que M. Reyer, dans son dernier discours, n’a guère fait que répéter ce qu’il avait déjà dit dans celui de la place Vintimille, dans son article nécrologique et dans nombre de feuilletons du Journal des Débats ; mais il eût été tout à fait inutile d’en agir autrement, car si, pas plus que M. Bourgeois dans les fragments ci-dessus cités, M. Reyer n’a rien appris à ceux qui sont familiers avec l’œuvre de Berlioz ou qui ont seulement lu ses Mémoires, ce qu’il a dit a paru être parfaitement inconnu et nouveau pour le public qui l’écoutait. Il s’est donc borné à raconter la vie du compositeur, en résumant ses Mémoires presque chapitre par chapitre. Le lieu était des plus favorables pour évoquer les souvenirs de sa jeunesse, que M. Reyer a rappelés ainsi :
Berlioz aimait sa ville natale et a parlé en vrai poète des sites ravissants qui avoisinent cette délicieuse vallée de l’Isère et où, tout enfant, une vision lui était apparue qu’il n’oublia jamais. C’est vers ce pays où était éclos son premier rêve que ses secrètes pensées et les battements de son cœur le ramenèrent sans cesse, comme s’il trouvait dans ce souvenir plus d’orgueil à ses triomphes, moins d’amertume à ses douleurs.
Il a apprécié ainsi qu’il suit le caractère de son génie :
Ce n’est pas de Berlioz qu’on peut dire : Il n’est jamais grand dans les petites choses, mais il est, en revanche, toujours petit dans les grandes. La puissance de ses inspirations a plus d’une fois fait éclater le moule où il prétendait les enfermer. Une simple mélodie de quelques mesures, la Captive, devient tout un poème par le développement qu’il donne à la pensée première, par l’adjonction de l’orchestre à la voix ; les Troyens, si soigneusement minutés par lui, trompent ses calculs en arrivant à la scène et prennent les dimensions de deux grands opéras.
Je regrette seulement de trouver, tout au début du discours, une phrase où il est question d’un pays où Berlioz a trouvé ses premiers succès, « mais où son patriotisme aussi bien que sa dignité, j’en ai la conviction intime, lui défendraient d’aller les chercher aujourd’hui », car j’ai pour ma part une autre « conviction intime », à savoir que le patriotisme n’a rien à faire dans l’estime accordée ou refusée aux œuvres d’art : j’espère que M. Reyer en conviendra le jour où Sigurd et Salammbô reviendront à leur tour d’Allemagne couverts d’applaudissements, ce qui ne saurait tarder. S’il tenait absolument à un effet de ce genre, il n’avait qu’à rappeler que Berlioz avait obtenu de son vivant de grands succès en Russie, ce qui n’aurait pas été accueilli avec de moindres transports d’enthousiasme.
M. Reyer a terminé en répétant sa phrase finale du discours de la place Vintimille, ne pensant pas, sans doute, qu’il lui fût possible d’en trouver une plus belle : « Honneur à Berlioz, à l’un des plus illustres compositeurs de tous les temps, au plus extraordinaire peut-être qui ait jamais existé. » Cette péroraison de l’éminent maître français a été couverte de longs applaudissements.
Entre temps, M. Salomon a lu une pièce de vers composée par un poète de la Côte Saint-André en l’honneur de son grand compatriote ; puis la Philharmonique de Vienne [en Isère] (musique d’honneur) a joué la Marche troyenne et les Francs-Juges de Berlioz, qui furent écoutées un peu distraitement ; enfin on alla banqueter, sous la présidence de l’honorable M. Bourgeois. De nombreux toasts furent prononcés au dessert : à M. Carnot, au ministre, au Dauphiné, à l’art français, à l’armée, à la revanche ; on a même bu à la mémoire de Berlioz : c’est M. Reyer qui a eu cette idée étonnante !
J’allais oublier de parler des distinctions honorifiques qui furent conférées à diverses personnes au cours de cette imposante cérémonie : On a distribué cinq palmes académiques, dont une au président de la Philharmonique de Vienne (les autres étrangères à la musique, naturellement) ; on a même décerné une décoration du Mérite agricole. L’on m’en voudrait de ne pas faire connaître aux futurs historiens de la musique le nom de l’estimable titulaire de cette distinction : C’est M. Mouton, horticulteur à Vienne.
Pendant ce temps les vingt-huit fanfares défilaient dans les rues, bannières déployées, puis chacune d’elles allait prendre possession de l’emplacement désigné d’avance pour y donner son concert : il y en avait sur tous les carrefours de la ville, où, tout le jour durant, l’on a exécuté du Joly, du Moulin, du Blémant, du Seymat, du Rigollier, du Comberousse, etc., en l’honneur de Berlioz.
Et le soir il y a eu un grand feu d’artifice dont la pièce principale représentait… Berlioz lui-même, debout et accoudé devant son pupitre, dans l’attitude que lui a donnée le statuaire.
Berlioz en feu d’artifice ! Quel rêve !!…
Mais, si les feux d’artifice passent, la statue reste : c’est ce qui vaut le mieux de tout.
JULIEN TIERSOT.
![]()
* Le texte exact de ces deux citations des Mémoires est : « ce terrible Dies iræ » et « Nunc dimittis servum tuum Domine. »
Voyez aussi sur ce site:
Berlioz: Pionniers et
Partisans: Julien Tiersot
Le square Berlioz
(anciennement Square Vintimille)
Une lettre autographe d’Édouard Colonne au Maire de La Côte Saint-André (20
juillet 1890)
Inauguration de la
statue de Berlioz (28 septembre 1890)
Ernest
Reyer
Ernest Reyer et Berlioz
![]()
Site Hector Berlioz créé le 18 juillet 1997 par Michel Austin et Monir Tayeb; cette page créée le 11 décembre 2012.
© Michel Austin et Monir Tayeb. Tous droits de reproduction réservés..
![]() Retour à la page Berlioz: Pionniers et
Partisans
Retour à la page Berlioz: Pionniers et
Partisans
![]() Retour à la page Exécutions et articles contemporains
Retour à la page Exécutions et articles contemporains
![]() Retour à la Page d’accueil
Retour à la Page d’accueil
![]() Back to Berlioz: Pioneers and Champions
Back to Berlioz: Pioneers and Champions
![]() Back to Contemporary Performances and Articles page
Back to Contemporary Performances and Articles page
![]() Back to Home Page
Back to Home Page