19. Chapitre IV. Berlioz directeur de concerts symphoniques
Cette page présente les 16 articles publiés par Julien Tiersot dans la série Berlioziana avec le sous-titre “Berlioz directeur de concerts symphoniques ”. Voir la page principale Julien Tiersot: Berlioziana.
Note: pour les lettres de Berlioz citées par Tiersot on a ajouté entre crochets des renvois au numérotage de la Correspondance Générale, par exemple [CG no. 48].
| Le Ménestrel, 16
Octobre
1909
Le Ménestrel, 13 Novembre 1909 Le Ménestrel, 27 Novembre 1909 Le Ménestrel, 11 Décembre 1909 |
Le Ménestrel, 15 Janvier 1910 |
![]()
![]() Le Ménestrel, 16
Octobre
1909, p. 332-333
Le Ménestrel, 16
Octobre
1909, p. 332-333
BERLIOZIANA (1)
![]()
CHAPITRE IV
BERLIOZ
DIRECTEUR DE CONCERTS SYMPHONIQUES
Les carrières d’artistes offrent autant de diversité que sont divers les individus. Parmi les compositeurs de musique, les uns — privilégiés de la vie ! — n’ont d’autre peine que celle de la production (une joie bien plutôt), et, l’œuvre créée, trouvent dans les institutions établies, théâtres ou concerts, toutes les ressources qu’il faut pour la présenter au public. D’autres, joignant au génie d’invention les talents de virtuose, sont leurs propres interprètes, en même temps que ceux des maîtres. Certains sont organistes, maîtres de chapelle, directeurs de théâtres, ou professeurs, écrivains, — sans parler de ceux dont l’activité multiple vient s’étendre sur des domaines étrangers à l’art : les maîtres russes, les uns généraux, d’autres savants ; Gluck, rétablissant sa fortune à vendre des pierres fines ; Philidor, joueur d’échecs ; Verdi, sénateur ; Liszt, abbé.
Berlioz n’était pas des premiers. Il fut de ceux, au contraire, dont la vie fut le plus multiple en ses manifestations. Compositeur génial, mais travaillant pour l’avenir, il fut connu de ses contemporains sous les aspects différents de journaliste, chef d’orchestre, auteur de livres de technique et de critique musicale, ancien apprenti médecin, voire bibliothécaire !
Nous voudrions consacrer ce chapitre à étudier Berlioz comme directeur de concerts symphoniques, le prenant uniquement pour tel, indépendamment de sa production, comme si la conduite de l’orchestre et l’organisation des entreprises musicales eussent été le principal objet de son effort d’artiste. Bien d’autres s’en fussent tenus là et en auraient rempli toute une carrière.
Aussi bien, s’il n’est pas douteux que le but essentiel du Berlioz directeur de concerts fut de faire connaître les œuvres du Berlioz compositeur, ce ne fut point un but exclusif. Nous verrons bientôt l’auteur de la Damnation de Faust, dans son ardeur à faire l’éducation d’un public rebelle au grand style, inscrire sur ses programmes les chefs-d’œuvre de Beethoven, Gluck, Palestrina, rappeler aux générations nouvelles la mémoire de ses maîtres tombés dans l’oubli, Lesueur, Spontini, et donner des premières auditions d’œuvres contemporaines. Un moment, il prendra la direction d’une institution musicale dont le programme comprenait l’exécution de la musique des jeunes compositeurs.
Les dates entre lesquelles se place cette partie de sa mission d’art sont elles-mêmes significatives. Il donne son premier concert au Conservatoire en 1828, c’est-à-dire dans la saison même où, sous l’impulsion d’Habeneck, la Société des concerts venait de se constituer pour révéler à un public encore restreint les chefs-d’œuvre de la symphonie allemande. Il continue jusque vers 1860, c’est-à-dire au moment où, arrivant à point pour profiter de son expérience et de ses efforts, Pasdeloup fondait les Concerts populaires et réalisait l’œuvre durable dont il avait, pendant trente ans et plus, vainement poursuivi la création.
C’est donc, à proprement parler, un chapitre, et non le moins important, de l’histoire des concerts en France que nous allons tracer ici.
La documentation nous en sera fournie surtout par les écrits publics : annonces et articles de journaux, programmes (dont la Bibliothèque du Conservatoire possède plusieurs originaux), et, en outre, par les récits de Berlioz dans ses Mémoires et dans ses lettres. Nous aurons à y ajouter plusieurs particularités inédites, venant d’une source qui nous est précieuse : ce sont des notes manuscrites provenant de Berlioz lui-même, et par lesquelles nous pourrons, s’il est permis d’ainsi parler, lui voir faire sa cuisine de chef d’orchestre et directeur de concerts. La plupart ont été retrouvées parmi les papiers qu’il a laissés à la Bibliothèque du Conservatoire ; d’autres sont restées dans sa famille, et m’ont été obligeamment communiquées par elle ; ni les unes ni les autres n’ont été encore utilisées.
A vrai dire, Berlioz l’avait dans le sang, l’organisation des concerts de musique instrumentale ! Le premier document direct que nous connaissions de son enfance nous le montre à l’œuvre : élève du séminaire de La Côte Saint-André, il écrit à un camarade d’apporter sa clarinette pour faire sa partie dans la bande musicale qui doit accompagner la procession (2) : c’est ainsi qu’il prélude aux grandes exécutions auxquelles il devait présider plus tard, quand, par exemple, il traversa les rues de Paris à la tête d’un cortège officiel, en faisant exécuter par la musique de la Garde nationale sa Symphonie funèbre et triomphale. Nous avons aussi montré que le petit mouvement musical qui anima pendant quelque temps la société de sa ville natale (exécutions de musique de chambre, organisation d’un enseignement musical) est exclusivement contemporain du premier éveil de son activité, et que, lui parti, c’en fut fini pour tout le monde (3) : c’est donc qu’il en était l’âme, le véritable organisateur.
Le voici à Paris. Tout d’abord, au cours de ses études, il ne pense qu’à s’entendre et se faire entendre, et, pour ce but, il s’agite prématurément. Mais que de bonnes leçons d’expérience il reçoit, et comme il sait bien en profiter ! C’est, pour commencer, la lecture de sa messe solennelle à Saint-Roch, pour l’exécution de laquelle il avait compté sur la complaisance d’un orchestre nombreux : il apprend dès le premier jour qu’il ne faut pas tant compter sur la complaisance des gens, et, en même temps, qu’un matériel de parties correctes est indispensable pour assurer une bonne exécution orchestrale. L’expérience n’est pas perdue ; dès le lendemain il se préoccupe de trouver les fonds nécessaires pour payer son orchestre, et il prend la peine de recopier de sa main toutes les parties (4). L’exécution a lieu enfin, le 10 juillet 1825, date où fut entendue pour la première fois publiquement une œuvre de Berlioz : il a à ce moment vingt et un ans et demi. Trop novice, il n’ose pas conduire, et confie le bâton à Valentino ; il a raison, car il manque de sang-froid, et sait si peu maîtriser son émotion que le chef d’orchestre est obligé de lui dire à la fin d’un morceau : « Mou ami, tâchez de vous tenir tranquille si vous ne voulez pas me faire perdre la tête. » Au moins a-t-il voulu se charger lui-même de la partie de tam-tam, et à l’évocation du Jugement dernier, « il en applique un coup si formidable que toute l’église en a tremblé ! » (5).
Il fait ses débuts de chef d’orchestre deux ans plus tard en dirigeant la même œuvre à Saint-Eustache, pour la fête de sainte Cécile (novembre 1827). Il nous a fait part lui-même, dans ses Mémoires et dans une lettre intime, des impressions que lui a laissées cette première expérience : « A part quelques inadvertances causées par l’émotion, je m’en tirai assez bien. Que j’étais loin pourtant de posséder les mille qualités de précision, de souplesse, de chaleur, de sensibilité et de sang-froid, unies à un instinct indéfinissable, qui constituent le talent du vrai chef d’orchestre ! et qu’il m’a fallu de temps, d’exercices et de réflexions pour en acquérir quelques-unes ! » (6). A son ami, au lendemain de la fête, il écrit : « J’avais assez bien conservé mon sang-froid, et il était important de ne pas me troubler. Je conduisais l’orchestre ; mais quand j’ai vu ce tableau du Jugement dernier, cette annonce chantée par six basses-tailles à l’unisson, ce terrible clangor tubarum, ces cris d’effroi de la multitude représentée par le chœur, j’ai été saisi d’un tremblement convulsif que j’ai eu la force de maîtriser jusqu’à la fin du morceau, mais qui m’a contraint de m’asseoir et de laisser reposer mon orchestre pendant quelques minutes ; je ne pouvais plus me tenir debout, et je craignais que le bâton ne m’échappât des mains (7) ».
Trois mois plus tard se produisait le grand événement de l’histoire des concerts en France : le 9 mars 1828, Habeneck dirigeait au Conservatoire la première séance de la Société des concerts. En tête du programme, ces mots magiques : « Symphonie héroïque ».
Berlioz, qui en avait été l’auditeur le plus enthousiaste, se dit : « Moi aussi je serai… » Osa-t-il penser : « Je serai Beethoven ? » Tout au moins l’entendit-on dire qu’il voulait reprendre l’art où Beethoven l’avait laissé. En tout cas, il résolut que sa propre musique serait, sans tarder davantage, entendue dans de semblables concerts ; et la première session de la nouvelle et triomphante société était à peine close, que déjà il s’occupait d’organiser, dans la même salle, un concert de ses œuvres.
Nous sommes abondamment renseignés sur les circonstances diverses qui accompagnèrent l’organisation et l’exécution de cette entreprise d’un jeune garçon de vingt-quatre ans, encore sur les bancs de l’école. Nous possédons notamment le dossier complet des lettres qui furent échangées entre lui, le surintendant des beaux-arts et le directeur du Conservatoire, pour l’obtention de la salle, et les Mémoires ont résumé toute cette négociation en un récit très fidèle sous son apparence fantaisiste (8). Par là, il nous apparaît dès l’abord que Berlioz était homme de tête, qu’il ne se laissait pas rebuter par les obstacles, et savait, ou les tourner, ou les rompre : qualités excellentes pour l’homme d’action que doit être nécessairement un organisateur de concerts symphoniques. Donc, brisant la résistance de Cherubini (agent subalterne, comme il s’exprime !), il obtient la salle du Conservatoire pour le lundi de la Pentecôte, 26 mai 1828.
Ce n’est pas tout d’avoir une salle ; il faut maintenant un public. Berlioz va donc s’efforcer d’attirer l’attention sur son entreprise par les moyens qu’il a à sa portée : il écrit une lettre aux journaux, où il s’excuse de la liberté grande et de la témérité qui le pousse à composer tout un programme avec ses œuvres, comme s’il était Beethoven ou Mozart ! « Une rumeur de blâme s’élève contre moi ; on me prête les intentions les plus ridicules. Je répondrai que je veux tout simplement me faire connaître…. (9) » Plusieurs journaux répandus dans la société mondaine et artiste insérèrent ce communiqué, qui présentait l’initiative hardie du jeune musicien sous un jour favorable.
Il fallait aussi un orchestre et des chœurs. C’est de cela que Berlioz semble s’être inquiété le moins. Disposé à tous les sacrifices (assez limités, il est vrai) qu’il était en son pouvoir de faire, il savait aussi pouvoir compter sur le désintéressement et le dévouement de bon nombre d’amis. A Cherubini, qui lui objectait : « Après nos concerts, vous ne pouvez pas vous présenter sans un orchestre formidable », il répondait : « Je suis sûr de mon fait, j’en aurai un au moins aussi beau que le vôtre (10) ».
Après l’exécution, il confiait à son père : « J’avais le plus bel orchestre qu’on puisse peut-être trouver en Europe. Malheureusement, ajoutait-il, les chœurs étaient de beaucoup inférieurs (11). » Les artistes, encore tout frémissants, pour la plupart, des nobles émotions ressenties naguère à la révélation du grand art symphonique allemand, ne ménageaient pas leurs sympathies au jeune musicien français qui en reprenait si promptement les traditions : plusieurs épisodes des répétitions, tels qu’ils nous sont racontés dans les lettres de Berlioz, nous apportent des preuves certaines de ce parfait accord entre le jeune maître et ses interprètes. Pour lui, se défiant encore de ses qualités professionnelles, il avait offert le bâton de direction à un ami, plus expert que lui, Bloc, chef d’orchestre de l’Odéon, lequel, en cette qualité, avait conduit les premières représentations du Freischütz en France. Lui-même se place dans l’orchestre, aux instruments à percussion ; et quand l’émotion l’étreint, il s’étend sur les timbales pour pleurer (12).
Le programme (qui n’a pas été retrouvé sous sa forme intégrale) peut être reconstitué grâce aux indications que nous devons à Berlioz lui-même et aux comptes rendus des journaux. Le voici :
Ouverture de Waverley. — Fragments des Francs-Juges : Air et Mélodie pastorale (trio et chœur) (13). — Marche des rois Mages. — Resurrexit (fragment du Credo de la Messe solennelle). — Ouverture des Francs-Juges. — Scène héroïque : la Révolution grecque (14).
Sauf l’ouverture de Waverley et celle des Francs-Juges, toutes ces œuvres étaient données en première audition (15).
Le public fut clairsemé, et la recette ne couvrit pas les frais. Mais du moins la qualité des auditeurs suppléa à la quantité. Berlioz cite parmi ceux qui l’honorèrent de leur présence : Herold, Auber ; ses maîtres Lesueur et Reicha ; les directeurs de l’Opéra et de l’Odéon ; les chanteurs Nourrit, Dérivis, Mme Catalani ; des membres de l’Institut, etc. (l6). Sur la scène, Duprez chantait. Et dans la presse, plusieurs articles parurent, célébrant les louanges du nouveau symphoniste français. Fétis, notamment, écrivit : « M. Berlioz a les plus heureuses dispositions ; il a de la capacité ; il a du génie. Son style est énergique et nerveux. Entraîné par sa jeune et ardente imagination, il s’épuise en combinaisons d’un effet original et passionné, etc. » (17).
Bref, le premier concert de Berlioz fut un honorable début, et plein de promesses pour l’avenir.
___________________________________
(1) Nous reprenons aujourd’hui la série des Berlioziana qui,
commencée par le Ménestrel en 1904, avait été interrompue (Voir le Ménestrel
du 1er décembre
1906).![]()
(2) Voyez le 1er chapitre de ces Berlioziana : « Au Musée
Berlioz », Ménestrel du 10 janvier
1904.![]()
(3) Même chapitre, Ménestrel du 13 mars
1904.![]()
(4) Mémoires de Berlioz, chapitre VII.![]()
(5) Lettre de Berlioz à Albert du Boys (20 juillet 1825) : Les Années romantiques, page
24 [CG no. 48].![]()
(6) Mémoires, chap. VIII.![]()
(7) Lettres intimes, p. 6 [29 novembre 1827, CG no. 77].![]()
(8) Mémoires de Berlioz, chap. XVIII. — Lettres : Les
Années romantiques, p. 38 et suivantes [CG nos 81, 82, 83, 84] ;
— H. DE CURZON, articles du Guide musical, 6 et 13 juillet 1902.![]()
(9) Paru dans la Revue musicale, le Corsaire, le Figaro,
la Pandore. Texte reproduit dans la Correspondance inédite, p. 65
[CG no. 86, 16 mai 1828].![]()
(10) Années romantiques, p. 42 [CG no. 83].![]()
(11) Années romantiques, p. 47 [CG no. 91].![]()
(12) Sur ce concert, voyez Mémoires, chapitre XIX ; lettres de
Berlioz à son père (Années romantiques, p. 47 et
suiv. [CG no. 91]) et à Humbert Ferrand (lettres intimes, pp. 10 et 15 [CG
no. 93, 6 juin 1828; CG no. 94, 28 juin 1828]). La première lettre à H.
Ferrand (du 6 juin) suffit, à un seul détail près, pour reconstituer le
programme. Tous les détails contenus dans les Mémoires sont confirmés,
en même temps que complétés, par les lettres et les autres témoignages
contemporains.![]()
(13) Les Mémoires seuls font mention de l’air des Francs-Juges,
au sujet duquel ils donnent ce détail, trop circonstancié pour qu’on en puisse
douter :
« L’air, que Duprez, avec sa voix alors faible et douce, fit valoir,
fut approuvé et applaudi. C’était une invocation au sommeil. » La lettre
à Humbert Ferrand du 6 juin, parlant de la « chère Mélodie pastorale »,
s’accorde avec les Mémoires pour assurer « que ce morceau fut
indignement chanté par les solos, et le chœur de la fin ne l’a pas été du
tout ». Dans la lettre à son père, Berlioz dit simplement :
« La partie vocale était écrasée par l’instrumentale ».![]()
(14) Berlioz a raconté dans les Mémoires qu’il avait voulu faire
entendre à cette place finale du programme sa cantate de la Mort
d’Orphée, et que la répétition à orchestre en eut lieu, mais que
l’indisposition de l’interprète (Alexis Dupont) empêcha de l’exécuter, et que
le Resurrexit, déjà connu, prit la place de la cantate. Ces faits sont
confirmés par l’inscription que Berlioz avait écrite prématurément sur
l’exemplaire de cette cantate dont il fit hommage à Humbert Ferrand :
« Ouvrage déclaré inexécutable par la section musicale de l’Institut et
exécuté à l’École royale de musique le 27 juillet 1828. » Voir,
ci-dessus, Berlioziana, Ménestrel du 26 août
1906.![]()
(15) Il n’est pas exact que quatre de ces œuvres soient les seules qui
existent encore. Toutes les six (sauf un seul air des Francs-Juges) nous
sont parfaitement connues.![]()
(16) Lettre au père, Années romantiques, p. 50 [CG no.
91].![]()
(17) Revue musicale, t. III (1828), pp. 422 et suivantes.![]()
![]()
![]() Le Ménestrel, 23
Octobre
1909, p. 339-341
Le Ménestrel, 23
Octobre
1909, p. 339-341
(Suite)
Le second eut lieu un an et demi plus tard, le dimanche 1er novembre 1829, toujours au Conservatoire. Déjà l’organisateur semblait prendre à tâche de se former un répertoire : trois œuvres inscrites sur la nouvelle affiche avaient déjà figuré sur celle du 26 mai 1828 ; une autre était inédite, le Concert des Sylphes, sextuor vocal où se trouvait déjà presque entièrement formée une des pages les plus accomplies de Berlioz, le chœur des Sylphes de la Damnation de Faust. Mais la plus grande partie du programme était composée d’œuvres d’autres maîtres, — même de quelques petits maîtres : ne faut-il pas aussi songer un peu au public ? Au reste, ce programme nous ayant été conservé, nous ne saurions mieux faire que d’en reproduire textuellement la teneur (1) :
PREMIÈRE PARTIE : 1° Ouverture de Waverley, par M. Berlioz ; 2° Le Concert des Sylphes, sextuor de Faust, musique de M. Berlioz, chantée par Mlles Leroux, Saint-Ange, Beck, et MM. Cambon, Ganaste, Devillers, élèves de l’Ecole royale (2) ; 3° Variations sur un thème de Mercadante, composées pour le violon par Mayseder, et exécutées par M. Urhan ; 4° Air italien, chanté par Mlle Marinoni ; 5° Grand concerto de piano en mi bémol, composé par Beethoven, exécuté par M. Ferdinand Hiller.
DEUXIÈME PARTIE : 6° Ouverture des Francs-Juges, par M. Berlioz ; 7° Duo italien chanté par Mlle Marinoni et M. de Rosa ; 8° Air varié de flûte, composé par M. Tulou, exécuté par M. Dorus ; 9° Grand chœur final de M. Berlioz (Resurrexit, annonce du Jugement dernier, chœur d’effroi des peuples de la terre).
L’on sera surpris peut-être de voir la virtuosité, parfois une virtuosité assez basse, tenir une si grande place dans un concert dont l’ensemble était d’une belle tenue. Mais les variations pour instruments à vent, aussi bien que les cavatines à l’italienne, étaient une nécessité de ce temps-là. Rappelons-nous le premier programme de la Société des concerts : entre la Symphonie héroïque et les harmonieux chœurs de Cherubini, il comportait un duo de Sémiramide, un solo pour cor à pistons, de Meifred, un air pour soprano de Rossini, et un concerto de Rode. Ne reprochons donc pas à Berlioz d’avoir cédé au courant qu’avait suivi la grande Société elle-même. Au reste, il savait bien à quoi s’en tenir. Ecoutons-le parler des incidents du concert : « Mademoiselle Marinoni venait d’entrer en scène pour chanter une pasquinade italienne… (3) » Une pasquinade ? Gageons qu’il s’agissait d’un air de Rossini ! Mais ne faut-il pas faire quelques sacrifices au goût du temps en faveur du but poursuivi ? Aussi bien, la partie du programme destinée à attirer le public ne contenait pas que des pasquinades ; il s’y trouvait, à la meilleure place, un chef-d’œuvre : le concerto pour piano (op. 73) de Beethoven, avec son adagio au grand style contemplatif, son finale fougueux comme une musique de tziganes, œuvre que les maîtres du clavier n’ont plus jamais cessé de regarder comme un des plus magnifiques monuments de leur art, et que l’on entendait pour la première fois dans la salle où, après deux sessions, la Société des concerts n’avait encore fait entendre que quatre des neuf symphonies, et où les concertos de Herz et de Kalkbrenner paraissaient bien mieux faits pour plaire au public que ceux de Beethoven.
Ainsi voilà que, dès sa seconde tentative, Berlioz songe à se faire l’initiateur des chefs-d’œuvre de l’art, autant qu’à assurer ses propres succès de compositeur (4).
A ce concert, pour lequel Habeneck avait consenti à diriger l’orchestre, le résultat fut sensiblement meilleur qu’au premier : non seulement les frais furent couverts, mais encore Berlioz put annoncer triomphalement un bénéfice de cent cinquante francs (5). Ce n’était pas trop mal, en somme, pour les hasards de l’entreprise.
Sur ces entrefaites, il composa la Symphonie fantastique.
C’est une des caractéristiques de la production de Berlioz que, lorsqu’il avait terminé une œuvre, il n’attendait pas que l’encre fût sèche pour en entreprendre l’exécution. Cette impatience lui joua maintes fois de mauvais tours, notamment pour la Damnation de Faust, qui aurait peut-être beaucoup mieux réussi si, moins pressé, l’auteur eût attendu un meilleur moment pour la présenter au public. Avec la symphonie, le dommage fut moins grand : son inexpérience lui valut simplement une nouvelle leçon, dont, il l’a déclaré lui-même, il sut profiter.
Renonçant cette fois à prendre la responsabilité de l’organisation d’un nouveau concert, il avait obtenu des directeurs d’un théâtre où l’on jouait l’opéra-comique, les Nouveautés (celui-là même où il avait été choriste), qu’ils donnassent eux-mêmes cette première audition. Mais la scène de ce théâtre de genre n’était même pas assez vaste pour contenir les exécutants nécessaires à une telle œuvre. Quand les musiciens vinrent répéter, les gradins n’étaient pas construits ; les pupitres manquaient, les chaises, les bougies ; pas de cordes aux contrebasses, pas de place pour les timbales ; bref, l’heure passa dans le tumulte et le désordre, et les directeurs renoncèrent, disant qu’ils ne savaient pas qu’il fallût tant de choses pour une symphonie ! « Et, conclut Berlioz, tout mon plan fut renversé faute de pupitres et de quelques planches… C’est depuis lors que je me préoccupe si fort du matériel de mes concerts. Je sais trop ce que la moindre négligence à cet égard peut amener de désastres (6). »
D’ailleurs, la notoriété du jeune compositeur grandissait. Dans l’été il obtenait le prix de Rome. Il trouvait des occasions de faire entendre sa musique dans des institutions régulières, par exemple à l’Opéra, qui donna, le 7 novembre, son poème symphonique la Tempête. Sa cantate de concours, Sardanapale, était exécutée à l’Institut. Même il conte qu’aux journées de Juillet il entendit un chœur populaire chanter une de ses Mélodies irlandaises, chant que son caractère patriotique rendait de circonstance. Bref, le public commençait à s’intéresser à lui. Il ne pouvait pas partir pour Rome avant de lui avoir fait connaître ses dernières œuvres : il donna donc un troisième concert au Conservatoire, le 5 décembre 1830. Comme pour le précédent, Habeneck dirigea. Le bénéfice était destiné aux blessés des journées de Juillet.
Nous avons signalé déjà qu’il reste une intéressante relique de ce concert : le programme explicatif de l’Episode de la vie d’un artiste, Symphonie fantastique en cinq parties, daté du 5 décembre 1830 et imprimé sur papier rose pour être distribué aux auditeurs ; la Bibliothèque du Conservatoire en possède trois exemplaires de deux éditions différentes (7). Le concert commença par l’ouverture des Francs-Juges; puis vinrent deux Mélodies irlandaises en chœur : sans doute le Chant sacré, sur la partition duquel Berlioz avait inscrit comme épigraphe ces paroles de Faust : « Prosternez-vous devant Celui qui est là-haut », et le Chant guerrier qui commence par ces vers :
N’oublions pas ces champs dont la poussière
Est teinte encor du sang de nos guerriers.
La cantate de Sardanapale suivit, allumant son incendie ; enfin, avant la symphonie, Urhan joua un morceau de violon : sauf ce dernier numéro, tout le programme était de Berlioz.
Inutile de revenir sur les détails de ce concert, une des manifestations les plus connues de la vie artistique de Berlioz. Bornons-nous à citer ce paragraphe final du compte rendu sommaire écrit par lui, dès le lendemain, dans une lettre à son père, où, après avoir constaté l’accueil enthousiaste du public et celui d’auditeurs tels que Liszt, Meyerbeer, Spontini, Fétis, — voire Camille Moke, — il poursuivait :
« On me tourmente pour redonner dimanche prochain un second concert, avec encore l’ouverture et la symphonie. Je vais voir si Cherubini veut me prêter encore la salle, si madame Malibran veut chanter, si Bériot veut me jouer un solo de violon, et je conduirai moi-même l’orchestre ; je crois que nous ferons de l’argent. Cette fois ce ne sera pas au bénéfice des blessés (8). »
Ce projet ne fut pas réalisé, et Berlioz n’eut pas l’occasion de faire ses débuts comme chef d’orchestre symphonique en 1830, aux côtés de la Malibran. Il partit pour l’Italie, où pendant plus d’un an il se consuma dans l’inaction, sans amour — et sans musique symphonique !
Il revint en France au printemps de 1832, et sa première pensée fut d’organiser des concerts. Pendant un séjour de cinq mois à la Côte-Saint-André, il passa son temps à copier des parties (9). En route pour revenir à Paris, il écrivait avec un air d’assurance : « Mon concert aura lieu dans les premiers jours de décembre. » (10). Il le fit comme il l’avait dit. Ce fut le 9 décembre qu’il donna la première audition intégrale de l’Episode de la vie d’un artiste, symphonie fantastique suivie du mélologue du Retour à la vie. L’ouverture des Francs-Juges complétait encore une fois le programme (11). Plus célèbre encore dans la vie de Berlioz que celui des deux ans antérieurs, ce concert ne doit pas davantage nous retenir ici : il suffit de le mentionner.
Plus heureux qu’en 1830, Berlioz put cette fois redonner presque immédiatement son concert : le 30 décembre, dans la salle du Conservatoire, on entendit de nouveau « la Symphonie fantastique et le Mélologue, suivis d’une Orientale de Victor Hugo et de l’ouverture des Francs-Juges (12) ».
L’Orientale de Victor Hugo dont il est ici question était sans aucun doute la romance la Captive, qui se trouve donc avoir eu sa première audition publique à cette date (13).
Puis 1833 commença. Ce fut l’année la plus agitée de la vie de Berlioz (celle de ses fiançailles et de son mariage avec miss Smithson), et la moins féconde comme production d’art. Au point de vue des concerts, il a dit lui-même qu’il fut réduit, pendant cette période, au « pénible métier de bénéficiaire (14). » Au moment où se produisit l’accident qui l’immobilisa pendant plusieurs mois, Henriette Smithson était occupée à organiser une représentation à son bénéfice. « Je lui avais organisé un concert assez beau dans un entr’acte (15) », écrivait Berlioz à ce moment même. La représentation eut lieu pourtant. Berlioz a témoigné à ce propos du dévouement de Mlle Mars à l’égard de sa camarade anglaise : pour lui, il lui procura, dit-il, le concours de Liszt et de Chopin, qui jouèrent dans un entr’acte (16). Pour Liszt cela est certain : d’autres documents confirment sa présence à cette représentation ; mais tout en ajoutant quelques autres noms célèbres, tous sont muets quant à Chopin (17). Les souvenirs de Berlioz l’auraient-ils trompé ici ? On peut le croire d’autant mieux que Chopin a toujours répugné grandement à se produire en public : autant il aimait à livrer son âme d’artiste devant des auditeurs restreints, surtout aristocratiques, autant il se sentait dépaysé au milieu de la foule. « Son génie, a écrit une de ses admiratrices, avait besoin de plus d’indépendance que n’en laisse ordinairement un public incolore, qui arrive avec des exigences vagues, avec des préférences arrêtées d’avance, auquel il est si difficile de comprendre rien hors de la voie battue, et qui très souvent fait descendre à lui l’artiste ou le poète plutôt que de s’élever à leur hauteur (18). » Berlioz aurait pu, assurément, observer pour lui les mêmes réserves : tout grand esprit, tout novateur est exposé à ces appréhensions lorsqu’il se trouve en contact avec le public ; mais lorsqu’il arrive à le dominer, n’a-t-il pas le droit d’être fier de sa victoire ? Au reste, nous verrons bientôt que Chopin, amicalement reçu plus tard dans la maison de Berlioz et de sa femme, ne refusa pas toujours au maître français, pour ses concerts, l’appui de son nom et le concours de son talent.
___________________________________
(1) Imprimé dans Le Corsaire du 28 octobre 1829, et reproduit dans
J.-G. PROD’HOMME, Hector Berlioz, p. 77. — La lettre à Humbert
Ferrand
du 3 octobre 1829 annonçait d’autre part le Grand Air de
Conrad (des Francs-Juges) auquel avait été ajouté un récitatif
obligé, et que Mme Dabadie avait promis de chanter, ainsi que l’air du Freischütz,
interprété en allemand par Mlle Heinefetter (Lettres intimes, p. 51 [CG no. 138]).
Ces projets, on le voit par le programme définitif, n’eurent pas de suite.![]()
(2) Aucun de ces six élèves, auxquels était échu l’honneur d’être les
premiers interprètes d’une telle œuvre, n’était promis à de hautes
destinées artistiques : leurs six noms sont restés parfaitement obscurs.
Berlioz a dit d’ailleurs que leur exécution fut médiocre : « Six
élèves du Conservatoire chantèrent cette scène. Elle ne produisit aucun
effet… Je l’ai confiée à un chœur : ne pouvant trouver six bons
chanteurs solistes, j’ai pris quatre-vingts choristes, et l’idée ressort. »
(Mémoires, chapitre XXVI). Et dans une lettre du lendemain (à son père)
[CG no. 141]: « Il n’y a eu que mon sextuor de Faust que je
n’ai pas eu le temps d’apprendre aux exécutants et au public. » (Années
romantiques, p. 82 [sic pour 81].)![]()
(3) Lettres intimes, p. 54 [CG no. 142, 6 novembre 1829].![]()
(4) Il écrit à son père, le 3 novembre [CG no. 141] : « J’ai
été mis à une épreuve effrayante, à laquelle je n’avais pas réfléchi.
Hiller, ce jeune Allemand dont je vous ai parlé, jouait dans mon concert un
concerto de piano de Beethoven, qui est une composition vraiment merveilleuse.
Immédiatement après venait mon ouverture des Francs-Juges. En voyant
l’effet du sublime concerto, tous mes amis m’ont cru perdu, écrasé, anéanti,
et j’avoue que j’ai éprouvé un moment de crainte mortelle. » Années
romantiques, p. 82.![]()
(5) Même lettre (3 novembre 1829, à son frère [sic pour
père]).![]()
(6) Mémoires, chap. XVI. On trouvera d’autres détails sur cette
tentative avortée dans les lettres de Berlioz à son père, du 10 au 28 mai (Années
romantiques, pp. 93 et 100 [CG nos. 160 et 163), et à
Humbert Ferrand (Lettres Intimes, p. 69 [CG no. 162, 13 mai
1830]). On y verra que Berlioz avait l’intention de compléter le programme par
une nouvelle exécution de l’ouverture des Francs-Juges et par des
morceaux de chant qu’il avait demandés aux chanteurs allemands Haitzinger et
Wilhelmine Schröder-Devrient ; qu’en outre, d’autres difficultés se
joignirent à celles dont parlent les Mémoires (coïncidence de date
avec d’autres attractions mondaines qui auraient écarté du concert de Berlioz
le public élégant et l’auraient privé même d’une partie de ses exécutants).
Déjà pourtant le Figaro (du 21 mai) avait annoncé le concert et
publié intégralement le texte du programme de la symphonie (voir ci-dessus,
chapitre II, Ménestrel des 26 Juin et
3 Juillet 1904).![]()
(7) Voir le 2me chapitre des Berlioziana : Programmes,
Prologues et Préfaces, Ménestrel du 26 juin au
10 juillet 1904.![]()
(8) Années romantiques, p. 120 [CG no. 190, 6 décembre 1830].![]()
(9) « Mes loisirs furent employés à la copie des parties d’orchestre
du monodrame qu’il s’agissait maintenant de produire à Paris. » Mémoires,
chap. XLIV. — « Je copie toute la journée les parties de mon Mélologue ;
depuis deux mois je ne fais pas autre chose, et j’en ai encore pour
soixante-deux jours ; vous voyez que j’ai de la patience. » Lettre du
7 août 1832, à F. Hiller, Correspondance inédite, p. 105 [CG
no. 284].![]()
(10) Lettre à Humbert Ferrand, de Lyon, 3 novembre 1832, Lettres intimes,
p. 124 [CG no. 289].![]()
(11) Voy. J.-G. PROD’HOMME, Hector Berlioz. p. 121.![]()
(12) Le Corsaire, 29 décembre 1832, ap. J.-G. PROD’HOMME, Hector
Berlioz, p. 127.![]()
(13) Il convient de rectifier la date que nous avions crue jusqu’ici être
celle de la première audition de la Captive, date qui, du 23 novembre
1834, se trouve reportée au 30 décembre 1832 (voy. Berlioziana, Ménestrel
du 29 novembre [sic pour le 19
novembre] 1905).![]()
(14) Mémoires, chap. XLV.![]()
(15) Lettre du 2 mars 1833, à Humbert Ferrand (Lettres intimes, p.
125 [CG no. 326]).![]()
(16) Mémoires, chap. XLIV.![]()
(17) M. J.-G. Prod’homme, qui a consacré une étude spéciale à Henriette
Smithson dans la Revue Bleue (23 janvier 1904), mentionne parmi les
artistes qui participèrent à cette représentation à bénéfice, outre Mlle
Mars, Mlle Duchesnois, Giulia et Giulietta Grisi, Rubini, Tamburini, Liszt,
Urhan, Huerta, et la troupe du Vaudeville. Paganini, sollicité, aurait refusé
son concours.![]()
(18) Communication d’une amie de Chopin, dans la Revue muicale du 1er
janvier 1904.![]()
![]()
![]() Le Ménestrel, 30
Octobre
1909, p. 347-348
Le Ménestrel, 30
Octobre
1909, p. 347-348
(Suite)
Cette représentation date du 2 avril. Berlioz n’y avait concouru que d’une façon indirecte. Mais, huit mois plus tard, la santé d’Henriette étant rétablie et le mariage consommé, il voulut jouer un rôle actif dans la nouvelle représentation à bénéfice qui eut lieu au Théâtre-Italien (salle de l’Odéon) le 24 novembre. La première partie du spectacle était purement dramatique, composée d’Antony et du 4e acte d’Hamlet. La seconde était un concert dont le programme avait toute l’importance d’une séance qui se fût suffi à elle-même : excès de richesses dont l’annonce pouvait être une attraction efficace pour le public, mais qui, dans la pratique, devait nécessairement produire un mauvais résultat. L’événement le prouva bien : le concert commença trop tard, devant un public déjà fatigué, et ne put s’achever, — quelques-uns des musiciens, déjà partisans de la journée de huit heures et ne reculant pas devant les actes de sabotage, en 1833 (ne savons-nous pas qu’en tout Berlioz fut en avance sur son temps !), s’étant mis en grève en cessant brusquement le travail. Or, Berlioz s’était enfin décidé ce soir-là à conduire l’exécution : c’était un fâcheux début, et qui le laissa longtemps encore sous le coup d’une inquiétude trop naturelle. Les compositions de lui avec lesquelles il devait se mesurer comme chef d’orchestre étaient l’ouverture des Francs-Juges, Sardanapale et la Symphonie fantastique, à quoi s’ajoutaient deux œuvres de Weber : le chœur de la Chasse de Lützow et le Concert-Stuck [sic], exécuté par Liszt, et naturellement accompagné par l’orchestre sous la direction de Berlioz (1).
« L’ouverture des Francs-Juges fut très médiocrement exécutée… Après le Concert-Stuck de Weber, je m’oubliai, dans mon enthousiasme pour Liszt, jusqu’à l’embrasser en plein théâtre devant le public. Stupide inconvenance qui pouvait nous couvrir tous les deux de ridicule, et dont les spectateurs néanmoins eurent la bonté de ne point se moquer. — Dans l’introduction instrumentale de Sardanapale, mon inexpérience de conduire l’orchestre fut cause que, les seconds violons ayant manqué une entrée, tout l’orchestre se perdit, et que je dus indiquer aux exécutants, comme point de ralliement, le dernier accord, en sautant tout le reste. L’incendie final, mal répété et mal rendu, produisit peu d’effet. Rien ne marchait plus : je n’entendais que le bruit sourd des pulsations de mes artères, il me semblait m’enfoncer en terre peu à peu. » C’est en ces termes sévères que Berlioz apprécie son début dans un art où il allait bientôt passer maître ; et les contemporains ont dit, avant qu’il l’eût avoué lui-même, avec quel accent de honte indignée il se tourna à la fin vers le public en criant : « Ayez pitié de moi ! » (2)
Aussi, au « concert de réhabilitation » qu’il donna le mois suivant, il n’osa pas se risquer de nouveau. Pourtant Habeneck lui avait refusé son concours. L’ouverture de Rob-Roy, exécutée sous sa direction à la Société des Concerts (14 avril 1833), n’avait pas réussi, et Berlioz sentait se former contre lui ce qu’il a appelé « la coterie du Conservatoire ». Mais son appréhension était telle que, plutôt que de la surmonter, il préféra confier la direction à Girard. Chef d’orchestre du Théâtre-Italien, celui-ci était plus apte à se débrouiller parmi les cabalettes et les finales d’opéras de Rossini ou Bellini qu’à travers les broussailles de la symphonie berliozienne. Déjà il avait eu quelques occasions, et pas toujours heureuses, de conduire les œuvres du jeune maître : à un concert de Liszt (12 mars 1833), il n’avait pas même su faire jouer correctement jusqu’au bout l’ouverture des Francs-Juges. Dans un concert donné par l’Europe littéraire, le 2 mai 1833, il avait présidé à l’exécution d’un programme portant les titres des ouvertures de Waverley et des Francs-Juges et de quelques fragments de l’Episode de la vie d’un artiste, symphonie et mélologue. Ainsi commença-t-il à former avec Berlioz une association qui, à la vérité, ne fut pas de longue durée.
Le concert du 22 décembre ajoutait aux compositions déjà connues une page importante, qui n’avait pas encore été offerte au public : l’ouverture du Roi Lear, ainsi que la romance du Jeune pâtre breton. On parle aussi d’une romance de Marie Tudor, inconnue dans la production de Berlioz [mais voyez ci-dessous]. Liszt et le violoniste Haumann se firent entendre. Enfin, une belle exécution de la Symphonie fantastique consacra la revanche sur la débâcle de l’Odéon. Pour la première fois la Marche au supplice fut bissée. Victor Hugo, Alfred de Vigny, Eugène Sue, Emile Deschamps, Ernest Legouvé, Paganini, étaient parmi les spectateurs, et la recette fut « assez belle » (3).
Ainsi, se termina pour Berlioz l’année 1833.
Il avait rêvé que la saison d’hiver ne se passerait pas sans quelque nouveau coup d’éclat. A Humbert Ferrand, le ler août, il écrivait : « Je vais monter une grande affaire de concerts pour cet hiver. Si je pouvais avoir l’esprit entièrement libre, tout irait bien ; je défierais la meute de l’Opéra et du Conservatoire, qui sont aujourd’hui plus acharnés que jamais à cause de mes articles de l’Europe littéraire sur l’illustre vieillard, etc. » [CG no. 341] Mais il faut croire qu’il n’avait pas l’esprit entièrement libre (ce que nous savons de sa vie à cette époque le confirme assez), car depuis le 21 décembre 1833 jusqu’à l’automne suivant il ne donna pas un seul concert.
Mais, à partir du 9 novembre 1834, il rentra dans la lice, inaugurant à cette date une série d’auditions symphoniques si régulières qu’elles prirent bientôt l’apparence d’une institution. A quelques années de là, Henri Heine, rendant compte dans des Lettres confidentielles (destinées à être lues par tout le monde) de l’état des institutions musicales de Paris, constatait que quelques concerts « procuraient aux amis de la musique un rafraîchissement extraordinaire » et comptait dans ce nombre « les dimanches du Conservatoire, quelques soirées particulières de la rue de Bondy, et surtout les concerts de Berlioz et de Liszt (4) ». Berlioz et Liszt en effet, se produisirent si souvent ensemble que leur réunion semblait former une véritable association.
Nous allons être plus abondamment renseignés sur ces nouvelles campagnes que nous ne l’avons été sur les précédentes, grâce à la Gazette musicale, qui, ayant commencé sa publication en cette même année 1834, compta bientôt Berlioz parmi ses plus actifs collaborateurs, et qui nous tient par le menu au courant de ses actes publics. C’est aussi à cette époque qu’appartiennent quelques-uns des papiers personnels de Berlioz, par lesquels nous pourrons voir, tracés de sa main, ses plans d’action.
Une de ses grandes préoccupations d’entrepreneur de concert, responsable des dépenses comme de la recette, était celle du droit des pauvres. Par un abus qui ne s’est pas perpétué, ce droit était concédé alors à un fermier, le « fermier des pauvres » (heureuse expression !), dont les procédés arbitraires et vexatoires ajoutaient encore à la charge imposée par la loi. Berlioz, qui avait eu affaire à lui dès ses premières tentatives, ne manquait pas une occasion de l’accabler de sa colère, d’ailleurs inefficace. Voici par exemple en quels termes, un mois avant de commencer sa série de concerts, il parlait de lui dans un article parfaitement étranger à ce sujet (5) :
C’est bien la plus déhontée, la plus absurde, la plus révoltante, la plus insolente et la plus impie des mystifications. Parce que nos honorables députés, que Dieu confonde ! ont fait une loi sur un objet qui leur était aussi étranger que beaucoup d’autres, un impôt, que dis-je, un impôt ? un mandat de spoliation se trouve lancé contre les donneurs de concerts. Un compositeur, qui n’a qu’à peine de quoi vivre, voudra faire entendre un ouvrage d’où dépend son avenir, il montera une belle solennité musicale, il engagera un superbe orchestre ; sa partition exécutée avec ensemble et vigueur ira aux nues ; mais la recette n’a été que de deux mille francs, les frais étaient de dix-neuf cents, et voilà le fermier du droit des pauvres qui vient réclamer cinq cents francs, le quart de la recette brute, auquel il a droit de par la loi. En sorte que le malheureux artiste, au lieu de la modique somme de cent francs qu’il gagnait pour avoir composé un ouvrage remarquable et avoir réussi à le faire exécuter à ses risques et périls, se trouve tout d’un coup dépouillé de son bénéfice et imposé de quatre cents francs de par la loi. C’est le droit des pauvres ; c’est-à dire le droit du fermier des pauvres, qui, ne donnant jamais de concerts, trouve fort commode qu’on en donne pour lui, — pour lui qui prend le quart de la recette sans faire entrer en ligne de compte la moindre partie des frais.
Dix ans plus tard, considérant le cas d’une représentation théâtrale en opposition avec celui d’un concert, il écrivait encore :
Le fermier des pauvres n’aurait le droit de prendre que le onzième de la recette au lieu du quart qu’il avait pris dans celle du concert, parce que cette fois il s’agissait d’une représentation dramatique. Admirable distinction ! il paraît que nos députés qui font de si belles lois en veulent personnellement à la musique. Ce sont sans doute les sérénades que beaucoup de ces messieurs essuient en retournant dans les départements qui leur ont inspiré une pareille haine pour les concerts (6).
Voyons donc Berlioz à l’œuvre. Nous avons sous les yeux une feuille de grand papier, quatre pages entièrement remplies de sa main, dont la dernière précise l’époque ; on y lit sur la première ligne : « Les frais de mon 1er concert du 9 novembre 1834 seront de… » : puis, en surcharge sur la date : « 7 décembre ». Comme Berlioz a donné concert à chacune de ces dates, nous pouvons donc être certain que les notes inscrites dans cette pièce concernent l’un aussi bien que l’autre, certaines parties raturées étant sans aucun doute relatives au premier concert et ayant fait place aux changements survenus pour le second.
Une liste de plus de cent instrumentistes tient les trois premières pages. Les violons sont au nombre de quarante-sept (quelques-uns biffés d’un trait). Ne surchargeons pas ces notes en reproduisant tous ces noms, mais notons ceux qui ont laissé quelques traces dans les souvenirs de la musicographie. Nous lisons, comme violons : Urhan (qui, dès le 23 novembre, posa son violon pour le remplacer par l’alto solo d’Harold) ; Clapisson (futur concurrent heureux de Berlioz à l’Institut) ; les deux frères Seghers (l’un d’eux, Jean-Baptiste, devait à son tour faire une tentative, guère plus heureuse que celle de Berlioz, pour acclimater la musique symphonique en France) ; Turbri, Dancla, Ancessy (plus tard chef d’orchestre de la Comédie-Française), Miolan (père de la plus parfaite cantatrice française du XIXe siècle), Croisilles (que l’on se souvient encore d’avoir entendu à l’Opéra-Comique comme violon solo). Les noms de Baillot fils et de Sauzay sont effacés d’un trait qui semble indiquer que leur concours fut demandé mais non accordé : peut-être étaient-ils de la « coterie du Conservatoire » ? Allard, perdu dans la foule des violons, pourrait bien être Delphin Alard, qui, devenu célèbre, devait être l’interprète du seul morceau écrit pour son instrument par Berlioz, de même qu’Ernst, inscrit à la même place, était sans doute, le Wilhem-Henri Ernst qui devint un des bons amis de Berlioz, et prêta souvent son concours, comme soliste, à ses concerts postérieurs : tous deux avaient alors moins de vingt ans, et étaient inconnus. Aux altos est inscrit Elwart. Aux violoncelles; Desmarest (vieil ami de Berlioz), Batta ; Dietsch aux contrebasses. Enfin les instruments à vent comptent pour titulaires la plupart des musiciens de l’Opéra.
Çà et là sont jetées sur le papier des instructions telles que : « Avoir le tambour. — Tambour de Basque chez Musard », et quelques adresses d’amis.
La quatrième page enfin porte un compte que nous reproduisons dans toute sa simplicité. Il dira quels étaient les frais d’un concert symphonique en 1834, et je sais des directeurs d’orchestre qui envieront cet heureux temps. Les chiffres de la première colonne sont raturés : deux sont surchargés au point que nous n’avons pu les déchiffrer (articles Chœur et Copie : la suppression fut sans doute intentionnelle, Berlioz n’ayant pas voulu comprendre les frais de copie parmi ceux d’un seul concert, et le programme du 9 novembre 1834 n’ayant pas comporté de chœurs). Ces chiffres sont sans doute, comme nous l’avons dit, ceux relatifs au premier concert, tandis que ceux de la 2e colonne se rapportent à celui du 7 décembre.
|
Droit des pauvres |
80 francs |
80 francs |
|
Frais de la salle et du service de l’orchestre avec l’éclairage et le chauffage |
240 — |
240 — |
|
Pour la lytographie |
25 — |
25 — |
|
Pour l’imprimerie |
138 — |
138 — |
|
Pour le chœur |
*** |
|
|
Pour la copie |
*** |
800 — |
|
Pour l’orchestre |
777 — |
|
|
TOTAL |
1.480 francs |
1.283 francs |
|
TOTAL |
1.280 — |
Avec les voitures cela ira à 1.300 francs. |
Dix-sept francs de voitures ! A quelles folles dépenses ne craignait pas de se risquer l’audacieux symphoniste !
Girard, cette année encore, était requis de tenir le bâton conducteur, et Urhan recevait de Berlioz une lettre amicale lui annonçant l’envoi de sa partie d’alto et de la partition d’Harold, afin qu’il pût « combiner son personnage avec l’ensemble (7). »
Pour la salle (celle du Conservatoire), Berlioz la demanda, pour trois dimanches, à l’intendant général de la liste civile, par une lettre du 9 octobre 1834 dont nous avons eu l’original entre les mains (8).
Et quant au répertoire, il passa tout l’été à le préparer, parmi tant d’autres occupations importunes. « Je suis toujours la plume à la main, soit pour achever les compositions que je destine à mes concerts de cet hiver… », écrivait-il à sa sœur Adèle le 31 juillet (9). Il venait en effet, quelques semaines avant cette date, de mettre la dernière main à sa symphonie d’Harold ; nous verrons, par le détail des programmes qui vont suivre, quels autres morceaux il avait préparés dans la même intention.
___________________________________
(1) Mémoires, chap. XLV. — Lettre à d’Ortigue du 15 octobre (Corresp.
inéd. p. 111 [CG no. 353]) ; 4 lettres dans les Années
romantiques (pp. 241 à 245 [CG nos. 358,
359, 361, 362) : l’une,
à Gounet [CG no. 361], a pour objet l’invitation au roi et à la famille
royale ; une autre est une invitation à l’éditeur Renduel [CG no.
362]. — Article de d’Ortigue dans la Quotidienne du 4 décembre. —
J’ai publié, dans le Ménestrel d’abord (3 octobre 1886), puis dans Hector
Berlioz et la société de son temps, p. 53, les souvenirs qu’avait
retracés à ma demande un contemporain, Ch. Jarrin (aujourd’hui mort, on le
pense bien), qui, étudiant à Paris en 1833, avait assisté à cette
représentation : ces souvenirs étaient restés très vifs quant à la
représentation d’Hamlet et à miss Smithson ; ils étaient plus
émoussés à l’égard de la partie musicale, dont la longueur excessive lui
avait paru justifier tout naturellement l’interruption. — Sur le chœur la
Chasse de Lützow, de Weber, on peut se reporter à trois lettres de
Berlioz, dont l’une contient la notation du premier couplet entier, avec sa
traduction, qui est de Gounet et avait été faite spécialement pour cette
audition (Lettres intimes, pp. 135 et 144 [CG nos. 342 et 398] ; Années romantiques, p. 241 [CG no. 358]).![]()
(2) Outre l’article de d’Ortigue déjà signalé, citons le Cabinet de
lecture du 24 décembre 1833 : « Ce fut une affreuse soirée pour
Hector Berlioz que celle où, abandonné et trahi par son orchestre, il vint, le
cœur brisé et la voix toute tremblante, crier pitié et merci… »![]()
(3) Voyez, outre les Mémoires, la lettre de Berlioz à sa sœur Adèle
du 26 décembre 1833 (Les Années romantiques, p. 247 [CG no.
370]). L’article du Cabinet de lecture auquel nous avons précédemment
emprunté quelques lignes donne en outre les détails suivants : « Le
concert commença par l’ouverture du Roi Lear, exécutée pour la
première fois ; elle a produit un grand effet. Un fragment du poème de Marie,
mis en musique par M. Berlioz, n’a pas été moins vivement applaudi. » A
son ami Gounet, Berlioz écrivait : « J’espère que vous viendrez
dimanche prochain entendre mon ouverture du Roi Lear, qui est une chose… »
Années romantiques, p. 247 [CG no. 366,
15-20 décembre 1833].![]()
(4) Gazette musicale du 4 février 1838. Henri Heine a reproduit ces Lettres
confidentielles dans son volume intitulé Lutèce.![]()
(5) Rubini à Calais, dans la Gazette musicale du 5 octobre
1834. Dans cette fantaisie, Berlioz imagine que Rubini prête son concours à
une « bénéficiaire » dans l’embarras, et il en profite pour
évoquer les souvenirs de son « pénible métier de bénéficiaire »
de l’an passé.![]()
(6) Revue et Gazette musicale du 12 mai 1844. La Bibliothèque du
Conservatoire possède une lettre de Berlioz au fermier des pauvres, un nommé
Mantou, devant lequel il s’humilie presque pour obtenir d’être un peu moins
dépouillé : « Je suis à votre merci… On ne loue presque rien,
j’ai dû donner les trois quarts des billets, je vous donne ma parole
d’honneur que c’est la vérité. Prenez donc cette nécessité en considération,
je vous prie, je compte sur votre équité. » (Années romantiques,
p. 437 [CG no. 1303, 14 février 1850 ou 1851]). Sur la chemise qui
enveloppe la lettre autographe, le bibliothécaire, M. Weckerlin, qui a des
souvenirs lointains, a écrit en regard du nom du destinataire ces mots
significatifs : « Je me souviendrai longtemps de cette vilaine
bête. ».![]()
(7) Les Années romantiques, p. 271 [CG no. 404, entre juillet
et octobre 1834]. Voir à la page 257 du même livre une lettre à Girard [CG
no. 392, 14 avril 1834] qui n’a pas trait aux concerts, mais montre du moins
quelle était la nature de leurs rapports.![]()
(8) Les Années romantiques, p. 270 [CG no. 411].![]()
(9) Les Années romantiques, p. 265 [CG no. 402].![]()
![]()
![]() Le Ménestrel, 13
Novembre 1909, p. 363-364
Le Ménestrel, 13
Novembre 1909, p. 363-364
(Suite)
Car, la chose est évidente, le fond des concerts de Berlioz était formé par les œuvres de Berlioz même : leur audition en était la raison d’être essentielle, et l’on pourrait définir cette entreprise symphonique en disant qu’elle avait pour but de constituer un répertoire composé principalement par l’œuvre d’un auteur, qui était Berlioz — de même que le Conservatoire à son début avait poursuivi un but analogue avec Beethoven, et que plus tard Lamoureux devait agir à peu près semblablement avec Wagner. Mais, nous le répétons, ce but n’était pas exclusif ; les œuvres de Berlioz ne constituèrent presque jamais l’intégralité des programmes, et nous verrons ceux-ci faire une place, de plus en plus grande avec le temps, aux compositions des autres maîtres.
Voici ces programmes pour les trois concerts de 1834. Nous les reproduisons d’après les annonces de la Gazette musicale.
1er Concert, le 9 novembre : 1° Ouverture du Roi Lear : 2° Quatuor pour 2 ténors et 2 basses, avec orchestre, sur une Orientale de Victor Hugo (Sara la baigneuse), exécuté pour la 1re fois. Chant, MM. Puig, Boulanger, ***** et Hense ; 3° Fantaisie pour le violon, sur la romance de Richard Cœur de Lion, composée et exécutée par Panofka (1) ; 4° air de la Donna del lago, chanté par Mme Willent-Bordogni ; 5° La Belle Voyageuse, légende irlandaise pour quatre voix et orchestre, exécutée pour la 1re fois (mêmes chanteurs que pour le n°2) : 6° Épisode de la vie d’un artiste, Symphonie fantastique en 5 parties. — Une note de la Gazette annonçait : « M. Berlioz a ajouté à son ouvrage plusieurs effets d’orchestre nouveaux qui en augmentent sensiblement l’éclat (2). »
2e Concert, le 23 novembre. « Tous les morceaux exécutés dans ce concert, dit la Gazette, sont nouveaux et n’ont jamais été exécutés auparavant. » lre partie : Fantaisie romantique pour soprano et orchestre sur une Orientale de Victor Hugo, chantée par Mlle Falcon (3). — Solo de violon par Ernst. — Les Ciseleurs de Florence, trio avec chœur et orchestre. — Grande fantaisie fantastique sur deux thèmes de Berlioz (La Ballade du Pêcheur et la Chanson des Brigands) composée et exécutée par Liszt. — Romance avec orchestre, chantée par Mlle Falcon. — Ouverture de Waverley. — Deuxième partie : Harold, symphonie en quatre parties, avec un alto principal (Urhan).
Ce programme, imprimé une semaine à l’avance, paraît avoir subi des modifications : le compte rendu de la Gazette musicale (no. du 7 décembre) ne mentionne pas le chœur des Ciseleurs (de Benvenuto Cellini), qui, annoncé de nouveau comme première audition pour le 3e concert, n’avait sans doute pas été chanté au second. Il est facile de concevoir que, pour cette séance, tout l’effort de l’exécution se soit porté sur la nouvelle symphonie. — Un autre programme annonce la Marche au supplice (redemandée) et un air de Bellini (4).
3me Concert, le 7 décembre. 1° Ouverture des Francs-Juges: 2° Les Ciseleurs de Florence, trio avec chœur et orchestre, exécuté pour la première fois ; 3° Andante pour le piano composé et exécuté par M. Chopin ; 4° Air chanté par Mlle Boucault ; 5° Ouverture du Roi Lear ; 6° Air italien chanté par Mme Gay-Saintville ; 7° Harold.
Cette fois encore il y eut des modifications apportées à la partie vocale du programme. La Gazette du jour même annonça que Mlle Heinefetter venait d’arriver à Paris pour remplir une promesse faite à Berlioz, et qu’elle chanterait à son concert un air de Donizetti. Aucun compte rendu, à notre connaissance, ne parle encore du chœur de Cellini, tandis que la Gazette loue Boulanger d’avoir chanté avec talent un morceau de la composition de Berlioz, qui devait être tout autre. Quant à l’andante de Chopin pour le piano, le même journal le déclare « très bien arrangé et fort riche en nuances délicates, de sorte qu’il présente des contrastes bien saillants avec les masses colossales de l’orchestre de Berlioz (5). »
Un quatrième concert, donné en supplément aux trois premiers, en consacra le succès. « J’ai été obligé de le donner pour faire un peu d’argent, écrivit Berlioz à d’Ortigue. Tout l’orchestre vint pour rien (6). » On y entendit pour la troisième fois Harold, et Liszt joua sur le piano le Bal et la Marche au supplice de la Symphonie fantastique, dont la transcription par lui venait de paraître. L’illustre et triomphant virtuose se fit entendre encore dans une autre de ses compositions, à deux pianos, qu’il exécuta avec une de ses élèves, Mlle Vial (7).
Ainsi, en quatre concerts donnés dans l’espace de deux mois, Berlioz avait fait entendre au public parisien, par un orchestre magnifique, une symphonie nouvelle et plusieurs autres pages de sa composition, des œuvres de Liszt, Chopin, Rossini, Donizetti et Bellini, des cantatrices telles que Mmes Falcon, Willent-Bordogni, Heinefetter, et comme virtuoses, avec les deux maîtres déjà nommés comme compositeurs, Chopin et Liszt, les violonistes Ernst et Panofka. Il semblait qu’il dût y avoir là des richesses suffisantes pour attirer l’attention du public.
De fait, cette tentative fut loin de passer inaperçue. A quelques séances, la recette s’était trouvée fort satisfaisante (8). Berlioz s’était fait dans le public et dans la presse d’ardents (quoique trop rares) admirateurs, et il était l’objet de discussions passionnées. Il était devenu si bien l’homme du jour, qu’il allait être l’objet d’une parodie retentissante. Au premier bal de l’Opéra, en janvier 1835, Arnal, dans un intermède, fit 1’« imitation » du compositeur de musique à programme, pendant que l’orchestre du bal exécutait, entre deux galops, la symphonie descriptive intitulée Épisode de la vie d’un joueur. C’était Adolphe Adam, paraît-il, qui avait écrit la musique de cette composition, qu’il croyait bouffonne. Elle est perdue. Il faut la regretter. Puisqu’Adam avait cherché à imiter Berlioz, il a peut-être fait quelque chose de très bien — mieux que le Chalet ! (9). L’auteur de l’authentique Symphonie fantastique ne voulut pas se priver du plaisir de rendre compte lui-même de cette petite manifestation ; et voici en quels termes il s’exprima :
Je n’ai pas besoin de dire sur qui cette plaisanterie était dirigée. Arnal a été charmant de verve comique, et, en acteur spirituel, il a su ne pas franchir la limite passé laquelle il fût infailliblement tombé dans la grosse farce. Il a saisi à merveille l’anxiété, les transports, les rages, les mouvements brusques du compositeur assistant à la première répétition de son œuvre chérie. Dans un discours préliminaire il a exposé comme quoi il n’avait besoin pour faire comprendre ses pensées dramatiques ni de paroles, ni de chanteurs, ni d’acteurs, ni de costumes, ni de décorations. « Tout cela, messieurs, est dans mon orchestre ; vous y verrez agir mon personnage, vous l’entendrez parler, je vous le dépeindrai des pieds jusqu’à la tête ; à la seconde reprise du premier allegro, je veux vous apprendre même comment il met sa cravate. Oh ! merveille de la musique instrumentale ! Mais je vous en ferai voir bien d’autres, dans ma seconde Symphonie sur… le Code civil… »
L’écrivain convenait d’ailleurs, pour conclure, que l’assemblée n’avait pas parfaitement compris l’intention satirique du discours ni les charges musicales de l’orchestre, car, déclare-t-il, « le tout a été assez mal accueilli » (10).
La Société des concerts commençant sa session au mois de janvier et la prolongeant jusqu’à la fin d’avril (elle ne donnait alors que huit concerts par an), la salle du Conservatoire ne pouvait pas être prêtée à Berlioz pendant cette période. Notons que, dans un concert avec orchestre donné par Liszt dans la salle Saint-Jean, à l’Hôtel de Ville, le 9 avril 1835, la Marche des Pèlerins d’Harold fut exécutée, et que Liszt joua sa Fantaisie symphonique sur deux thèmes de Berlioz (Ballade du Pêcheur et Chanson de brigands) après que le chanteur Boulanger eut fait entendre les thèmes originaux tels que l’auteur les avaient écrits dans le Retour à la vie (11).
Enfin, le 3 mai, les concerts du Conservatoire étant terminés, Berlioz occupa encore une fois la salle, où il donna l’Episode de la vie d’un artiste dans son intégralité. Geffroy, alors débutant, remplaça Bocage dans le mélologue. Liszt, toujours sur la brèche, se fit entendre dans l’intermède : il exécuta des variations sur la Marche d’Alexandre de Moschelès (12).
___________________________________
(1) « Panofka, violoniste allemand, vint à Paris en 1834 ; il se
fit entendre pour la première fois au Conservatoire dans un concert donné par
Berlioz » (FÉTIS).![]()
(2) L’un de ces « effets nouveaux » était la conclusion du
premier morceau, que nous avons constaté en effet avoir été ajoutée, sur le
manuscrit, à la suite de la barre finale primitivement tracée.![]()
(3) Le compte rendu du 7 décembre spécifie que les deux morceaux chantés
à ce concert par Mlle Falcon, et annoncés par le programme en termes vagues,
étaient la Captive et la romance de Marie (le Jeune pâtre
breton). Cf. lettre à Humbert Ferrand du 30 novembre [CG no. 416].![]()
(4) Programme distribué dans la salle (au musée de la Côte-Saint-André).![]()
(5) Gazette musicale du 28 décembre 1838 [sic
pour 1834]. Laissons aux biographes de
Chopin le soin de déterminer quel est l’andante que le maître polonais
exécuta pour Berlioz à ce concert, et disons simplement que, nul programme ou
compte rendu ne spécifiant que ce morceau fût accompagné par l’orchestre, il
est plus que douteux que cet andante soit la Romanze en mouvement Larghetto
de son Concerto en mi mineur.![]()
(6) Années romantiques, p. 275 [CG no. 420]. Sur le même
concert, voir dans le mémo recueil et à la même page, la lettre du 10
janvier 1835 (à sa sœur Adèle [CG no. 424]), ainsi que celle du même
jour à Humbert Ferrand (Lettres intimes, p. 156 [CG no. 425]).![]()
(7) Gazette musicale du 11 janvier 1835.![]()
(8) La Gazette musicale du 7 décembre écrit : « L’affluence
a été telle au dernier concert (première audition d’Harold) qu’on a
refusé plus de cent cinquante personnes aux stalles et parterre ». Et
(sans doute grâce au 4me concert dont les frais étaient notablement diminués)
Berlioz put résumer la situation en disant que, somme toute, il avait réalisé
un bénéfice d’à peu près deux mille francs (lettre à sa sœur, du 10
janvier 1835 [CG no. 424]).![]()
(9) Rappelons en quels termes, dans le même temps, Ad. Adam formulait son
opinion : « Berlioz annonce pour dimanche, sous le titre de concert,
un de ces charivaris qu’il intitule Symphonies fantastiques. Je n’irai
certainement pas l’entendre. Si barbares que puissent être les compositions de
Spontini, je suis bien sûr que c’est du Cimarosa à côté de ce que fait ce
fou-là, etc., etc., etc. » Lettres sur la musique française,
d’Adolphe Adam, parues dans la Revue de Paris en 1903, année du commun
centenaire des deux compositeurs. L’éditeur chargé de leur publication n’a pas
encore trouvé le temps de réunir en un volume ces pages de fine critique.![]()
(10) Gazette musicale du 18 janvier 1835.![]()
(11) Gazette musicale, 5 et 12 avril 1835.![]()
(12) Gazette musicale, 26 avril et 10 mai 1835. Lettres du 17 avril
(à sa sœur Adèle) et du 6 mai (à son père), les Années romantiques,
pp. 279 et 284 [CG nos. 430 et 435].![]()
![]()
![]() Le Ménestrel, 27
Novembre 1909, p.
379-380
Le Ménestrel, 27
Novembre 1909, p.
379-380
(Suite)
La situation musicale à Paris était assez particulière, en ces années qui suivirent de près 1830. On pouvait se demander s’il y avait vraiment dans la grand’ville un public capable d’aimer la bonne musique. On se rappelle le mot du dernier roi déchu, à qui l’on demandait un jour s’il aimait la musique : « Je ne la crains pas », répondit avec résignation Charles X. Le public parisien semblait vouloir partager cette audace. Il ne craignait pas la musique. Pourtant, fallait-il que la bête lui fût montrée avec quelque précaution. Au Conservatoire même, quelques morceaux de cor à pistons et cavatines italiennes avaient été indispensables pour faire passer les symphonies de Beethoven. A présent, le public se familiarisait ; mais où devait-il aller pour apprendre à connaître les chefs-d’œuvre de la symphonie ? Chez Musard, seule institution régulière où l’on entendit de la musique d’orchestre ! Mais, disait un article anonyme dont nous reconnaîtrons bientôt l’auteur, la salle de Musard et les autres du même genre ne sont que « des lieux de rendez-vous, où l’on se promène en causant pendant que l’orchestre exécute les œuvres de Weber, de Meyerbeer et de Beethoven, et où l’on ne se tait un instant que pour écouter le quadrille de la Brise du matin ou le galop de la Chaise cassée (1) ». Un écrivain qui fut un des ennemis perfides de Berlioz, après s’être dit quelque temps son ami, J. Mainzer, dit incidemment, au cours d’une de ses attaques, que l’on chantait Palestrina chez Musard et chez Valentino ! (2) Ce dernier chef d’orchestre, le même à qui nous avons vu diriger en 1825 la première œuvre de Berlioz, avait en effet ouvert à son tour, en 1837, des concerts qui jouirent d’une certaine renommée : on y jouait « des contredanses pour faire passer les symphonies, et, au moyen de quelques quadrilles, Beethoven et Mozart étaient très bien supportés (3) ».
Dans l’année même où Berlioz venait d’organiser cette première saison de concerts si laborieuse, une institution tenta de se former, plus sérieuse que celles qui viennent d’être dites, et prétendant à devenir régulière. Elle ouvrit une salle, sous le nom de Gymnase musical, dans le voisinage du Gymnase dramatique, et dès son premier concert, mit sur son programme une symphonie (de Weber : choix à la vérité malheureux), ainsi que le Concertstück (du même) exécuté par Liszt, et des morceaux de virtuosité. L’orchestre était nombreux (vingt-six violons ; le reste en proportion) ; Tilmant le dirigeait. Le chef de l’entreprise aurait voulu lui adjoindre un chœur et des chanteurs solistes ; mais en un temps où la liberté des théâtres n’existait point, cela ne pouvait être que si les privilégiés y consentaient : or, déjà l’Opéra-Comique avait pris ombrage. « On eût, dit l’article anonyme que nous avons déjà cité, chanté de beaux chœurs de Haendel, de Palestrina, de Scarlatti, de Bach, de Weber, de Gluck, de Mozart ; qu’est-ce que tout cela a de commun avec le répertoire de l’Opéra-Comique ? » Au reste, l’article se terminait par des conseils, que voici : « L’on ne saurait apporter trop de soin dans le choix des morceaux qui composent les programmes, car de là dépend en grande partie le succès de pareils concerts. Cette partie importante de l’administration ne peut être confiée qu’à un artiste doué de tact, de goût, et de connaissances bibliographiques très étendues. L’ancienne musique doit trouver place à côté de la nouvelle, et le Gymnase rendra un double service à l’art si, en offrant aux jeunes compositeurs les moyens de se faire connaître, il devient en même temps le Conservatoire des belles productions de tous les temps (4) ». Les idées exprimées là équivalent à une signature, en même temps que la conclusion était une position de candidature : il n’y a pas à s’y tromper, l’article était de Berlioz.
Berlioz, en effet, fut occupé pendant toute la dernière partie de 1835 par cette affaire du Gymnase musical. Ses lettres disent que l’entrepreneur l’avait nommé directeur musical, ce qui, en lui assurant une position lucrative, eût en même temps réalisé son rêve d’artiste en le mettant à la tête d’une institution régulièrement constituée. Mais ce rêve était subordonné à la réalisation des projets d’exécution chorale exposés dès le premier article. Il fallait être autorisé à chanter des oratorios : déjà Berlioz songeait à adjoindre à l’institution une école de chœurs dans le genre de celle de Choron. Les destins — et Adolphe Thiers — ne le voulurent pas ; l’autorisation de chanter ne fut pas donnée ; Berlioz y perdit sa place, ou plutôt ne l’occupa jamais, et le Gymnase musical ferma bientôt (5).
Il fallait donc recommencer à donner des concerts lui-même, et sous sa responsabilité. Pour cela, il était nécessaire d’enrichir le répertoire fondamental, c’est-à-dire la production de Berlioz. Toujours plein de grandes idées, il rêva, pendant tout l’été de 1835, d’une vaste composition, dont il traça les grandes lignes et écrivit quelques pages : une Fête funèbre à la mémoire des hommes illustres de la France, composée de sept parties, et qui aurait dû avoir pour salle d’audition les voûtes retentissantes du Panthéon (6). A défaut de ce temple, dont il craignit sans doute de ne pouvoir pas obtenir la disposition, il se rabattit sur le Conservatoire, aux dimensions moindres ; et voici (résumé dans quelques parties de détail) le projet qu’il écrivit de sa main, et que nous avons retrouvé parmi ses papiers laissés à la Bibliothèque du Conservatoire :
FÊTE MUSICALE FUNÈBRE
DONNÉE AU CONSERVATOIRE LE JEUDI (7) 22 NOVEMBRE
JOUR DE [LA] SAINTE-CÉCILE
PAR M. H. BERLIOZ
|
8 artistes à 15 fr. |
120 fr. |
|
16 — à 20 fr. |
320 fr. |
|
88 — à 10 fr. |
880 fr. |
|
Total pour l’orchestre |
1.320 fr. |
|
20 petits garçons à 6 fr. |
120 fr. |
|
20 femmes à 15 fr. |
300 fr. |
|
25 ténors à 15 fr. |
375 fr. |
|
26 basses à 15 fr. |
390 fr. |
|
Total pour le chœur |
1.185 fr. |
|
Salle |
200 fr. |
|
Imprimerie |
200 fr. |
|
Luthier |
100 fr. |
|
Cabriolets |
30 fr. |
|
Garçons |
30 fr. |
|
560 fr. |
|
|
Droit des indigents |
400 fr. |
|
Total général des frais |
3.465 fr. |
Recette possible (résumé : 800 places, de 10 à 2 francs) |
|
|
Total recette de la salle |
4.576 fr. |
|
Probabilités : |
|
|
Le Duc d’Orléans |
200 fr. |
|
Le Roi |
200 fr. |
|
Le Ministre de l’Intérieur |
50 fr. |
|
Total général de la recette possible |
5.026 fr. |
|
Frais certains |
3.465 fr. |
|
Bénéfice qui en résulterait |
1.561 fr. |
Artistes qui viendront gratuitement.
Vocale : Duprez, Wartel, F. Prévost, Serda, Massol, Alizard, etc. (total 12).
Orchestre : Clapisson, Seghers aîné, Eugène Prévost, Desmarest, Montfort, etc. (total 13).
Composition de l’orchestre (notons seulement 8 trompettes et 2 cornets, 8 trombones et 2 ophicléides, 10 timbaliers ; le reste dans les proportions ordinaires : total, 111 instruments).
C’est ainsi que Berlioz organisait l’exécution de son œuvre, supputait la recette, les frais, le bénéfice probable, avant que cette œuvre fût écrite ! De fait, elle ne le fut jamais. Une lettre [à Humbert Ferrand, CG no. 440, après le 23 août 1835] dit que deux morceaux sur les sept étaient composés. L’un nous est connu : c’est le Cinq mai ; l’autre a probablement passé dans le Requiem : le luxe de trompettes, trombones et timbales prévus par le projet nous informe que la réalisation de ce qui devint bientôt le tonitruant Tuba mirum préoccupait déjà fortement Berlioz. Quoi qu’il en soit, ce ne fut que plus tard qu’on l’entendit, et, pour commencer la saison 1835-36, il fallut bien en revenir aux conditions d’exécution ordinaires (8).
___________________________________
(1) Gazette musicale du 31 mai 1835, p. 184. Comparez ce fragment
d’une lettre de Berlioz à Humbert Ferrand : « A Paris, nous
assistons en ce moment au triomphe de Musard qui se croit, d’après ses succès
et l’assurance que lui en donnent les habitués de son bastringue, bien
supérieur à Mozart. Je le crois bien ! Mozart a-t-il jamais fait un
quadrille tapé comme celui de la Brise du matin, ou celui du Coup
de pistolet, ou celui de la Chaise cassée ? » (Lettres
intimes, p. 162 [CG no. 440, après le 23 août 1835]).![]()
(2) « N’avons-nous pas entendu, il y a quinze mois, chez Musard, et l’hiver
dernier chez Valentino, son Alla riva del Tebro ? » Chronique
musicale de Paris, par JOSEPH MAINZER, 1re livraison : M. Berlioz,
1838.![]()
(3) Compte rendu des Concerts-Valentino, par Berlioz, dans la Gazette
musicale du 29 octobre 1837.![]()
(4) Gazette musicale du 31 mai 1835.![]()
(5) Voy. Lettres à Humbert Ferrand, du 23 janvier 1836 (Let. int.
169 [CG no. 459]), et à Liszt, du 25 janvier (Années romantiques
[CG no. 461]). Berlioz dit dans la première : « On m’avait nommé
directeur général du Gymnase musical avec des appointements de six mille
francs, plus deux concerts sans frais à mon bénéfice et des droits d’auteur
pour chacune de mes compositions ; Thiers me fait perdre cette place en
refusant obstinément de permettre le chant au Gymnase. » A Humbert
Ferrand, il parle d’un appointement de douze mille francs : cela revient au
même si la recette de chaque bénéfiee devait s’élever à trois mille francs.![]()
(6) Plusieurs lettres de Berlioz nous renseignent sur ce projet avorté. Du
15 avril 1835, à Humbert Ferrand : « Je vais faire cet été une
troisième symphonie sur un plan vaste, et nouveau (Let. int. 170
[CG no. 429]). Il est probable que ce projet était le germe de celui qui
se formula d’une manière plus précise dans les lettres du 6 mai (à son père,
Années romantiques, p. 287 [CG no. 435]) du 2 août (à sa sœur
Adèle, p. 289 [CG no. 438 D]) et que nous voyons développer dans la
lettre postérieure à Humbert Ferrand (Let. int. 149 [sic
pour 159] [CG
no. 440, 23 août 1835] ).![]()
(7) Il est fort à croire que le mot « Jeudi » est là par une
erreur de plume. Le 22 novembre 1835 fut un dimanche, jour ordinaire des
concerts de Berlioz ; d’autre part, le projet de Fête funèbre n’ayant
laissé d’autres traces que celles que nous avons relevées en 1835, il est
difficile d’admettre que ces notes furent prises pour une autre année. Berlioz
donna un concert (avec un autre programme) ce même 22 novembre, et il en
annonça la date en des termes identiques à ceux que nous avons lus dans son
manuscrit : « 22 novembre 1835, Jour de la Sainte-Cécile ».![]()
(8) Les notes manuscrites de Berlioz laissées à la Bibliothèque du
Conservatoire abondent pour cette saison 1835 ; elles ne remplissent pas
moins de quatre cahiers en feuilles doubles, savoir : 1° Un projet
d’ensemble : Orchestre des trois concerts de M. H. Berlioz (il n’y
en eut que deux) en novembre et décembre 1835, — plus les chœurs
et la note des dépenses accessoires, huit pages autographes contenant plus
de cent noms et adresses de musiciens, et un devis des frais s’élevant, pour le
premier concert, à 1.782 francs.—2° Liste de l’orchestre pour le concert
du 13 novembre 1835 (le premier concert de la saison eut lieu le 22, mais la
liste semble avoir servi pour lui) quatre pages de noms et comptes divers se
résumant ainsi : Total pour l’orchestre, 1.000 francs ; chœurs (25
voix), 300 francs ; frais de salle et d’impression, 750 francs. Total
général sans y comprendre cependant le droit des indigents, 1.750
francs de frais. — plus la copie et les courses en cabriolet et le garçon
d’orchestre Legué. — 3° Orchestre pour mes concerts du mois de novembre
1835, autre liste de musiciens indiquant les prix à payer à chacun,
savoir : quelques-uns gratis (publions les noms de ces braves :
Seghers aîné, Bessems, de Flamesnil et « un camarade », violons ;
Desmarest, violoncelliste, et une contrebasse, Daniele, ainsi qu’un harpiste,
Larivière) ; les autres sont cotés : Un violon et une contrebasse à
15 francs ; le reste des cordes à 10 francs ; les instruments à
vent, 15 ou 12 francs ; quelques seconds à 10 francs ; les bassons et
cors à 20 francs. Notons le nom de Musard comme tambour de basque : ce chef
d’orchestre de bals fut donc de ceux à qui Berlioz eut recours pour
interpréter le pittoresque italien de la Symphonie d’Harold ! Au
revers de cette liste, écrite sur une longue feuille d’un papier ayant servi à
un emballage, on lit cette adresse :
M. Berlioz, rue Saint-Denis, no. 12, Montmartre. — 4° Orchestre des
concerts de M. H. Berlioz en novembre et décembre
1835, cahier de douze
pages, liste d’émargement contenant, en regard des noms écrits de la main de
Berlioz, la signature de chacun. — Rappelons cette phrase d’une lettre de
Berlioz à sa sœur : « J’ai donné le premier concert en société
avec le chef d’orchestre Girard, et le bénéfice a dû, en conséquence, être
partagé. » 24 décembre 1835, Années romantiques, p. 299 [CG
no. 454].![]()
![]()
![]() Le Ménestrel, 11
Décembre 1909, p. 395-396
Le Ménestrel, 11
Décembre 1909, p. 395-396
(Suite)
Et comme Berlioz était toujours retenu par l’appréhension de conduire l’orchestre, et que Girard lui prêtait le concours de son bras, il fallut bien que ce concours finit par donner lieu à une association. Ce fut ainsi que le concert donné au Conservatoire le jour de la Sainte-Cécile ne fut plus donné seulement « par M. Hector Berlioz », suivant la formule antérieure, mais « par MM. Hector Berlioz et Girard », et que les œuvres des deux associés tinrent une place à peu près équivalente sur le programme, que voici :
1° Grande ouverture d’Antigone, par M. Girard (exécutée pour la première fois) ; 2° Fantaisie, pour soprano et orchestre, de M. H. Berlioz, chantée par Mlle Falcon ; (1) 3° Le Cinq mai ou la Mort de Napoléon (de Béranger), chant de soldats pour vingt voix de basse à l’unisson, avec chœur et orchestre, de M. Berlioz (exécuté pour la première fois) ; 4° Harold, symphonie, etc. ; 5° Air du Crociato, de Meyerbeer, chanté par Mlle Falcon ; 6° Sonate fantaisie en ut dièse mineur, de Beethoven, mise en symphonie par M. Girard (exécutée pour la première fois).
Oh ! ce ne fut pas long ! Fût-ce le dégoût de voir déshonorer son programme par la MISE EN SYMPHONIE, perpétrée par Girard, de la Sonate en ut dièse mineur, de Beethoven, — fût-ce simplement le dépit de voir sa propre musique maltraitée par un chef d’orchestre maladroit et qui ne faisait aucun effort (2) — toujours est-il que, dès le second jour de l’association, Berlioz la rompit. La Gazette musicale du 29 novembre annonçait encore, pour le 6 décembre, un second concert Berlioz-Girard, reproduisant à peu près le programme du premier (la mise en symphonie de la sonate de Beethoven était placée en tête du programme, pour être exécutée pour la deuxième fois). Mais le numéro suivant du journal annonçait l’ajournement de la séance, qui, définitivement fixée au 13 décembre, ne fut plus, dès lors, que « le concert de M. Berlioz », tandis que le nom de Girard avait complètement disparu.
Car, surmontant ses craintes, l’auteur de la Symphonie fantastique s’était décidé à n’avoir plus désormais d’autre chef d’orchestre que lui-même.
Il faut reproduire le programme de ce premier concert où Berlioz prit le bâton qu’il sut manier bien vite avec autorité et maîtrise, car d’un accord unanime, ceux qui l’ont vu à l’œuvre ont déclaré le tenir pour le premier chef d’orchestre symphonique moderne.
1° Ouverture du Roi Lear ; 2° Le Cinq mai ou la Mort de Napoléon (exécuté pour la deuxième fois) ; 3° Symphonie fantastique ; 4° Air d’Armide, de Gluck (Plus j’observe ces lieux), chanté par Boulanger ; 3° Solo de violoncelle, par Batta ; 6° Le Moine, de Meyerbeer, chanté par Géraldi ; 7° Marche des Pèlerins d’Harold.
Remarquons que, sur ce premier programme dirigé par Berlioz, figure une page de Gluck, ainsi qu’une œuvre de Meyerbeer donnée en première audition.
Ce fut tout pour cette saison. Une autre direction musicale allait bientôt solliciter Berlioz et lui prendre tout le temps que lui laissaient sa collaboration aux journaux et la composition de Benvenuto Cellini : nous voulons parler des répétitions de la Esmeralda, de Mlle Louise Bertin, où il tenait lieu de l’auteur. Toute l’année 1836 fut prise par ces occupations, et il fallut encore attendre décembre pour le voir remonter sur l’estrade du Conservatoire.
Notons au passage une impression de ces concerts, qui nous fera constater l’intérêt qu’y prenaient de hautes personnalités contemporaines : c’est, sous la date de septembre 1836, le paragraphe final d’une des Lettres d’un voyageur de George Sand, dédiée à Giacomo Meyerbeer. Les détails qui y sont contenus établissent que le concert dont il est question est bien celui du 13 décembre 1835, où Berlioz dirigea pour la première fois l’orchestre, et où il fit entendre, avec la Symphonie fantastique, une composition nouvelle de l’auteur des Huguenots :
Vous souvenez-vous, maître, écrit George Sand, qu’un soir j’eus l’honneur de vous rencontrer à un concert de Berlioz ? Nous étions fort mal placés, car Berlioz n’est rien moins que galant dans l’envoi de ses billets ; mais ce fut une vraie fortune pour moi que d’être jeté là par la foule et le hasard. On joua la Marche au supplice. Je n’oublierai jamais votre serrement de main sympathique et l’effusion de sensibilité avec laquelle cette main chargée de couronnes applaudit le grand artiste méconnu qui lutte avec héroïsme contre son public ingrat et son âpre destinée ; vous eussiez voulu partager avec lui vos trophées, etc., etc.
Ayant constaté par ces lignes combien le cœur de Meyerbeer était plein de bonnes intentions (il aurait voulu partager ses trophées ! Et quel ne fut pas son désespoir quand il se vit obligé de les garder pour lui !), relevons simplement la malicieuse allusion de George Sand au peu de générosité de Berlioz en matière d’invitations à ses concerts. Lui-même a fait à cet égard des déclarations entièrement conformes. Il écrivait vers le même temps à sa sœur :
J’ai été assassiné de demandes de billets par les quarante ou cinquante journaux, petits et grands, qui déraisonnent dans Paris, et j’ai été obligé, pour ne pas m’attirer une avalanche d’injures dont ces messieurs ne se font pas faute pour se venger quand on les refuse, de leur donner tout ce qu’ils me demandaient.
Trois ans plus tard, pour la première audition de Roméo et Juliette, il dit à son père :
L’affluence a été telle qu’on a refusé au bureau pour plus de quinze cents francs de location malgré l’énorme quantité de billets que les exigences incroyables de la presse m’ont arrachée… (3).
Passons rapidement sur la suite, maintenant que le mouvement est imprimé. Le 4 décembre 1836, outre Harold et la Fantastique, le programme annonce l’air de Quasimodo de la Esmeralda (Mlle Bertin) chanté par Massol, — Une larme, harmonie religieuse de Lamartine, musique de Urhan, chantée par Mlle Falcon et accompagnée sur le violon et le violoncelle par l’auteur et Chevillard (saluons au passage le concours si anciennement prêté à Berlioz par le père d’un des plus distingués successeurs du maître comme chef d’orchestre symphonique) — et un solo de harpe par Labarre. « On a refusé du monde », dit la Gazette musicale (4).
Le 18 décembre, le concert est donné par Berlioz et Liszt : celui-ci fait entendre de nouveau sa fantaisie symphonique sur deux thèmes du mélologue, ainsi que sa transcription du Bal et de la Marche de la Fantastique. Il arriva plus d’une fois au grand virtuose (qui faisait ce jour-là une rentrée devant le public parisien, après une longue absence) de redire ainsi sur le piano ce que l’orchestre venait de faire entendre (il l’osa même pour des symphonies de Beethoven !) ; et voici en quels termes, à l’occasion d’un concert de quelques années postérieur, Berlioz apprécia lui-même cette prouesse et le sentiment dans lequel elle était réalisée :
Liszt, en exécutant après l’orchestre le Bal de la Symphonie fantastique, a fait un tour de force, non point dans le sens que l’on pourrait croire, c’est-à-dire en obtenant du piano des sons de masses orchestrales, mais en chantant les mélodies avec une grâce, un abandon, un voluptueux caprice que l’orchestre le plus simple, le plus exercé, le plus un dans sa complexité ne pourra jamais atteindre (5).
Se prodiguant ce jour-là, Liszt exécuta encore son Divertissement sur une cavatine de Pacini. Urhan, le violoniste romantique, qui jouait un grand rôle dans les concerts de Berlioz, donna une mélodie de sa composition : L’Ange et l’Enfant (poème qui devait être repris par César Franck), chanté par Mlle Nau, avec « accompagnement d’orchestre imitant la harpe éolienne ». Un solo de violoncelle par Lee, de Hambourg, un air de la Sonnambula (Mlle Nau), un autre de Mercadante (Alizard), figurèrent aussi sur le programme, que la virtuosité vocale et instrumentale encombrait grandement. Pour Berlioz, il en fut réduit ce jour-là à l’ouverture des Francs-Juges et aux deux premières parties d’Harold.
___________________________________
(1) Voir la demande d’autorisation adressée au directeur de l’Opéra pour
obtenir le concours de Mlle Falcon, lettre du 3 novembre 1835, Années
romantiques, p. 297 [CG no, 447].![]()
(2) A propos de Girard, M. Saint-Saëns a évoqué des souvenirs personnels
qu’il n’est point inopportun de rapporter ici. Il conte une visite qu’il eut
l’occasion de faire dans sa jeunesse à l’ancien associé de Berlioz, devenu
chef d’orchestre de la Société des Concerts. « Girard profite de la
circonstance pour me faire un cours de morale musicale et pour me dire, entre
autres choses, qu’il ne fallait pas employer les trombones dans une symphonie :
« Mais, lui répondis-je timidement, il me semble que Beethoven, dans la Symphonie
pastorale, dans la Symphonie en ut mineur… — Oui, me
dit-il, c’est vrai, mais il aurait peut-être mieux fait de ne pas le faire. »
On comprend, avec de tels principes, ce qu’il devait penser de la Symphonie
fantastique. » CAMILLE SAINT-SAËNS, Portraits et Souvenirs, p.
11.![]()
(3) Les Années romantiques, pp. 321-22 et 407-08 [CG nos. 485
et 683].![]()
(4) Sur l’organisation de ce concert, nous trouvons encore des notes de
Berlioz, non plus parmi les papiers laissés au Conservatoire, mais dans un
album conservé par la famille, duquel nous avons déjà extrait d’autres
renseignements. Bornons-nous ici à reproduire les suivants : Aujourd’hui
Ludi (sic) 28. — Chez Liszt. — Aller chez
Schlesinger prendre de l’argent. — Chez M. Mantoue pour le droit des
pauvres. — Porter ou envoyer le reste des journaux. — Aller
aux Débats, rue de la Victoire, pour l’affaire d’Urhan… — Aller chez
Mlle Bertin. — Envoyer des billets à Ch. Maurice, etc. En marge :
Attention : envoyer la loge aux de Rohan. — Faire imprimer les
grands programmes de la Symphonie. Puis, aux pages suivantes, un compte de
places destinées à la location et confiées, pour être placées, à
Schlesinger, Pacini, Ste B. Puis encore : J’ai pris 50 francs chez M.
Réty, 10 francs chez Schlesinger, — plus 10 francs que je lui dois.![]()
(5) Revue et Gazette musicale du 12 juin 1844.![]()
![]()
![]() Le Ménestrel, 25
Décembre 1909, p. 410-411
Le Ménestrel, 25
Décembre 1909, p. 410-411
(Suite)
1837 est l’année du Requiem. Tout l’effort de Berlioz se porte exclusivement sur la composition et l’exécution de cette œuvre : il ne donne donc pas de concerts (1). Mais il s’est si bien entraîné à la direction de l’orchestre, lui qui, il y a dix-huit mois, tremblait devant ses dangers, que maintenant il ne veut plus que personne autre que lui conduise ses œuvres ; et l’on sait à quels incidents a donné lieu, à l’occasion de cette exécution, sa rivalité avec Habeneck.
En 1838, Benvenuto Cellini est représenté et tombe. Il faut donc que Berlioz en revienne à ses concerts, puisque c’est encore là qu’il réussit le mieux. Le 25 novembre, il annonce l’ouverture du Roi Lear, d’importants fragments du 3me acte d’Alceste de Gluck (scène des Enfers) et de la partie correspondante d’Alceste de Lulli (air de Caron, chanté par Alizard), le piquant madrigal à deux voix de l’abbé Clari, Cantando undi, enfin, de lui-même, la Fantastique, le Jeune pâtre breton et l’ouverture de Waverley.
Le jour du concert, une annonce fait savoir que Mmes Dorus-Gras et Stoltz, dévouées interprètes de Benvenuto, chanteront leurs airs de cet opéra pour remplacer une autre cantatrice indisposée.
Mais, et ceci est plus grave, Berlioz, épuisé par tant de besognes et de déboires, a dû lui-même renoncer à conduire : il est malade ; Habeneck, obligeamment, le remplace.
Un intéressant compte rendu est écrit à cette occasion par Stephen Heller (2).
Enfin, voici, trois semaines plus tard (16 décembre 1838), le vrai concert de réhabilitation, celui qui annonce la renaissance, le « retour à la vie », pour employer la propre expression de Berlioz. Le vaincu a pu se traîner jusqu’à la salle du concert. Ses deux symphonies sont inscrites ; entre elles, du Gluck (Alceste) et quelques autres morceaux moindres. Mais il est un numéro qui n’est pas annoncé par le programme, le dernier : après la dernière note de la Ronde du Sabbat, Paganini monte sur l’estrade et s’agenouille devant Berlioz (3).
La conséquence immédiate de ce geste, ce furent les trois concerts des 24 novembre, 1er et 15 décembre 1839, où furent données les premières auditions de Roméo et Juliette, symphonie dramatique, dédiée à Nicolo Paganini.
Voici le programme du premier :
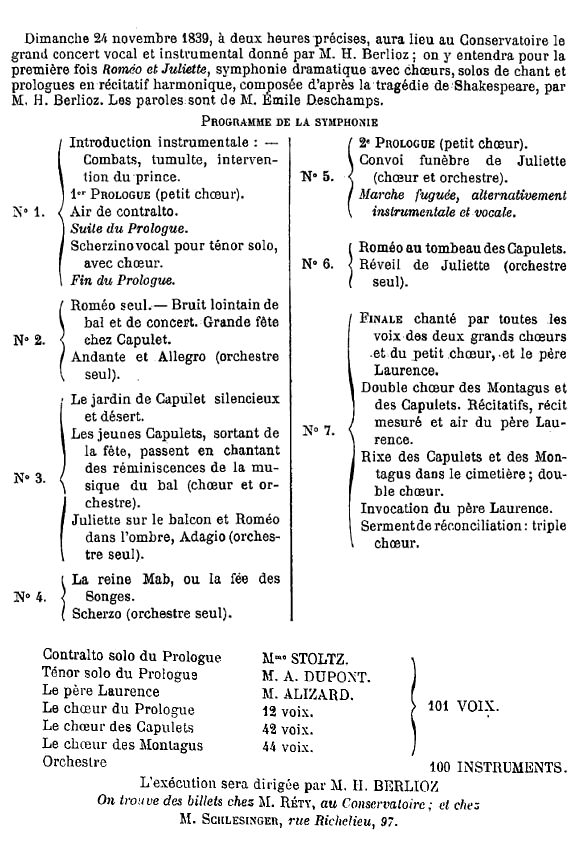
Ces concerts appartenant à l’histoire générale de la musique autant et plus qu’à ce qui fait l’objet particulier de ce chapitre, nous n’y insisterons pas. Rappelons seulement que Mme Stoltz, indisposée, fut remplacée par Mme Widemann, qui fut ainsi la première interprète des strophes du prologue ; qu’annoncée de nouveau pour le troisième, où le programme avait été enrichi de son air d’Ascanio dans Benvenuto Cellini et des deux premières partie d’Harold, elle fit encore défaut, et que Madame Dorus-Gras vint à sa place dire l’air de son propre rôle de Teresa.
Mais voici de l’inédit sur ces auditions mémorables. Ce sont encore les papiers laissés par Berlioz à la Bibliothèque du Conservatoire qui vont nous le fournir. Il s’agit ici de deux grandes pages, remplies de sa main, et portant en titre : Billets à donner, — Suite des billets à donner. Nous pourrons ainsi connaître par leurs noms les principaux auditeurs et reconstituer la physionomie de la salle à la première audition de Roméo et Juliette. Passons rapidement sur ceux qui, ayant coutume de rendre leurs bons offices à Berlioz, avaient bien le droit d’être remerciés par quelques invitations : Urhan, Desmarest, Alard, Dieppo, Hallé, Dietsch, Seghers, Habeneck, Girard, Alizard, Panofka, Réty, etc. Mais le groupe des gens de lettres mérite qu’on lui prête attention. « C’était un cerveau que votre salle », disait Balzac à Berlioz en le complimentant (4). En effet, parmi les invités, on trouve les noms d’Alfred de Vigny, Théophile Gautier, Henri Heine, Brizeux, toute la famille Bertin, Jules Janin, Mme de Bawr, Mme Liszt (la mère), Horace Vernet et sa fille Mme Delaroche, Emile et Antony Deschamps, Scribe, Raoul Rochette, Kastner, Germain Delavigne, Léon Pillet, Cavé, etc.
Une notabilité dont le nom mérite d’être relevé, c’est Schindler. L’ami de Beethoven était en effet à Paris vers ce temps-là. Il eût été intéressant de savoir ce qu’il pensait de la symphonie de Berlioz ; mais nous n’avons pas connaissance qu’il ait fait part de son opinion à personne.
A la fin de la page 1, ces simples mots :
« Mme Berlioz — 6 [places] — La loge ».
La Juliette, l’Ophélie de 1827 méritait en effet d’être bien placée à ce concert-là.
Une large part est faite au service de presse : d’Ortigue, Léon Kreutzer, Ch. Maurice, Villemessant, Thierry, Hyp. Prévost, y sont compris nominativement. Le Ménestrel, tout jeune périodique musical, est porté pour deux parquets (5).
Il y avait aussi quelques musiciens, — pas beaucoup, ni de bien considérables : Farrenc, Elwart, Boisselot, Stephen Heller, Auguste Morel.
Faisons pourtant attention à celui-ci, que nous trouvons perdu dans la foule. Berlioz l’a inscrit de sa main, pour une seule place. Voici son nom :
« R. Wagner. »
On sait que Richard Wagner était arrivé pour la première fois à Paris, venant de Riga, dans le courant de l’automne 1839 (6).
___________________________________
(1) Au nombre des papiers autographes laissés par Berlioz au Conservatoire est un cahier de 16 pages (verso laissé en blanc sur la plupart) qui ne porte pas de titre, mais dont le contenu indique, sans doute possible, qu’il a rapport à la préparation de l’exécution du Requiem : les violons sont au nombre de 40 ; les basses, 16 à chaque partie ; 12 cors, 11 trompettes et cornets à pistons ; 20 trombones et ophicléides ; 10 timbaliers ; un chœur de 155 voix, etc. Et, pour résumer, le compte suivant, que nous reproduisons textuellement :
20 enfants à 40 francs chacun et 135 choristes devant faire TROIS répétitions et l’exécution pour 35 fr. chacun, en somme font |
|
|
162 musiciens d’orchestre devant faire 2 répétitions et l’exécution pour 30 fr., en somme font |
|
|
Pour Duprez |
400 fr. |
|
Pour Habeneck |
400 fr. |
|
Menus frais et transports d’instruments |
400 fr. |
|
Dette du Ministre de l’Intérieur pour le compositeur, la copie et les répétitions faites en juillet |
|
|
|
_________ |
(Suivent encore quelques dispositions de détail, qui d’une part augmentent
les frais de 160 francs et d’autre part les diminuent de 360.)![]()
(2) Revue et Gazette musicale du 2 décembre 1838.![]()
(3) Papiers de Berlioz, à la Bibliothèque du Conservatoire, relatifs aux
deux concerts de novembre et décembre 1838 : 1° Lettre de H. Réty,
secrétaire du Conservatoire (3 décembre), annonçant un envoi de
billets ; 2° Note d’imprimerie (22 décembre), 34 francs ; 3° Mémoire
des impressions faites pour le service de M. Berlioz, par Vinchon, fils et
successeur de Mme Ve BALLARD, imprimeur, rue J.-J. Rousseau, 8
(Ballard ! ce nom, évoqué à propos de Berlioz, nous ramène à Louis XIV,
— que dis-je ? à Charles IX !) Pour les deux concerts de novembre
et décembre, les frais d’affiches, programmes (y compris mille exemplaires de
l’Épisode de la vie d’un
artiste, sur raisin rose), timbrés à 1, 5, et 10
centimes, s’élèvent à un total de 366 francs.![]()
(4) Lettre de Berlioz à son père, du 26 novembre 1839 (Années
romantiques, p. 408 [CG no. 683]).![]()
(5) Voici quelques-unes des appréciations du Ménestrel sur Roméo
et Juliette, première occasion sans doute qu’eut ce journal de s’occuper de
Berlioz, en en attendant beaucoup d’autres :
No. du 1er décembre 1839 : « Hâtons-nous de dire que M. Berlioz
a remporté un grand succès, mais nous faisons nos réserves.
« Il faut avouer que la symphonie avec chœurs est un véritable
événement dans le monde musical. Beethoven l’avait entrevu, mais il nous avait
légué sa pensée à l’état d’ébauche. Cette pensée, Berlioz vient de la
réaliser dans toute sa plénitude. La symphonie avec chœurs sera désormais à
l’opéra ce que l’épopée est au drame. »
Au numéro suivant (8 décembre), le critique déclare avoir
« pénétré
plus avant dans cette forêt musicale », et il apprécie chaque morceau en
des termes, parfois maladroits et naïfs, mais assez justes pour nous donner la
preuve que Berlioz pouvait être suffisamment compris en 1839 lorsqu’on voulait
bien se donner la peine de l’écouter.![]()
(6) Les papiers de Berlioz restés au Conservatoire comprennent encore une
note autographe relative au placement de quelques billets, et un compte des
trois concerts établi par H. Réty, secrétaire du Conservatoire, établissant
les recettes faites par le Conservatoire et par la maison Schlesinger, et les
dépenses réglées au Conservatoire. Ce compte, étant incomplet, ne nous
parait pas d’un intérêt suffisant pour être reproduit ici.![]()
![]()
![]() Le Ménestrel, 8
Janvier 1910, p. 11-12
Le Ménestrel, 8
Janvier 1910, p. 11-12
(Suite)
Les répétitions étaient accessibles à ceux qui savaient s’intéresser à ces travaux préparatoires. Gounod, alors élève d’Halévy, a raconté, dans la préface qui lui fut demandée pour les Lettres intimes de Berlioz, qu’il assista à celle de Roméo et Juliette et y fut si fortement frappé par le chant du « Serment de réconciliation » qu’il put, après la séance, le redire par cœur, sur le piano, à l’auteur qui « n’en revenait pas ».
La symphonie Roméo et Juliette eut donc pour premiers auditeurs un parterre de rois de la pensée et de l’art.
Le 6 février 1840, Berlioz dirigea le concert symphonique offert par la Gazette musicale à ses abonnés. Harold et l’ouverture de Benvenuto y triomphèrent. « Fétis a failli en avoir un coup de sang… de rage », écrivit-il (1). A noter la présence sur le programme de la vieille ouverture de Démophon, de Vogel, célèbre au XVIIIe siècle, type et modèle (après Gluck) des ouvertures françaises de Méhul, Cherubini, etc.
Puis il composa sa Symphonie funèbre et triomphale pour le dixième anniversaire des journées de Juillet 1830. L’exécution, le 28 juillet 1840, en plein air, par un orchestre militaire de deux cents instrumentistes, fut précédée par une répétition à demi publique dans la salle des concerts de la rue Vivienne (Valentino), le 26, et suivie par deux concerts, dans la même salle, où la nouvelle symphonie fut le morceau de résistance (6 et 14 août). L’ouverture de Benvenuto Cellini, les trois premières parties d’Harold, le Bal et la Marche de la Fantastique, ainsi que la Fête chez Capulet de Roméo l’accompagnèrent à tour de rôle (2).
Trois mois après, Berlioz tenta l’un des principaux efforts de sa carrière de directeur de concerts : il donna à l’Opéra, le 1er novembre, son premier grand festival pour orchestre, soli et chœurs : 430 exécutants, disait l’affiche. Le chapitre LI des Mémoires a donné sur cette manifestation des détails circonstanciés et très fidèles. Bornons-nous à rappeler que le programme comprenait un acte entier d’Iphigénie en Tauride de Gluck, pour la première fois transportée au concert, un fragment en chœur avec solo de Haendel (Athalie), le madrigal de Palestrina : Alla riva del Tebro, et des fragments de deux œuvres de Berlioz, le Requiem et Roméo et Juliette, ainsi que la Symphonie funèbre et triomphale dans son entier (3).
Le 13 décembre suivant, concert symphonique au Conservatoire. Le répertoire berliozien en fait tous les frais : Roméo, Fantastique, l’Orientale de Victor Hugo à 4 voix (Sara la baigneuse) et le Cinq mai, ce dernier morceau étant de circonstance à la veille du retour des cendres de Napoléon à Paris (4).
L’année 1841 ne voit aucun concert de Berlioz. Le compositeur-chef d’orchestre se prépare à ses tournées d’Allemagne ; il est, en outre, occupé à présider à l’exécution du Freischütz à l’Opéra. Il songe à l’éventualité d’une combinaison qui, basée sur la retraite de Cherubini qui serait remplacé par Habeneck comme directeur du Conservatoire, lui permettrait de devenir chef d’orchestre de l’Opéra (5) — car il voit bien que c’est comme chef d’orchestre que sont, au point de vue de la vie pratique, ses meilleures chances d’avenir. Mais cette combinaison ne se réalise pas.
En février 1842 il donne deux concerts à la salle Vivienne, les mardis 1er et 15 : Harold, Fantastique, Symphonie militaire (funèbre et triomphale) ; puis, pour la première fois au concert, l’Invitation à la valse, orchestrée pour l’Opéra, et une première audition : la Rêverie et Caprice pour le violon (avec accompagnement d’orchestre) exécutée par Alard aux deux séances. Comme œuvres d’autres compositeurs, il faut noter la première audition à Paris du triple concerto pour piano, violon et violoncelle, de Beethoven, avec Hallé, Alard et Desmarest pour solistes, et un Caprice symphonique pour piano, de Stephen Heller (6).
Le 7 novembre, dans une représentation ordinaire de l’Opéra (un dimanche), Berlioz est admis à conduire l’orchestre, non pourtant sans restrictions à son autorité de chef : entre un acte de Gustave ou le Bal masqué, d’Auber, et le ballet Giselle, d’Ad. Adam, on a placé une audition de la Symphonie funèbre et triomphale, à deux orchestres et chœur (car Berlioz a ajouté les voix et les cordes à son instrumentation première). Mais Habeneck reste à son pupitre dans l’orchestre, tandis que Berlioz est sur la scène, conduisant la bande militaire et le chœur.
Puis, le mois suivant, il part pour l’Allemagne. Déjà, il y a quelques semaines, il a dirigé à Bruxelles les deux premiers concerts qu’il ait donnés à l’étranger.
Nous ne le suivrons pas dans ses pérégrinations hors de France. Là, il a pour but exclusif la propagation de son œuvre, tandis qu’à Paris nous le verrons s’appliquer plus résolument encore au retour à faire l’éducation du public en lui offrant l’audition d’œuvres autres que les siennes. Constatons simplement que, par ses campagnes répétées en pays étranger, il inaugura, lui premier sans conteste, ces tournées de compositeurs-chefs d’orchestre qui se renouvelèrent souvent, parfois avec éclat, après lui : il suffit pour s’en convaincre de rappeler les concerts donnés en pays étrangers par Richard Wagner, et, plus récemment, par les maîtres russes, M. Richard Strauss, M. Vincent d’Indy, etc. Insistons aussi sur le fait que cette initiative prise par le maître français en 1842 était un peu plus hasardeuse que les entreprises de ses successeurs. Ceux-ci n’ont plus aujourd’hui qu’à monter dans un wagon de chemin de fer pour être arrivés le lendemain à destination, toutes dispositions ayant d’ailleurs été prises au préalable grâce à la facilité et la promptitude des communications postales et télégraphiques. Il n’en était pas de même dans la première moitié du XIXe siècle. Les premiers voyages de Berlioz furent encore faits par les moyens primitifs et coûteux de l’antique voiture publique. Il arrivait dans les villes sans qu’il y eût rien, ou presque, d’organisé pour le recevoir ; aussi, bien des fois se trouva-t-il découragé et prêt à retourner sur ses pas : il en fut ainsi notamment pendant la première partie de son premier voyage en Allemagne, qui débuta vraiment fort mal. Son récit (7) le montre aux prises avec des difficultés telles, à Bruxelles, à Mayence, à Francfort, qu’il dut renoncer à donner concert dans ces villes, bien qu’en partant il s’en crût assuré. La continuation et l’achèvement de la tournée furent, à la vérité, plus heureux, et il put revenir en France, non sans quelque gloire, et ayant acquis un surcroît d’autorité en dirigeant des orchestres au pays de la symphonie.
A peine de retour, on le voit remonter sur la brèche. Le 19 novembre 1843, il fait sa rentrée devant son public parisien ordinaire en dirigeant au Conservatoire un concert entier de ses œuvres : au programme, outre nos vieilles connaissances : Harold, Roi Lear, Symphonie triomphale, Reine Mab, Romance pour violon, cavatine de Benvenuto, il produit pour la première fois au concert le trio du premier acte de son opéra, chanté par les créateurs, Mme Dorus-Gras, Duprez et Massol, et donne en outre une véritable première audition : Absence, mélodie avec orchestre (paroles de Théophile Gautier), avec Duprez pour interprète. Les frais sont de 2.021 francs, la recette de 2.570 francs : il y a donc un bénéfice de 549 francs (8).
Mais ce concert dut laisser à Berlioz un souvenir mélancolique : ce fut le dernier qu’il lui fut permis de donner dans la salle du Conservatoire, qui lui fut désormais fermée. Il s’est expliqué sur cette exclusion avec une amertume trop légitime. Dans la première conclusion de ses Mémoires, il dit :
La coterie du Conservatoire a trouvé le moyen de me faire interdire l’accès de la salle, et M. le Ministre de l’Intérieur est un jour venu, à une distribution de prix, déclarer à tout l’auditoire que cette salle (la seule convenable qui existe à Paris) était la propriété exclusive de la Société du Conservatoire, et qu’elle ne serait plus désormais prêtée à personne pour y donner des concerts. Or, personne, c’était moi ; car, à deux ou trois exceptions près, aucun autre que moi n’y avait donné de grandes exécutions musicales depuis vingt ans (9).
Il n’est guère possible en effet d’exagérer le dommage que cette injustifiable mesure causa à Berlioz. Nul doute que si, trois ans plus tard, il eût pu disposer encore du Conservatoire, le public, habitué à l’y suivre, n’eût pas délaissé la Damnation de Faust comme il fit tout naturellement quand le chef-d’œuvre fut relégué dans un local défavorable : par cela seul l’orientation de la fin de sa vie eût été changée, et Berlioz ne serait pas mort désespéré. Que la responsabilité d’un tel résultat retombe sur qui de droit. Aussi bien, il n’y a pas à faire doute que cette interdiction ait été une mesure hostile prise contre lui personnellement. Cela est si vrai qu’un an n’était pas encore passé depuis son dernier concert quand Félicien David obtint la salle pour faire entendre le Désert (8 décembre 1844). Reber, César Franck, M. Weckerlin, d’autres encore, purent y donner concert à leur tour. Quand Pasdeloup fonda les Concerts populaires, bien que les exécutions eussent lieu ailleurs il jouit de la faveur d’y faire deux répétitions par semaine. Pourtant, si l’antériorité confère des droits (ne parlons pas du génie !) Berlioz en avait d’évidents ; il avait donné son premier concert dans l’année même de la première session de la société ; son entreprise était donc presque aussi ancienne. Et quelle prétention exorbitante que celle d’un orchestre qui, parce qu’il donnait neuf concerts dans l’année, s’arrogeait le droit de fermer à toute autre pendant le reste du temps la seule salle — propriété de l’État, non la sienne — qui existât alors ? C’est donc par droit de conquête que Berlioz fut chassé de la place, et cela ne fut ni généreux ni digne d’un groupe d’artistes qui aurait dû avoir pour unique préoccupation le progrès et les intérêts de l’art (10).
___________________________________
(1) Lettre à sa sœur Adèle, du 13 février 1840 (Années romantiques,
p. 415 [CG no. 703]).![]()
(2) La Bibliothèque du Conservatoire possède trois exemplaires du programme
original du 6 août, encadré d’une vignette bien dans le goût du temps.![]()
(3) La Bibliothèque du Conservatoire possède un exemplaire du programme de
ce Festival.![]()
(4) Papiers Berlioz au Conservatoire : Compte (incomplet) des recettes
et dépenses du concert du 13 décembre 1840, signé Réty.![]()
(5) Lettre à Humbert Ferrand du 3 octobre 1841 (Lettres intimes, p.
195 [CG no. 755]).![]()
(6) Papiers de Berlioz au Conservatoire : sur ces concerts de février
1842, programme (lithographié) du 15 ; enveloppe portant ces mots en
suscription, de la main de Berlioz : Liste des billets que j’ai reçus
et envoyés pour le concert du 1er février, et contenant une note dont la
conclusion est : En somme, au maximum il y aura 280 billets
donnés ; resteront 720 places payantes, à peu près 3.000 francs. —
Reçu du droit des indigents, 212 fr. 75 c, daté 1er février 1842, et
deux reçus pour le service de la garde (10 francs) et celui de deux sergents de
ville (2 francs).![]()
(7) Premier voyage en Allemagne, dix lettres reproduites dans les Mémoires.![]()
(8) Papiers de Berlioz au Conservatoire : 2 programmes imprimés, dont
l’un est épinglé avec trois pièces de comptabilité manuscrites, deux de la
main de Berlioz (l’une est une liste de choristes, étrangère d’ailleurs à
l’organisation définitive de ce concert, qui fut donné sans chœur).![]()
(9) Berlioz dit encore : « Cette société célèbre, dont presque
tous les membres exécutants sont de mes amis ou partisans, est dirigée par un
chef et par un petit nombre de faiseurs qui me sont hostiles. » Ce chef
était Girard, devenu aussi chef d’orchestre de l’Opéra, et dont nous avons vu
quelles avaient été autrefois les relations avec Berlioz.![]()
(10) Il est bien entendu que nous ne faisons ici que de l’histoire et que la
Société des Concerts de 1909 n’est aucunement visée par des observations qui
s’appliquent à la Société de 1843.![]()
![]()
![]() Le Ménestrel, 15
Janvier 1910, p. 20
Le Ménestrel, 15
Janvier 1910, p. 20
(Suite)
Voici donc maintenant Berlioz errant à la recherche d’une salle où il pût faire entendre au public parisien ses œuvres et celles de ses maîtres préférés. Nous le trouvons d’abord émigrant à la salle Herz. Le 3 février 1844, il y donne un concert avec orchestre et chœurs, dont le programme est intéressant : outre les trois morceaux symphoniques de Roméo et Juliette et l’Invitation à la valse, ainsi que d’importants fragments de l’Alceste de Gluck (comprenant des morceaux empruntés aux deux partitions, l’italienne et la française : l’air Divinités du Styx, par exemple, était chanté sur des paroles reproduisant littéralement les mots italiens : Ombres ! Larves !), on y entendit plusieurs compositions nouvelles, dont l’ouverture du Carnaval romain, une scène de Faust : Marguerite seule (ceci deux ans et demi avant la Damnation), la ballade d’Hélène (des Mélodies irlandaises) transcrite pour chœur d’hommes et orchestre, et un Hymne pour six instruments à vent inventés par Adolphe Sax (1).
Obligé de courir de salle en salle, Berlioz en est réduit à donner ses concerts dans des théâtres. Il loue l’Opéra-Comique pour y donner un concert spirituel le Samedi-Saint 6 avril. Le programme est bien ce qu’il faut pour une audition théâtrale : rien que de petites œuvres, douze numéros, pas de symphonie (sauf la Funèbre et triomphale, qui est si peu symphonique), mais des fragments d’opéras (duo d’Armide, un morceau de Robert le Diable transcrit pour les instruments Sax), des concertos de violon (Sivori) et de piano, deux ouvertures de Berlioz, le Cinq mai, le Sanctus du Requiem. Notons ici un délicat souvenir donné par Berlioz à la mémoire de son maître : il fait chanter par Alexis Dupont le motet de Lesueur : In media nocte (la veillée de David), « qui a un si beau caractère », écrit-il (2).
Le 4 mai, autre concert au théâtre — le Théâtre-Italien cette fois. Liszt y prête son concours (3) : il joue le concerto de Weber, sa Fantaisie sur Don Juan, et, après l’orchestre, le Bal de la Symphonie fantastique ; puis encore Trois mélodies hongroises (s’agirait-il de la première audition des célèbres et resplendissantes Rapsodies ?), et le concert s’acheva par un « Hexameron, variations brillantes pour deux pianos, composées par Thalberg, Herz, Chopin, Czerny, Pixis et Liszt, exécutées par Liszt et Döhler. » Puis encore du Bériot, du Lachner, une scène de Weber : que restait-il donc pour place à Berlioz ? Tout juste celle de faire entendre Harold et le Carnaval romain, et ce n’était guère la peine de déranger pour cela les 140 musiciens qu’annonce le programme (4).
En vérité, l’ère des difficultés était ouverte ; loin d’être parvenue à l’état d’institution stable, celle qu’avait tentée Berlioz était déjà en décadence.
Il n’en rêvait pas moins de faire grand, toujours plus grand. Et c’est en cette même année 1844, le 1er août, à l’occasion de l’Exposition des produits de l’Industrie, qu’il accomplit sa tentative la plus hasardée, celle d’un festival dont l’exécution ne demandait pas moins de mille exécutants et exigeait les trente-deux mille francs réalisés par la recette pour que les frais en fussent couverts. Les Mémoires ont raconté en détail les péripéties de cette entreprise ; des lettres, que nous publierons prochainement dans un deuxième volume de correspondance de Berlioz, ajouteront quelques précisions à son récit. Rappelons simplement ici que le programme comprenait les noms et les œuvres des plus grands maîtres du passé et du présent : Beethoven, Gluck, Weber, Spontini, Rossini, Auber, Halévy, Mendelssohn, Meyerbeer (5), un chœur inédit de Méreaux, enfin trois morceaux de Berlioz, dont l’Hymne à la France avait été spécialement composé pour cette occasion. La critique constata que cette puissante manifestation d’art rappelait « les temps héroïques de la République française, alors que les Méhul, les Berton, les Lesueur, les Catel et les Cherubini (6) mettaient leur génie au service de la patrie et créaient notre école musicale (7) ».
C’est aussi de ce jour que date la réputation particulière faite à Berlioz, que résume le mot historique d’un grand personnage (serait-ce point quelque vieux maréchal de France ?) : « Alors, c’est vous qui faites de la musique pour cinq cents musiciens ?… »
Quant à lui, au prix de mille labeurs, il s’estima heureux d’avoir pu réaliser un bénéfice de huit cents francs ! (8)
Depuis lors, et jusqu’au jour où il eut à offrir au public son plus définitif chef-d’œuvre, c’est-à-dire pendant deux ans et plusieurs mois, Berlioz renonça à organiser des concerts à Paris sous sa responsabilité personnelle. Mais il ne resta pas inactif pour cela, car il eut à diriger quatre grandes auditions musicales qui eurent lieu au Cirque des Champs-Elysées, de par l’initiative du propriétaire de cet établissement. Ce fut ainsi que l’on entendit pour la première fois de la musique symphonique et chorale dans un cirque, idée dont devaient grandement bénéficier, par la suite, Pasdeloup d’abord, au boulevard des Filles-du-Calvaire, puis Charles Lamoureux, dans ce même Cirque des Champs-Elysées où il fit connaître en premier lieu au public parisien les oratorios de Bach et d’Haendel, et où il revint plus tard pour y révéler Wagner et les œuvres de la jeune école française. Souvenirs déjà lointains ! Cet édifice d’harmonie, où nous avons éprouvé tant d’impressions inoubliables, a maintenant disparu sous la pioche des démolisseurs. Les regrets n’en doivent-ils pas être plus vifs encore quand nous songeons que ce fut Berlioz qui l’inaugura ?
A la vérité, il n’eut pas l’idée qui seule a permis d’employer utilement les cirques aux auditions symphoniques, celle qui consiste à dresser pour les exécutants une estrade appliquée à l’un des côtés de l’amphithéâtre. Pour lui, il avait placé son personnel orchestral dans l’arène, tandis que, sur un des côtés, une petite estrade mettait bien en vue le chef d’orchestre, les solistes et un petit chœur ; du côté opposé, le chœur principal s’étageait sur les gradins de l’amphithéâtre. Les solistes étaient séparés du chœur par toute l’étendue de l’orchestre, et c’était là une disposition peu heureuse.
___________________________________
(1) La Bibliothèque du Conservatoire possède tout un paquet de programmes
de ce concert (17 exemplaires).![]()
(2) Lettre de Berlioz, du 15 mars 1844 [CG no. 889], imprimée dans
OCTAVE FOUQUE, Un précurseur de Berlioz, J.-F. Lesueur, dans les
Révolutionnaires de la Musique, p. 160.![]()
(3) Par une lettre du 16 mars 1844 [CG no. 890], Berlioz, informé que
Liszt était à la veille de venir à Paris, lui avait demandé son concours
pour son concert du 6 avril. L’événement nous apprend que ce concours fut
accordé un mois plus tard.![]()
(4) Programme conservé parmi les papiers de Berlioz à la Bibliothèque du
Conservatoire (3 exemplaires).![]()
(5) Deux des morceaux que Berlioz avait inscrits sur ce programme sont
restés longtemps au répertoire des concerts d’orchestre et chœurs : la Bénédiction
des poignards, qui ne disparut qu’à partir du moment où Meyerbeer cessa de
plaire au public symphonique, et la scène des jardins d’Armide, avec sa
gavotte et ses chœurs ravissants (Jamais dans ces beaux lieux, Voici
la charmante retraite), que Pasdeloup se plaisait à diriger dans les
grandes occasions, et que nous nous souvenons d’avoir entendue encore dans un
grand festival en l’honneur de Berlioz, dirigé par Ernest
Reyer, à l’ancien
Hippodrome, vers 1880 [le 8
mars 1879].![]()
(6) N’est-il pas digne de remarque de constater combien Gossec, véritable
initiateur du mouvement dont il est ici parlé, était oublié, quinze ans à
peine après sa mort, quand nous voyons son nom omis d’une pareille
énumération !![]()
(7) Revue et Gazette musicale, 4 août 1844.![]()
(8) Mémoires, chapitre LIII.![]()
![]()
![]() Le Ménestrel, 22
Janvier 1910, p. 27-28
Le Ménestrel, 22
Janvier 1910, p. 27-28
(Suite)
Les concerts eurent lieu les 19 janvier, 16 février, 16 mars et 6 avril 1845. Il s’en faut qu’ils aient été consacrés exclusivement, ni même principalement, aux œuvres de Berlioz : sauf le Tuba mirum du Requiem, dont les grandes lignes se développaient largement dans l’ampleur du vaisseau, et qui, pour cette raison, fut répété à chaque séance, les programmes ne comprirent, de la composition du chef, que l’Hymne à la France, des fragments de Roméo et Juliette (notamment le finale à trois chœurs), les ouvertures des Francs-Juges et du Carnaval romain, ainsi que la Tour de Nice (donnée pour la première et unique fois le 19 janvier) et l’orchestration de l’Invitation à la valse. Mais Beethoven, avec le concerto pour piano en mi bémol, Gluck, avec les grandes scènes (l’Orphée et l’Alceste, Piccinni même, avec le chœur du sommeil d’Atys (comme si Berlioz avait voulu reprendre pour lui le mot qui l’avait scandalisé naguère : « J’ai été fervent gluckiste — et piccinniste, donc ! »), Weber (ouverture du Freischütz), Rossini (Prière de Moïse) contribuèrent largement au répertoire de la saison. Les œuvres nouvelles n’y furent pas négligées non plus : le Désert, dans tout l’éclat de son premier succès, prit la principale place du deuxième concert, et des fragments d’Esmeralda, de Mlle Bertin, parurent au programme du quatrième. Il y eut même plusieurs premières auditions : outre la Tour de Nice, déjà citée, un Chœur de Janissaires et un Nonetto pour instruments à vent, de Félicien David ; une Ouverture du Spectre, de Schneitzhœffer ; la Marche marocaine, de Léopold de Meyer, exécutée sur le piano, le 16 février, par l’auteur, puis, « instrumentée avec une coda nouvelle par M. Berlioz » et donnée sous cette forme le 6 avril. Enfin (et cela est plus intéressant) Berlioz fit connaître pour la première fois au public français les œuvres de l’école russe, en donnant au troisième et au quatrième concert divers fragments de la Vie pour le Tzar et de Rousslan et Ludmilla, de Glinka.
Cette activité artistique eût été digne d’un meilleur succès — car, on le devine, l’entrepreneur de ces concerts — Franconi, puisqu’il faut l’appeler par son nom ! — n’y fit pas ses frais. Pourtant, le public avait montré quelque curiosité ; les artistes, trouvant un débouché pour les œuvres nouvelles, avaient tout intérêt à soutenir l’entreprise. Mais le fruit n’était pas mûr : un autre devait le cueillir — plus de quinze ans plus tard.
De fait, en ces quatre concerts Berlioz avait plus fait pour le progrès de l’art que pendant toute sa session (et quelques autres encore) la Société des Concerts, se reposant paresseusement sur ses lauriers d’autrefois. Il devint une figure à la mode : le chef des festivals, celui qui déchaîne l’ouragan des instruments et des voix ! Un roman à clefs, Jérôme Paturot, satire de la société parisienne à cette époque (1846), lui fait place dans un chapitre consacré aux pratiques de la vie mondaine.
L’auteur (Reybaud) imagine qu’à la faveur d’une œuvre de bienfaisance, ou soi-disant telle, la patronnesse songe à rechercher l’attraction d’un festival. Pour cela, elle s’adresse « à l’artiste breveté qui exécute ce genre de plaisanteries ».
Après avoir secoué quatre fois sa crinière, l’artiste promit. Billets à 15 fr. ; neuf cent soixante et douze exécutants, une messe de mort, et le Combat des Horaces et des Curiaces mis en musique : voilà quel fut son programme court, mais significatif. On prit jour. Tous les cuivres disponibles furent arrêtés à l’avance, ce qui ne devait nuire ni aux instrument à vent ni aux instruments à cordes.
« Princesse, disait l’artiste en agitant sa chevelure, je retrouverai pour vous l’hymne de la création perdu depuis le déluge. »
Le jour du festival arriva : les patronnesses avaient admirablement opéré, tous les billets étaient placés, la grande société de Paris était accourue. L’artiste n’avait laissé à personne le soin de conduire son œuvre. Il siégeait au pupitre à cinq mètres au-dessus du niveau des flots de l’orchestre. Dans le périmètre étaient disposés les croque-notes chevelus jugés dignes d’applaudir avec discernement. Lui, cependant, l’artiste, le révélateur musical, l’aigle de la clef de fa, promenait son regard sur l’assemblée, cherchant à rappeler à l’ordre une incommode mèche de cheveux, et s’inspirant d’avance du succès qu’il allait obtenir. Parlez-moi du génie pour inspirer la confiance et inoculer de l’aplomb : c’est à cette pierre de touche qu’on le reconnaît.
Épargnons au lecteur la description de la symphonie, et passons immédiatement à la fin du concert, où le héros de la soirée se sent « vaincu par les émotions de l’enfantement et noyé dans sa mèche de cheveux toujours rebelle ».
Les croque-notes chevelus, disposés dans les angles de la salle, s’élancèrent vers le maestro pour le porter vers son carrosse et en dételer les chevaux ; lui pourtant, en génie modeste, se déroba par une porte de derrière, demanda son manteau et ses socques, et alla rédiger l’article de la même main qui avait écrit la partition et tenu le bâton de mesure.
Et une vignette placée en cul-de-lampe montre deux mains, sortant du même bras, l’une, avec une plume d’oie, écrivant un feuilleton musical, tandis que l’autre brandit un bâton de mesure au-dessus d’une partition.
Ce n’était pas là, il faut l’avouer, le genre de réputation qu’aurait souhaité et que méritait Berlioz.
Il fit de nouveaux voyages, en Autriche, en Prusse, en France même, où il alla diriger des concerts à Marseille, Lyon, Lille (1).
Le 24 juillet 1846, un grand festival de musiques militaires réunit à Paris 1.800 exécutants : on y donna du Gluck, du Spontini, de l’Haendel, du Rossini, du Meyerbeer, et l’Apothéose de la Symphonie funèbre et triomphale. Ce ne fut pas Berlioz qui dirigea : ce fut Tilmant. Mais il aurait eu le droit de dire : « C’est moi qui ai fait cela ! » Car qui donc avait ouvert la voie et prêché d’exemple ?
A cette époque, l’Association des artistes musiciens venait de se former, sous la présidence du baron Taylor, et Berlioz en avait été un des premiers adhérents. Voulant affirmer son existence par une grande manifestation musicale, le comité résolut de célébrer à Saint-Eustache un service religieux à la mémoire de Gluck. Mais l’auteur des Iphigénies n’a laissé à la postérité que peu de musique religieuse ; on choisit donc, pour être exécuté en son honneur, le Requiem de Berlioz, que l’auteur dirigea (19 août) (2).
Et quatre mois plus tard arriva la date fatale : celle qui aurait dû être pour Berlioz le jour de gloire, et qui fut celui du désastre — la première audition de la Damnation de Faust. Ce chef-d’œuvre fut donné, sous sa direction, au théâtre de l’Opéra-Comique, le 6 et le 20 décembre 1846 (3). Les circonstances de ces auditions sont, hélas ! trop connues pour qu’il soit utile d’y revenir. Notons seulement ce détail, généralement ignoré : au deuxième concert, Roger, indisposé, passa l’Invocation à la Nature. Oh ! les belles auditions de la Damnation de Faust, où le public ignora que l’Invocation à la Nature existait !
Tenant toujours son bâton de chef d’orchestre qu’il n’avait pas lâché dans la mêlée, Berlioz le porta en Russie, où cinq concerts triomphants réparèrent les pertes que les auditions de son chef-d’œuvre lui avaient fait subir à Paris.
Ne trouverait-il pas au moins, grâce à son talent de conducteur, les ressources refusées au génie du compositeur ? Il le pensa un moment, quand, au changement de direction qui se produisit à l’Opéra en 1847, il fut question de l’y nommer directeur de la musique. Mais la combinaison échoua (4).
Pourtant c’était si bien là sa seule ressource que, dans l’année même, il signa un engagement comme chef d’orchestre de théâtre à Londres — et nous le voyons, dans une lettre, se féliciter, pour son début, d’avoir obtenu pour un chœur de Lucie de Lammermoor une exécution dont « les Anglais sont dans la stupéfaction (5) ». Il reviendra bientôt en Angleterre, songeant que, par la mort de Mendelssohn, il peut y avoir là une position à prendre — car il en est toujours à chercher une position. Nous le verrons encore songer à devenir kapellmeister à Dresde, pour y reprendre le bâton qu’avait tenu naguère le jeune Richard Wagner.
A Paris, il a renoncé à donner des concerts ; mais il accepte volontiers les occasions qui s’offrent à lui d’y diriger des exécutions. C’est ainsi que, le 29 octobre 1848, l’Association des artistes musiciens donnant, au bénéfice de sa caisse de secours, un concert dans le palais de Versailles, Berlioz est chargé de le conduire. Il en profite pour faire entendre la 2me partie de Roméo et Juliette, la Captive (donnée pour la première fois en France dans son développement orchestral définitif), la Marche hongroise et l’Invitation à la Valse, ainsi que des fragments d’Armide, l’Ave verum de Mozart, l’ouverture de Léonore, — celle de la Gazza ladra aussi (6).
En 1849, rien.
Mais voici qu’en 1850 il sembla devoir se former une œuvre dont la réussite eût comblé les vœux de Berlioz. Une Société philharmonique fut fondée à Paris, à l’exemple des sociétés similaires de Londres et de Berlin, et Berlioz, qui n’avait pas été étranger à cette institution, en fut nommé chef d’orchestre (7). Les concerts avaient lieu dans une nouvelle salle, construite rue de la Chaussée-d’Antin, et baptisée salle Sainte-Cécile. Déjà il avait salué avec joie l’inauguration de cette salle lorsqu’elle eut lieu sous les auspices d’une autre institution au commencernent de 1849. « Notons cette année avec une pierre blanche », écrivait-il le 28 janvier, poursuivant : « Paris pourra se dire enfin pourvu aussi bien que Londres, Vienne, Berlin ou Stuttgard, ou même que le village de Heckingen. » La salle Sainte-Cécile avait en effet abrité d’abord une nouvelle société de concerts, dirigée par un inconnu, nommé Manéra : celle-ci, malgré ses bonnes intentions, ne tarda pas à péricliter. La Société philharmonique se trouva toute prête à la remplacer dès le commencement de l’année suivante. L’inauguration eut lieu, le 19 février 1850, par un premier concert qui ne manqua pas d’éclat. Madame Viardot y chanta Iphigénie en Tauride ; Joachim se fit entendre, pour la première fois à Paris sous les auspices de Berlioz, en jouant une composition d’Ernst ; les deux premières parties de la Damnation de Faust furent données avec Roger et Levasseur pour interprètes : le premier chanta encore l’air de Joseph, et Mlle Dobrée dit un air de Gluck, d’un choix assez rare, celui qui commence le troisième acte d’Echo et Narcisse. L’ouverture de Léonore ouvrait la séance, qui se terminait par la Bénédiction des poignards.
Eugène Delacroix, artiste génial et dilettante tout ensemble, assista à ce concert d’ouverture. Déjà l’année précédente il avait entendu de la musique dans le même local, qu’il décrivait ainsi : « Salle immense, foule confuse et sale, quoique le dimanche : jamais un pareil lieu ne réunira une élite de connaisseurs. » Et voici les réflexions qu’il a notées dans son journal, sur l’audition de la Société Philharmonique :
19 février. — Chez Berlioz. L’ouverture de Léonore m’a produit la même sensation confuse ; j’ai conclu qu’elle est mauvaise, pleine, si l’on veut de passages étincelants, mais sans union. Berlioz, de même : ce bruit est assommant ; c’est un héroïque gâchis. »
A la page suivante, le peintre de la Barque du Dante développe l’idée que Mozart est plus parfait que tous les autres musiciens, mais que Cimarosa est la perfection même. — Il y a des affinités qui échappent à ceux qui en offrent les plus évidents témoignages, et la nature humaine est pleine de contradictions !
___________________________________
(1) Voy. Deuxième voyage en Allemagne, six lettres dans les Mémoires.
— Correspondance académique, dans les Grotesques de la
musique. — LÉON VALLAS, Un Festival Berlioz à Lyon, dans la
Revue musicale de Lyon, 25 novembre 1906.![]()
(2) Parmi les papiers provenant de Berlioz et restés à la Bibliothèque du
Conservatoire est un cahier portant en titre : Association des Artistes
musiciens, Festival, liste nominative de l’orchestre. La composition de cette
liste indique qu’elle ne fut pas établie pour une exécution du Requiem,
— Un autre cahier donne une liste de Noms et adresses des membres de
l’Association des Artistes musiciens. Cette liste comprend environ 800 noms.
Elle a plus d’intérêt pour l’histoire de cette association que pour celle de
Berlioz, qui y figure seulement par son nom inscrit à son rang alphabétique.![]()
(3) Un programme de la première audition de la Damnation de Faust est
resté à la Bibliothèque du Consîrvatoire, où il a été relié en tête de
la partition autographe.![]()
(4) Mémoires,
chap. LVII.![]()
(5) Lettre du 8 décembre 1847, à Auguste Morel (Correspondance inédite,
p. 156 [CG no. 1149]).![]()
(6) Ce concert, donné dans les premiers mois de la République de 1848, a
donné lieu, à côté de la musique, à des commentaires assez réjouissants à
relire de loin. Un compte rendu, après avoir donné un souvenir au roi déchu
à propos des morceaux de Gluck, qu’il dit lui avoir été « si chers »
(on ne le croirait guère à constater l’oubli dans lequel étaient tombées les
œuvres de l’auteur d’Armide tout justement pendant le régne de
Louis-Philippe), reproche aux choristes admis à l’honneur de chanter dans le
palais de Louis XIV de manquer de tenue. « Des fanchons, des marmottes,
des jupes de laine brune, c’était par trop républicain, par trop carmagnole et
sans-culotte dans un théâtre d’or et de pourpre rêvé par la Pompadour. N’a-t-on
pas vu d’ailleurs que le Chef de la République portait des gants paille les
plus frais du monde ? » Considérable préoccupation ! Berlioz,
de son côté, sans paraître faire attention aux gants jaunes de l’autorité,
s’indignait d’avoir eu pour plus notables auditeurs « l’illustre Marrast
entouré de sa pléiade de gredins, siégeant aux lieu et place de Louis XIV et
de sa cour. » (Lettre au comte Wielhorski, dans O. FOUQUE, les
Révolutionnaires de la Musique, p. 223 [CG no. 1240]). Notons enfin
que, quelques jours avant Berlioz, Adolphe Adam avait été admis à faire
entendre sa musique à Versailles, où l’on avait chanté une messe de lui dans
la chapelle. Ne doit-il pas y en avoir pour tous les goûts en République ?
Au reste, Berlioz aurait eu tort de se plaindre du gouvernement, car, si
celui-ci eût voulu s’en tenir au principe des majorités, entre Adolphe Adam et
lui la part n’eût pas été égale : il eût été cruellement battu !![]()
(7) Papiers provenant de Berlioz : 1° à la Bibliothèque du
Conservatoire, un état du personnel de l’orchestre de la Grande Société
philharmonique (non autographe) sur lequel nous relevons ces noms : en
première ligne, aux 1ers violons, L. Massart (fidèle ami des derniers jours de
Berlioz ; sa femme, pianiste renommée, joua plusieurs fois en solo dans
les concerts de la Société), Léon Reynier, Gastinel, Dien,
Waldteufel ;
aux altos, Bloc et Offenbach (lequel n’était pas encore dans sa gloire !) ;
aux violoncelles, Jacquard, Tajan-Rogé ; au triangle, Léon Kreutzer. —
2° (conservés par la famille) divers papiers concernant les derniers concerts
de la Société, notamment l’état des présences du 4 mai 1851 (le nom
d’Offenbach y est écrit en surcharge de la main de Berlioz) et une autre
pièce, portant des signatures collectives, dont il sera fait mention dans notre
texte. — Les programmes et comptes rendus permettant de reconstituer les actes
extérieurs de la Société sont donnés avec beaucoup d’exactitude par la
Revue et Gazette musicale.![]()
![]()
![]() Le Ménestrel, 29
Janvier 1910, p. 34-36
Le Ménestrel, 29
Janvier 1910, p. 34-36
(Suite)
Au 2me concert (19 mars), Adoramus te de Palestrina, et la pavane Belle qui tient ma vie (c’était Dietsch qui dirigeait le chœur) ; fragments d’Alceste, finale de Moïse, ouverture du Freischütz.
Dès la constitution de la Société, Berlioz avait fait inscrire dans le règlement un article, bien significatif de ses intentions généreuses, par lequel il s’engageait à exécuter tous les ans une œuvre nouvelle composée par un lauréat de l’Institut à son retour de Rome. Cette disposition trouva son application dès le troisième concert (30 mars), et le premier jeune artiste qui en bénéficia fut Léon Gastinel, prix de Rome de 1846, dont l’orchestre de Berlioz exécuta deux morceaux de symphonie. Au même programme, des œuvres de Dietsch, Niedermeyer ; le Concertstück de Weber, exécuté par Madame Massart ; un air de Fernand Cortez ; la vieille ouverture de Demophoon. Un seul morceau de Berlioz : la Marche des Pèlerins.
Le 23 avril, la session fut close par un quatrième concert, où l’on entendit, en première audition, l’ouverture d’Athalie de Mendelssohn, puis des fragments de Moïse au Sinaï, de Félicien David (sous la direction de l’auteur), la première partie de la Damnation de Faust, et divers solistes.
Et, le 3 mai, la Société ne craignit pas d’aller faire entendre le Requiem de Berlioz, à Saint-Eustache, au bénéfice des victimes d’une catastrophe.
C’était là du temps bien employé, et, quoique le public vint encore lentement, ou pouvait espérer en l’avenir d’une Société menée dans un si excellent esprit. Aussi recommença-t-elle ses séances sans attendre plus tard que le 22 octobre, jour où eut lieu le premier concert de la deuxième année. Pour cette seconde inauguration, Berlioz ne craignit pas de faire mesurer son orchestre et son public, de se mesurer lui-même avec la grande symphonie beethovénienne, qu’il avait tenue jusqu’alors en dehors de son répertoire habituel, voulant, sans doute, faire œuvre différente de celle de la Société des Concerts. C’était là pourtant qu’était l’avenir : aussi la Symphonie en ut mineur forma-t-elle pour cette seconde année un magnifique prologue. Sara la baigneuse, de Berlioz, sous une nouvelle forme (à trois chœurs), des chants religieux de Borniantsky [sic], le psaume à grand chœur Quis enarrabit, de Lesueur, des morceaux de Schubert, Weber, Halévy, Bellini, Berlioz, complétaient le programme.
Au suivant (12 novembre 1850), Berlioz voulut diriger la Symphonie fantastique, que l’on n’avait pas entendue à Paris depuis longtemps. Ce fut encore ce jour-là que le programme annonça les Adieux des bergers à la Sainte Famille, chanson en chœur de la Fuite en Egypte, mystère de Pierre Ducré, maître de musique de la Sainte-Chapelle de Paris, exécuté pour la première fois en 1677 — en 1679, rectifiait un programme postérieur — car, en ces matières d’érudition, on ne saurait être trop rigoureux !… On avait bien exécuté l’an passé Palestrina et la Pavane, pourquoi ne ressusciterait-on pas maintenant Pierre Ducré ? « Le morceau a paru assez joli et modulé assez heureusement pour un temps où l’on ne modulait guère », professa la critique (1). Plus modernes, Borniantsky, Piccinni, Weber, Donizetti, et Verdi lui-même, firent escorte au maître imaginaire de la Sainte-Chapelle.
Le 17 décembre, fragments d’Armide, de la Caverne et d’Alexandre à Babylone de Lesueur, d’Obéron, la prière de Moïse, la Chasse du Jeune Henri, et divers solistes (Jacquard, Prudent) : programme d’un intérêt presque archaïque, et auquel l’œuvre de Berlioz n’eut aucune part — même sous un faux nom.
Mais déjà venaient du dehors des nouvelles peu rassurantes pour l’avenir. La Société n’était déjà pas si prospère que la concurrence dût venir se mêler de précipiter sa chute ! Or, dès novembre, un ancien musicien de l’orchestre de Berlioz, Seghers, fit annoncer la constitution d’une nouvelle Société symphonique, qui devait donner ses concerts dans la même salle, sous le nom de Société de Sainte-Cécile. Comme il n’y avait même pas un public suffisant pour un, il fallait bien qu’un second accourût pour avoir sa part ! Oh ! les intentions des nouveaux venus étaient pures ! L’ouverture du Carnaval romain entra bientôt au répertoire de la Société de Sainte-Cécile. On y joua aussi des symphonies de Reber. Et ce fut là encore qu’on entendit pour la première fois en France l’ouverture de Tannhäuser, au sujet de laquelle un critique parisien écrivit, en 1850, cette phrase monumentale : « Ce genre de musique a fait son temps !!! (2) » Il y avait aussi un jeune artiste qui jouait des concertos de Mozart et que l’on disait être « le pianiste en titre de la Société ». Il se nommait Camille Saint-Saëns. Une autre pianiste, depuis longtemps connue celle-là, « celle aujourd’hui de nos virtuoses la plus célèbre par son talent et ses aventures », comme écrivait Berlioz (qui l’avait beaucoup connue sous son nom de jeune fille, aux environs de 1830), Mme Pleyel, y vint jouer le Concerto de Weber. Plus d’une fois enfin le bâton de commandement fut confié à Félicien David, afin que la Société de Sainte-Cécile eût aussi le lustre d’être conduite par un compositeur, — et il fut constaté publiquement qu’en procédant ainsi la nouvelle institution « élevait autel contre autel (3) ».
En outre, Paris comptait déjà une autre Société qui se qualifiait Philharmonique : elle était, celle-ci, composée d’amateurs : l’on y jouait des pots-pourris et l’on y chantait force ariettes. Cause de confusion qui n’avait rien d’avantageux pour la vraie Société philharmonique, la « Grande (4) » !
Celle-ci continua donc ses séances tant bien que mal. Le 28 janvier 1851, Berlioz y dirigea les quatre premières parties de Roméo et Juliette, le Pater noster de Borniantsky, dont la Société, dit un compte rendu, « a eu la gloire » de révéler le nom aux amateurs de musique religieuse, la première audition d’une cantate d’Edmond Membrée, le duo d’Armide et d’autres morceaux, parmi lesquels l’air d’église de Stradella. Pourquoi pas ? Après Pierre Ducré… Le programme prenait la peine d’en indiquer la date : 1667, douze ans de plus que l’Adieu des Bergers…
Le 25 février, la jeune et déjà célèbre pianiste Wilhelmine Claus est à Paris : on l’a mise en rivalité avec Mme Pleyel ; sa place est donc toute marquée aux concerts dirigés par Berlioz. Elle y joue au moins, elle, de la musique sérieuse : la Sonate en fa mineur de Beethoven, et des œuvres d’un compositeur Scandinave, Wilmers. Madame Viardot se couvre de gloire en chantant du Pergolèse, un air de Rossini, et des chansons populaires espagnoles. Mais la part faite à la symphonie se restreint de plus en plus : une seconde audition des fragments de Roméo et Juliette la constitue presque entièrement.
Le 23 mars, la musique de Berlioz reprend sa place légitime au programme : Fantastique, cavatine de Benvenuto, la Belle voyageuse, chœur de femmes, et la première audition d’un chœur d’hommes, la Menace des Francs. Reinecke est au piano, et l’on chante du Cherubini, du Donizetti, de l’Auber. Comme nouveautés, une ouverture de Léon Gastinel. Léon Kreutzer, en rendant compte, avoue que les recettes « ne seront probablement pas la partie brillante des concerts donnés par les Sociétés Seghers et David, et par la grande Société philharmonique. »
Celle-ci manifeste encore son existence le 29 avril. Le programme est composé de deux œuvres nouvelles : une ouverture d’Auguste Morel, et le Moine, poème lyrique pour soli, chœur et orchestre, par Henri Cohen. Mais, ce dernier effort en faveur de la cause des jeunes compositeurs ne parvient pas à rendre la force à l’association : ce concert est le dernier qu’elle donne dans la salle de la Chaussée-d’Antin.
Deux fois encore elle donnera quelques signes de vie, en un lieu mal destiné aux hautes manifestations de l’art : le Jardin d’hiver. Les papiers laissés par Berlioz sont seuls à nous permettre de percevoir ces derniers souffles. L’un est l’état des présences au concert donné en ce lieu, le 4 mai 1851. Le nom d’Offenbach, comme musicien d’orchestre, y est inscrit de la propre main de Berlioz. Une autre pièce est conçue en ces termes :
L’administration du Jardin d’hiver propose à M. Berlioz et à Messieurs les artistes de la Société philharmonique 800 francs pour exécuter dimanche prochain à 1h. 1/2, sans répétition : 1° La Fête chez Capulet de Roméo, 2° l’Invitation à la valse, 3° La Marche hongroise, et 4° le solo de piston de M. Denault.
Soixante-dix signatures, en signe d’acceptation, sont apposées au bas de cette invitation : celle de Berlioz en premier lieu ; plus loin celle d’Offenbach. M. Denault joua donc son solo de piston, sous la direction de Berlioz.
Ce fut le dernier souffle de la Philharmonique.
Mort sans gloire !
Ne croyons pourtant pas que le temps consacré à cette tentative ait été perdu : il le fut pour Berlioz, depuis si longtemps accoutumé à ne jamais voir couronner son effort ; mais c’était de bonne semence jetée au vent, et prête à germer dans un avenir assez proche. La Société avait contribué à familiariser le public parisien avec l’idée que les maîtres de l’art symphonique ne lui étaient pas si inaccesibles qu’il le croyait ; elle avait rappelé à son souvenir l’exemple des grands classiques d’autrefois ; elle avait fourni à de jeunes musiciens l’occasion de s’entendre, et ce n’était pas la faute du chef si aucun n’avait produit un chef-d’œuvre.
Enfin quelques productions des contemporains étrangers avaient été offertes au public français. Nous avons lu sur les programmes le nom de Mendelssohn, alors fort peu connu. A vrai dire, nous avons à constater l’omission de Schumann : mais combien de temps ne fallut-il pas encore avant que celui-ci reçut en France son Dignus intrare ! M. Saint-Saëns a rapporté malicieusement le mot qui lui fut dit, à une époque beaucoup plus récente, par un membre de la Société des Concerts : « Nous avons cherché dans Schumann nous n’avons rien trouvé (5) ».
Berlioz est bien pardonnable de n’avoir pas devancé le temps et l’on sait assez que ce ne fut ni par défaut de sympathie, ni par indifférence. — Il y avait aussi Wagner, mais celui-ci était plus nouveau encore. Ce n’est pas que Berlioz en ignorât non plus l’existence : outre qu’il l’avait connu à Paris et à Leipzig [Dresde], Liszt avait eu soin de lui recommander son œuvre, ainsi que nous pouvons nous en assurer par une lettre dont il importe que nous détachions quelques mots :
Je te recommande en particulier l’ouverture de Tannhäuser, où tu auras le plaisir de retrouver ton bien, notamment dans les effets de violons en trémolos aigus. Si tu as occasion de la faire exécuter à quelque concert monstre de la République, je suis persuadé qu’elle ne manquera pas son effet (6).
Mais les modestes séances de la Société Philharmonique n’étaient pas des concerts monstres, et Berlioz n’y fit pas exécuter l’ouverture de Tannhäuser.
___________________________________
(1) Revue et Gazette musicale du 24 novembre 1850, p. 388 (Léon
Kreutzer).![]()
(2) Revue et Gazette musicale de Paris, du 1er décembre 1850
(Henri Blanchard).![]()
(3) Revue et Gazette musicale de Paris du 2 mars 1851.![]()
(4) Revue et Gazelle musicale de Paris du 19 janvier 1851.![]()
(5) C. SAINT-SAËNS, Harmonie et mélodie, p. 195.![]()
(6) Lettre de Liszt à Berlioz, de Weimar, 3 janvier 1849 (original conservé
par la famille de Berlioz [CG no. 1242 bis]).![]()
![]()
![]() Le Ménestrel, 12
février 1910, p. 50-51
Le Ménestrel, 12
février 1910, p. 50-51
(Suite)
Et l’année d’après, s’il dirigea l’orchestre d’une Société philharmonique, ce ne fut plus à Paris, mais à Londres. Engagé pour la saison, il y conduisit en effet les symphonies de Mozart et de Beethoven, les ouvertures de Weber et de Mendelssohn, le Chant des Chérubins de Borniantsky, qu’il avait eu le premier l’idée de transporter de Russie dans l’Europe occidentale, Roméo et Juliette, etc. Il eut aussi l’occasion agréable d’y retrouver, engagée comme virtuose, sa vieille connaissance Mme Pleyel, et dirigea l’orchestre du Concertstück de Weber durant qu’elle l’exécutait. La chronique ne dit pas si cette audition lui causa de nouvelles distractions, violentes ou non. — Mais il eut une joie plus pure : pour la première fois de sa vie il conduisit la Neuvième Symphonie !
Revenu à Paris, il dirige une fois de plus le Requiem, dans un service funèbre célébré à Saint-Eustache, le 22 octobre 1852, à la mémoire du baron de Trémont. Roger chante le Sanctus ; les élèves des classes de chant du Conservatoire, spécialement autorisés par Auber (grand ami du défunt), forment le chœur. C’est la seule occasion qu’il ait de conduire l’orchestre à Paris, et pour longtemps encore.
Pourtant, dans sa robuste confiance en l’avenir (un avenir qui ne devait se réaliser, pour le compositeur, que dix ans après sa mort, et qui échappa toujours à l’homme de l’action immédiate), malgré tant de déboires, il ne désespérait pas encore.
A ce moment, la République avait fait place au second Empire. Cette évolution de la politique avait mis sur le trône de France le neveu du grand homme dont l’admiration enthousiaste avait suivi Berlioz depuis l’enfance sans se lasser jamais. Ce que Napoléon Ier avait fait pour ses maîtres, Spontini, Lesueur, il crut que Napoléon III serait capable de le faire pour lui, Berlioz. Nous ne savons que trop à quelles désillusions le conduisit cet espoir lorsqu’il eut composé les Troyens. Il en eut un avant-goût, dès le commencement du règne, ainsi que nous allons l’apprendre.
Quand l’Empire eût été proclamé, il fut décidé que la chapelle impériale serait rétablie. Lesueur et Paisiello en avaient été les chefs ; Berlioz avait gardé très distinctement le souvenir de ce que cette chapelle souveraine était sous la Restauration, quand elle avait pour surintendants son directeur, Cherubini, et son maître, Lesueur. Pourquoi ne serait-il pas, lui, surintendant de la chapelle de Napoléon III ? Cette perspective ravivait son zèle d’une nouvelle ardeur ; et voici comment il s’y prit pour poser, sans d’ailleurs paraître intervenir nominativement, sa candidature à cette officielle fonction.
La Bibliothèque du Conservatoire possède, entièrement écrit et signé de sa main, le document que voici, resté inédit jusqu’à ce jour :
NOTES POUR L’ORGANISATION
D’UNE CHAPELLE IMPÉRIALE A PARIS
Il y a deux partis à prendre pour réaliser cette idée. On peut se borner à refaire ce qui a déjà été fait, en suivant l’ornière commune sans tenir compte des progrès de l’art, de ceux des idées du public et des artistes, ni du discrédit dans lequel sont tombés de vieux préjugés. Il suffira alors de copier fidèlement le plan sur lequel avaient été organisées les chapelles de Louis XVIII et de Charles X.
Elles étaient ainsi composées :
Il y avait deux surintendants compositeurs, MM. Cherubini et Lesueur, ne dirigeant point eux-mêmes, mais assistant seulement aux exécutions et rarement aux répétitions. Ils se partageaient le service de la chapelle Royale, dont ils prenaient successivement trois mois deux fois l’an. Aucune stipulation de leur engagement n’obligeait ces maîtres à composer pour la chapelle. Ils écrivaient à volonté et fort rarement. Leurs œuvres, en conséquence, ne suffisaient point à alimenter le répertoire religieux, et ils devaient, pour en combler les lacunes, recourir à de très faibles partitions des maîtres de l’école allemande qui, par l’inconvenance et la mesquinerie de leur style (il faut l’avouer), contrastaient avec les formes plus pures et plus grandes des œuvres des deux surintendants. Il n’en pouvait guère être autrement, le nombre des messes et oratorios conçus dans un style vraiment musical et religieux étant excessivement restreint si l’on ne peut exécuter celles de l’ancienne école italienne. Et c’était alors le cas.
L’orchestre en rapport avec l’exiguïté du local de la chapelle des Tuileries était sans puissance, et dur et sec comme sont tous les orchestres peu fournis d’instruments à cordes.
Le chœur, composé en grande partie de voix sourdes et usées, avait bien moins de valeur encore. Quant aux solistes, on était forcé de reconnaître parmi eux un grand nombre de médiocrités, et le roi n’entendait que des chanteurs à peu près nuls, pour ne pas dire détestables, quand des talents jeunes et brillants charmaient le public. La chapelle royale était une sorte d’hôtel des Invalides pour quelques grandes renommées chantantes, d’où ces vétérans, une fois qu’ils y avaient été admis, ne sortaient que par leur mort.
Quand des cérémonies extraordinaires, telles que la messe dite du St-Esprit, ou celles pour l’ouverture des Chambres, pour le sacre et les funérailles du souverain, avaient lieu à Notre-Dame, à Saint-Denis ou à Reims, le petit orchestre et le petit chœur de la chapelle royale étaient alors triplés ou quadruplés par un certain nombre d’artistes externes, payés au cachet pour ces solennités, et dont le nombre insuffisant encore ne produisait qu’un effet maigre et sans grandeur dans ces vastes cathédrales.
En somme, cette institution n’avait ni bases solides, ni but élevé. Tous les musiciens, chanteurs et maîtres, qui en faisaient partie, songeaient à toucher leurs appointements, à intriguer pour en faire augmenter le chiffre, et se souciaient peu du reste.
Aussi, à l’exception de plusieurs petits oratorios de Lesueur et des quatre messes solennelles de Cherubini, dont la plupart encore furent composés avant que ces deux maîtres occupassent le poste de surintendant à la chapelle royale, cette institution n’a rien produit, rien fait naître, rien développé, rien réformé, rien encouragé.
Un seul chef d’orchestre (M. Plantade) était chargé de présider aux répétitions du chant et à celles de l’orchestre, et de diriger les exécutions.
Dans le cas où l’Empereur voudrait donner une importance réelle à sa chapelle et la mettre en harmonie avec l’état actuel des idées, avec les ressources dont l’art aujourd’hui dispose, et les aspirations grandioses qui existent en germe dans tous les esprits, où Sa Majesté, enfin, jugerait convenable d’élever à l’art musical religieux un monument digne d’elle, il faudrait, je crois, ne tenir aucun compte de ce qui a été fait.
On devrait alors construire aux Tuileries une chapelle plus vaste : composer un orchestre plus nombreux et réunissant de vrais artistes, jeunes et valides ; un chœur spécialement et uniquement attaché au service de l’Empereur, faisant sous la direction d’un vrai maître des études constantes et quotidiennes ; dont les membres choisis avec discernement pourraient se consacrer exclusivement à ces études, les plus difficiles et les moins connues en France, même dans les classes du Conservatoire.
Il faudrait enfin obtenir un personnel de choristes capables, sinon d’égaler le chœur merveilleux de la chapelle de l’empereur de Russie, ni même celui du Dôme de Berlin, au moins d’approcher d’eux le plus possible. On pourrait alors exécuter à la chapelle impériale tous les chefs-d’œuvre de l’ancienne école d’Italie, ceux de Palestrina, de Leo, de Durante, d’Allegri, qui firent la gloire de la chapelle Sixtine et que les choristes parisiens sont, à l’heure qu’il est, aussi incapables d’exécuter que les violonistes du dixième ordre le sont de jouer les concertos de Paganini.
N’est-il pas étrange que le premier chœur du monde existe aujourd’hui à Saint-Pétersbourg et que Paris ne se doute même pas de l’incroyable puissance d’émotion qui réside dans une masse de voix ainsi exercées dans les conditions impérieusement exigées par la nature de l’art !!…
Le surintendant de l’Empereur, s’il est pénétré de l’amour de sa tâche, de la beauté de sa mission, et s’il possède les connaissances et l’instinct, sinon le génie, nécessaires, pourra entrer dans les vues de Sa Majesté et faire naître une grande et admirable institution. S’il n’est qu’un artiste médiocre, ou fatigué, sans flamme, étranger au vrai style religieux, ou préoccupé de son intérêt personnel, dans la plus vulgaire acception de ces mots, malgré la volonté du souverain et ses injonctions les plus précises, le but ne sera évidemment jamais atteint.
Son importance comme compositeur devrait aussi être déterminée. Il devrait lui être obligatoire d’écrire, tous les ans au moins, une œuvre nouvelle destinée à la chapelle impériale. D’autres compositeurs de toutes les nations pourraient être aussi invités à envoyer leurs productions à un comité spécial institué pour choisir celles qui seraient dignes de figurer dans le répertoire impérial.
En outre, pour les grandes cérémonies officielles, un corps considérable de chanteurs et d’instrumentistes devrait être formé par le maître de chapelle de l’Empereur, et ce corps devrait être tenu de savoir un répertoire destiné aux cérémonies assez rares où la musique monumentale doit figurer. L’Empereur aurait au moins la certitude que l’art musical remplirait dignement et grandement sa mission dans ces circonstances exceptionnelles ; on n’aurait plus à redouter le ridicule des exécutions improvisées, insuffisantes, impuissantes, et les dépenses souvent considérables qui sont faites en pareil cas auraient un résultat. En dernière analyse, c’est à l’Empereur à vouloir et à son maître de chapelle à pouvoir, car tout est faisable. Les ressources de la France sont immenses, il ne s’agit que de les utiliser.
H. BERLIOZ.
Cette démarche permet de juger de l’esprit pratique de Berlioz quand il s’agissait, non de composer ou d’exécuter de la musique, mais de faire appel au concours d’autrui : la première idée qui lui vienne est qu’il faut démolir la chapelle existante pour en construire une autre plus vaste ; de sorte que ce n’est pas la musique qui doit être faite pour l’édifice, mais l’édifice pour la musique ! Il avait peu de chances d’être écouté, parlant ainsi au dilettante qu’était Napoléon III. Et puis, il avait commencé par poser un dilemme imprudent. « Il y a deux partis à prendre : refaire ce qui a été déjà fait ou tenir compte des progrès de l’art… » Entre les deux propositions, l’Empereur ne devait pas hésiter : « Refaire ce qui a été déjà fait », telle était sa réponse inéluctable ! Aussi Auber fut-il nommé maître de la chapelle impériale, fonction qui ne paraît pas avoir absorbé beaucoup de son temps, et dont la réalisation la plus significative consista, au mariage de l’Empereur, à faire accompagner le cortège aux sons de la Marche des filets de Vulcain, vieux ballet de l’Opéra ! Quant à Berlioz, il ne put même pas faire entendre, en l’honneur de son Empereur, son Te Deum à ce moment prêt à paraître !
![]()
![]() Le Ménestrel, 5
Mars 1910, p. 75-76
Le Ménestrel, 5
Mars 1910, p. 75-76
Il retourne donc battre la mesure à des orchestres étrangers. Au printemps de 1853, il est à Londres, où, en attendant que Covent-Garden mette en scène Benvenuto Cellini, la Philharmonie Society lui confie la direction de son concert du 1er juin, au Hanover-Square : Gardoni y donne, avec succès, la première audition du Repos de la Sainte Famille qui prendra bientôt place dans la Fuite en Égypte, puis dans l’Enfance du Christ ; par la même occasion, Harold et le Carnaval romain forcent les portes de la classique et vénérable société symphonique.
En août, il se rend à Bade, où, pour la première fois, le fermier des jeux Bénazet (1) l’engage pour diriger des festivals, qu’il renouvellera annuellement par la suite.
Puis il recommence ses courses en Allemagne. Il y passe presque entièrement la dernière partie de l’année, faisant entendre de nouveau le Repos de la Sainte Famille, à Francfort (29 août), donnant, à Leipzig (1er décembre), la première audition complète de la Fuite en Égypte, à un concert d’abonnement du Gewandhaus dont on lui a confié la direction (il y fait exécuter, avec ses œuvres, la Symphonie en fa, de Beethoven), se consolant enfin, par les applaudissements donnés un peu partout à la Damnation de Faust, des déboires que cet ouvrage lui a fait subir dans son pays.
Au printemps suivant, il est encore en Allemagne — car les chemins de fer qui commencent à sillonner l’Europe rendent maintenant les voyages plus faciles qu’à l’époque de ses premières incursions à l’étranger. Il dirige des concerts à Hanovre, Brunswick, Dresde, en avril et mai 1854. C’est vers ce temps qu’il est question de le nommer maître de chapelle du roi de Saxe, après Weber et Wagner, et cette perspective n’est pas sans lui causer quelque émoi.
A ce moment, son activité comme chef d’orchestre est certainement supérieure à celle de n’importe quel professionnel ; mais il ne jouit pas des avantages de la profession, et si parfois il parvient à en retirer quelques menus bénéfices, ce n’est jamais que d’une façon passagère, et sans espoir de lendemain.
Pourtant il voudrait bien la trouver enfin, cette position qu’après cinquante ans d’âge il cherche encore, qui a toujours été refusée au compositeur, et qui échappera de même au chef d’orchestre, car rien d’assuré ni de stable ne sortira jamais pour lui.
En France, au moins, la situation est franche : il a renoncé à fonder aucun espoir sur son pays. Depuis l’échec définitif de la Société philharmonique, et pendant près de trois ans entiers, celui-ci reste absolument en dehors de son champ d’action.
Et pourtant, quelques-unes de ses idées commencent à y germer. La Société de Sainte-Cécile, concurrente heureuse de sa Philharmonique française, poursuivait le cours de son existence et ne lui était point défavorable, maintenant qu’elle l’avait écarté de son chemin. C’est elle qui donna la première audition française de la Fuite en Égypte, le 18 décembre 1853, deux semaines après qu’il l’eût fait entendre pour la première fois en Allemagne. Un an et demi après, le 1er avril 1855, la même société donnait une autre première audition de Berlioz : l’ouverture du Corsaire. Seghers avait alors cédé le bâton de direction à Barbereau (car sa société périclitait à son tour) et M. Weckerlin continuait à faire chanter en chœur la Pavane : « Belle qui tiens ma vie ». Mais déjà Pasdeloup instituait sa Société des Jeunes Artistes, tandis que Niedermeyer ouvrait son école de musique religieuse, à l’imitation de celle de Choron. Tout cela, Berlioz s’était ingénié à le mettre sur pied depuis vingt ans et plus. Mais il était écrit que ce seraient d’autres qui cueilleraient le fruit des labeurs de toute sa vie.
Nous allons cependant, après un si long silence, le voir revenir à l’activité, et, ô surprise ! recevoir pour un nouvel effort une récompense passagère. Il a achevé la composition de l’Enfance du Christ, qui n’est plus de la musique monumentale et n’a pas besoin, pour être offerte au public, des voûtes des Invalides ou du Panthéon : il pense donc risquer moins que pour la Damnation de Faust s’il produit une œuvre de dimensions restreintes, et il se décide à la faire entendre à la salle Herz. C’est le 10 décembre 1854 qu’eut lieu cette première audition. Pour bien assurer le caractère presque intime du concert, il ouvrit le programme par une œuvre de musique de chambre : un trio de Mendelssohn, exécuté par Maurin, Chevillard et Mme Mattmann ; après la nouvelle trilogie sacrée, Maurin joua sa romance pour violon, que le programme intitula ce jour-là : Tendresse et Caprice, et, l’orchestre termina la séance par le finale d’une Symphonie en ré mineur, d’Haydn.
La rentrée de Berlioz devant le public parisien fut fêtée comme le retour de l’Enfant prodigue, et l’œuvre nouvelle obtint un succès unanime et immédiat. Une deuxième et une troisième auditions eurent lieu le 24 décembre et le 28 janvier suivant ; Mme Stoltz y rehaussa le programme par sa présence, en chantant la Captive. Puis, le soir du samedi saint (7 avril 1855), l’Opéra-Comique organisa un concert spirituel pour faire entendre l’œuvre au grand public, et Berlioz dirigea encore (une seconde partie du concert, conduite par Tilmant, se termina par la fête de Roméo). Le théâtre refusa du monde ; il dut, quinze jours plus tard, renouveler l’audition (2).
Au lendemain de cette série triomphale (qu’entrecoupèrent quelques nouvelles incursions en Allemagne et en Belgique, principalement pour y faire entendre la nouvelle œuvre), Berlioz eut encore un autre ouvrage inédit à produire : le Te Deum, que nous lui avons vu offrir en vain pour rehausser l’éclat des premières cérémonies impériales. L’Exposition universelle de 1855, en attirant à Paris des représentants de tous les peuples du monde, lui procura une occasion de le faire entendre dans une vaste enceinte et devant un nombreux auditoire : il en dirigea l’exécution dans une cérémonie solennelle qui eut lieu à Saint-Eustache le 30 avril, veille de l’ouverture de l’Exposition. Il semble avoir eu une assez grande part d’initiative dans l’idée même de la fête religieuse. C’est lui qui proposa au curé de clore la cérémonie par « la bénédiction des drapeaux et bannières des exposants catholiques pendant un morceau du Te Deum composé pour cela (3) ». En effet, nous connaissons bien le morceau dont il parle : c’est la Marche des drapeaux qui termine la partition, et qui nous le savons, était composée bien avant qu’il fût question de la fête de Saint-Eustache. Ainsi Berlioz put-il, cette fois, réaliser son hautain rêve d’artiste : asservir à l’œuvre les éléments extérieurs et non construire cette œuvre en vue d’une destination fixée.
« Il faut que l’immense église soit pleine », écrivait-il à Liszt en lui annonçant la solennité. « La machine musicale seule coûte 7.000 fr. Il y a de quoi trembler ! » [CG no. 1935] Il avait en effet, soutenu par des patrons dignes de confiance (dont Ducroquet, facteur des orgues de Saint-Eustache), assumé la responsabilité de l’entreprise, et avait sous ses ordres un orchestre et un chœur immense : 950 exécutants, dont 800 enfants, remplissaient un vaste amphithéâtre élevé à la hauteur de deux étages. Batiste tenait le grand orgue, sur lequel se fit entendre, en solo, un organiste anglais, Henri Smart. Berlioz ne se plaignit point du résultat, encore qu’il eût pu espérer mieux. « Belloni (4) est furieux, écrivait-il encore à Liszt [CG no. 1959] : on nous a volés comme dans un bois ; mais n’importe ! » Et dans une lettre à sa sœur il précise, écrivant [CG no. 1961] : « Mes agents assurent, et je n’en doute pas, que j’ai été volé comme dans un bois par les percepteurs des billets d’entrée. On n’accuse que 6.030 fr. de recette, et tout le monde qui a vu l’église pense qu’on a dû dépasser 10.000 francs. » En post-scriptum : « Marie est malade de chagrin de nous avoir vu volés de cette façon. » Marie, c’est Mme Berlioz la deuxième, qu’on nous avait toujours dit avoir été, auprès de son mari (avant même qu’il fût son mari) une comptable sévère et non dénuée d’âpreté. Au reste, il prenait plus facilement parti des déficits quand il s’agissait de l’argent des autres, et il paraît que la garantie qu’il s’était assurée était suffisante, car nous le voyons écrire encore : « Les frais sont couverts, et je rentre ainsi dans douze cents francs que m’avait coûtés la copie il y a trois ans, et sur lesquels je ne comptais plus. (5) »
___________________________________
(1) Nous avons trouvé naguère, sur la personne de Bénazet, une indication
fournie par une source assez imprévue : c’est, dans la revue historique, la
Révolution française, un article consacré à l’École de Mars, citant le
nom de ce futur entrepreneur de jeux de hasard parmi ceux des élèves de la
jeune phalange qui passait pour avoir voulu servir de garde du corps à
Robespierre. Voy. J. GUILLAUME, Études révolutionnaires,
1re série, p. 106.![]()
(2) A partir de cette époque, les papiers de Berlioz restés à la
Bibliothèque du Conservatoire ne nous fournissent plus rien ; mais ceux
qu’a conservés la famille nous offriront encore plusieurs notes intéressantes.
Cependant nous n’y avons rien trouvé de relatif à la première audition de l’Enfance
du Christ ni à la seconde. De la troisième (28 janvier 1855), il est
resté une feuille d’émargement portant (en bloc) le compte suivant : 43
choristes à 12 francs (les coryphées à 24 francs), total, 540 francs. Le nom
de Guiraud, comme répétiteur, est inscrit sur la liste, de la main de Berlioz,
et porté pour 15 francs, puis effacé. Il s’agit d’Ernest Guiraud, dont le
père avait été camarade d’études de Berlioz au Conservatoire et qui avait
coopéré à l’exécution de l’Enfance du Christ. « Le fils de
Guiraud m’a été bien utile, écrivit Berlioz à un ami commun. C’est un
charmant garçon qui deviendra un homme. » (Correspondance
inédite, page 222 [CG no. 1905, à Dominique Tajan-Rogé)]).![]()
(3) Lettre de Berlioz à son beau-frère Suat, du 20 avril 1855 (présentement
inédite [CG no. 1945, 18 ou 19 avril 1855]).![]()
(4) Homme d’affaires de Liszt, qui assista parfois Berlioz pour
l’organisation de ses concerts.![]()
(5) Lettres à Liszt (fin avril et 30 avril 1855 [CG no.
1935, vers le 14 avril; CG no. 1959, 30 avril]),
deuxième volume des Lettres de contemporains célèbres à Franz Liszt,
pages 17, 19, 20. — Lettres de Berlioz à son beau-frère Suat et à sa sœur Adèle,
du 20 avril [CG no. 1945, 18 ou 19 avril] et du 4 mai [CG no.
1961] (présentement inédites). — les papiers conservés
par la famille donnent, pour le Te Deum, ce simple compte de détail :
« Chœurs, 60 femmes, 98 hommes, à 15 francs, 4 répétiteurs, 1 à 30
francs, 3 à 25. Total général, 2.550 francs. » Au nombre des « répétiteurs
du grand chœur », Guiraul (sic) est porté à l’émargement pour
30 francs, et a signé : R. Guiraud.![]()
![]()
![]() Le Ménestrel, 19
Mars 1910, p. 91-92
Le Ménestrel, 19
Mars 1910, p. 91-92
(Suite)
Ayant inauguré l’Exposition par ses religieux accords, Berlioz la clôtura avec des sons plus profanes, en dirigeant l’exécution d’apparat qui accompagna la cérémonie de la distribution des récompenses au Palais de l’Industrie sous la présidence de l’empereur. Le prince Napoléon, qui le protégeait, lui avait confié cette mission officielle ; il fut en outre autorisé à disposer du local, au lendemain de la fête, pour donner deux festivals publics. Il put, cette fois au moins, donner libre cours à son rêve de musique colossale. Un orchestre et un chœur de 1.200 exécutants manœuvrèrent sous ses ordres. La fête eut lieu le 15 novembre ; le programme musical était composé ainsi qu’il suit :
L’Impériale, cantate à deux chœurs (que Berlioz avait écrite pour la circonstance) ; chœur : « Chantons victoire » de Judas Macchabée (Haendel) ; Andante, Scherzo et Finale de la Symphonie en ut mineur de Beethoven ; chœurs et airs de danse d’Armide (Gluck) ; grand chœur des Huguenots (Meyerbeer) ; prière de Moïse (Rossini) ; Ave verum de Mozart ; et, pour finir, reprise du finale de la cantate : « Dieu qui protège la France. — Veille sur son Empereur. »
Il fut constaté ce jour-là que, perdue parmi tant d’autorités, la musique « accompagnait, mais ne régnait pas » : c’était si vrai que l’Empereur, pressé de prononcer son discours, fit interrompre avant la fin la cantate composée en son honneur ! Mais le lendemain, Berlioz prit sa revanche. Le corps de musique, qui, à la cérémonie, était relégué dans une galerie supérieure, fut placé à l’endroit même où le trône s’élevait la veille ; le programme fut enrichi par l’ouverture du Freischütz, l’apothéose de la Symphonie funèbre et triomphale, le Tibi omnes angeli et la Marche des drapeaux du Te Deum. L’immense nef était pleine ; Berlioz se réjouit d’avoir un « auditoire apocalyptique » ; il se crut transporté « dans la vallée de Josaphat », et la recette fut de plus de soixante mille francs.
Au reste, il ne fut pas seul à profiter de l’aubaine : la série des festivals fut continuée après lui. Ce fut, le dimanche 18, l’ensemble de l’Orphéon, 1.600 voix, sous la direction de Gounod ; le mardi et le jeudi, des auditions d’œuvres de Félicien David. Le samedi 25, Berlioz donna la troisième exécution de son programme ; enfin, un dernier festival de sociétés chorales eut lieu, pour la clôture, le dimanche 26 novembre. Le budget de ces manifestations sonores fut arrêté ainsi qu’il suit : Recette générale, 114.333 francs, répartie entre : Droit des pauvres, 12.500 francs ; rétribution des artistes, 77.794 francs ; entreprises de travaux et frais divers, 11.207 francs ; direction et location du Palais, 12.831 francs. Berlioz qui avait décliné la responsabilité financière de l’entreprise, réalisa pour sa part un bénéfice de près de 8.000 francs. Ce fut la meilleure affaire de sa carrière de chef d’orchestre (1).
Cette période d’un peu plus d’une année fut celle de la plus grande activité de Berlioz à cet égard. Au printemps (par conséquent entre le Te Deum et les festivals de l’Exposition), il avait été appelé à Londres pour diriger la Season de la New-Philharmonic, tandis que Wagner conduisait les concerts de l’ancienne Société. Il y fit exécuter, entre autres œuvres, la Symphonie en sol mineur de Mozart ; nous savons cela grâce à une communication de Wagner, qui trouva l’exécution mauvaise, naturellement.
Puis, le 25 janvier 1856, il voulut donner encore, à la salle Herz, une audition de l’Enfance du Christ, accompagnée, sur le programme, par l’air d’Anacreon, de Grétry, chanté par Battaille, une fantaisie sur le Trovatore pour le piano-melodium Alexandre, et les chœurs et danses d’Armide ; un compte rendu ajoute le Moine, de Meyerbeer.
Nous ne nous arrêterions pas sur ce dernier concert si une abondance assez rare de documents s’y rapportant (2) ne venait nous apprendre que cette séance eut une importance toute particulière dans la vie de Berlioz à cette époque.
Notons d’abord une lettre à Peter Cornélius (inédite), datée de la veille du concert (24 janvier 1856 [CG no. 2083]), et dont le texte montre que Berlioz se promettait des joies toutes particulières de cette exécution :
J’ai un concert ici demain, nous donnons l’Enfance du Christ ; j’ai le plus merveilleux petit orchestre qui existe peut-être, un chœur de 54 voix excellent, et les cinq principaux chanteurs sont les seuls qui conviennent de tout point à mes personnages (3).
Tous ces artistes savent presque par cœur mon ouvrage et j’espère une admirable exécution.
Puis c’est un cahier de contrôle, portant en tète le plan de la salle, et donnant l’indication des places vendues et données ; parmi les bénéficiaires de ces dernières, citons les docteurs Amussat et Blanche, Massart, Mmes Stoltz et Viardot, Roger, Vivier, et des journalistes (Heugel, du Ménestrel, est inscrit pour deux places). Un autre est un petit cahier entièrement autographe, donnant d’abord l’état sommaire du personnel exécutant et des divers frais (48 choristes, 557 francs ; orchestre, 660 ; location d’instruments, 41 ; impressions (?) ; pauvres, 100 ; salle, 300 ; garçon, 6 ; total des frais, 1664). Dans la liste des exécutants, relevons : aux seconds violons, Lamoureux ; Daussoigne-Méhul au mélodium ; E. Guiraud accompagnateur et conducteur du chœur dans la coulisse. Puis encore des noms d’invités : Brizeux, Chenavard, Eugène Delacroix, Charles Blanc, A. Robert, Ed. Bertin, Camille Doucet, Eugène de Mirecourt, Amiral Cécile, abbé Rose (au tournant d’une page : Heugel, 2 de plus) — et, ô surprise, des musiciens ! Gounod, Félicien David, Reyer, Kreutzer, Boisselot, Chélard, etc. — Et voici passer le bout de l’oreille : une colonne spéciale porte en titre : LES MEMBRES DE L’INSTITUT ! Thomas et Clapisson sont portés pour 2 places, Reber pour une ; Adam était déjà inscrit pour trois dans la série du service de presse. Nous comprenons donc la raison d’être de cette audition qui, bien loin d’être la première, n’en donna pas moins lieu à un nombre inusité d’invitations (plus de 150, dans une salle de 532 places) : c’était une position de candidature. Et la manœuvre n’était point inutile ni maladroite : cinq mois n’étaient pas passés que Berlioz était élu membre de l’Académie des Beaux-Arts.
C’est aussi dans la même année qu’il ajouta à son Traité d’instrumentation le supplément consacré à l’Art du chef d’orchestre (4), écrit où il exposa le résultat de son expérience personnelle et codifia, en quelque sorte, l’ensemble de ses observations. Celles-ci, devenues aujourd’hui monnaie courante, étaient encore, en beaucoup de cas, de grandes nouveautés et de véritables audaces. La lecture en est édifiante pour montrer à quel état subalterne était encore réduit, au milieu du dix-neuvième siècle, le chef d’orchestre, surtout au théâtre. Elle justifie aussi, par la nature des prescriptions, l’opinion que Berlioz fut bien le fondateur de l’école des chefs d’orchestre modernes et le premier d’entre eux.
Cependant, à partir de ce jour, son activité de chef d’orchestre se ralentit au point de s’arrêter presque entièrement, du moins en France. Nous pourrions pourtant comprendre encore à son actif ses festivals de Bade, — car cette ville était alors comme un prolongement du boulevard, à peu près comme aujourd’hui Monte-Carlo. Nous l’avons vu déjà s’y présenter en 1853 : de 1856 jusqu’à 1863, il renouvellera annuellement ce voyage d’outre-Rhin. Groupons ici, aussi brièvement que possible, la relation des diverses manifestations auxquelles il présida ainsi pendant près de dix ans.
En 1856 (16 août), il dirige un programme tout classique, composé de l’ouverture de la Flûte enchantée, de fragments d’Iphigénie en Aulide, Orphée et Armide de Gluck ; la Symphonie en si bémol de Beethoven ; un air de Graun, un motet de Victoria. Mme Viardot chante des airs populaires espagnols, qu’elle interprétait avec une volubilité et un sentiment du pittoresque exquis (5). Mlle Duprez dit les Vêpres siciliennes, la Somnambule. Quant à Berlioz, il en est réduit, en tant que compositeur, à quelques fragments de l’Enfance du Christ et à son orchestration de l’Invitation à la valse.
1857 (18 août) : ouverture des Francs Juges, fragments de l’Enfance du Christ et du Te Deum, pages de Gluck, Beethoven, Haydn. M. Faure chante des airs de Rossini, Verdi, Mozart.
1858 (27 août) : ouverture d’Euryanthe, fragments de Roméo et Juliette (Mme Charton-Demeur et Schnorr, futur Tristan, chantent les soli du prologue), chœur de Victoria ; Sara la baigneuse, ouverture de Léonore. Litolff joue un de ses concertos, et Vivier, le corniste facétieux, dont Berlioz était jaloux pour ses calembours, fait entendre les sons les plus inattendus de son instrument. Georges Kastner écrit dans son compte rendu : « Berlioz a les trois vertus théologales du chef d’orchestre : la foi, l’inspiration et l’autorité. »
1859 (29 août) : programme tout particulièrement intéressant. Mme Viardot et Jules Lefort donnent la première audition des deux grandes scènes en duo des Troyens : celle de Cassandre et Chorèbe, et celle d’Enée et Didon. On entend encore les fragments de Roméo, avec Mme Viardot dans le prologue ; deux œuvres nouvelles de Théodore Ritter, des chansons populaires françaises et russes (Mme Viardot), des morceaux de Spontini, Meyerbeer, etc.
En 1860 (le 27 août), les solistes prennent une place de plus en plus prépondérante sur le programme : celui-ci annonce les concours simultanés des deux plus illustres cantatrices françaises du XIXe siècle, Mmes Pauline Viardot et Miolan-Carvalho, ainsi que ceux de Roger, Vieuxtemps, Jacquard. Au piano : le jeune Alphonse Duvernoy, frais émoulu du Conservatoire.
Ce dernier m’a raconté les souvenirs qu’il avait gardés de cette réunion hautement artistique ; certains méritent peut-être d’être retenus. La plupart convergent sur les faits et gestes de la madame Berlioz de ce temps-là. J’ai longtemps cherché sur cette dame — peut-être par goût de la contradiction — un témoignage, un seul, qui ne la représentât pas comme une personne parfaitement désagréable ; mais je dois avouer que, jusqu’à présent, je n’en ai pas trouvé. Les récits de Duvernoy n’ont rien eu qui vînt contredire cette impression générale des contemporains. Inutile d’entrer, à ce sujet, dans des détails un peu trop familiers et secondaires. Mais voici une petite anecdote qui, en offrant quelques traits de caractère, va nous faire entrer tout à fait dans l’intimité du ménage Berlioz en voyage.
Mme Carvalho avait résolu de chanter à ce concert l’Ave Maria de Gounod sur le premier prélude de Bach. Il paraît que Berlioz ne pouvait pas souffrir ce morceau. Etait-ce Bach ? Etait-ce Gounod la cause de cette répugnance ? Peut-être les deux, l’un aggravant l’autre !… Toujours est-il qu’en envoyant le programme à l’imprimeur, il oublia d’y porter ce titre.
La cantatrice eut vent de cette infidélité, dont elle fut informée à l’heure même où le tirage de l’affiche allait commencer. Pleine d’ire, mais ne voulant point exposer sa dignité en des querelles, elle chargea l’accompagnateur, jeune homme sans importance, d’aller incontinent transmettre au chef d’orchestre son ultimatum. Or, il était neuf heures du soir, et Berlioz était un couche-tôt, du moins en province. Il n’y avait pas à hésiter cependant. Duvernoy s’en vint donc bravement sonner à la porte du maître. « Qui va là ? » crie une voie féminine. Il se nomme, et voici paraître à l’huis Mme Berlioz, dans le simple appareil d’une beauté qu’on vient d’arracher au sommeil. Sans se laisser émouvoir à l’excès par cette apparition nocturne, le messager s’avance jusqu’au lit sur lequel reposait l’auteur de la Symphonie funèbre et triomphale, et, fidèle à sa mission, il déclare : « M’sieu Berlioz, Mme Carvalho m’envoie vous dire que, si l’affiche n’annonce pas l’Ave Maria de Gounod, elle ne chantera pas. » Je laisse à deviner au lecteur perspicace si ces paroles furent suivies de certaines imprécations, prononcées dans le même simple appareil… Toujours est-il que Mme Carvalho chanta l’Ave Maria ! (6) Des fragments d’Orphée, avec Mme Viardot, consolèrent Berlioz de cette défaite. Roger dit aussi l’air de Joseph, ainsi que le Roi des Aulnes, que Berlioz avait orchestré pour cette audition. L’ouverture des Francs-Juges et la Scène des Sylphes furent la seule part du lion qu’il conserva pour lui-même.
Il se fit cette part plus large l’année suivante, qui fut la dernière où il dirigea le festival de Bade (26 août 1861) : Harold et d’importants fragments du Requiem (dont le Tuba mirum) formèrent les gros morceaux du programme, qui comprenait encore la Fantaisie pour piano, avec orchestre et chœur, de Beethoven, le concerto pour violon de Mendelssohn (par Sivori), la vieille et toujours vivante ouverture du Jeune Henri, de Méhul, et quelques autres morceaux empruntés au répertoire courant (7).
___________________________________
(1) Mémoires de Berlioz, Postface. —
Lettre à Liszt, 17 novembre
1855 [CG no. 2046]. — Revue et Gazette musicale, depuis le 28
octobre jusqu’au 7 décembre. — Les papiers de Berlioz conservés par la
famille comprennent, sur ces concerts de l’Exposition de 1855, un dossier de
sept pièces, savoir : 1° Circulaire adressée aux musiciens, leur proposant de prendre part à trois concerts et trois répétitions, total six
séances, pour 40 fr. Une note autographe sur le même objet, à l’adresse
d’Ancessy, chef d’orchestre de l’Odéon, y est jointe. — 2° Calculs ayant
pour objet de réaliser quelques économies sur la composition de l’orchestre,
afin de relever d’autre part le cachet des chefs (86 violons au lieu
de 96 ; 33 violoncelles au lieu de 36 ; 34 contrebasses au lieu de
36 ; 8 hautbois au lieu de 10 ; clarinettes, idem ; 10 bassons au
lieu de 12 ; 12 cors au lieu de 16). « A finir la liste avec l’Odéon
et le Conservatoire. » Cette note est entièrement autographe. — 3°
Adresses de musiciens de l’Ambigu, l’Odéon, etc. — 4° Lettre de Masson,
maître de musique à Saint-Roch, adressant à Berlioz deux basses de sa
chapelle (saluons au passage cette offre de concours du vieux maître de
chapelle qui, à plus de trente ans en deçà, avait été le premier à
favoriser la production de Berlioz inconnu). — 5° Demande d’un musicien pour
faire partie de l’orchestre, écrite à Desmarest. — 6° Autre demande
analogue. — 7° Fragment de la liste des musiciens de l’orchestre, allant du
no 142 à 293 ; à la tête des violoncelles figurent Chevillard et Léon
Jacquard.![]()
(2) Conservés par la famille.![]()
(3) Ces chanteurs réalisant le rêve de Berlioz étaient Battaille, Depassio,
Jourdan Meillet et Mme Meillet.![]()
(4) Paru d’abord dans la Revue et Gazette musicale, nos 1 à 9 de
1856.![]()
(5) Ces airs espagnols, que Madame Viardot aimait à chanter, en
s’accompagnant au piano, dans les concerts les plus sévères, sont la dernière
musique que j’aie entendu interpréter à l’illustre cantatrice. C’était dans
une réunion tout intime, chez Gaston Paris, il doit y avoir une quinzaine
d’années de cela : l’artiste septuagénaire semblait avoir quinze ans !![]()
(6) Rapprocher de cette anecdote ces mots extraits d’un
article de Berlioz (sous
forme de lettre ouverte) écrit de Bade l’année suivante : « Il me
reste à m’entendre avec les dieux et les déesses du chant sur le choix de
leurs morceaux. Quant à désigner moi-même ce qu’ils devront chanter, je m’en
garde, je sais trop le respect que les simples mortels doivent aux divinités.
Au bout de six semaines on parvient, en général, à découvrir qu’on ne peut
pas s’entendre, les cantatrices surtout ayant pour habitude de changer dix fois
d’avis avant le moment du concert. » A travers chants, p. 261.![]()
(7) Un programme de ce concert, imprimé en lettres dorées sur carte glacée,
est conservé dans la famille de Berlioz. Il porte en titre : Solennité
musicale. Grand Concert au profit de l’hôpital de la ville de Bade, sous la
direction de M. HECTOR BERLIOZ. — C’est à ce séjour à Bade que se
rattache la lettre de Berlioz « A MM. les membres de l’Académie des
Beaux-Arts de l’Institut », datée du 11 septembre 1861, reproduite dans A
travers chants, pp. 259 et suiv.![]()
![]()
![]() Le Ménestrel, 26
Mars 1910, p. 99-100
Le Ménestrel, 26
Mars 1910, p. 99-100
(Suite)
En 1862, les festivals furent remplacés par des représentations d’opéra, dans une nouvelle salle de théâtre que Berlioz avait été requis d’inaugurer par une œuvre nouvelle : Béatrice et Bénédict, spécialement composé pour cette occasion. Il en dirigea la première représentation, le 9 août.
Il revint pour la dernière fois à Bade l’année suivante, où il conduisit de nouveau l’orchestre à la reprise de son opéra-comique (14 août 1863).
Et ce fut la fin. L’année suivante, les Troyens à Carthage ayant été représentés à Paris, Berlioz résolut de se retirer dans une retraite presque complète. « Ma carrière est finie : je ne compose plus de musique, je ne dirige plus de concerts », écrit-il à ce moment même dans la Postface de ses Mémoires. Et si, en 1865, le festival de Bade inscrit encore sur son programme la Fuite en Égypte et l’acte du septuor des Troyens, ce n’est plus lui, c’est Ernest Reyer qui, pieusement, dirige en sa place.
A Paris, la fin de sa carrière de chef d’orchestre fut, hélas ! peu brillante : l’on peut dire qu’après son dernier effort de 1854 et 1855 elle était terminée. Berlioz ne fut plus désormais qu’une façon de chef d’orchestre amateur, prêtant son concours à des amis, par pure complaisance : le bénéficiaire voulait bien, en retour, inscrire ordinairement sur le programme un morceau de lui, qu’on avait peine à choisir, car l’orchestre était restreint et ne répétait guère ; et c’est à ce rôle mesquin qu’était réduit celui qui, pendant trente ans et plus, avait eu l’initiative des plus grandioses manifestations musicales qu’ait vues le siècle.
C’est ainsi qu’en 1856, il n’eut pour toute besogne qu’à diriger une messe de Niedermeyer, le 16 juillet, pour l’inauguration de Saint-Eugène, cette église en fer, comme un hall d’exposition, construite, par actions, sur les terrains voisins du Conservatoire. Maigre exploit ! — Le 19 avril 1857, à la salle Herz, Théodore Ritter donne un concert pour faire entendre deux ouvertures de sa composition et se faire entendre lui-même dans un Concerto symphonique de Litolff : Arban joue un solo de cornet à piston avec orchestre, et une chanteuse chante l’air d’Obéron : on demande à celle-ci d’ajouter à son programme le Spectre de la Rose, de Berlioz ; il vient donc conduire l’orchestre, y compris le solo de pistons. — L’an d’après (2 mai 1858), c’est Litolff qui, étant venu donner des concerts à Paris, a demandé à Berlioz d’en diriger un (pour deux autres le bâton est tenu par Pasdeloup — un nom qui devient menaçant !) ; l’auteur de la Damnation de Faust conduit l’ouverture des Guelfes, un concerto, ainsi que la Fête chez Capulet et la Captive ; à la fin du concert, Litolff reprend la baguette pour diriger lui-même une Scène de Faust (pastorale) de sa composition, pour soli, chœur et orchestre. Encore un Faust !
Le 23 avril 1859, l’Opéra-Comique a voulu donner une nouvelle audition de l’Enfance du Christ dans un concert spirituel. Berlioz y préside et fait entendre en outre la Scène des Sylphes, l’Hymne à la France, ainsi que Plaisir d’amour, qu’il a orchestré pour Battaille. Ritter lui prête son concours, et le nom de Gounod, dont on venait de donner le Faust, est inscrit au programme.
Au milieu de juin, Berlioz va à Bordeaux diriger quelques œuvres de sa composition à la Société philharmonique.
Dans les derniers mois de l’année, il dirige les études musicales d’Orphée de Gluck au Théâtre-Lyrique, mais sans conduire l’orchestre. Il en fait autant pour Alceste à l’Opéra en 1861.
En janvier 1860, la mort subite de Girard a laissé vacants les postes de chef d’orchestre de l’Opéra, de la Cour et de la Société des Concerts. Berlioz rentrerait avec joie dans la vie active si cette dernière direction lui était confiée ; mais il connaît trop bien les dispositions qu’on a pour risquer la moindre tentative. Voici deux lettres (présentement inédites) qui viennent nous éclairer pleinement là-dessus.
La première, du 2 février 1860, est adressée à sa sœur Adèle. Nous n’en donnons qu’un fragment [CG no. 2475]:
Tu me parles de la place de l’Opéra ; on m’eût donné trente mille francs que je l’eusse refusée. C’est un métier de chien. Il s’agit maintenant de celle de la Cour, qui n’en rapporte que trois mille, mais qui ne me fatiguerait pas. Tout le monde veut me la donner, le ministre M. Fould, le prince Napoléon, le prince Poniatowski ; il s’agit seulement de détruire l’opposition que fait Auber (le maître de chapelle) qui prétend que cette place n’est pas digne de moi et préfère pour chef d’orchestre un simple violoniste de la chapelle. Il ne veut pas… de quelqu’un qui puisse lui porter ombrage ; c’est un manœuvre obscur qu’il lui faut. On fera ce qu’on voudra, je ne m’en mêle plus.
Cette autre lettre, à Ernest Legouvé, précise l’attitude pleine de dignité (un peu hautaine) de Berlioz en cette circonstance. La voici en entier [CG no. 2465] :
Merci, mon cher Legouvé, de la nouvelle preuve d’affection que vous me donnez et de vos offres de service. J’ai pris le parti de laisser faire et de ne pas me mettre en avant ; si l’on me veut on saura bien me trouver et je verrai alors quelle réponse j’aurai à donner. Mais je ne dois pas solliciter. Ce n’est point par fierté exagérée et mal entendue, mais bien parce que je ne puis accepter une tâche comme celle qu’il s’agit de remplir qu’avec l’assentiment cordial et spontané des artistes.
Il n’y a pas de loi qui m’oblige à faire le Coriolan et montrer mes blessures sur la place publique. J’ai d’ailleurs, entre nous soit dit, très peu d’ambition, et me résigne parfaitement à n’être pas Consul.
Mais votre sollicitude m’a touché vivement, je vous remercie de tout mon cœur.
A vous en tout et toujours.
H. BERLIOZ.
Paris, 19 janvier.
Dans le même temps, la Revue et Gazette musicale (22 janvier), annonçant à la fois la mort de Girard et l’élection de son successeur au Conservatoire, posait la candidature de Berlioz aux fonctions de chef d’orchestre des concerts de la Cour. Ce furent Dietsch et Tilmant qui se partagèrent les dépouilles du défunt. L’on sait quelle incapacité manifesta le premier quand il eut à diriger Tannhäuser. Quant au second, il resta à peine trois ans à la direction de la Société des Concerts, fonction dont il se démit volontairement, ne se sentant pas de force à la remplir. — Le triomphe des chefs d’orchestre-violonistes sur le chef d’orchestre-compositeur était complet.
L’année d’après, un événement capital se produisit dans l’histoire des concerts en France. Le 21 octobre 1861, Pasdeloup inaugura les Concerts populaires de musique classique. Ce n’est pas trop dire que de constater que cette institution eut pour effet de transformer, en l’élevant à des hauteurs inconnues, la mentalité musicale de la France. Je serais un ingrat, moi qui, comme tant d’autres, ai dû aux Concerts Pasdeloup la révélation du grand art symphonique, et dont la jeunesse en a reçu des impressions inoubliables, si je venais aujourd’hui essayer de diminuer les mérites de l’homme à qui fut dû un résultat si heureux. Mais ce n’est pas en mériter le reproche que d’examiner si d’autres n’y ont point participé, et je ne pense pas que la réponse puisse faire doute pour ceux qui ont suivi cet exposé historique de la carrière de Berlioz comme chef d’orchestre.
La vérité est que, ce que Pasdeloup réussit du premier coup, c’est ce à quoi Berlioz avait vainement tenté d’atteindre pendant toute sa vie. Sans doute, la grande idée du nouveau règne fut de mettre les places à quinze sous — les premières à deux francs cinquante (exemple si lointain, apparaît-il aujourd’hui !) ; mais quant au répertoire, le chef de la nouvelle institution, loin de tenter aucun effort pour le constituer, prit à tâche de reproduire servilement les programmes du Conservatoire, et de ne point s’écarter des œuvres consacrées par lui. Cependant, Berlioz n’avait pas attendu jusque-là pour faire entendre au public, même parisien, les symphonies de Beethoven, les ouvertures de Weber et les grandes pages lyriques de Gluck. Sa tentative de la Société philharmonique, dès 1850, est aussi intéressante pour le moins que celle de Pasdeloup plus de dix ans plus tard.
La gloire de Pasdeloup est donc celle d’un chef qui a remporté la victoire. Gardons-nous de la lui disputer. Mais il est telle victoire qui a été rendue facile, soit parce que la bataille a été livrée dans des circonstances favorables, soit parce que le chef a pu profiter des exemples de devanciers moins heureux que lui, mais non moins habiles : — peut-être même plus. C’est bien là, à ce qu’il semble, la situation de Pasdeloup vis-à-vis de Berlioz. Et quand celui-ci assista au triomphe des Concerts populaires, sans doute il s’en réjouit au nom du progrès de l’art, qu’il avait si ardemment souhaité ; mais en même temps il fut bien excusable si (lui qui aimait à citer Virgile) il répéta, en l’appliquant à lui-même, le Sic vos non vobis mellificatis apes !
Dès lors, le grand symphoniste de la Fantastique se sent définitivement annihilé. Il ne dirige plus aucun concert sérieux, du moins à Paris : depuis le printemps de 1859, où il a donné pour la dernière fois l’Enfance du Christ, jusqu’en 1863, on ne l’y voit pas une seule fois tenir le bâton, fût-ce pour de petits concerts.
En cette dernière année, le 8 février, il reparaîtra un soir pour diriger la seconde partie d’un concert de la Société nationale des Beaux-Arts, salle Martinet, boulevard des Italiens ; le programme porte Vasco de Gama, de Bizet, Vercingétorix, de Debillemont, la Symphonie en mi bémol de Félicien David (dirigée par l’auteur), et, de lui-même, la Fuite en Égypte, le Carnaval romain et l’Invitation à la valse. L’on constate qu’à partir de son arrivée au pupitre « l’orchestre s’est subitement métamorphosé ». Une autre audition de la même société a lieu le 22 février suivant (1).
Puis (c’est l’année de la représentation des Troyens et il lui faut bien se tenir en haleine) il fait quelques incursions au dehors : à Strasbourg, Weimar, Lœvenberg.
___________________________________
(1) Revue et Gazette musicale, 1 et 5 février 1863 ; lettre à Humbert Ferrand, du 22 février (Lettres intimes [CG no. 2697]).
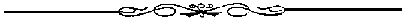
Le Ménestrel, 2 Avril 1910, p. 107-108
(Suite et fin)
A ce moment, un revirement, précurseur de la grande réhabilitation posthume, commençait à se produire en faveur du compositeur, d’ailleurs en dehors de son action personnelle. La Société des concerts, maintenant que Girard n’était plus là pour faire opposition, commençait à ne plus le traiter en étranger. Elle fit entendre en 1861 la scène des Sylphes et le chœur des Soldats et Étudiants de la Damnation de Faust, en 1863, le duo-nocturne de Béatrice et Bénédict. Il s’ensuivit une reprise de relations amicales dont témoignent trois lettres, de la même année (1863), écrites par Berlioz au comité de la Société (l).
Par la première (du 25 mars [CG no. 2702]), Berlioz annonçait à la Société, comme à « la seule institution musicale de France dont l’avenir puisse inspirer de la confiance à un compositeur », qu’il lui faisait don de tout son matériel musical, partitions et parties séparées de ses œuvres. « Peut-être, écrivait-il, plus tard ces ouvrages auront-ils pour la Société des concerts quelque valeur. »
Trois jours après (28 mars [CG no. 2703]), une nouvelle lettre entretenait le comité d’un projet de nouvelle audition du duo de Béatrice.
Puis, la session close, Tilmant se retira. La direction de l’orchestre était de nouveau vacante. Cette fois, Berlioz n’y tint plus. La démarche qu’il avait refusé de faire trois ans auparavant, il se décida cette fois à la tenter : il posa sa candidature. Le 19 décembre 1863, il écrivit au comité la lettre suivante [CG no. 2812] :
MESSIEURS,
Veuillez informer la Société des concerts du Conservatoire que je la prie de me compter parmi les artistes qui sollicitent ses suffrages pour la place de chef d’orchestre devenue vacante par la retraite de M. Tilmant.
Je serais d’autant plus heureux que votre illustre Société me fît l’honneur de me confier ces fonctions que je pourrais maintenant m’y consacrer absolument et y donner tout mon temps.
Recever, Messieurs, l’assurance de mon dévouement et de mes sentiments les plus distingués.
H. BERLIOZ.
Mais ce fut encore une nouvelle défaite. L’élection eut lieu le 21 décembre, et Berlioz ne fut pas nommé. Une fois de plus la majorité de l’assemblée préféra porter son choix sur un chef d’orchestre de théâtre : Georges Hainl fut élu. Il était dit que Berlioz ne serait jamais chef d’orchestre d’une institution régulière. Au reste, il n’en garda pas rancune. Dans la Postface de ses Mémoires, il fait cette constatation apaisée : « La Société du Conservatoire, dirigée maintenant par un de mes amis, M. Georges Hainl, ne m’est plus hostile » ; et rappelant le don qu’il venait de faire de sa bibliothèque musicale « qui, ajouta-t-il, ne saurait être en meilleures mains », il se félicite des succès que ses œuvres commençaient à obtenir dans le Sanctorium.
Ce n’en était pas moins pour lui-même la fin, la retraite absolue, définitive.
Après 1863, Berlioz, compositeur, écrivain, chef d’orchestre, a fini son rôle.
Rien en 1864. Il refuse l’invitation que lui fait Carvalho de diriger le septuor des Troyens dans un concert spirituel : le morceau, déjà annoncé, est retiré de l’affiche (2).
Rien non plus en 1865.
En 1866, pourtant, il cède aux instances de l’amitié. Mme Massart donne, le 1er mars, un concert avec orchestre à la salle Érard ; elle y joue un concerto symphonique de Léon Kreutzer. Il est requis de diriger l’exécution d’ensemble. Ce fut la dernière fois que le public parisien fut admis à voir Berlioz à la tête d’un orchestre (3).
Cette manifestation mesquine de l’art de celui qu’on avait vu naguère à la tête des plus grandes exécutions eût même marqué l’achèvement de sa carrière si, un an avant qu’il mourût, il n’eût eu enfin l’occasion de donner, loin de France, sa pleine et définitive mesure dans un milieu digne de lui. Déjà, dans l’hiver de 1866-67, il avait été conduire ses œuvres à Vienne et à Cologne. A la fin de l’été suivant, la grande-duchesse Hélène de Russie, belle-sœur de l’empereur Nicolas et tante de l’empereur Alexandre, voulant relever le niveau des concerts du Conservatoire de Saint-Pétersbourg, proposa à Berlioz de diriger six séances de cette institution au cours de la session qui allait s’ouvrir. Elle lui offrait pour son concours, outre les frais de voyage et l’hospitalité dans son palais, des honoraires de quinze mille francs. Malgré sa fatigue et son découragement, il accepta et, dès les premiers jours d’octobre, envoya en Russie un projet d’ensemble qui mérite d’être reproduit intégralement ici, car c’est un modèle de composition pour un ensemble de programmes classiques.
PREMIER CONCERT. — Symphonie pastorale (Beethoven). — Chœur des prêtres d’Isis de la Flûte enchantée (Mozart). — Concerto de piano en ut mineur, de Mozart. — Ave verum, chœur de Mozart. — Air de la comtesse de Figaro, (Mozart), chanté par Mlle Regan. — Ouverture d’Obéron (Weber).
DEUXIÈME CONCERT. — Ouverture de Léonore (Beethoven). — Fragments d’Iphigénie en Tauride (Gluck) : Récit et air de Thoas (baryton) ; chœur et ballet des Scythes. — Hymne à l’empereur d’Autriche du quatuor 77e (Haydn), thème varié, joué par tous les instruments à cordes. — Symphonie en si bémol (Beethoven).
TROISIÈME CONCERT. — Symphonie héroïque (Beethoven). — Air de Sarastro (pour voix de basse) de la Flûte enchantée (Mozart). — Second acte complet (le Tartare et les Champs-Elysées) d’Orphée (Gluck), chanté par Mlle Lavrowsky. — Ouverture d’Euryanthe (Weber).
QUATRIÈME CONCERT. — Ouverture de la Grotte de Fingal (Mendelssohn). — Romance pour le violon (Berlioz) jouée par M. Wieniawski. — Scène de la Haine dans Armide (Gluck) : Armide, Mlle Budell; la Haine, Mlle *** ; chœurs et air de danse. — Symphonie en ut mineur (Beethoven).
CINQUIÈME CONCERT. — Symphonie avec chœurs (Beethoven) et quatre voix seules. — Duo nocturne de Béatrice et Bénédict (Berlioz), chanté par Mlles Regan et Lavrowsky. — Ouverture du Freischütz (Weber).
SIXIÈME CONCERT. — Fragments de Roméo et Juliette, symphonie avec chœurs (Berlioz), nos 1, 2 et 4. — Reviens, reviens, mélodie chantée par Mlle Regan (Berlioz). — La Captive, mélodie chantée par Mlle Lavrowsky (Berlioz). — Chœur des sylphes : Faust, ténor ; Méphistophélès, basse ; chœurs. — Harold en Italie, symphonie avec alto principal (Berlioz). L’alto sera joué par M. Wieniawski (4).
Quelques remaniements furent apportés à ces programmes, dont l’économie générale fut d’ailleurs respectée : les principaux consistèrent à augmenter le nombre des œuvres de Berlioz, que le public russe manifesta une grande curiosité d’entendre. Mais Gluck et Beethoven gardèrent la large place qu’il leur avait attribuée (encore que la Symphonie avec chœurs n’ait pu être maintenue) et ce fut une joie pour Berlioz de les faire vivre une dernière fois sous sa baguette. « Au premier concert, écrivit-il, j’ai dirigé l’exécution de la Symphonie pastorale de Beethoven, et j’ai profondément adoré ce pauvre grand homme qui a pu créer une si étonnante poésie musicale. Mais comme nous l’avons chantée, cette poésie ! Quel bel orchestre !… » Et, quelques jours plus tard : « Je vais diriger la scène du Temple d’Alceste, que j’ai eu bien de la peine à faire marcher, mais qui va bien maintenant. Quelle joie d’initier un peuple à des beautés pareilles ! Les Russes ne connaissent pas Gluck. » Sa musique lui cause aussi des ravissements. « Moi qui n’avais pas entendu la Symphonie fantastique depuis plus de dix ans, je faisais des efforts pour me contenir et ne pas céder à l’envie de pleurer que m’avait donnée la Scène aux champs » (5).
Le chef d’orchestre ne fut pas moins admiré que le compositeur. « Comme il comprend Beethoven ! écrivit César Cui. Quelle sévérité, quelle austérité dans l’exécution ! et quel effet sans aucune concession au clinquant ni au mauvais goût ! Je préfère de beaucoup Berlioz à Wagner comme chef d’orchestre quand il s’agit de Beethoven. Malgré toutes ses excellentes qualités, Wagner fait voir souvent de l’affectation et il introduit dans la mesure des ralentis d’une sentimentalité douteuse. » (6). Et Rimsky-Karsakov, dans des souvenirs récemment publiés, tout en exprimant le regret que l’affaiblissement de sa santé ait empêché Berlioz de faire la connaissance des « espoirs russes », reconnaît qu’il redevenait « vaillant durant le concert », et, sans voiler d’ailleurs certaines défaillances de ses facultés, constate que « l’exécution fut magnifique : l’ascendant de la célébrité agissait sur l’orchestre russe. Les gestes de Berlioz étaient simples, clairs et beaux. Aucune recherche dans les nuances… (7) »
Entre temps, il alla à Moscou pour y donner deux concerts, le premier devant un auditoire de dix mille personnes.
La dernière œuvre d’autrui qu’il dirigea fut la Symphonie en si bémol de Beethoven, la « Symphonie heureuse » (8).
Et quand, le 27 janvier 1868, après avoir conduit les plus importants morceaux de Roméo et de la Damnation de Faust, il abaissa son bras sur le plein accord de sol majeur qui conclut le finale de sa symphonie d’Harold, il put se dire que le terme était venu pour lui, car il n’eut plus une seule autre occasion d’entendre sa musique ; mais du moins il avait pu, par cette révision dernière, éprouver une jouissance d’art dont la fin de sa vie fut un moment illuminée.
Un an après être revenu en France, Berlioz mourut.
Cette étude d’une manifestation secondaire de son activité a, en fin de compte, pris l’apparence d’une biographie complète. C’est qu’en effet, pour tout autre, de pareils travaux auraient suffi à remplir une vie ; et tel, qui n’eut à son actif ni sa production musicale ni ses écrits littéraires, se fût fait honneur d’une carrière de chef d’orchestre si activement, honorablement et utilement parcourue.
(Fin.)
___________________________________
(1) Les lettres de Berlioz à la Société des concerts, après m’avoir été communiquées pour être publiées dans la correspondance générale de Berlioz (deux ont déjà paru, du fait de leur date, dans le premier volume : Les Années romantiques) ont été exposées publiquement dans la salle des Pas-Perdus du Conservatoire lors des auditions de l’Enfance du Christ qui y furent données les 19 et 26 décembre 1909.

(2) Lettre (présentement inédite) de Berlioz à son fils, du mardi 29 mars l864 [CG no. 2849].
(3) Il ne nous a pas été possible de retrouver le programme de ce concert. La maison Érard n’a pas conservé la collection des programmes de cette époque ; quant aux Journaux, les seuls où nous en ayons trouvé mention (la Gazette musicale et le Ménestrel) s’en tiennent à citer le concerto de Léon Kreutzer comme unique morceau comportant la participation de l’orchestre et à dire, avec les banales formules d’usage, que Berlioz dirigeait. Ce fut ainsi qu’il acheva si obscurément son rôle que nul ne sait plus dire en quoi consista son adieu.
(4) Ces programmes étaient joints à la lettre écrite par Berlioz le 10 octobre 1867 [CG no. 3289, à Vasily A. Kologrivov] (voy. Berlioz en Russie, par OCTAVE FOUQUE, dans les Révolutionnaires de la musique, pp. 239-40).
(5) Lettres (présentement inédites) de Berlioz à son oncle Marmion (du 8 décembre 1867 [CG no. 3310]) et à sa nièce Mme Joséphine Chapot (27 décembre [CG no. 3319. Cette lettre date du 28 décembre 1867]).
(6) Cité dans O. FOUQUE, les Révolutionnaires de la musique, p. 252.
(7) Rimski-Korsakow, Ma vie musicale, fragments traduits et publiés dans la Revue bleue, 18 septembre 1909.
(8) Le programme du concert qui se terminait par cette œuvre (le cinquième des six que Berlioz dirigea à Saint-Pétersbourg) contient un titre qui n’était point dû à son initiative : l’Aria de la Suite en ré de J.-S. Bach. Ce morceau est depuis longtemps favori du public russe. Tolstoï, dans son livre : Qu’est-ce que l’art, qui est la condamnation en bloc de l’art presque entier, le compte au nombre des cinq ou six pages musicales auxquelles il fait grâce. L’on connaît d’autre part le peu de sympathie de Berlioz pour la musique de Bach (qu’à la vérité il ne connaissait pas). Nous devons donc croire que ce fut contraint et forcé qu’il accepta, pour la première fois de sa vie à son dernier concert, de diriger une œuvre de Bach. Celle-ci d’ailleurs, ainsi que l’indique le programme, n’était pas donnée sous sa forme originale, c’est-à-dire chantée par tous les violons de l’orchestre, mais exécutée en arrangement pour violon solo (Wilhelmij).
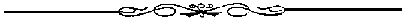
Site Hector Berlioz créé par Monir Tayeb et Michel Austin le 18 juillet 1997; page Julien Tiersot: Berlioziana créée le 1er mai 2012; cette page créée le 1er septembre 2013.
© Monir Tayeb et Michel Austin. Tous droits de reproduction réservés.
Retour à la page Julien Tiersot: Berlioziana
Retour à la page Exécutions et articles contemporains
Retour à la Page d’accueil
Back to Julien Tiersot: Berlioziana page
Back to Contemporary Performances and Articles page
Back to Home Page