16. Œuvres inÉdites
Cette page présente les articles publiés par Julien Tiersot dans la série Berlioziana avec le sous-titre “Œuvres inédites” et les lettres ouvertes en réponse à quelques-uns de ces articles. Voir la page principale Julien Tiersot: Berlioziana.
Note: pour les lettres de Berlioz citées par Tiersot on a ajouté entre crochets des renvois au numérotage de la Correspondance Générale, par exemple [CG no. 38].
| Le Ménestrel, 8 Avril 1906 |
Le Ménestrel, 2 Septembre 1906 Le Ménestrel, 9 Septembre 1906 Le Ménestrel, 16 Septembre 1906 Le Ménestrel, 10 Novembre 1906 Le Ménestrel, 17 Novembre 1906 |
![]()
![]() Le Ménestrel, 8
Avril 1906, p. 107-108
Le Ménestrel, 8
Avril 1906, p. 107-108
ŒUVRES INÉDITES
Nous entrons ici dans une série nouvelle qui nous promet des observations plus intéressantes encore que toutes celles que nous avons pu faire jusqu’ici, car elles nous révéleront dans l’œuvre de Berlioz une part d’inédit dont la réelle importance n’échappera pas aux lecteurs.
Ce sont des œuvres laissées par lui en manuscrit, et qui n’ont jamais été publiées de son vivant.
Quelques-unes, à la vérité, ont, à une époque récente, vu le jour de l’édition ; mais les conditions mêmes de leur publication nous autorisent à les considérer encore comme inédites. Elles n’ont en effet paru qu’en Allemagne, où, par suite des lois différentes sur la propriété artistique, l’œuvre de Berlioz est tombée dans le domaine public depuis 1899, trente ans après sa mort, alors qu’elle n’y doit entrer en France qu’après cinquante ans, en 1919. Il résulte de ce fait que l’édition dans laquelle elles sont contenues, ne peut pas légalement passer nos frontières en ce moment, et cette prohibition a été affirmée par les éditeurs français de Berlioz, lesquels ont rédigé et signé en commun la circulaire suivante :
Janvier 1900
Les éditeurs soussignés, conformément aux traités internationaux et seuls propriétaires des œuvres de H. BERLIOZ dans les pays suivants : France, Belgique, Hollande, Danemark, Suède, Norvège, Italie, Espagne, Tunisie, Principauté de Monaco, Luxembourg, etc., portent à la connaissance du public et plus particulièrement des Éditeurs, Libraires et Marchands de musique, que des éditions allemandes des dites œuvres viennent d’être mises en circulation.
Les éditeurs soussignés sont absolument déterminés à poursuivre devant les tribunaux, pour délit de débit de contrefaçon, tout ceux qui aideraient d’une façon quelconque à l’introduction et à la vente de toutes éditions en dehors de celles provenant de leurs maisons respectives.
Veuillez, M et cher confrère, prendre note de cette déclaration qui n’a pour but que de vous éclairer sur une situation que vous ignorez sans doute, et éviter pour l’avenir toute difficulté entre nous.
Veuillez agréer nos salutations empressées.
Suivent les signatures.
Au reste, nous n’avons eu nul besoin de faire usage de cette édition, ayant eu tous les manuscrits originaux de ces œuvres inédites à notre disposition à la Bibliothèque Nationale, à celle du Conservatoire, et dans la famille de Berlioz. Nous devons ajouter que plusieurs des œuvres comprises dans cette série de notre étude, et non les moins importantes, n’ont pas été insérées dans l’édition allemande.
Un mot d’abord au sujet d’une observation qui a été déjà faite maintes fois au sujet de certaines compositions de Berlioz. On lit parfois dans ses Mémoires qu’après avoir entendu telle de ses productions il n’en fut pas satisfait, et qu’il la détruisit. Or les manuscrits de quelques-unes des partitions qu’il désigne ainsi ont été retrouvés. Est-ce là une raison suffisante pour mettre en doute, comme on aime à le faire, la véracité de la parole de Berlioz ? En aucune manière. Quand, mécontent d’une de ses œuvres, il voulait la détruire, il détruisait, ce qu’il avait en sa possession ; mais il y eut beaucoup de cas où des exemplaires des œuvres condamnées étaient déjà sortis de ses mains, et ceux-là il ne pouvait les atteindre. Nous verrons plusieurs exemples de ce cas dans les pages qui vont suivre. Le Resurrexit de sa première messe, l’ouverture de Rob Roy, sont parmi les œuvres qu’il dit avoir fait disparaître : il est parfaitement exact que rien n’en a été retrouvé parmi ses papiers personnels. Mais ces œuvres étaient des envois de Rome ; les exemplaires réglementaires qu’il en avait communiqués à l’Institut ne lui appartenaient pas : c’est eux qui nous sont parvenus. Il en est de même pour ses cantates de concours : encore y en a-t-il deux sur quatre que l’administration à laquelle elles appartenaient eut l’imprudence de lui confier, et qu’il a sacrifiées ; s’il nous en est venu quelque chose, c’est toujours par des voies indirectes. De sa Scène héroïque, dont il tentait encore l’exécution à une époque où il était déjà célèbre, le seul exemplaire qui nous soit connu est celui qu’il avait fait copier pour l’envoyer en hommage à son collaborateur littéraire. Et le même ami avait eu entre les mains le dernier exemplaire, dont la trace semble définitivement perdue aujourd’hui, d’une de ses cantates disparues.
Parfois cependant il faisait des réserves, reculant, au dernier moment, devant le sacrifice de certaines pages qui lui rappelaient des souvenirs d’art ou en lesquelles il reconnaissait des beautés fragmentaires. Il est tel de ces manuscrits sur lequel nous lisons ces mots, tracés au crayon, comme à regret : « A brûler après ma mort ». Ce sont là de ces ordres auxquels on s’estime trop heureux de ne pas obéir ! Tel autre ne portait aucune indication ni de nom ni de titre, et son identification nous a fort intrigué : nous pensons nous être tiré du problème avec honneur ; l’on en pourra juger par la suite de cette lecture.
En tout cas, s’il se peut que cette partie de notre étude n’ait pas à nous révéler de chefs-d’œuvre nouveaux et complets, nous n’y découvrirons certainement rien dont la mémoire de Berlioz ait à souffrir. Nous y trouverons au contraire des traces constantes de son labeur incessant et probe, de sa haute conscience d’artiste, de son effort toujours transcendant ; enfin, nous aurons l’occasion d’y faire un grand nombre d’observations qui sont, croyons-nous, d’un rare intérêt pour ce qui regarde l’élaboration de son œuvre et l’activité de son génie.
RESURREXIT DE LA MESSE SOLENNELLE
L’histoire de la Messe solennelle, première œuvre de Berlioz admise aux honneurs de l’exécution publique, est intéressante, amusante aussi par endroits.
Il l’a racontée assez longuement dans ses Mémoires, et plusieurs de ses lettres ajoutent à son récit d’heureuses précisions.
Il avait entrepris bravement la composition de cette œuvre importante alors qu’il venait à peine de commencer ses études musicales sous la direction de Lesueur. Tous ses essais antérieurs, nous l’avons dit, sont restés inconnus : cantate du Cheval arabe, opéra d’Estelle, scène de Beverley, oratorio du Passage de la Mer Rouge. La Messe est le premier grand ouvrage de Berlioz dont il nous reste quelque chose.
Il serait important d’en pouvoir déterminer la date de composition. Essayons-le. Dans le chapitre des Mémoires où il en parle pour la première fois, il raconte la tentative qu’il fit auprès d’Andrieux pour en obtenir un poème : infructueuse, cette démarche lui valut du moins une lettre aimable du vieil homme de lettres, qui va nous servir à notre tour en nous donnant une première date. La lettre d’Andrieux fut écrite le 17 juin 1823. C’était quelques mois après l’admission de l’étudiant en médecine parmi les élèves particuliers de Lesueur ; c’est « un peu plus tard », spécifie-t-il, que le maître de chapelle de Saint-Roch lui proposa d’écrire une messe que sa maîtrise exécuterait pour la fête des saints Innocents. L’œuvre fut composée, copiée, répétée ; mais la première lecture à l’orchestre fut si mauvaise qu’il fallut renoncer à l’exécution. Au reste, ce ne fut pas une expérience perdue : Berlioz, s’entendant pour la première fois, se rendit compte des défauts les plus saillants de son écriture, et il prit le parti de refaire l’ouvrage ; il poussa cette fois le souci de l’exécution matérielle jusqu’à copier lui-même les parties séparées, et résolut d’organiser l’exécution à ses frais. Les chapitres VII et VIII des Mémoires donnent sur ce sujet des détails bien connus ; ajoutons-y, d’après d’autres documents, un renseignement important, la date de la première audition : 10 juillet 1825.
Voilà donc fixées les dates extrêmes entre lesquelles se place la composition de la Messe, la première par approximation (milieu de juin 1823), la seconde de façon positive (10 juillet 1825). A cette dernière, Berlioz était âgé de vingt et un ans et demi.
Reprenons les documents dont nous disposons, et tâchons de préciser encore. Il dit qu’après avoir achevé l’œuvre sous sa deuxième forme et exécuté tout le travail matériel qui suivit, « aussi empêché avec sa messe que Robinson avec son grand canot qu’il ne pouvait lancer », il écrivit à Chateaubriand pour lui demander secours, et que Chateaubriand répondit par une lettre datée du 31 décembre 1824 [CG no. 38]. D’autre part, la fête des saints Innocents tombe le 28 décembre ; comme ce n’est pas du 28 au 31 qu’il put composer une partition complète, en tirer les parties, écrire à Chateaubriand et en recevoir la réponse, il en résulterait que la première tentative d’exécution remonterait à l’année précédente, décembre 1823, — et cela s’accorde assez bien avec quelques-unes des données acquises. Si donc il en fut ainsi, la Messe aurait été composée dans l’été ou l’automne de 1823, c’est-à-dire avant que Berlioz eût atteint sa vingtième année.
Il est cependant certaines indications, qui seront précisées plus loin, et qui nous font croire que cette composition ne remonte pas si haut : on peut très bien admettre que Berlioz a commis une erreur de mémoire dans la succession des faits (ce ne serait pas la seule, tant s’en faut !), et qu’il écrit à Chateaubriand, non pas après avoir recomposé la partition, mais immédiatement après l’essai fâcheux de la première répétition, et sous le coup d’un échec qu’il avait à cœur de réparer le plus tôt possible. Les dates s’accordent parfaitement en faveur de cette hypothèse : la répétition ayant eu lieu la veille ou l’avant-veille de la fête, 26 ou 27 décembre 1824, dans le dépit que lui cause le résultat, il écrit immédiatement sa requête au grand homme, et reçoit la réponse le 31 ; il lui reste encore, pour faire ses derniers préparatifs, plus de six mois avant le jour de l’exécution.
Il est invraisemblable, en effet, que cette Messe ait occupé Berlioz pendant deux années presque entières. Il ne fut jamais dans ses habitudes de s’attarder si longtemps sur une œuvre : il devait être plus pressé encore en l’heureux temps de la jeunesse, qui ne doute de rien !
Voici un document contemporain de la composition, le seul que nous possédions : c’est une lette écrite de la Côte Saint-André par Berlioz à Lesueur au commencement de l’été de 1824 (1). Il dit ceci :
Quand j’ai voulu me mettre à cette messe dont je vous avais parlé, je suis demeuré si froid, si glacé en lisant le Credo et le Kyrie, que, bien convaincu que je ne pourrais jamais rien faire de supportable dans une pareille disposition d’esprit, j’y ai renoncé. Je me suis mis à retoucher cet oratorio du Passage de la Mer Rouge que je vous ai montré et que je trouve à présent terriblement barbouillé dans certains endroits. J’espère pouvoir le faire exécuter à Saint-Roch, à mon retour, qui aura lieu, je crois, avant les premiers jours d’août. [CG no. 26]
Il résulte de cet extrait que Berlioz avait composé, au moins ébauché la musique de sa Messe dans l’été de 1824 ; qu’il ne l’avait pas montrée encore à son maître, mais simplement « lui en avait parlé » ; il n’est fait à ce moment aucune allusion à une exécution antérieure : quant à la mention de Saint-Roch, elle signifie que Berlioz fondait des espérances sur l’audition de ses œuvres dans cette église, mais point du tout que ces espérances avaient été déjà une fois réalisées.
Il semble donc, après cela, qu’il faille écarter l’hypothèse d’une date trop éloignée, et admettre, pour la composition de la Messe solennelle, celle du courant de 1824, époque où Berlioz venait d’avoir vingt ans.
Ces détails minutieux ne sont pas sans importance, puisqu’ils permettent de fixer l’époque exacte à laquelle s’est formé et développé le génie de Berlioz.
___________________________________
(1) Cette lettre, insérée dans l’appendice de la troisième édition de la Correspondance
inédite, porte en tête cette simple indication : « Sans date —
vers 1825 — de
la Côte Saint-André. » Berlioz y dit qu’il rentrera à Paris avant les
premiers jours d’août : il était donc arrivé dans son pays assez
longtemps avant cette date, sans doute en mai ou en juin, car, en un temps où
les voyages étaient longs et dispendieux, un jeune étudiant ne se serait pas
contenté d’aller passer quelques jours seulement dans sa famille. Or, nous
savons qu’en 1825 il réside à Paris pendant tout le mois de juillet, puisque
c’est le 10 de ce mois qu’il donna la première audition de son œuvre. Ce ne
fut donc pas en 1825 qu’il écrivit cette lettre. Ce ne fut pas non plus en
1823, car nous l’avons vu le 17 juin de cette année-là recevoir la visite
d’Andrieux, qui lui apportait lui-même sa lettre datée de ce jour, et il ne
semblait pas, à ce moment, d’humeur à partir pour aller quelques semaines en
Dauphiné, et être de retour avant le mois d’août. Si donc il y a
incompatibilité entre les faits connus et les dates de 1823 et 1825, il faut
adopter la date de 1824, avec laquelle tout s’arrange très bien.![]()
![]()
![]() Le
Ménestrel, 20 Mai 1906, p. 153
Le
Ménestrel, 20 Mai 1906, p. 153
Sur la Marche au Supplice
Les exigences de l’actualité ayant retardé momentanément la publication de notre étude sur Berlioz, nous ne voulons pas attendre davantage pour aborder une question qui eût trouvé sa place naturelle dans un prochain chapitre (consacré aux Francs-Juges), mais dont il vaut mieux ne pas différer l’examen, car il y a plusieurs mois déjà qu’elle s’est trouvée soulevée par un livre, d’ailleurs paru à une époque où j’étais éloigné de France et d’Europe : La Jeunesse d’un romantique, par M. Adolphe Boschot.
On lit, en plusieurs endroits du chapitre consacré, dans cet ouvrage, à « la Fantastique », des affirmations et des appréciations qui seront exactement portées à la connaissance de nos lecteurs par les citations suivantes.
Si l’on en croit les Mémoires de Berlioz, la Marche au Supplice est « écrite en une nuit ».
Par malheur, le manuscrit même de la Marche au Supplice ne permet pas d’accepter cette enfantine affirmation. La Marche, tout entière, était écrite depuis longtemps… (p. 388).
... un vieux manuscrit d’une Marche des Gardes devient une hoffmanesque Marche au Supplice… (p. 389).
Berlioz a déjà écrit une marche d’un caractère lugubre, funèbre ; et cette marche, inutilisée pour les Francs-Juges (refusés à l’Opéra), cette marche, dont l’auteur a vraiment le droit d’être satisfait, deviendra une Marche au Supplice…
Cette marche, comment la relier aux autres parties ?… Rien n’est plus facile : le programme est là pour tout expliquer ; et, quant à l’unité musicale, Berlioz plaquera, au bon endroit, un rappel de l’Idée fixe (pp. 393-394).
Deux notes précisent la pensée et les assertions de l’auteur :
Ce fut le seul changement qu’il fit à la musique de son ancienne Marche des Gardes : il arrêta le dernier fortissimo sur la dominante, intercala, avant les accords du ton, quatre mesures de l’idée fixe (clarinette), et les pizzicati du quatuor.
Cette interpolation est écrite sur une collette. En soulevant la collette, on voit l’ancien texte des Francs-Juges.
Ce que Berlioz a écrit en une nuit, c’est la collette (p. 394).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je n’insiste pas. M. Charles Malherbe (qui, pour ce chapitre encore, fut presque un véritable collaborateur) se réserve d’écrire une étude spéciale sur le manuscrit qu’il possède. Alors quelques légendes seront réduites à la vérité historique.
Que de choses, jusqu’à présent, échappent aux meilleurs berlioziens parce qu’ils n’étudient pas les manuscrits mêmes.
Un berliozien trop dévot, et qui travaille avec une hâte plus conforme aux exigences du journalisme qu’aux scrupules de la science, n’a pas dit ce qu’il y a sur le manuscrit de Berlioz.
Cette omision serait-elle volontaire ?…
En effet, ce berliozien agenouillé s’attache surtout à montrer, par un habile examen de certaines pièces, que les Mémoires de notre fantasque romantique sont l’exactitude même (pp. 388-389).
Je ne m’arrêterai pas à relever, comme il siérait peut-être, ce qu’il y a de peu convenable dans les personnalités contenues dans cette dernière note. Je n’en retiendrai qu’un mot, pour déclarer que j’en accepte parfaitement la signification : c’est l’épithète « agenouillé ». Je ne me considère comme aucunement mortifié si M. Boschot m’a surpris dans cette humble position, — car si, parmi les douze Apôtres, il en est un pour lequel je professe une considération toute particulière, — saint Thomas, qui ne tenait les choses pour vraies que lorsqu’il les avait vues, — il en est un autre que je ne prendrais jamais pour patron : c’est saint Pierre, qui renia son Dieu.
Aussi bien, ces querelles seraient vaines et nos personnalités, à M. Boschot comme à moi, n’intéressent personne. Par contre, en ce qui concerne l’œuvre de Berlioz, la question est d’un rare intérêt, qui n’a pas été exagéré. Puis donc que j’ai, sur ce point particulier, cité fidèlement — et longuement — les paroles de M. Boschot, je vais reproduire à mon tour les quelques lignes que j’ai écrites, ici même, et qui font l’objet de sa contradiction.
Après avoir rapporté, d’après la partition autographe que j’avais sous les yeux, le libellé du titre : Marche au supplice, etc., et décrit l’aspect extérieur du manuscrit, j’ajoutais les observations suivantes :
... La conclusion seule révèle des hésitations : elle a été écrite trois fois ; les premières versions sont trop brusques, comme si Berlioz avait mis un empressement haletant d’en finir avec sa hantise !
Notons un détail au passage. On a dit (c’est Mme Damcke, paraît-il, qui aurait mis cette tradition en circulation) que la Marche au Supplice est un emprunt fait par Berlioz à sa partition inachevée des Francs-Juges. Cela n’est pas impossible ; mais le manuscrit ne révèle aucune particularité qui vienne confirmer cette assertion. Les remaniements de la fin ne prouvent rien en sa faveur, car tous viennent à la suite du rappel de l’idée fixe, partie intégrante de la symphonie, qui se trouve ainsi comprise dans la notation du premier jet. (Le Ménestrel 23 juillet 1905.)
La contradiction est formelle, en effet : M. Boschot nous dit que le rappel de l’Idée fixe est une rajouture faite sur une collette, et qu’en soulevant la collette on voit l’ancien texte des Francs-Juges ; moi, au contraire, j’ai vu la notation de l’Idée fixe tracée sur le papier même du cahier original, et constaté que les remaniements que l’auteur a apportés à la conclusion de la Marche viennent à la suite de cet épisode significatif.
Lequel de nous deux a mal lu ?
La question, je le répète, est importante. Elle touche aux origines d’une des productions les plus célèbres de la symphonie française, cette Marche au Supplice, que, tout récemment encore, un chef d’orchestre allemand, profondément pénétré du sentiment génial de l’œuvre française, M. Weingartner, faisait acclamer par un auditoire tout vibrant d’enthousiasme, au milieu d’une magnifique série d’exécutions musicales où Berlioz voisinait et fraternisait avec son immortel modèle, Beethoven. Il est donc, à tous égards, nécessaire de savoir à quoi s’en tenir sur le sens véritable et l’histoire d’un tel morceau. En outre, les affirmations de M. Boschot ont abouti à des conséquences auxquelles je ne m’associerais d’ailleurs en aucune manière, fussent-elles reconnues exactes : je ne verrais, en effet, aucun motif de blâme, si Berlioz avait intercalé dans sa symphonie un thème ou un morceau entier emprunté à une autre œuvre, ce morceau étant celui que nous connaissons ; j’ai cru longtemps moi-même, sur la foi de la tradition dont j’ai dit l’origine, qu’il en était ainsi, et n’en ai point été choqué. Mais puisque l’on tire de là des conclusions si défavorables, il serait bon d’être renseigné d’une manière définitive et certaine, et de connaître si les critiques reposent sur une base solide, ou si cette base doit s’effondrer, entraînant naturellement tout le reste avec elle.
Pour avoir ce complément d’information, je proposerai la solution suivante : que le manuscrit de la Symphonie fantastique soit soumis à un nouvel examen, auquel prendraient part des personnalités compétentes, désignées par nous. Nul doute que M. Charles Malherbe, l’heureux possesseur de ce document, veuille bien y consentir, et qu’après M. Boschot et moi, qui lui devons déjà d’en avoir eu connaissance, il donne la même licence à nos arbitres. Ceux-ci pourraient être au nombre de quatre, à raison de deux choisis par chacun de nous ; eux mêmes, jugeraient s’il convient d’en adjoindre un cinquième, désigné par eux, dans l’éventualité (invraisemblable, puisqu’il s’agit d’une question de fait), d’un désaccord qui occasionnerait un partage égal des suffrages.
La question sur laquelle ils auraient à se prononcer serait celle-ci :
Est-il vrai que le manuscrit autographe de la Marche au Supplice, dans la Symphonie fantastique, apporte des preuves certaines et authentiques que ce morceau est emprunté à l’opéra des Francs-Juges ?
Subsidiairement :
Cette preuve serait-elle fournie par un document, autre que le manuscrit décrit dans le chapitre de ces Berlioziana, consacré à la Symphonie fantastique ?
Bien convaincu que ni M. Malherbe ni M. Boschot ne se refusera à un arrangement qui ne saurait manquer de mettre tout le monde d’accord, je n’attends pas davantage pour désigner ceux à l’arbitrage desquels j’ai, pour ce qui me concerne, l’intention de faire appel, et dont la compétence générale et spéciale, non plus que la haute conscience, ne seront suspectées par personne : j’ai nommé mes confrères Romain Rolland et Michel Brenet.
![]()
![]() Le
Ménestrel, 27 Mai 1906, p. 160-161
Le
Ménestrel, 27 Mai 1906, p. 160-161
[Lettre d’Adolphe Boschot au rédacteur du journal, à propos de l’article du 20 mai par Tiersot]
La “ Marche au
Supplice ”
vient des “ Francs-Juges ”
_____
Correspondance
_____
Je n’ai aucun goût pour les polémiques. Dans ma vie littéraire je n’en ai encore eu qu’une seule : c’est avec M. Sully Prudhomme. Alors, j’étais un bien jeune homme, et pourtant de cet échange de lettres ouvertes, sollicité par le poète dans la Revue de Paris, est née une amitié dont je m’honore.
Quant à polémiquer avec M. Tiersot, je m’y refuse.
Et tous nos confrères savent pourquoi : M. Tiersot travaille trop vite, donc il se trompe abondamment. Puis, pour donner le change, il polémique avec les historiens plus consciencieux. — Aujourd’hui, qui donc polémiquerait encore avec lui ?…
Rappellerai-je qu’à propos de Palestrina, M. Habert défit M. Tiersot ?… Et, à propos des « musiciens de la Révolution », M. Constant Pierre défit le même M. Tiersot… Et, à propos de chants populaires, M, Jean Ritz démontra ce qu’il fallait penser d’un invraisemblable ouvrage de M. Tiersot : comme Chants populaires de Savoie, on peut y voir notées telles mélodies qui sont de Dalayrac ou même de Beethoven ; il est vrai que M. Tiersot les agrémente de petites histoires sur les savoyards et leurs marmottes. Il prétend même que les airs de Beethoven (ou des Savoyards) servent à faire danser les marmottes (?!). Ainsi, grâce à M. Tiersot, l’auteur des Neuf Symphonies passe désormais pour être l’auteur d’une Valse des Soupirs à l’usage de la gent trotte-menu.
On sourit. — Et l’on sourit encore lorsqu’on pense que de tels ouvrages sont faits par un fonctionnaire du Conservatoire, et subventionnés avec l’argent des contribuables.
Mais revenons à la citation à comparaître que me fait tenir l’inventeur des valses pour marmottes.
M. Tiersot veut constituer un jury d’honneur ! Il m’adresse, par la voie d’un journal, une sorte de cartel pour que je vienne ergoter avec lui, devant témoins, sur trois ou quatre portées de musique !
Et pourquoi veut-il convoquer nos confrères à cette nouvelle conférence d’Algésiras ?… C’est pour décider qui de nous deux a lu de travers.
La réponse est bien simple : M. Tiersot a lu de travers, et la preuve lui en sera faite, et bien faite, et même avec des photographies à l’appui. « M. Malherbe, — ai-je écrit dans la Jeunesse d’un Romantique, et M. Tiersot cite cette phrase dans sa citation à comparoir, — M. Malherbe se réserve d’écrire une étude spéciale sur le manuscrit qu’il possède. Alors quelques légendes seront réduites à la vérité historique. »
Et je l’écris de nouveau : la Marche au Supplice vient des Francs-Juges.
Que veut donc M. Tiersot ?
Suspecte-t-il la compétence ou la sincérité de M. Malherbe ? Ou s’attaque-t-il à moi, afin de faire une niche à M. Malherbe, et de publier, — lui M. Tiersot — ce que M. Malherbe se réserve de publier lui-même ?
Je ne puis me prêter à cette manœuvre. M. Malherbe est pour moi, très amicalement et avec un désintéressement admirable, un collaborateur et un guide. Je l’ai écrit dans la Jeunesse d’un Romantique, et je l’écris encore avec le plus sincère plaisir. M. Malherbe a mis le manuscrit de la Fantastique à la disposition de M. Tiersot, comme il l’a mis à la mienne. Mais M. Tiersot, qui confond l’histoire et le steeple chase, a lu au grandissime galop : il a sauté toutes les variantes probantes… Ah, M. Tiersot, quels sauts !… Dans son étourdissante rapidité, il n’a rien vu : cet aveuglement est héroïque.
Autre chose. — Pour remercier M. Malherbe, il l’a cité, dans un Berlioziana, avec une discrétion bien remarquable. Je me rappelle qu’en lisant ce berlioziana, je pensais : « M. Tiersot a donc dépouillé deux manuscrits, l’un où il n’y a rien de notable, et qui appartient à M. Malherbe, — et un autre, qui peut servir de tremplin pour les cabrioles les plus lyriques : voici que Berlioz (d’après ce berlioziana) trouve des contrepoints dignes de Sébastien Bach !… » Mais alors, pensant ainsi, j’étais en province… A Paris, quand je revis le manuscrit de Berlioz, je constatai que M. Tiersot n’avait pas dépouillé d’autre manuscrit que celui de M. Malherbe (si discrètement obnubilé par un manuscrit fantôme) ; je constatai que le contresujet digne de Sébastien Bach n’était qu’une suite de notes de l’accompagnement : Berlioz, sur une portée écrite au crayon, les détacha des accords et les mit en dehors en les confiant aux flûtes et hautbois ; — je revis la fameuse collette, je revis aussi les preuves graphiques que la Marche au Supplice vient des Francs-Juges, — ces preuves que M. Tiersot, trop cursif, a sautées, sans même les voir.
Et je revis même autre chose.
C’est une inscription de Berlioz qui prouve que M. Tiersot est un aveugle à éclipses ou, si l’on préfère, un aveugle volontaire. — Quand M. Tiersot regarde, il lui arrive de ne pas voir, ou de voir mal : ses nombreuses polémiques et ses travaux sur Berlioz le prouvent abondamment. — Mais voici qui est plus grave : quand M. Tiersot juge qu’il ne doit plus voir l’évidence, il ne regarde plus.
Et pour les curieux de romantisme, pour les curieux d’histoire musicale qui n’auraient pas lu ma Jeunesse d’un Romantique, je vais recommencer la démonstration qui se trouve dans le chapitre intitulé le Suicide de Berlioz.
Dans son Voyage musical (1844), puis dans les Mémoires (1864), Berlioz, avec sa verve et sa fantaisie méridionale, a raconté sa pseudonoyade de Gênes. Il a cité une inscription qui se trouve sur le manuscrit de la Fantastique (1831).
Que doit faire tout historien scrupuleux ? Il doit comparer les deux textes et noter leurs différences : dans l’espèce, elles sont très significatives.
Mais que fait M. Tiersot ?
Il se refuse à lire l’inscription du manuscrit, sous prétexte qu’elle est biffée, et il cite les Mémoires !
— « Mesdames, disent les escamoteurs, si vous n’avez pas vu passer la muscade, nous allons recommencer. »
M. Tiersot recommence, indéfiniment.
J’ai vu d’excellents berlioziens, qui connaissent les pièces originales, s’en indigner. — Avouerai-je que j’ai toujours opposé à leur indignation une ironique indulgence ?
Je voudrais croire que M. Tiersot est de bonne foi. S’il avait un peu de poésie et de charme, j’aimerais à le considérer comme un disciple, égaré dans notre siècle, du bienheureux Jacques de Voragine : sans prétendre écrire la vie de Saint-Berlioz, M. Tiersot nous présente Berlioz comme un petit saint ; et le portrait, qu’il caresse sans s’ennuyer lui-même, qu’il caresse d’un blaireau onctueux, ne laisse pas de ressembler à un chromo de la rue Saint-Sulpice.
« Feux et tonnerres ! » que doit en penser notre byronien romantique, si le murmure de nos voix pénètre encore, parmi les pâles prairies des Ombres, sous sa chevelure rousse et turgescente…
Du moins que cette pensée vers l’au-delà me rende accessible (et j’y suis tout disposé) à l’indulgence et au pardon.
M. Tiersot travaille trop vite, et avec un parti pris qui l’aveugle : c’est humain.
M. Tiersot, quand ses erreurs sont rectifiées (même avec une discrétion, une délicatesse qu’il aurait dû reconnaître aux notes de mon livre) se fâche et convoque des jurys d’honneur : ce procédé n’a rien qui doive nous surprendre à l’issue d’une période électorale.
M. Tiersot reconnaîtra son erreur, quand M. Malherbe publiera les photographies du manuscrit. — Mais il pourrait la reconnaître tout de suite, s’il relisait sans aucun parti pris le chapitre VII de la Jeunesse d’un Romantique.
Il pourrait même relire le chapitre V (Conservatoire et « coups de foudre ») où il verrait que la fameuse idée fixe (une « rajouture », comme dit avec élégance M. Tiersot) fut utilisée et développée par Berlioz dans une cantate de concours, dans Herminie, deux ans avant d’écrire la Fantastique. — Et sans aucun jury d’honneur, M. Tiersot pourrait voir le manuscrit, et même le regarder plus lentement, puisque le manuscrit d’Herminie est à la bibliothèque du Conservatoire.
Enfin, j’ose espérer que M. Tiersot ne recommencera plus une telle algarade. Sans vérifier ses pièces, il ne convoquera plus ses confrères à comparaître devant des conseils d’enquête, ou, comme l’on dit, il ne les appellera plus aux prudhommes. Si seulement il avait agrémenté sa proposition prudhommesque par un déjeuner, — amende du perdant, — où nous aurions combiné un menu un peu fashionable et berliozien : des oiseaux crus, du chianti dans un crâne, et un orchestre de carabines…
Allons, M. Tiersot, je ne vous en veux pas, et je ne conserve nulle aigreur, nul ressentiment pour votre agression. — Seulement, à l’avenir, tâchez de ne plus bousculer vos confrères, et…
Ne criez pas si fort
Lorsque vous avez tort. (bis).
Quant à vous, cher monsieur Heugel, excusez-moi, je vous prie, d’avoir été si long. Mais veuillez remarquer que, si je voulais dire tout ce qu’il faut ce serait sans fin : pour écrire l’histoire (et non la légende) de Berlioz jeune, il m’a fallu un volume de cinq cents pages. Aujourd’hui, si j’avais voulu relever les erreurs de M. Tiersot à propos de cette seule période (des origines de Berlioz jusqu’à son suicide), il m’aurait fallu réimprimer ici la moitié de mon volume.
Veuillez croire, cher monsieur, à mon entière sympathie ; veuillez aussi remercier encore le collaborateur du Ménestrel, qui, dans le Ménestrel même, a bien voulu écrire que j’avais, dans la Jeunesse d’un Romantique, donné « un Berlioz vrai, exact, complet, et tel que nul n’avait osé ou voulu nous le montrer jusqu’ici ».
ADOLPHE BOSCHOT
![]()
![]() Le Ménestrel,
3 juin 1906, p. 169-170
Le Ménestrel,
3 juin 1906, p. 169-170
[Réponse de Tiersot à la lettre du 27 mai de Boschot]
La “ Marche au
Supplice ”
ne vient pas des “ Francs-Juges ”
______
Les lecteurs du Ménestrel ont eu connaissance de la lettre de M. Ad. Boschot, qui commence à peu près par ces mots : « Je me refuse à polémiquer avec M. Tiersot », et se continue par deux colonnes d’un texte très fin, où il ne m’a pas semblé que M. Boschot ait fait autre chose que de « polémiquer ».
Dans la même semaine, je recevais de M. Ch. Malherbe une lettre dont il importe de verser à ce débat public la partie principale. Après y avoir exposé son intention d’« attendre son heure » et de « lancer son mot quand tout le monde aura parlé », M. Malherbe s’exprime ainsi :
Vous n’avez sûrement pas réfléchi que votre proposition constituait pour moi la plus grave injure ! Cela vous étonne, n’est-ce pas, parce que telle ne fut pas votre intention, je le sais. Comment ? Un débat surgit au sujet d’un texte que je possède, et, au lieu de m’interroger, on nommerait des arbitres qui jugeraient au-dessus de moi, ou à côté, si vous préférez ! Autrement dit vous me refusez les qualités de juge pour les attribuer à Romain Rolland et Michel Brenet. S’il s’agissait d’une discussion entre nous deux, je comprendrais qu’on eût recours à un tiers ; mais dans le cas présent, j’ai qualité plus que personne pour trancher la question ; ne pas s’en rapporter à moi, c’est douter de ma compétence ou de ma bonne foi, et dans l’une ou l’autre hypothèse, l’offense est intolérable.
Je n’ai garde d’ajouter un seul mot de commentaire à ces deux documents ; le public sait ce que parler veut dire, et je tiens à l’en laisser entièrement juge. Je me borne donc à prendre acte du refus opposé par MM. Boschot et Malherbe à une proposition qui, ayant pour seul objet de porter la lumière sur une question controversée, n’était peut-être pas de nature à offusquer ceux à qui je l’adressais au point qu’ils dussent s’en considérer comme insultés.
Aussi bien, ce n’était pas pour m’éclairer moi-même que je demandais ce supplément d’information. Je n’avais d’autre but, en réclamant l’intervention de personnes compétentes et étrangères à tout débat antérieur (1), que d’apporter la preuve publique de l’exactitude de mes observations. Mais, de celle-ci, je ne fais aucun doute, et, aujourd’hui comme hier, je répète et déclare ceci :
La partition autographe de la Marche au Supplice ne renferme aucune particularité permettant d’établir que cette partition a été détachée de celle des Francs-Juges pour prendre place dans la Symphonie fantastique.
En particulier, le rappel final de l’Idée fixe n’est pas écrit sur une collette, mais sur le papier même de tout le reste du cahier.
Enfin, si la partition de la Symphonie fantastique ne nous apporte aucune preuve en faveur de la thèse soutenue par M. Boschot, par contre celle des Francs-Juges nous apportera la preuve du contraire.
C’est ce que j’établirai aussi à mon heure, laquelle sera très prochaine (2).
JULIEN TIERSOT.
(1) J’ai poussé, à cet égard, le scrupule de l’impartialité à un point
tel que, parmi les deux confrères que j’ai désignés pour me représenter dans
l’examen des pièces que l’on sait, il en est un qui s’était prononça
antérieurement CONTRE la thèse que je soutiens. J’avais lu, en effet, les
lignes suivantes dans un article du Mercure musical (15 février 1906),
sous la signature MICHEL BRENET : « …La « Marche des gardes »,
des Francs-Juges, est devenue la « Marche au supplice ».
Cette assertion, souvent produite, et à laquelle, jusqu’ici, nous refusons de
nous soumettre — tant paraissait improbable l’utilisation par Berlioz d’un
morceau de son opéra, longtemps avant qu’il eût perdu tout espoir de le faire
représenter — est confirmée par M. Boschot par la description de la
partition dans laquelle une collette, etc… » Il eût été curieux de
savoir si l’opinion de notre confrère, fixée présentement par sa confiance en
l’affirmation de M. Boschot, fût restée telle après l’examen direct du
document.![]()
(2) Afin de ne pas laisser égarer les lecteurs non prévenus par celles des assertions de M. Boschot qui, d’ailleurs étrangères au sujet précis de ce débat, ont pour objet l’œuvre de Berlioz presque autant que mon humble personne, je relèverai simplement dans sa lettre les trois points suivants :
M. Boschot a constaté la présence du thème principal de la Symphonie fantastique dans une cantate de concours de Berlioz, Herminie (l828). A la façon dont ce thème y est présenté, il eût été surprenant en effet qu’il ne le reconnût pas. Mais il y a plus d’un an que, de mon côté, j’ai rédigé et déposé au Ménestrel le manuscrit du chapitre de ces Berlioziana consacré aux cantates de concours de Berlioz : il n’y sera pas changé un mot quand viendra son tour de publication ; les lecteurs pourront se convaincre alors que je n’ai pas attendu M. Boschot pour faire sur ce sujet les observations nécessaires.
Rapprochant une phrase inscrite sur le manuscrit de la Symphonie fantastique de la citation qu’en fait Berlioz dans ses Mémoires : « Je n’ai pas le temps de finir, etc. » et constatant qu’il y a entre ces deux versions quelques différences de rédaction, M. Boschot en profite pour faire entendre que Berlioz et moi nous mentons : Ces deux rédactions disent identiquement la même chose. Elles le disent, à la vérité, en des termes différents. Mais il me semble que le cas n’est pas très rare, et qu’on a pu voir parfois les mêmes idées exprimées avec d’autres mots…
A
propos d’un thème exposé passagèrement dans le développement du premier
morceau de la Symphonie, et dont j’avais cherché à caractériser la valeur par
des termes dont M. Boschot reproduit inexactement le sens et la forme, il écrit
que « ce contresujèt n’est qu’une suite de notes de
l’accompagnement. » Ce même thème a été apprécié de façon un
peu différente par Schumann, dans l’article si pénétrant et prophétique
qu’il a consacré à l’œuvre de jeunesse de Berlioz : il le qualifie une
de ses « plus belles pensées » (Seine
Schönsten Gedanken) et appuie
son opinion d’une citation musicale qui est celle du chant en question. Combien
ne dois-je pas être navré en songeant que, sur ce point de critique, je me
trouve être en désaccord avec M. Adolphe Boschot, pour penser comme Robert
Schumann !![]()
![]()
![]() Le Ménestrel,
17 juin 1906, p. 184-185
Le Ménestrel,
17 juin 1906, p. 184-185
ŒUVRES INÉDITES (1)
(Suite)
Les détails de l’exécution du 10 juillet 1825 nous sont donnés, et de la façon la plus vivante, dans deux lettres de Berlioz, l’une à sa mère, du 14 juillet [CG no. 47], l’autre à son compatriote et ami Albert du Boys, le 20 du même mois [CG no. 48]. Nous n’en retiendrons ici que les appréciations que, dans son enthousiasme de débutant plein de foi et d’espérance, il donne lui-même des diverses parties de son œuvre. Il dit à Du Boys :
Je crois que ma messe a produit un effet d’enfer ; surtout les morceaux de force, tels que le Kyrie, le Crucifixus, l’Iterum venturus, le Domine salvum, le Sanctus. Quand j’ai entendu le crescendo de la fin du Kyrie, ma poitrine s’enflait comme l’orchestre, les battements de mon cœur suivaient les coups de baguette du timbalier… Dans l’Iterum venturus, après avoir annoncé par toutes les trompettes et trombones du monde l’arrivée du Juge suprême, le chœur des humains séchant d’épouvante s’est déployé ; O Dieu ! je nageais sur cette mer agitée, etc.
Le peuple des amateurs s’est prononcé pour le Gloria in excelsis, morceau brillant et en style léger ; c’était immanquable.
Il faut noter aussi, dans la même lettre, les paroles qu’il recueillit de la bouche de Lesueur :
« Venez que je vous embrasse ! Morbleu, vous ne serez ni médecin, ni apothicaire, mais un grand compositeur. Vous avez du génie : je vous le dis parce que c’est vrai. Il y a trop de notes dans votre messe, vous vous êtes laissé emporter, mais à travers toute cette pétulance d’idées, pas une intention n’est manquée, tous vos tableaux sont vrais ; c’est d’un effet inconcevable. »
Avec sa mère, il prend des airs de jeune homme modeste :
Enfin voilà le premier pas fait heureusement ; mais je n’en ai pas moins vu combien j’ai besoin de travailler ; des défauts nombreux, qui avaient échappé à la multitude entraînée par la fougue des idées, m’ont été signalés, je les ai reconnus et je m’efforcerai de les éviter une autre fois.
A cette première audition se rattache encore une de ces boutades si plaisantes dont il émaillait souvent ses articles critiques, au grand détriment des œuvres dont il était censé rendre compte. Celle-ci est tirée de son chapitre De viris illustribus urbis Romæ, autrement dit « des claqueurs », qu’il a fort à propos conservé dans ses Soirées de l’orchestre. Il y rappelle ses souvenirs d’habitué du parterre de l’Opéra, pendant sa jeunesse, et la sympathie que lui avait vouée celui des Romains qui y occupait le banc de la présidence, sous le nom impérial d’Auguste. Et voici ce qu’il raconte à ce propos :
Ma Messe a été exécutée avec un succès double de la première fois. Le morceau Et iterum venturus surtout, qui avait été manqué la première fois, a été exécuté, celle-ci, d’une manière foudroyante, par six trompettes, quatre cors, trois trombones et deux ophicléides. Le chant du chœur qui suit, que j’ai fait exécuter par toutes les voix à l’octave, avec un éclat de cuivre au milieu, a produit sur tout le monde une impression terrible. Pour mon compte j’avais assez bien conservé mon sang froid jusque là, et il était important de ne pas me troubler : je conduisais l’orchestre. Mais quand j’ai vu ce tableau du Jugement dernier, cette annonce chantée par six basses-tailles à l’unisson, ce terrible clangor tubarum, ces cris d’effroi de la multitude représentée par le chœur, tout enfin rendu exactement comme je l’avais conçu, j’ai été saisi d’un tremblement convulsif, etc.
Mais avec ses amis il ne se contient pas. Plus de deux ans plus tard, à la deuxième (et dernière) audition qui fut donnée de la Messe, — pour la Sainte-Cécile, à Saint-Eustache, un jour d’émeute, — il écrit à Humbert Ferrand (29 novembre 1827) :
Ayant fait exécuter à cette époque dans l’église de Saint-Roch ma première partition (une messe solennelle), les vieilles dévotes, la loueuse de chaises, le donneur d’eau bénite, les bedeaux et tous les badauds du quartier, s’en montrèrent fort satisfaits, et j’eus la simplicité de croire à un succès. Mais hélas ! ce n’était qu’un quart de succès tout au plus ; je ne fus pas longtemps à le découvrir. En me revoyant, deux jours après cette exécution : « Eh bien, me dit l’empereur Auguste, vous avez donc débuté à Saint-Roch avant hier ? Pourquoi diable ne m’avez-vous pas prévenu de cela ? Nous y serions tous allés ! — Ah ! vous aimez à ce point la musique religieuse ? — Eh non ! quelle idée ! mais nous aurions chauffé solidement. — Comment ? On n’applaudit pas dans les églises. — On n’applaudit pas, non ; mais on tousse, on se mouche, on remue les chaises, on frotte les pieds contre terre, on dit : « Hum ! hum ! », on lève les yeux au ciel ; le tremblement, quoi ! nous vous eussions fait mousser un peu bien ; un succès entier, comme pour un prédicateur à la mode. » [CG no. 77]
Il est vrai que, si Berlioz eut pour lui le discours en trois points du curé, les compliments des auditeurs ébahis et l’accolade paternelle du bon Lesueur, ces dernières manifestations manquèrent à son début !
Après les deux exécutions intégrales de 1825 et 1827, Berlioz détacha de la partition le Resurrexit, c’est-à-dire la seconde moitié du Credo, contenant plusieurs des épisodes qu’il signale dans ses lettres comme lui ayant causé de grandes émotions ; il détruisit le reste, en compagnie de plusieurs de ses autres essais d’écolier. Mais le morceau conservé garda longtemps encore ses préférences. Il l’inscrivit sur les programmes de ses deux premiers concerts, en 1828 et 1829, la seconde fois sous le titre du Jugement dernier (voir lettre à H. Ferrand du 30 octobre [CG no. 140]) ; il s’extasiait encore, à cette date, sur l’effet d’« un récitatif accompagné par quatre paires de timbales en harmonie ». Enfin, après avoir obtenu le prix de Rome, obligé par le règlement de l’Institut de consacrer un de ses envois à une œuvre de musique religieuse, il se borna à recopier une dernière fois ce fragment et le soumit sans scrupule aux suffrages de la docte Académie. Les Mémoires assurent qu’à la lecture de cette page écrite quand l’auteur avait vingt ans, « ces messieurs trouvèrent un progrès très remarquable, une preuve sensible de l’influence du séjour de Rome sur ses idées, et l’abandon complet de ses fâcheuses tendances musicales ». Même il songeait encore à cette mystification à la veille d’être admis lui-même à siéger parmi les immortels : c’est ainsi que dans une lettre qu’il écrivait le 16 décembre 1854 à la princesse Wittgenstein [CG no. 1847], après la première audition de l’Enfance du Christ, il reproduisait, ironiquement, presque mot pour mot, les appréciations ci-dessus, afin de prouver que ce n’était pas lui qui avait modifié sa manière, mais le public qui avait changé d’opinion, que ce n’était pas la première fois que le cas se présentait. Mais, réserve piquante, il se repentit aussitôt d’avoir fait cette confidence intempestive, et, dès le lendemain, il écrivit à Liszt pour s’efforcer d’en conjurer les fâcheux effets possibles : « Je me suis laissé aller à dire quelques vérités sur les impressions parisiennes dans ma lettre d’hier… Je t’écris aujourd’hui pour te prier de demander le secret sur ces aveux. Toute vérité n’est pas bonne à dire ; celle-là surtout me ferait un tort affreux si l’on savait que j’ai osé la reconnaître. » [CG no. 1848] C’est qu’alors il était question de lui pour l’Académie, où il entra en effet dix-huit mois plus tard ! Le moment n’était pas favorable pour rappeler ses anciennes facéties d’élève indiscipliné.
C’est à la faveur de cet envoi que nous devons la conservation d’un fragment de la première œuvre de Berlioz. Je l’ai retrouvé, il y a longtemps déjà, sur les rayons de la Bibliothèque du Conservatoire, parmi ses autres travaux d’école. Est-il absolument identique à la composition primitive ? Non sans doute : déjà nous avons vu l’auteur récrire une première fois l’œuvre entière avant même d’en avoir pu obtenir l’exécution ; après cela il la retoucha encore : une lettre de 1827 (29 novembre [CG no. 77]), à Humbert Ferrand, qui avait été parmi les auditeurs de 1825, parle de « petites corrections qu’il y a faites » ; une autre, du 6 juin suivant [CG no. 93], dit en propres termes : « Vous n’avez jamais entendu le Resurrexit depuis que je l’ai retouché ». Enfin, il est possible que l’envoi de Rome soit conforme à ces dernières retouches ; mais le manuscrit n’est ni celui qui les porte, ni, à plus forte raison, le manuscrit primitif : il est écrit sur le papier de très grand format qui a servi à tous les envois de Rome de Berlioz, avec la même écriture soignée, en grosses notes, qu’il crut bon d’adopter pour ces circonstances officielles : l’auteur a donc, à l’intention de l’Académie, au moins recopié son premier manuscrit.
Au reste, il y a tout lieu de croire que les retouches signalées par lui-même portent uniquement sur des détails de forme et d’écriture, et que la conception générale n’en a pas été modifiée.
La partition porte ce titre autographe, occupant toute la première page :
RESURREXIT
ET ITERUM VENTURUS
Grands Chœurs
avec orchestre
Par
HECTOR BERLIOZ
Rome, 1831.
Ce fragment est en réalité toute une moitié de Credo, car le texte du symbole est épuisé depuis le verset indiqué jusques et y compris l’Amen final.
___________________________________
(1) Voir le numéro du 8 avril (Resurrexit de la Messe
solennelle).![]()
![]()
![]() Le Ménestrel,
24 juin 1906, p. 190-192
Le Ménestrel,
24 juin 1906, p. 190-192
ŒUVRES INÉDITES
(Suite)
Si l’on ouvre la partition à sa première page, on pense d’abord être en présence de l’ouverture de Semiramide... L’évocation de cette œuvre rossinienne était inattendue : elle prouve au moins que le Berlioz de la vingtième année ne craignait pas de reproduire les formules courantes, semblable en cela à tout auteur novice. Ce début suit d’ailleurs fidèlement les paroles : l’Ascendit in cœlum est exprimé par une large montée des voix ; la période se déroule, sans grand intérêt musical, mai sagement, dans le ton sol, pour aboutir à la cadence parfaite…
Mais voici que soudain, au moment où les voix retombent sur la tonique, un accord formidable de mi bémol éclate aux cuivres. Quatre trompettes, les cors, trois trombones, un ophicléide et un serpent, — sans compter les clarinettes et les bassons, — partent du même coup, puis se répondent les uns aux autres, soutenus par le tonnerre de plusieurs timbales roulant en accords. Ceci n’est plus du tout du Rossini, c’est du Berlioz. Il faut citer le passage entier, il en vaut la peine (1).

On l’a reconnu : c’est, constitué dans toutes ses parties essentielles, le Tuba mirum du Requiem, cette page que Berlioz regardait comme la plus haute manifestation de son génie (2). Même il n’a pas craint d’ajouter au verset du Credo les deux vers significatifs de la Prose des morts, — de même que dans le manuscrit et la première édition de sa grande œuvre il avait, nous l’avons dit en son temps, conservé les paroles qui lui avaient inspiré en premier lieu cette superbe trouvaille.
Et ce n’est pas tout. A la fanfare et à la menaçante mélopée proférée par les basses succède un épisode animé où les voix s’entrecroisent et se répondent, redisant les mêmes paroles mais en exprimant un sentiment différent : l’inquiétude, l’effroi. Or, dans le grand final de Benvenuto Cellini, nous retrouvons ce même épisode musical (quarante cinq mesures entières, sans autre changement que des détails d’orchestre) chanté par le peuple pour exprimer l’émotion causée par le meurtre de Pompeo : « Assassiner un capucin ! »
Enfin le Credo s’achève par le développement d’une large phrase, assez emphatique, et plus théâtrale que religieuse, que toutes les voix chantent à l’unisson accompagée par les accords plaqués de l’orchestre, et cette phrase encore a retrouvé place dans le même final de Benvenuto, où elle sert de thème à la brillante et tumultueuse péroraison.
On le voit donc : cette œuvre, de la vingtième année de Berlioz contenait en germe plusieurs de ses compositions postérieures, et non des moindres ; depuis la fanfare de l’Iterum venturus jusqu’à la fin, sans interruption, tout lui a servi pour constituer quelques-unes de ses pages les plus définitives.
Le style général peut enfin nous inspirer d’intéressantes observations. L’œuvre, assez faiblement exécutée quant aux détails, révèle déjà un véritable génie d’architecte de sons. Non que la construction soit irréprochable : l’enchaînement des tonalités, la conduite des modulations sont trop souvent embarrassés, peu naturels ; mais l’ensemble atteste l’instinct d’une composition naïve et sommaire, procédant, non par de menus détails comme ceux dans lesquels se perdent si souvent les jeunes artistes cherchant leur voie, mais par larges plans, bien en place, et posés de manière que tout se tienne solidement sur ses bases. Peu importe si les transitions sont maladroites, si l’entourage est défectueux : ce qui doit être mis en valeur apparaît tonjours en bonne place et de manière à s’imposer à l’attention. Quant aux artifices scolastiques, ils sont absents, par la raison qu’à ce moment l’auteur les ignore. Il ne cherche pas, comme il fera plus tard, à accumuler fugues, canons, contrepoints de diverses espèces. L’Amen de son Credo se borne à quelques accords qui n’ont d’autre prétention que d’amener une heureuse conclusion musicale. Il obéit à la seule nature, et se borne à reproduire ingénument les formes courantes de la musique pratique. Cependant, si l’étincelle jaillit, il sait faire de ces trouvailles personnelles par lesquelles se révèle un génie primesautier et vraiment puissant. Au reste, il est fort sensible à l’émotion extérieure. Un accord altéré, un son de trompettes suffisait à le troubler : tendance dangereuse et qui aurait pu le conduire aux pires excès du mauvais goût ; mais il sut se retenir : ce premier ouvrage est ordonné avec une mesure et un tact parfaits. Sans doute il s’agit encore de l’œuvre d’un enfant : à aucun point de vue on ne peut la donner comme faite. Mais quelles promesses d’avenir !
___________________________________
(1) Nous avons écrit (sur deux portées) une transcription de l’orchestre
plutôt qu’un arrangement pour piano, ayant voulu conserver
à chaque groupe
d’instruments sa physionomie exacte et son diapason réel.![]()
(2) J’ai fait cette découverte il y a dejà longtemps, et l’ai
communiquée
pour la première fois au public dans un article paru,
à l’occasion d’une
audition du Requiem de Berlioz aux Concerts-Colonne, dans la Revue
bleue du 20 avril 1895. Un de mes
confrères a prétendu m’en retirer le
mérite en avançant qu’un auteur allemand avait dit la même chose
antérieurement ; mais, vérification faite, il a été reconnu que cet
auteur n’ai fait que reproduire des passages de lettres de Berlioz, bien connues,
mais non le document musical que je viens de reproduire, et qui est le principal
qui importe ici.![]()
![]()
![]() Le Ménestrel,
1er Juillet 1906, p. 199-200
Le Ménestrel,
1er Juillet 1906, p. 199-200
LES FRANCS-JUGES
Les Francs-Juges, premier essai théâtral de Berlioz, ont occupé l’auteur pendant plusieurs années de sa jeunesse.
Nous ne sommes pas renseignés sur la première origine de cette composition. Le librettiste est Humbert Ferrand, l’ami à qui furent adressées les lettres dont la série forme le volume entier des Lettres intimes de Berlioz : or, la première de ces lettres où il soit question de leur œuvre commune (la troisième de la collection, du 6 juin 1828 [CG no. 93]), a pour but d’annoncer l’exécution publique de fragments importants des Francs-Juges. La collaboration des deux amis avait donc dû commencer depuis assez longtemps. Peut-être en avaient-ils jeté les premières bases à Paris, où Ferrand avait été étudiant en même temps que Berlioz (il y était encore en 1828) ; ou bien ce fut l’année suivante, pendant les vacances que celui-ci alla passer en Dauphiné, mais pas plus tard. Les Mémoires, assez précis en cet endroit, spécifient que Berlioz composait la musique des Francs-Juges « avec un entraînement sans égal » alors qu’il venait d’être inscrit comme élève du Conservatoire dans la classe de Reicha ; cette inscription est d’octobre 1826, et la date s’accorde parfaitement avec les déductions précédentes. Le livre continue ainsi : « Ferrand avait écrit aussi une scène héroïque avec chœurs, dont le sujet, la Révolution Grecque, occupait alors tous les esprits. Sans interrompre bien longtemps le travail des Francs-Juges, je l’avais mise en musique ». Cette scène lyrique, ainsi que trois morceaux de l’opéra (dont l’ouverture), ont figuré sur le programme du premier concert de Berlioz, le 26 mai 1828 : cette date et la mention des Mémoires sont les premières indications positives que nous possédions sur les Francs-Juges.
Une partie de l’œuvre était donc achevée au printemps de 1828, et sans doute depuis quelque temps. Mais l’ensemble était loin d’être terminé. Un mois après le concert, nous voyons Berlioz réclamer à son ami, devenu moins ardent au travail le premier et le troisième acte des Francs-Juges, qu’il « attend avec la plus grande impatience » (Lettre du 28 juin 1828 [CG no. 94]). Il accuse réception de ces deux actes le 15 juillet (1). « Je trouve le dernier magnifique, écrit-il ; l’interrogatoire surtout est de la plus grande beauté ; le dénouement vaut mille fois mieux que celui dont nous étions convenus. » Au reste, les mois qui suivirent semblent marquer la fin de l’activité de Berlioz. Dans l’hiver 1828-29, nous le voyons écrire déjà plus froidement : « Il s’en faut de beaucoup que je renonce à notre opéra… achevez-le le plus tôt possible. » Le 2 février 1829 [CG no. 113], il en réclame une copie complète afin de la présenter à l’Opéra ; mais au même moment, il est occupé de bien d’autres choses : les Huit scènes de Faust, prêtes à paraître, une Symphonie descriptive de Faust qui bouillonne dans sa tête et qui deviendra bientôt la Fantastique, et, par dessus tout, son amour pour Henriette Smithson. Aussi est-ce d’un air parfaitement résigné que, le 3 juin suivant, il annonce que le poème des Francs-Juges est refusé à l’Opéra. Il voudrait pourtant utiliser les parties existantes en faisant une traduction allemande (lettres du 3 juin 1829 et du 13 mai 1830 [CG no. 126; CG no. 162]), et il donne encore un air (outre l’ouverture) à son concert du 1er novembre 1829. Au reste, le 3 juin 1829, expliquant un projet de transformer l’opéra en un ouvrage dans le genre du Freischütz, « moitié parlé, moitié mélodrame, et le reste en musique », il ajoute : « J’achèverai la musique », et il énumère les morceaux qui restent à faire. Mais un peu plus tard, le 13 mai 1830, il dit encore que les mêmes morceaux sont à faire : il n’avait donc pas touché à son opéra depuis un an et plus.
II résulte de tout cela que toute la musique composée pour les Francs-Juges date des années 1826 à 1828, et qu’à partir de 1829, si Berlioz y pensa parfois encore, il n’y travailla plus guère.
Et cependant, plusieurs années après, à un moment où son génie avait atteint sa pleine maturité, il eut encore un retour vers cette œuvre commencée sur les bancs de l’école. Voulant sauver quelques pages de sa musique, pour laquelle il a toujours éprouvé une secrète tendresse — peut-être en raison des souvenirs de sa jeunesse qu’elles lui rappelaient — il essaya encore une fois de remanier l’œuvre en la réduisant aux proportions d’un simple acte d’opéra, une sorte d’intermède. Nous en avons pour preuve le document le plus authentique qu’on puisse souhaiter, et qui n’est autre que la copie de cet arrangement du poème écrite de la main même de Berlioz ; en outre, plusieurs lettres adressées à un correspondant et ami non moins fidèle, Thomas Gounet, nous apportent de nouvelles précisions. Le titre avait changé : Les Francs-Juges étaient devenus le Cri de guerre du Brisgau. Le 1er août 1833 [CG no. 341], Berlioz dit encore à Ferrand qu’il a toujours les Francs-Juges sur sa table, et qu’il a écrit la scène des Bohémiens (finale du 1er acte) en y mettant le chœur qui commence le 2e acte : L’ombre descend. Mais trois mois plus tard c’est à Gounet qu’il s’adresse, témoignant ainsi qu’il l’a fait entrer dans la collaboration : « Travaillez-vous ?… Est-ce notre acte ? Je voudrais bien avoir le Cri de guerre… » (1er novembre 1833 [CG no. 359]). Quelques semaines plus tard : « Eh bien, mon cher, avez-vous eu le temps de faire quelques vers pour notre acte ? Il faut le plus tôt possible en finir. Je suis libre de toute autre occupation, et le vent est bon à l’Opéra. » (28 novembre [CG no. 371; cette lettre date du 28 décembre 1833].) Il insiste encore le 3 janvier 1834 [CG no. 375], réclamant des vers, et s’efforçant de hâter « l’achèvement de l’opuscule ». Sans doute l’appel fut entendu, puisque le poème du Cri de guerre du Brisgau existe complet ; mais il n’apparaît pas que la musique des parties nouvelles ait été écrite. Et pourtant, plus d’un an après, il témoigne n’avoir pas encore renoncé à son projet : revenant à son premier collaborateur, il lui écrit le 15 avril 1835 (2) : « Je viens de refaire ou plutôt de faire la musique de votre scène des Francs-Juges : Noble amitié, etc. » [CG no. 429]
Les Mémoires disent : « J’ai employé ça et là les meilleures idées de cet opéra, en les développant, dans mes compositions postérieures ; le reste subira probablement le même sort, ou sera brûlé. » La plus grande partie de la musique des Francs-Juges, en effet, a été détruite ; pourtant, il est quelques morceaux. — cinq, sans compter l’ouverture — dont l’auteur n’a pas voulu consommer le sacrifice : il en a offert en souvenir le manuscrit original, auquel est joint le poème de l’acte du Cri de guerre, à Mlle Fanny Pelletan, son admiratrice autorisée, qui, sous son inspiration, avait entrepris l’édition monumentale de Gluck à laquelle est attaché son nom ; celle-ci, ayant aussi reçu des mains du maître les fragments également incomplets d’un autre opéra, la Nonne sanglante, et l’autographe de deux parties de l’Enfance du Christ, a remis à son tour la totalité de ce précieux dépôt à la Bibliothèque Nationale (3).
Enfin, uue copie du poème des Francs-Juges, contenant de nombreuses annotations de la main de Berlioz, a été laissée par l’auteur à la Bibliothèque du Conservatoire.
Nous pourrons, grâce à ces divers documents, connaître au moins en partie cette œuvre de jeunesse, restée entièrement inédite (4).
___________________________________
(1) La lettre est datée par erreur, dans le livre, de 1829 : elle est
manifestement de l’année précédente.![]()
(2) La lettre est datée par erreur, dans le livre, de 1836.![]()
(3) La partition autographe des fragments des Francs-Juges est
conservée à la Bibliothèque Nationale, département des Imprimés, sous la
cote V2m. 177.![]()
(4) Nous ne devons pas omettre de signaler que les documents de la
Bibliothèque Nationale ont été étudiés en premier lieu par notre excellent
confrère Michel Brenet, qui en a fait usage dans un article intitulé Berlioz
inédit (Guide musical du 26 janvier 1896).![]()
![]()
![]() Le
Ménestrel, 8 Juillet 1906, p. 207-208
Le
Ménestrel, 8 Juillet 1906, p. 207-208
LES FRANCS-JUGES
(Suite)
La brochure du Conservatoire, formant 53 pages copiées avec soin, porte le titre suivant :
« Lénor ou Les derniers Francs-Juges, Drame lyrique en trois actes. »
Au verso de ce titre, moulé avec un véritable luxe, à la mode du temps, est la distribution des personnages ; et là apparaît déjà l’écriture de Berlioz, qui a tracé en regard de chaque nom la nature de la voix correspondante.
L’action se passe dans les forêts du Brisgau, à une époque vaguement féodale. Le pays a pour roi un usurpateur et un tyran, Olmerik, monté sur le trône au prix du meurtre de son frère Venceslas. Il poursuit de sa haine le fils de celui-ci, Lénor, héritier légitime de son pouvoir, et cherche à le faire disparaître : il fait servir à ses desseins criminels l’association secrète des Francs-Juges, dont il est le chef. Ces Francs-Juges sont des hommes masqués, insensibles et muets, formant une sorte de tribunal, non sans rapports avec ce Conseil des Dix qui joue son rôle sinistre dans Angelo, tyran de Padoue :
Nulle part et partout, c’est en vain qu’on le fuit.
Il peuple ce palais, et ce palais l’ignore ;
Son œil puissant interroge la nuit,
Et l’ombre vainement lui ravit sa victime…
Ajoutons à cet exposé complexe qu’Olmerik est aussi en état de révolte contre « les Césars », et qu’il pousse l’esprit d’usurpation jusqu’à vouloir épouser la fiancée de Lénor, Amélie, laquelle se résigne à cet hymen, pensant ainsi servir la cause de celui qu’elle aime.
Les Francs-Juges comptent, pour exécuter leurs basses œuvres, sur un guerrier, Conrad, qui, on ne sait trop comment, se trouve égaré dans leurs rangs, car c’est un cœur vaillant et loyal, et en même temps un ami de Lénor.
Celui-ci, disparu, a su se dérober aux recherches. Pourtant il n’est pas loin : caché au milieu d’une troupe de Bohémiens, il se rapproche sous le couvert d’un déguisement et a une entrevue avec Amélie et Conrad. Mais sa présence ne peut échapper au tribunal redoutable. Un Franc-Juge masqué (c’est Conrad lui-même, qui joue ainsi double jeu) vient, au milieu d’une fête pastorale, lui donner un rendez-vous mystérieux pour minuit, — l’heure du crime !
Lénor est exact. Il est conduit dans une caverne où l’on voit douze sièges de pierre disposés autour d’une vaste table tendue de noir et couverte de poignards et d’objets symboliques. La caverne n’est éclairée que par les reflets de la lune brillant dans la partie la plus reculée. Les Francs-Juges entrent de tous côtés par les issues irrégulières des rochers, au bruit d’une marche lugubre ; ils ont le visage voilé et sont vêtus de noir ; une large épée est suspendue à leur côté par une ceinture blanche. Ils s’approchent les uns des autres, entrechoquent leurs boucliers d’airain, puis se rangent sur une seule ligne et chantent un hymne.
Dans le fond apparaît une statue de bronze, de dimensions colossales, sur le piédestal de laquelle étaient placés les condamnés : ceux-ci, grâce à des ressorts secrets que leur poids faisait mouvoir, étaient saisis par les bras de la statue, écrasés et entraînés dans un gouffre (1).
Lénor est appelé à comparaître, interrogé — longuement — et condamné à mourir. Par bonheur, c’est Conrad qui, se tenant derrière lui, le poignard à la main, doit procéder à l’exécution, et il ne se hâte pas. Il se hâte même si peu qu’il laisse aux libérateurs — prévenus par lui — le temps de trouver le chemin de la caverne. Des soldats, guidés par Amélie, viennent en effet surprendre les Francs-Juges dans l’exercice de leurs sinistres fonctions : Olmerik, pris au piège, n’a plus qu’à se jeter dans les bras meurtriers de la statue de bronze, et il disparaît au milieu des flammes… Tout le monde maintenant salue le « fier Germain », qui reprend sa place sur le trône, et acclame le nom des Césars. Encore un dénouement issu de celui de Molière : « Nous vivons sous un prince ennemi de la fraude », lequel, faisant intervenir le gendarme, a été copieusement utilisé dans les opéras et les drames depuis que le Deus ex machina a perdu son prestige !
La couleur de ce poème devait séduire Berlioz. Par malheur, la forme littéraire est loin de répondre au caractère de la conception. Les scènes sont écrites dans le plus déplorable style de tragédie empire, déclamatoire et filandreux. Toute l’action se passe en récits ; près de la moitié des personnages sont des confidents ; l’ouvrage est plein de longues tirades en inexorables alexandrins, de tout point réfractaires au lyrisme. Aussi Berlioz n’a jamais songé à mettre ces parties en musique : nous en trouvons la preuve dans le livret manuscrit qui, parmi des indications de sa main telles que : « Musique faite, — musique à faire », porte cette autre mention plus fréquente encore : « Parlé, — dialogue parlé, — monologue parlé. » Son intention était donc de traiter ce drame lyrique dans la forme de l’opéra-comique. Ce n’était pas inadmissible en principe, ni contraire aux usages de son temps : plusieurs des bons ouvrages de l’école française à la fin du XVIIIe siècle auraient pu lui servir d’exemples, ainsi qu’à son collaborateur : tels Euphrosine et Coradin, Montano et Stéphanie, Ariodant, etc. Mais les auteurs de ces pièces, qui renferment, comme les Francs-Juges, des scènes parfois fort sombres, avaient bien su distinguer les morceaux de chant des dialogues parlés, et chacune de ces parties était traitée dans le style différent qui convenait. Humbert Ferrand, lui, n’avait pas de préoccupations si subtiles ! Il avait évidemment écrit son poème dans la pensée que Berlioz le mettrait entièrement en musique, comme tout poème d’opéra. Mais l’étendue et la monotonie de ses tirades, de ses récits, de ses dialogues, auraient rendu la tâche impossible, même à des compositeurs moins novices. Déclamées sans musique, les mêmes scènes auraient été d’un ennui profond.
Le résultat fut donc ce qu’il devait nécessairement être : le poème fut refusé à l’Opéra, et la partition, ainsi que le disent les Mémoires de Berlioz, « fut du même coup condamnée à l’obscurité, d’où elle n’est jamais sortie ».
Nous avons vu pourtant que le jeune maître aurait voulu utiliser les parties de son travail qui, après plusieurs années, lui semblaient encore satisfaisantes, et que de ce désir est né le projet d’arrangement et de réduction en un acte du poème des Francs-Juges, sous le nom du Cri de guerre du Brisgau.
Donnons donc un rapide coup d’œil sur ce nouveau poème dont, nous l’avons dit, la Bibliothèque Nationale conserve le manuscrit, transcrit en entier par la main de Berlioz. Chose curieuse : ce ne sont pas les sombres scènes du dernier acte que l’auteur de la Fantastique a voulu garder ; ses préférences se sont portées, au contraire, sur de simples épisodes empruntés en grande partie au deuxième acte des Francs-Juges, le plus vide d’action.
Le premier morceau est un chœur de Bohémiens, Scherzando qui, dans l’original, formait le final du premier acte ; il s’enchaîne immédiatement à un chœur de paysans : « L’ombre descend dans la vallée », que suit un divertissement pittoresque ; puis c’est un trio pastoral, chanté par Lénor « déguisé en berger sous le nom d’Obald » et deux bergères, Nise et Mery, aux voix desquels le chœur se joint à la fin. Cet épisode, purement musical, était, sauf le premier chœur, le début du second acte des Francs-Juges.
Quand les chants et les danses sont terminés, un semblant d’action s’engage. En un récit qui n’est pas dans l’ouvrage primitif, et dont, conséquemment, les vers sont de Gounet, le faux Obald révèle sa personnalité aux paysans au milieu desquels il a reçu asile : il est Lénor, fils du roi légitime assassiné par Olmerik, et il adjure le peuple de se soulever avec lui contre l’usurpateur. Ses paroles sont écoutées avec méfiance : les paysans s’éloignent, il reste seul, et, la nuit étant venue, il s’endort.
Pendant son sommeil, un bûcheron s’approche en chantant : il arrive de si loin que, dit le livret, « le premier couplet ne peut s’entendre en entier à cause de l’éloignement » ; en effet, on lit en cet endroit du manuscrit, après six lignes de points, deux vers qui sont les derniers de ce premier couplet, puis un deuxième, un troisième et un quatrième couplets, et cela nous est bien connu, car le morceau n’est autre qu’une des romances favorites de Berlioz, le Jeune pâtre breton, dont les vers sont de Brizeux. Encore un collaborateur à ajouter à la liste nombreuse des hommes de lettres qui ont apporté leur concours à cette œuvre disparate !… Cette entrée du bûcheron n’a pas d’autre but que de faire entendre un morceau de musique (fort joli, nous le savons), car l’homme s’éloigne, comme il est venu, sans avoir rien fait ni rien dit qui se rattache au drame. Au reste, l’ensemble de l’épisode a été biffé par quelques coups rapides de crayon rouge.
Enfin, au milieu de la nuit, survient l’ami fidèle de Lénor, Conrad ; il l’éveille, et ils forment ensemble le projet d’aller tuer Olmerik. Les paysans sont rassemblés ; plus confiants que naguère, ils se mettent, avec enthousiasme, sous le commandement de Lénor, et poussent avec lui leur cri de guerre, le cri de guerre du Brisgau.
L’intention qu’avait Berlioz de présenter à l’Opéra cette réduction des Francs-Juges, se marque nettement par le libellé de la distribution inscrit, de sa main comme tout le reste, au verso du titre :
« Les acteurs seraient : A. Nourrit, Lénor ; Dabadie, Conrad ; A. Dupont, le bûcheron ; Mme Dorus, la Bohémienne ; Mlle Jawureck, Nise ; Mme Mori, Mery ; Dérivis et Massol, deux Bohémiens. »
Enfin ce remaniement, dont l’exécution a été poussée si loin, ne suffit pas encore à satisfaire son désir de sauver la musique des Francs-Juges : en voici encore un autre dont nous trouvons le projet écrit, toujours de sa main, en travers de la première page du manuscrit musical, dont nous allons bientôt commencer l’examen. Celui-ci était destiné à conserver quelques-unes des parties du troisième acte, écartées dans le remaniement précédent : pourtant, dans l’un comme dans l’autre, on trouve au moins un morceau commun, le trio pastoral, et il est probable que le final, étant donnés les termes en lesquels il en est parlé, était, dans la pensée de Berlioz, le même dans cette dernière réduction que dans le Cri de guerre du Brisgau.
Voici ce dernier projet :
N° 1 serait le duo terminé en chœur des Francs-Juges et précédé par l’hymne des Francs-Juges au tribunal secret. Ce serait ainsi un andante suivi d’un allegro développé et de plus en plus énergique.
N° 2. Trio pastoral, suivi sans interruption d’une valse en style suisse, avec la quatrième note du ton diésée.
N° 3. Chant du meurtrier d’Olmerik, caché avec son jeune fils dans la forêt noire, pendant une froide nuit d’hiver, accompagnée des gémissements du vent du nord et interrompu souvent par la plainte de l’enfant : « Ah ! père, j’ai froid ! » Le père répondra toujours à cette plainte en récitant le De profundis. Mort de l’un et de l’autre. Arrivée d’une confrérie de moines qui emportent les deux corps.
Final. Chœur du peuple finissant en majeur avec l’explosion et les thèmes de la coda de l’ouverture.
___________________________________
(1) Il y a là un souvenir évident de la vierge de fer de Nuremberg.![]()
![]()
![]() Le
Ménestrel, 15 Juillet 1906, p. 215-216
Le
Ménestrel, 15 Juillet 1906, p. 215-216
LES FRANCS-JUGES
(Suite)
Abordons enfin l’étude du manuscrit musical. C’est un recueil de morceaux détachés, reliés ensemble dans l’ordre suivant :
1° Nocturne à trois voix concertantes avec chœur. Paroles de M. Humbert Ferrand (fragment de l’opéra des Francs-Juges).
Ce morceau, autographe, et noté de la plus belle écriture, donne simplement, avec les voix, une réduction au piano de l’orchestre. Au bas de la première page, on lit la note suivante en renvoi du titre :
Cet opéra n’a jamais été représenté, l’auteur en a détruit presque entièrement la partition, après en avoir publié l’ouverture seulement. Dans la scène dont ce petit morceau fait partie, Arnold, jeune prince fugitif que poursuit le tribunal secret, se trouve mêlé, sous un déguisement et sous le nom d’Obald, à une fête pastorale.
2° Le Cri de guerre de Brisgau, intermède en un acte. C’est la réduction du poème qui a fait l’objet de l’analyse ci-dessus.
3° Chœur de soldats auquel se joint ensuite celui du peuple. Ce morceau, comme tous ceux qui vont suivre, est en grande partition d’orchestre, autographe.
4° Duo : « Conrad s’arma pour nous ».
5° Chœur des bergers (acte second, no 6).
6° Hymne des Francs-Juges : deux reprises, orchestrées différemment, et séparées l’une de l’autre par une série de feuillets déchirés, près du bord. Une autre série de feuillets déchirés, mais dont quelques vestiges sont encore lisibles, termine le volume.
Considérons-en, avec quelques détails, les éléments, en les remettant à la place qu’ils occupaient dans les diverses versions du poème.
Nous n’avons pas à insister sur l’ouverture, dont nous ne possédons pas l’autographe, mais dont la partition est gravée. Disons simplement que ce morceau contient deux motifs qui devaient entrer dans la composition intérieure de l’opéra. L’un est le chant largement dessiné par les trombones à l’unisson dans l’Adagio initial ; il était destiné, disait Berlioz dans une lettre (à son père [CG no. 91]) à « peindre la terrible puissance des Francs-Juges et leur sombre fanatisme » ; dans une autre lettre écrite à son collaborateur [CG no. 93], il le désignait par ces mots : « Cet épouvantable solo de trombones sur lequel vous avez mis des paroles pour Olmerick, au troisième acte ». Nous rechercherons, tout à l’heure, quelle devait être sa place dans le drame. L’autre est le thème en rythme de chanson militaire qui provient (les Mémoires nous l’ont dit) d’un quintette écrit dans son enfance ; la note précédemment reproduite : « Chœur du peuple finissant en majeur avec l’explosion et les thèmes de la coda de l’ouverture », atteste qu’il devait être utilisé dans le final du Cri de guerre de Brisgau, ainsi que dans le troisième projet. Quant au chant des flûtes, et des clarinettes qui se déroule longuement au milieu de l’ouverture, et qu’une lettre (du 8 mai 1836 [CG no 472]) appelle « la prière », nous n’en saurions déterminer la correspondance avec aucune partie du poème.
Le premier morceau que la brochure désigne comme ayant sa « musique faite » est l’ensemble de la scène première : « Lénor, entends nos fers… » Il nous a été conservé par le manuscrit de la Bibliothèque nationale. C’est un chœur très sonore, pas très neuf, en style ordinaire de chœur d’opéra, mais plus développé que ne le comporte la moyenne du genre. La calligraphie en est fort belle : on voit que, dès sa jeunesse, Berlioz avait les soucis d’exécution matérielle dont nous avons remarqué le retour dans ses dernières œuvres. — La fin de ce morceau donne lieu à des observations particulièrement intéressantes. Après le premier épisode, qu’on pourrait appeler le « chœur du soulèvement », le tyran, sortant de son château, apparaît devant le peuple, dont cette vue suffit à refréner les intentions belliqueuses. Le chœur chante :
Ah ! voici le tyran ! Son œil cherche la proie
Qu’il promet au poignard de ses juges affreux.
Malheureux ! la terreur nous condamne à la joie !
Ces trois vers sont chantés en style de récitatif choral, d’une déclamation saccadée, haletante… Mais voici qu’Olmerick approche : il faut, de gré ou de force, le saluer d’acclamations ; le peuple termine donc ainsi :
Qu’il vive de longs jours ! qu’il règne aimé des cieux !
Sur les premiers mots, en effet, les voix éclatent comme des trompettes, faisant succéder au mineur un strident accord majeur. Mais le Vivat a peine à se prolonger : déjà le verbe « règne » est souligné d’un menaçant retour au mineur, et la fin : « aimé des cieux » tombe avec l’accent d’une plainte. Au bas de la page, on lit cette note : « Les chœurs doivent prononcer ces mots : « aimé des cieux » avec un accent de honte et de crainte, comme si leur bouche se refusait a proférer un souhait qui est si loin de leurs cœurs ». On avait relevé de ces mêmes indications, bien caractéristiques de l’esprit de Berlioz, jusque dans les Troyens : « Cette note doit être soupirée et non chantée », etc. On voit qu’il était capable d’en trouver d’analogues dès le premier essai de sa jeunesse.
Le second morceau qui, dans le poème, porte la mention : « Musique faite », est, après une très longue scène en dialogue entre Olmerick et son confident Christiern, un duo dans lequel les deux personnages exhalent leur haine contre Lénor. La musique en est également conservée. Nous ne saurions mieux en caractériser le style qu’en le rapprochant du célèbre duo d’Euphrosine et Coradin, de Méhul, bien connu de Berlioz, ainsi que l’atteste cette anecdote qu’il rapporte dans ses Soirées de l’Orchestre : « La première fois que j’entendis Euphrosine, il m’arriva de causer un étrange scandale par un cri affreux que je ne pus contenir à la péroraison de ce duo : « Ingrat, j’ai soufflé dans ton âme ! » Comme on ne croit guère, dans les théâtres, à des émotions aussi naïvement violentes qu’était la mienne, Gavaudan, qui jouait encore le rôle de Coradin, où il excellait, ne douta point qu’on eût voulu le railler par une farce indécente, et sortit de scène courroucé. Il n’avait pourtant jamais peut-être produit d’effet plus réel. » Le duo des Francs-Juges est d’une énergie presque comparable, avec une certaine sécheresse dans la musicalité, également commune aux deux morceaux. Il est développé à l’excès : les clameurs des deux complices se répètent avec une insistance qui finit par lasser l’attention, malgré une large coupure indiquée vers les dernières pages. A noter ces mots qu’on lit au passage le plus véhément de la péroraison : « Ils s’avancent vers la rampe avec le dernier degré de fureur, et tirent leurs poignards sur le fa bécarre de la deuxième mesure. » Toujours plein de conviction, le jeune auteur !
Le premier acte renferme encore trois morceaux sur les paroles desquels sont inscrit les mots : « Musique faite ». C’est d’abord un récit et air de Conrad : « Noble amitié » ; puis une Elégie chantée par Amélie ; enfin un quatuor : « Frais vallons où dorment nos pères. » Le premier a figuré sur le programme du second concert de Berlioz, en 1829 ; les paroles, remaniées et mises dans un duo, se retrouvent dans le Cri de guerre du Brisgau de 1833 ; enfin, en 1835 encore, Berlioz mandait à son collaborateur qu’il en avait écrit la musique pour être chantée indifféremment par une voix d’homme ou de femme, et qu’il se proposait de demander à Mlle Falcon de l’interpréter. Cette musique n’a pourtant pas été retrouvée, non plus que celle des deux autres morceaux mentionnés dans le même acte. Est-ce elle qui contenait les thèmes que Berlioz nous a dit avoir utilisés dans ses œuvres postérieures ? Cela peut être, mais nous n’avons présentement aucun moyen de le savoir.
Le second acte commence par un chœur de bergers : « L’ombre descend dans la vallée », que nous retrouvons tout entier dans le manuscrit musical. C’est une page vraiment ravissante, où le sentiment de la nature, que Berlioz possédait si intimement, s’exprime en toute sa plénitude. Le chant n’est autre que celui d’un ranz des vaches, que déroule la partie supérieure du chœur : non celui, de Jean-Jacques Rousseau, que Grétry avait introduit dans l’ouverture de son Guillaume Tell, et dont Rossini devait reprendre le thème à son tour pour le faire entendre (par deux fois) dans son chef-d’œuvre du même nom. Celui qu’a adopté Berlioz est un type plus populaire encore, qui paraît répandu surtout dans la Suisse française (région de Fribourg : la Gruyère), et dont nous connaissons plusieurs notations, différentes entre elles par quelques traits, mais tout à fait semblables par la disposition générale (1). Le chœur bâti sur cette base est harmonieux et charmant, à l’égal du chœur d’introduction de Guillaume Tell : « Quel jour serein le ciel présage », une des meilleurs inspirations de Rossini, — nous savons par ailleurs que la musique des Francs-Juges est antérieure à 1829, année de la première représentation de cet opéra : donc, aucune possibilité de soupçonner Berlioz d’avoir plagié Rossini, ce qui serait d’ailleurs invraisemblable ! Plus personnelle encore est la façon dont le jeune maître use de l’orchestre. Il met deux cors dans la coulisse d’un côté, deux clarinettes de l’autre côté, deux trompettes dans les combles ; quelques voix et un petit orchestre d’instruments à cordes sont sur la scène, derrière la toile de fond ; et tout cela dialogue, répond au choeur et à l’orchestre principal, comme l’écho passe d’une montagne à une autre montagne… Cette page de jeunesse est l’œuvre d’un vrai poète musical.
Les danses qui suivent n’ont pas été écrites ; le manuscrit musical lui-même l’atteste par ces mots : « Chœurs de danse à faire ». Mais le trio pastoral nous a été conservé comme morceau vocal avec accompagnement de piano. C’est, de l’opéra tout entier, celui qui semble avoir joui avec le plus de continuité des préférences de Berlioz. Il le fit entendre à son premier concert, en 1828, où l’exécution lui causa une des premières désillusions de ce genre qu’il éprouva dans sa vie : les choristes manquèrent leur entrée, et le morceau dut s’achever sans le chœur écrit pour la conclusion. Il lui fit place dans le Cri de guerre du Brisgau, ainsi que dans l’autre projet d’arrangement. Écrivant à son collaborateur le lendemain de la première audition [CG no. 93], il l’appelle : « Notre chère mélodie pastorale ».
Je ne partage pas absolument cette admiration : en fait de sentiment pastoral, le chœur précédent me semble bien préférable. Chose singulière, la forme de ce trio avec chœur est empruntée à un art qui n’avait guère les sympathies de Berlioz : l’ensemble d’opéra italien, avec exposition d’un thème par une première voix, reprises successives du même thème par toutes les autres voix entrant à tour de rôle, celle qui a fini le chant continuant et s’unissant aux voix suivantes en des dessins accompagnants, où la vocalise n’est pas sans jouer son rôle. Moïse, le Siège de Corinthe, et combien d’autres ouvrages du répertoire du théâtre italien, en fournissaient des modèles : il faut que ceux-là se soient imposés, avec une insistance singulière, puisque nous les voyons suivis par Berlioz lui-même !
Voici quel était le thème de ce trio pastoral : nous pouvons, sans dommage, en donner le chant seul, l’accompagnement, dans le rythme uniforme de deux croches et un demi-soupir par temps, étant très simple et pouvant être aisément sous-entendu. Pour les contre-chants, ils se multiplient à la fin, de manière à étouffer un peu trop la mélodie principale. A cette complication, nous cessons de reconnaître l’imitateur du style italien, et nous retrouvons Berlioz !
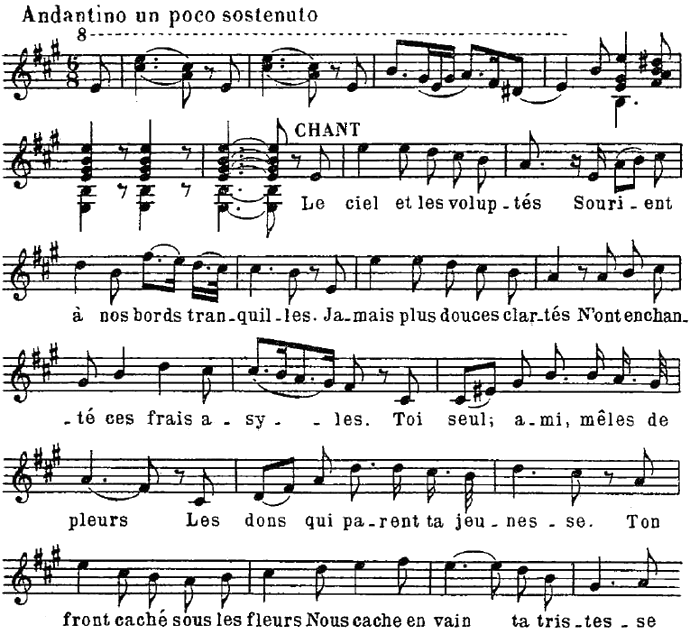
Dans le même acte, un duo entre Amélie et Lénor, puis un final avec chœur, sont portés dans le livret avec la mention : « Musique faite » ; cette musique n’est pas conservée.
Nous voici arrivés au troisième acte, qui renferme les scènes les plus caractéristiques de l’opéra. Il résulte de l’inspection du manuscrit de la Bibliothèque Nationale que tout ce que Berlioz voulait mettre en musique a été écrit, mais qu’une grande partie de cette musique a été détruite par lui-même.
La partition reliée des Francs-Juges s’achève en effet par un épais cahier de papier à musique ; mais s’il en reste intactes deux strophes d’un même morceau : l’Hymne des Francs-Juges, tous les feuillets qui précèdent et suivent sont déchirés du haut en bas, plus ou moins près du bord intérieur, de manière à laisser encore lire par endroits quelques mots ou quelques notes, mais jamais rien qui forme un développement complet. L’on a très sagement recueilli et laissé à leur place ces débris qui, comparés avec le poème, nous permettent tout au moins de nous reconnaître dans cette partie du travail.
Nous trouvons ainsi tout d’abord les vestiges de l’invocation au sommeil, morceau que Berlioz fit entendre à son premier concert (1828), où il fut chanté par Duprez, alors jeune débutant, et qu’il désigna plus tard pour être conservé dans le Cri de guerre du Brisgau. Malgré cette faveur manifestée à si longue distance, l’auteur a fini par condamner cette musique, car, de par la déchirure irrégulière qu’il a fait subir à sa partition, il n’est plus possible que de lire, sur les bords des pages, les noms des instruments, quelques fragments de vers dont nous retrouvons la correspondance dans le poème, des suites de notes qui constituent rarement un dessin complet, enfin quelques-unes de ces prescriptions originales, en tout temps familières à l’auteur, comme celle-ci, par exemple : « Clarinettes avec les pavillons enveloppés dans une bourse de… » On peut compléter : « Une bourse de cuir », car nous avons déjà lu cette même indication sur une autre page musicale de très peu postérieure aux Francs-Juges : le « Chant de bonheur » du Retour à la vie (Lelio), qui lui-même provient de la cantate : La Mort d’Orphée, présentée au concours de Rome en 1827. Si peu qu’il nous reste du morceau des Francs-Juges, nous en avons assez pour nous faire une idée de sa couleur : nous y relevons des traces d’un chant à l’aigu des violoncelles qu’enveloppent des dessins calmes et doux des violons (probablement en sourdines) et où viennent se poser, parfois, deux flûtes en tierces. Quant au motif lui-même, s’il ne peut être reconstitué en entier, ce qui subsiste nous apprend qu’il n’est pas de ceux que Berlioz a replacés dans une de ses œuvres postérieures, car rien n’en est reconnu.
L’air est suivi d’un tableau muet pendant lequel Lénor, endormi, rêve. « Les principales scènes des actes précédents, dit le livret, lui apparaissent confusément en songe… L’orchestre rappelle tour à tour et sans suite les motifs de la scène pastorale, la marche des gardes d’Olmerick, la fin du final du premier acte, l’anathème du Franc-Juge. » Voilà un programme de symphonie qui est bien du Berlioz et fait pressentir déjà la Fantastique. Puis Conrad, habillé en Franc-Juge, tenant d’une main un poignard et de l’autre une lanterne sourde, sort de la forêt et vient éveiller Lénor. On entend, au loin, sonner minuit : Lénor, frissonnant à cet aspect et à ces bruits sinistres, obéit sans mot dire, et tous deux disparaissent silencieusement… On n’avait, certes, jamais eu de pareilles conceptions à l’Opéra français, et cet essai dramatique de Berlioz est la première œuvre qui nous en donne l’exemple. Ici, dans le manuscrit, les feuillets sont déchirés tout près du bord, comme si l’auteur avait voulu qu’il ne restât aucune trace de cette ébauche de symphonie descriptive adaptée à la scène. Notons seulement la présence à la tablature d’une cloche en la, et de l’écho de cette cloche ; nous en savons la cause : on entendait sonner minuit.
Le dernier tableau, dans la caverne où siège le mystérieux tribunal, commence « au bruit d’une marche lugubre » accompagnant l’entrée des Francs-Juges. L’on a dit que la Marche au supplice de la Symphonie fantastique avait été composée d’abord pour les Francs-Juges : s’il en était ainsi, le morceau ne pourrait avoir été fait que pour cette situation. Voyons donc ce que nous apprendra le manuscrit musical. Il conserve ici les bords de trois feuillets, déchirés assez loin pour permettre de lire des mesures entières, et près de deux pages complètes en partition ; celles-ci, servant à amener l’entrée du chœur, nous font connaître la conclusion du morceau instrumental. Or, sans donner à cet examen aucun développement, nous pouvons dire qu’il n’y a aucun rapport, ni de ton, ni de mouvement, ni de style, ni de forme musicale, entre ce prélude et la marche célèbre. Souvenons-nous, d’autre part, que l’inspection du manuscrit de la Symphonie fantastique ne nous avait permis d’y relever aucune trace d’éléments étrangers, et que la Marche au supplice y apparaissait comme faisant corps intégralement avec l’ensemble de l’œuvre. La preuve est donc faite de part et d’autre, et voilà une nouvelle légende qui s’en va : la Marche au supplice de la Symphonie fantastique n’est pas un emprunt fait aux Francs-Juges.
Le paragraphe ci-dessus reproduit sans aucun changement la rédaction première de ces Berlioziana telle qu’elle est fixée depuis plus d’un an. Une controverse, récemment ouverte, nous obligera d’y ajouter quelques observations complémentaires : c’est ce qui sera fait dans un prochain numéro.
___________________________________
(1) Parmi
les ranz des vaches de ce type, nous devons citer celui dont la notation a été
donnée par Viotti : on y lit un passage en notes brèves, à deux temps,
qui se retrouve textuellement dans l’arrangement de Berlioz.![]()
![]()
![]() Le
Ménestrel, 5 Août 1906, p. 240-242
Le
Ménestrel, 5 Août 1906, p. 240-242
FRANCS-JUGES ET SYMPHONIE FANTASTIQUE
Les éclaircissements donnés au cours de cette étude ont dû suffire à la plus grande partie de nos lecteurs pour établir leur conviction que la Marche au supplice ne vient pas des Francs-Juges. Profitons cependant de l’occasion que nous offre présentement l’examen de l’opéra de jeunesse laissé inachevé par Berlioz pour confirmer ce résultat acquis à l’aide de nouvelles preuves.
Pour que la Marche au supplice de la Symphonie fantastique soit tirée des Francs-Juges, il faut qu’elle ait figuré d’abord dans la partition de cet opéra. C’est là une de ces vérités élémentaires dont M. de La Palisse lui-même accueillerait l’évidence.
Or jamais ce morceau n’a existé dans les Francs-Juges, où il n’y a aucune place pour lui.
M. Ad. Boschot, inspiré par M. Ch. Malherbe, dit le contraire. Mais ses assertions sur ce point sont d’une imprécision qui va jusqu’à se contredire.
On lit en effet à la page 23l de son livre :
« De toute la fin du troisième acte (deuxième tableau), le jeune Berlioz n’écrivit guère que la « marche lugubre » pour les Francs-Juges se glissant dans la caverne. En 1830 il l’enlèvera de son opéra pour l’utiliser, etc. »
Voilà déjà de quoi nous renseigner sur le degré de créance à accorder aux observations de M. Boschot. Tout à l’encontre de ses dires, le troisième acte des Francs-Juges est celui pour lequel Berlioz a écrit le plus de musique. Cette musique (on l’a vu dans le dernier Berlioziana) existe dans le manuscrit de la Bibliothèque Nationale, soit intégralement conservée, comme c’est le cas pour l’Hymne des Francs-Juges (dont notre prochain numéro reproduira la transcription), soit par lambeaux dont j’ai expliqué la nature et la provenance. Enfin le prélude orchestral — la « marche lugubre » pour les Francs-Juges se glissant dans la caverne — n’est pas la Marche au supplice et n’a avec elle de ressemblance d’aucune espèce (1).
Mais voici qu’à la page 389, notre auteur dit tout autre chose :
« L’emploi d’un vieux manuscrit d’une Marche des Gardes qui devient une hoffmannesque Marche au supplice… »
Et, cinq pages plus loin :
« Berlioz plaque, au bon endroit, un rappel de l’idée fixe… Ce fut le seul changement qu’il fit à la musique de son ancienne Marche des Gardes. »
Je laisse volontiers M. Boschot se débrouiller tout seul pour nous expliquer comment la marche des Francs-Juges dans la caverne s’est muée d’abord en marche des Gardes (ou inversement) pour devenir ensuite Marche au supplice. Quant à moi, j’ai simplement à dire ceci : que, dans l’opéra des Francs-Juges, il n’y a pas de Marche des Gardes.
On peut se reporter au poème manuscrit du Conservatoire ; on peut s’en tenir aux analyses que M. Boschot et moi en avons données : on n’y trouvera aucune place pour un tel morceau.
Dans la brochure, la distribution des personnages énumérant, après les protagonistes, des groupes de « Bohémiens et Bohémiennes, hérauts, peuple, soldats, bergers, Francs-Juges », etc., ne fait aucune mention de « Gardes ».
Admettons que ces « Gardes » étaient compris sous la dénomination générale de « Soldats », et poursuivons attentivement la lecture du poème.
A la première scène, « Olmerick (le tyran) s’avance avec Christiern ». Il n’est pas dit qu’ils soient escortés de gardes.
A la fin de la scène II, terminée en duo par les personnages nommés, on lit : « Olmerick sort ; les gardes le suivent ». Ah ! enfin ! Il y a donc des gardes ! Mais ceux-là sont les simples comparses de tragédie, à qui l’on dit : « Gardes, qu’on se retire », et qui obéissent sans bruit : il y a peu d’apparence que cette sortie, s’effectuant sans aucun doute sur la ritournelle même du duo (dont la musique nous est connue), ait été accompagnée par la Marche au supplice, qui dure sept minutes et met en mouvement tout le fracas de l’orchestre le plus puissant.
Pas plus à la fin du premier acte qu’au cours du second acte en entier il n’y a place pour une Marche des Gardes ni pour un morceau du caractère de la Marche au supplice.
Par contre, j’ouvre ici une parenthèse pour faire une observation relative à un autre morceau.
A la page 247, au cours de son analyse, M. Boschot, reproduisant les indications de mise en scène au lever du rideau du second acte, transcrit :
« On entend les cornemuses se répondre d’une montagne à l’autre. »
Il ajoute : « Musique faite, note Berlioz sur le manuscrit. »
De là à conclure que cette musique des cornemuses se répondant est la Scène aux champs elle-même, il n’y a qu’un pas, et ce pas est vite franchi, — car c’est son idée fixe, à lui, que toute la Symphonie fantastique soit prise dans les Francs-Juges !
Je poursuis la citation :
« Or, si l’on feuillette la partition manuscrite (Bibliothèque Nationale), on constate que ces pages de « musique faite » ont disparu ».
Vraiment ?… Elle a disparu, cette musique ?… Et moi qui l’ai relue, il n’y a pas quinze jours, parfaitement à sa place dans le volume de la Bibliothèque Nationale, après en avoir rédigé une analyse circonstanciée que nos lecteurs ont lue dans le dernier Berlioziana… Même ce que j’en ai dit a pu suffire à démolir par avance l’hypothèse de mon contradicteur. Il n’y a aucune ressemblance entre cette « musique faite » pour les Francs-Juges et la Scène aux Champs de la Fantastique. M. Boschot, qui, n’étant pas musicien, ne peut guère se rendre compte d’une partition à la simple lecture, ne s’est pas aperçu de cela, — à moins que, tout simplement, il n’ait pas pris la peine d’ouvrir le livre du contenu duquel il parle avec tant d’abondance (2).
En tout cas, il n’est pas plus heureux dans son affirmation que dans son hypothèse, — et je marque pour moi un joli coup double !
Je ferme la parenthèse, et passe au troisième acte.
Là se trouve écrit le seul mot qui puisse être pris pour indice (combien fragile, on va le voir) en faveur de la thèse de MM. Boschot et Malherbe. L’acte ayant commencé par un air chanté par Lénor, celui-ci s’endort, et, pendant son sommeil, « l’orchestre rappelle tour à tour et sans suite les motifs de la Scène pastorale, la Marche des Gardes d’Olmerick, etc. »
Marche des Gardes ! Le mot est là. Il indique un rappel de thème. Comment rappeler le thème d’un morceau qui n’a pas paru antérieurement, c’est ce que d’autres prendront soin d’expliquer s’ils le peuvent. Quant à moi, j’insinuerais volontiers (en dépit de mon « agenouillement » bien connu) que le livret des Francs-Juges n’est peut-être pas un chef-d’œuvre de construction et de logique, et que ce titre : Marche des Gardes, a pu être écrit par les auteurs au hasard de la plume, sans qu’ils y attachassent une importance notable, — que, du moins, le plus qu’il puisse désigner serait le rappel d’un rythme, d’une ritournelle. En tout cas, je ne pense pas que personne soutienne que le morceau écrit pour représenter un rêve de ténor d’opéra était la Marche au supplice elle-même, — et enfin, si quelqu’un s’en avisait, je le renverrais encore au manuscrit, où il trouverait des lambeaux qui, si incomplets qu’ils soient, suffiraient à lui prouver qu’il n’exista jamais à cet endroit aucune trace de cette marche.
A ces premiers arguments, fournis par l’œuvre même, il va s’en ajouter d’autres.
Et d’abord, voici une preuve, tirée de l’exécution matérielle, qui nous permettra d’établir que jamais le cahier sur lequel est écrite la Marche au supplice n’a figuré dans la partition des Francs-Juges.
La musique de cet opéra est écrite, d’un bout à l’autre et sans aucune exception, sur un papier d’un format moyen, mesurant 22 centimètres sur 30 (3).
La musique des trois seuls morceaux de la Symphonie fantastique appartenant à la rédaction première, nos 1, 4 et 5 (4), est écrite sur un papier de grand format, mesurant 27 centimètres sur 35.
Ces deux papiers ne se distinguent pas seulement par le format, mais encore par la teinte, le grain, etc. Les encres sont différentes. L’écriture même de Berlioz a subi, d’une œuvre à l’autre, des modifications qui ne sauraient échapper à l’œil le moins exercé.
Il y a donc, très distincts l’un de l’autre, deux matériels : celui de la Symphonie fantastique, celui des Francs-Juges.
La Marche au supplice appartient au premier, non au second.
Faut-il ajouter qu’il me semble qu’il faudrait avoir le sens critique quelque peu oblitéré pour admettre, pour peu qu’on y réfléchisse, que la Marche au supplice, dans la réalisation musicale de laquelle on trouve une évocation si étonnante du programme littéraire (le cortège s’avance aux sons d’une marche tantôt sombre et farouche, tantôt brillante et solennelle, dans laquelle un bruit sourd de pas graves succède sans transition aux éclats les plus bruyants, etc), ne soit qu’une marche d’opéra, faite pour une situation tout autre, et replacée dans la symphonie sans autre modification qu’une addition de quelques mesures à la fin, comme le soutient formellement M. Boschot ?
Et il suffit de même d’avoir jeté un coup d’œil sur la musique des Francs-Juges pour sentir quelle énorme différence il y a entre cette œuvre, essai intéressant d’un écolier ayant du tempérament et plein d’avenir, mais ne faisant guère encore qu’imiter ses maîtres, et une page aussi puissamment définitive que le morceau de la Symphonie fantastique.
Voilà bien des raisons dont ni M. Boschot, ni M. Malherbe ne se sont avisés.
Et maintenant que j’ai utilisé comme il convenait le manuscrit des Francs-Juges, je passe à l’autre document de la cause, le manuscrit de la Symphonie fantastique, appartenant à M. Ch. Malherbe.
Dois-je dire ici que j’éprouve un peu plus d’embarras ? L’on m’a reproché de travailler trop vite. J’en conviens, et je confesse, devant les jeunes biographes de Berlioz, qu’il n’y a guère plus de trente ans que j’ai commencé d’étudier mon sujet. Je me vois encore, au temps où j’étais étudiant en médecine (oui, parfaitement, moi aussi : en ma qualité de futur « agenouillé », je devais bien au grand homme cet hommage anticipé, d’avoir comme lui, avant d’entrer au Conservatoire, commencé les études médicales !), je me vois, dis-je, passant mes soirées de quartier latin, non à la Source, mais à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, où il y a une collection du Journal des Débats dans laquelle j’ai lu tous les feuilletons de Berlioz, et pris des notes qu’il me serait facile d’utiliser aujourd’hui pour combler les lacunes que j’ai relevées dans une publication faite, beaucoup plus récemment, sur ce sujet même, par un autre biographe (5). Et déjà M. Colonne avait commencé à faire entendre l’Enfance du Christ et Roméo et Juliette, dont je n’avais pas manqué une audition. Cela se passait en l’année scolaire 1875-76 (6). Je tremble de penser à la préparation qu’à cette époque M. Adolphe Boschot n’avait pas dû manquer d’entreprendre en vue de son futur chef-d’œuvre !…
La chose est donc entendue : je travaille trop vite.
En ce qui concerne le manuscrit autographe de la Symphonie fantastique, cela est un peu vrai, et je suis obligé de reconnaître que je n’ai pu l’étudier que pendant deux heures, ce qui est peu de temps en effet. Sans doute je n’eusse pas demandé mieux que de prolonger l’examen, et surtout de le renouveler ; mais je sentais qu’à demander davantage je risquais d’être importun, et je devais déjà m’estimer heureux d’avoir obtenu cette communication. Pourtant, que mes lecteurs ne soient pas trop inquiets. En deux heures, on a le temps d’apprendre bien des choses, surtout quand on a l’expérience du travail, qu’on possède son sujet, et qu’on s’est préalablement livré à la préparation nécessaire. L’hospitalité qu’a bien voulu m’offrir M. Malherbe était donc suffisante pour me permettre de m’éclairer entièrement sur une particularité sur laquelle mon attention était attirée d’avance.
Il y avait longtemps en effet que j’avais entendu parler de ces corrections introduites par Berlioz à la fin de la Marche au supplice, desquelles devait ressortir la conviction que ce morceau était tiré des Francs Juges comme bien l’on pense, je m’y suis porté avec un empressement tout particulier. Or, qu’ai-je aperçu ? Des corrections, certes, mais de nature identique à celles qu’on voit dans tout le reste de la partition, et rien absolument qui en diffère et indique une autre origine.
Au reste, je vais transcrire fidèlement mes notes, dans tout leur négligé hâtif :
Autographe splendide… Quelques mesures changées au basson (simple détail d’écriture : un rythme, avec les silences déplacés). Les trois pages de la fanfare sont splendides ! — Deux petites collettes dans le développement, qui, une fois amorcé, se poursuit avec la même maîtrise jusqu’à la fin, — puis là, hésitation pour conclure : trois projets de fin ; toujours il finissait trop brusquement.
Cette dernière observation venait à l’appui de celles que j’avais déjà faites sur les morceaux précédents, portant les traces de conclusions d’abord trop hâtives, développées après coup : particularité qui établit par elle seule l’unité de composition de la symphonie. Nous n’avons trouvé à faire aucune constatation analogue dans les Francs-Juges.
Je poursuis la transcription des notes prises le manuscrit sous les yeux :
Pour la Marche, la coda n’indique pas qu’elle est des Francs-Juges, car l’idée-fixe est à sa place, et si les corrections commencent deux mesures avant son entrée, on ne voit nulle part qu’il y ait de barre finale supprimée.
Ces derniers mots forment le nœud de la question. Quelle est en effet la prétention de mes contradicteurs ? Que Berlioz, ayant écrit une marche pour son opéra, l’a reprise pour l’introduire dans la symphonie, en substituant une conclusion nouvelle à la conclusion primitive. Or, le manuscrit montre qu’il n’y a jamais eu d’autre conclusion que celle de la symphonie, — qu’il y a eu hésitation pour y aboutir, mais rien de plus. Les mesures effacées avant le rappel de l’idée fixe n’ont aucunement le caractère d’une fin de morceau à laquelle une autre fin aurait été substituée. Cette observation est corroborée par l’absence de toute barre finale en cet endroit, et la barre finale est un signe que Berlioz n’omet jamais ; on peut s’en convaincre, sans aller plus loin, en se reportant, dans le même manuscrit, à la fin du premier morceau : là, les accords religieux formant la conclusion ont été ajoutés après coup, et l’on voit très bien la trace de la double barre qui marquait la fin de la première version (sans que d’ailleurs il en résulte que le morceau provienne d’une autre œuvre). Cet indice ne se trouve pas dans la Marche au supplice.
Et je puis ajouter encore ceci : qu’il n’y a pas de collette à la dernière page de la Marche au supplice, mais seulement des ratures. Et puis encore, y eût-il une collette, qu’est-ce que cela prouverait ? Est-ce que collette signifie Francs-Juges ? Il y a peut être cent collettes dans le manuscrit de la Symphonie fantastique : cela veut-il dire que tout ce qui est écrit dessous est tiré d’ouvrages antérieurs.
Est-il nécessaire que j’ajoute que je suis prêt à faire la preuve de tout ce que je viens de dire, documents en main ? Il est vrai, qu’il en est un que je n’ai pas à ma disposition, le manuscrit de la Symphonie fantastique, propriété personnelle de M. Charles Malherbe, et l’on sait que lorsque je lui demandai récemment d’en donner communication à des confrères absolument qualifiés pour une pareille marque de confiance, il me répondit que ma proposition « constituait pour lui la plus grave injure », que c’était « douter de sa compétence ou de sa bonne foi, et que, dans l’une ou l’autre hypothèse, l’offense est intolérable ».
Mon Dieu, je n’incrimine pas la bonne foi de M. Charles Malherbe, ni sa compétence non plus. Mais, s’il m’est permis de dire ma pensée, je crois qu’il est influencé par ce que l’on peut appeler « l’état d’âme du collectionneur ». Ce cas psychologique est connu : il a pour effet de donner à celui qui en est atteint l’illusion que tout ce qui provient de sa collection est la chose la plus extraordinaire du monde, tandis que ce qui n’en est pas n’a absolument aucune valeur. M. Charles Malherbe possède le manuscrit de la Symphonie fantastique : c’est, sans contredit, une pièce de premier ordre, qui n’a pas sa pareille dans sa collection, du moins en ce qui concerne l’œuvre de Berlioz. Mais la Bibliothèque du Conservatoire, la Bibliothèque Nationale, le Musée de la Côte Saint-André, la famille de Berlioz, et des particuliers, comme M. Alexis Rostand, M. Raoul Pugno, etc., en ont bien d’autres, dont l’ensemble constitue à peu de chose près la totalité des manuscrits musicaux du Maître. Je les ai tous étudiés, analysés et commentés. Comment donc se fait-il que la Symphonie fantastique soit la seule œuvre qui ait provoqué la discussion à laquelle j’ai été amené à prendre part, du fait d’un écrivain qui se fait honneur d’avoir eu les confidences de M. Malherbe et de parler en son nom ? On a pu voir d’ailleurs comment ses imputatations étaient justifiées, et ce qui en reste. Et par là encore se découvre un point faible de la méthode de M. Malherbe. Il a trop de confiance dans les expertises en écriture, et une tendance trop marquée à s’en tenir exclusivement aux données qu’elles lui fournissent. Il ne faut pas croire que l’étude des manuscrits soit toute la critique ; il y a bien d’autres éléments à y ajouter pour arriver à la certitude. Trop d’expériences récentes nous ont montré la fragilité de jugements fondés sur les observations de cette nature. Et je me permettrai de dire aussi que nous sommes en un temps où les pièces secrètes sont passées de mode.
Quant à M. Adolphe Boschot, il me semble, à la fin de cette discussion, qu’il passe bien à l’arrière-plan. Disons mieux : il n’existe pas. Il nous l’a assez dit : M. Malherbe fut pour lui « un véritable collaborateur », et de fait, il n’a guère fait autre chose que répéter ce qu’il lui soufflait. Oh ! je ne conteste pas qu’il ait tenu la plume, et ne veux point nier ses qualités littéraires, — car son livre est tout « littérature. ». Il m’a confirmé aussi, ce que je savais déjà, qu’il y a dans Paris un dépôt public où l’on collectionne, avec des bretelles, les éreintements des confrères. S’il faut tout lui dire, le dossier duquel il a tiré ses renseignements sur moi est très incomplet ; j’en possède un bien plus considérable, et que je garde jalousement. Les guerriers d’autrefois montraient avec orgueil les blessures qu’ils avaient reçues dans les combats : dans la lutte artistique, pourquoi ne ferais-je pas de même ? Des miennes, je ne suis pas mort, et je suis toujours prêt à porter de nouveaux coups. Il me plaît de batailler pour Berlioz, le grand méconnu d’autrefois, encore attaqué dans sa gloire posthume, ce qui est une preuve de plus qu’il donne de sa vitalité. Libre à d’autres, sous couleur de critique, de lui consacrer leurs livres prétentieux et faux. Je laisse aussi à qui plaît cette besogne l’utilisation des petits papiers et des petits potins, me réservant pour moi-même une meilleure part : la recherche constante de la vérité vraie, et la défense obstinée du génie.
___________________________________
(1) Je crois avoir donné sur ce point des explications suffisantes dans le
précédent paragraphe de cette étude, quand j’ai dit « qu’il n’y a aucun
rapport ni de ton, ni de mouvement, ni de style, ni de forme musicale, entre ce
prélude et la marche célèbre ». Ayant, à l’occasion de ce débat,
voulu revoir par acquit de conscience la partition de la Bibliothèque Nationale,
je me suis assuré de l’exactitude de mes observations premières, et j’ai pris
quelques nouvelles notes. Il ne sera vraisemblablement pas nécessaire que
j’utilise ces dernières : ce ne serait, je pense, qu’allonger inutilement
la discussion. Je me borne donc à les tenir en réserve pour le cas où ce que
je viens d’exposer serait contesté.![]()
(2) A défaut de cette lecture, M. Boschot aurait pu se renseigner, de la
façon la plus simple du monde, en lisant l’étude que Mlle Michel Brenet a, la
première, consacrée au manuscrit musical des Francs-Juges, où, avec sa
conscience et sa compétence accoutumées, elle donne des éclaircissements qui
auraient pu lui être utiles.![]()
(3) Je parle, bien entendu, de la partition d’orchestre, et laisse de
côté la transcription au piano, très postérieure, du trio pastoral, reliée
dans la partition avec les autres morceaux de l’opéra, bien qu’étant d’un
format tout autre.![]()
(4) Sur ces particularités, je renvoie au chapitre de ces Berlioziana
où ont été données des explications qui n’ont pas été contestées.![]()
(5) Ce léger coup de patte en passant n’ôte rien à l’estime que j’ai pour
le livre, d’une méthode excellente, et plein de renseignements utiles, que M.
J.-G. Prud’homme a consacré à notre commun héros.![]()
(6) Qu’il me soit permis de rappeler aussi que le premier article que j’ai
donné au Ménestrel avait pour sujet : Un Pèlerinage au pays de
Berlioz. Il ne date pas tout à fait de trente ans, mais en tout cas de plus
de vingt (1885).![]()
![]()
![]() Le
Ménestrel, 12 Août 1906, p. 246-248
Le
Ménestrel, 12 Août 1906, p. 246-248
LES FRANCS-JUGES
(Suite)
Quant à l’Hymne des Francs-Juges, Berlioz ayant manifesté la considération qu’il avait pour cette page musicale en l’épargnant ostensiblement, et la laissant subsister seule au milieu des débris qui l’entourent — disjecta membra, — nous ne saurions mieux faire que d’en reproduire purement et simplement une transcription : ce ne sera pas la moindre contribution que nous aurons fournie à l’études de Berlioz inédit. La partition n’indique pas de mouvement, le chœur continuant le prélude orchestral, dont les premières pages sont déchirées ; il est manifeste que ce mouvement est lent et soutenu. Le chant est écrit à trois voix d’hommes, comme les hymnes de Gossec : rapprochement intéressant à constater, on relève une très sensible analogie entre le début du Chant du 14 Juillet, de ce rnaître, et celui de l’hymne des Francs-Juges. Les parties vocales sont identiques dans les deux strophes, mais l’orchestre est tout autre : la première fois, les voix sont simplement accompagnées par les instruments à cordes et les clarinettes, cors et bassons ; mais dans la seconde strophe, qui doit être chantée « avec une expression plus sombre », les accords lugubres des trombones viennent s’unir au chœur ; les timbales sont « couvertes avec un drap épais » ; successivement entrent les trompettes et tous les autres instruments à vent ; enfin les violons, qui s’étaient tus d’abord, s’élancent en une gamme rapide sur les mots : « Flambeau sublime », les timbales sont découvertes, quelques vibrants coups de cymbales sont appliqués à propos, et l’hymne s’achève dans une superbe sonorité.
HYMNE DES FRANCS-JUGES

La transcription ci-dessus, faite d’après la première strophe, donne les parties vocales en grosses notes (les ténors notés en clef de sol suivant l’usage), et, en petites notes, les dessins ou accords ajoutés par les instruments.
Nous avons dit, d’après une lettre de Berlioz, que le chant des trombones, au commencement de l’ouverture des Francs-Juges, avait dû être remis au troisième acte, sous forme de chant pour Olmerick. Nous pensons en retrouver la place dans le « Récit mesuré » qui précède immédiatement la reprise de l’hymne, et qui porte l’habituelle mention autographe : « Musique faite ». Les premiers vers s’y adaptent assez exactement :
Tous que le ciel chargea du soin de sa vengeance,
Que votre cœur se ferme à la clémence.
Par contre, à la fin, vers et musique ne vont plus ensemble ; si donc Berlioz voulut faire chanter son thème jusqu’au bout, il fallut qu’il demandât à son collaborateur un changement de paroles.
Au reste, malgré la mention « Musique faite », le manuscrit musical n’a conservé aucune trace de cet épisode.
L’opéra s’achève enfin par un grand ensemble chanté qui, sur le livret, porte encore l’indication : « Musique faite ». La partition en marque la place par des restes de feuillets assez largement déchirés pour qu’on puisse en lire parfois jusqu’à trois ou quatre mesures de suite. Nous avons pu y reconnaître un des thèmes que Berlioz a repris pour une œuvre postérieure. Le voici : nous l’avons lu sept fois au moins sur ces débris de pages :

Il a été replacé dans Benvenuto Cellini, au cours d’un épisode du Carnaval, ainsi transformé en temps de danse :

Cette œuvre de la jeunesse de Berlioz, écrite sur les bancs de l’école, antérieure à tout ce qu’il a publié, méritait d’être étudiée avec ce développement, car elle est, à tous égards, d’un haut intérêt. Elle nous montre ce qu’était l’artiste avant d’avoir subi les influences qui déterminèrent sa marche définitive, — car la composition des Francs-Juges est antérieure à l’époque où il eut, presque simultanément, la révélation de Beethoven et de Shakespeare. Hormis Weber, dont l’exemple à dû agir sur la conception des scènes fantastiques du dernier acte, Berlioz ne connaissait alors d’autre musique (l’opéra italien, qu’il méprisait, étant écarté) que celle des maîtres de l’école française, desquels il est visible qu’il suivit la tradition. L’analyse nous a fait évoquer au passage les noms de Méhul et de Gossec. Certes, les modèles étaient excellents. Mais il s’y joint déjà quelque chose de plus nouveau et plus moderne. L’orchestre a un éclat de coloris, une ampleur de sonorité auparavant inconnus. L’auteur conçoit grand ; par cette œuvre de début il fait déjà songer à cette réflexion que, bien plus tard, il communiquait à Schumann : « J’ai besoin de beaucoup de moyens pour produire quelque effet. » [CG no. 486] Et c’est vrai : il se trouve naturellement à l’aise au milieu des complications des combinaisons instrumentales, tandis qu’on le sent gêné s’il ne dispose que de moindres ressources. Il publiait vers le même temps des romances dont les accompagnements de piano sont d’une insigne pauvreté : il se trouve, au contraire, écrire pour l’orchestre de la façon la plus satisfaisante. Enfin il a le sentiment inné de la déclamation juste et de l’accent tragique, en même temps que de la poésie de la nature. Mieux encore, il est poète dans toute la force du terme. Nous avons assisté à ses hésitations devant les pauvretés du poème, à ses trouvailles de scènes formant tableau — tableaux toujours sombres ! Ces conceptions, il n’osait pas encore les réaliser littérairement : il se bornait à faire part de ses idées à ses collaborateurs, qui, d’ordinaire, les traduisaient bien mal. Mais lui, il avait la musique, et, grâce à cette langue qu’il savait déjà rendre éloquente et charmeuse, il exprimait une part de son idéal. Car on en trouve la réalisation presque complète en certaines pages des Francs-Juges. Cette œuvre, par laquelle s’affirme sa personnalité, atteste que, n’eût-il pas changé son orientation ni subi l’ascendant de puissants génies étrangers, il serait devenu quand même (cet essai l’atteste) un des plus grands maîtres de la musique française.
![]()
![]() Le
Ménestrel, 19 Août 1906, p. 255-256
Le
Ménestrel, 19 Août 1906, p. 255-256
SCÈNE HÉROIQUE (LA RÉVOLUTION GRECQUE)
II a été dit un mot de cette œuvre à propos des Francs-Juges. Berlioz avait interrompu la composition de son opéra pour l’écrire : ce qui en fixe la date à l’hiver de 1826-27 ; il l’avait, en outre, fait exécuter à son premier concert, le 26 mai 1828 (1). Pendant longtemps il n’y songea guère ; pourtant, sept ans après, il lui vint l’idée de la faire entendre encore, dans un concert en plein air donné dans le jardin des Tuileries, pour l’anniversaire des journées de juillet, en 1833 ; mais les bougies manquèrent, et, les musiciens n’y voyant plus, le morceau de Berlioz fut simplement remplacé par la Marseillaise et « l’ignoble Parisienne, qu’on pouvait exécuter sans voir ». (Lettres intimes, 1er août 1833. [CG no 341])
Berlioz détruisit plus tard cette partition. Mais il en restait une copie, appartenant à l’auteur des paroles, Humbert Ferrand ; celle-ci a été conservée. Mise en vente après la mort des deux collaborateurs, elle a été acquise pour la Bibliothèque du Conservatoire. Elle forme un beau volume, relié avec un soin tout particulier, dans le goût du temps. On y a inséré, en manière d’illustration, des lithographies, représentant des scènes analogues au sujet : un groupe de gens armés regardant du haut d’une montagne un village qui brûle dans la plaine, une Liberté aux yeux farouches appuyant sur la tête d’un lion son bras vigoureux, etc.
Le titre est :
SCÈNE HÉROÏQUE
à grands chœurs et à grand orchestre
Paroles de M. FERRAND
Musique de M. HECTOR BERLIOZ
Exécutée pour la première fois à l’École Royale de musique
le 22 juillet 1828 (2)
A la copie musicale est joint un petit imprimé contenant le texte, pour être, vraisemblablement, distribué au concert (3) : le titre s’arrête après le nom de Berlioz, et diffère de celui de la partition par la suppression du nom du poète, remplacé par trois étoiles. Cette scène lyrique est, par la date, la première manifestation artistique du grand mouvement de sympathie qui s’élevait alors par toute la France, en faveur de la cause de l’indépendance grecque. Les tableaux splendides d’Eugène Delacroix, les Orientales de Victor Hugo, les Messéniennes de Casimir Delavigne en furent des témoignages plus brillants, certes, et plus durables, mais postérieurs : la tentative fût-elle prématurée, il n’est pas inopportun de rappeler que Berlioz fut le premier qui se soit inspiré de ces nobles efforts.
Jetons les yeux d’abord sur le poème. Il est plus intéressant par ses grandes divisions et ses titres, surtout par les indications qu’il contient, que par ses vers. Il se compose de strophes inégales, chantées à tour de rôle par un Chef grec, un Prêtre, Chœur des guerriers, Chœur de femmes, Rapsodes, Chœur général, et pour finir, Chœur de prêtres. Après la première strophe du Prêtre, on lit : « Le Labarum apparaît dan les nues. » A l’entrée des Rapsodes : « On entend des harpes lointaines et le bruit d’une foule qui s’avance. » Après leur strophe : « De nouveaux bataillons entrent de toutes parts au bruit des harpes et des instruments guerriers. » Enfin : « Le canon gronde, les guerriers agitent avec fureur leurs épées et se précipitent sur le devant de la scène ». Et quand ils sont sortis pour combattre, le chœur des prêtres entonne un dernier chant :
Europe, lève-toi !... regarde-les mourir.
Tout ce mouvement devait plaire singulièrement à Berlioz, et facilement échauffer sa jeune imagination.
De petites vignettes, placées en divers endroits du texte, contribuent à en préciser la signification : c’est, tour à tour, une épée antique, une croix au milieu des nuées, un casque.
En réalité, une contradiction visible se manifeste entre la conception du poète et la réalisation du musicien. Le premier, esprit essentiellement religieux, avait donné une grande importance aux parties de l’œuvre dont le sentiment était conforme à sa foi : Berlioz, déjà incroyant, les avait reléguées à l’arrière-plan, mettant principalement en valeur celles qui correspondaient à ses aspirations d’art et d’indépendance. Les chœurs des prêtres ont presque entièrement disparu de sa partition, sur laquelle, si elle eût été illustrée, l’étendard de la révolte aurait volontiers remplacé le labarum ! Par contre, les chants des guerriers et et les harpes des Rapsodes y ont pris une place presque exclusive que le poème avait été loin de prévoir si large.
Berlioz a ainsi jugé son œuvre : « On y sentait à chaque page l’énergique influence du style de Spontini. » [Mémoires, Chapitre XI] Dans la lettre intime qu’il écrivit à son collaborateur, au lendemain de l’audition unique qui, avoue-t-il dans les Mémoires, laissa le public assez froid, son style exigeant de grandes masses vocales absentes de l’exécution, il précise ainsi ses impressions : « Notre Scène héroïque a été fort mal exécutée. Bloc, qui conduisait, s’est trompé de mouvement en commençant : Des sommets de l’Olympe, et, pour ramener l’orchestre au mouvement véritable, il a causé un désordre momentané dans les violons, qui a failli tout gâter. Malgré cela, l’effet est aussi grand et peut-être plus grand que vous ne vous imaginez. Cette marche précipitée des auxiliaires grecs, et cette exclamation : Ils s’avancent ! sont d’un dramatique étonnant. Je ne me gêne pas avec vous, comme vous voyez, et je dis franchement ce que je pense de ma musique. » [CG no. 93]
L’appréciation n’est pas si fausse. Il est bien vrai que les formes musicales manquent encore d’originalité, et l’influence de Spontini est sensible : d’abord dans un chœur de femmes en qui l’on retrouve quelque chose du parfum de classicisme fané des chœurs de prêtresses dans la Vestale ; puis dans le chant en mouvement de marche guerrière :
Le monde entier prépare le trophée
Que nous promet un si beau sort.
Celui-ci, c’est plutôt Fernand Cortez qu’il évoque, avec ses rythmes militaires dont l’accent est si conforme aux aspirations de l’épopée napoléonniene.
Mais nous devons estimer principalement dans l’œuvre du jeune artiste ce sentiment des proportions architecturales que nous avons déjà loué dans sa première grande composition, le Resurrexit. Il y a, dans la dernière partie de la Scène héroïque, un morceau d’ensemble dont la construction est vraiment remarquable. Il représente l’approche des guerriers accourant pour la délivrance, accompagnés des Rapsodes. Une lointaine sonnerie de trompettes et des accords de harpe les annoncent. « Ils s’avancent ! » Et un long crescendo commence, extrêmement ménagé. L’orchestre est traité dans un esprit vraiment réaliste : le dessin, les formes semblent importer peu ; le son est tout, le son pour lui-même, comme dans l’art primitif, — et en effet, ces essais du jeune Berlioz, ce sont comme les primitifs d’un art nouveau. On entend d’abord des accords de harpes, espacés, puis un peu plus pressés ; une seconde partie de harpe y viendra bientôt joindre ses arpèges. Les instruments et les voix entrent peu à peu sur une longue pédale de basse, tonique du mode mineur sur laquelle se posent les accords les plus variés. Puis la basse monte à la dominante : le lent crescendo se poursuit. Elle revient encore à son premier degré ; maintenant le développement est si avancé que l’on pressent un aboutissement prochain. En effet, l’harmonie passe soudain au relatif majeur, ton principal du morceau, et sur cette modulation éclatante s’échafaudent, dans le chœur, deux chants déjà entendus. Berlioz usera souvent de ce procédé par la suite : cette œuvre de sa jeunesse, — la troisième en date qu’il nous soit donné d’analyser — est celle où il l’a employé pour la première fois.
Cette composition est donc comme un schéma, déjà très bien dessiné, de ces formes futures dont Berlioz ne tardera pas à se rendre maître : on y constate le sentiment inné des proportions grandioses, des plans, des oppositions, de tout ce qui constitue l’architecture sonore. On y devine aussi un enthousiasme encore latent et contenu, l’auteur n’étant pas encore libéré des entraves que lui imposent les formes, mais qui ne demande qu’à s’épancher largement.
Pas plus que les partitions précédentes, la Scène héroïque n’est donc encore une œuvre faite ; mais c’est un document bien intéressant pour l’étude de la formation d’un génie qui, maintenant, est tout près de s’épanouir.
___________________________________
(1) Voy. Mémoires, chap. XI et
XIX, et Lettres intimes, p.
13.![]()
(2) Date inexacte : le concert où cette œuvre fut exécutée eut lieu,
on l’a déjà vu, le 26 mai.![]()
(3) Les deux collaborateurs eurent un instant la pensée de publier l’œnvre
complète : le 11 novembre 1828, Berlioz écrivait à Ferrand [CG
no. 102]: « Vous me demandez combien coûterait la gravure de notre Scène
grecque. Il y a bien longtemps que je me suis informé du prix de la
lithographie, mais elle coûte, en France, un tiers de plus que la gravure. Les
planches gravées de notre ouvrage reviendront à 750 francs, avec l’impression
d’une cinquantaine d’exemplaires. » Lettres intimes, p. 26, Il n’a
pas été donné suite à ce projet.![]()
![]()
![]() Le
Ménestrel, 19 Août 1906, p. 256
Le
Ménestrel, 19 Août 1906, p. 256
[Lettre de Charles Malherbe au rédacteur du journal, à propos de la Marche au Supplice]
PRO DOMO
_______
Cormeilles (Eure), 13 août 1906.
MON CHER DIRECTEUR ET AMI,
Si j’usais du droit de réponse que concède la loi, je vous causerais un sérieux dommage, car à ses multiples talents, M. Julien Tiersot ne joint pas celui de la brièveté. Il considère sans doute les lecteurs du Ménestrel comme une famille ; c’est pour cela qu’il lave son linge devant elle. Au risque de paraître moins propre que lui, je vous épargnerai cette publique lessive.
M. Julien Tiersot veut m’entraîner dans la lutte qu’il a imprudemment engagée contre M. Adolphe Boschot ; il lui arrivera la déconvenue habituelle des polémiques qu’il soulève en France ou à l’étranger, partout agressif et toujours vaincu. Si je me tais provisoirement, c’est que je ne veux pas tomber dans le piège qu’il me tend. Je connais M. Julien Tiersot depuis de longues années ; j’ai eu pour lui plus que de la sympathie, une vraie amitié. Je n’en ai pas donné seulement la preuve par ces menues complaisances qui sont la monnaie courante d’une bonne confraternité ; je lui ai rendu un de ces services dont dépend le succès de toute une carrière. Il n’en sait rien ou n’en veut rien savoir ; mais, pour me récompenser, il m’accuse de « collectionner, avec des bretelles, les éreintements des confrères », et il va me dénoncer en haut lieu, afin d’attirer sur moi les foudres de mes chefs. Tant pis pour lui et non pour moi ! Il se flatte de posséder un arsenal très complet, rempli d’armes qu’il garde « jalousement », il se compare à un guerrier et se déclare « toujours prêt à porter de nouveaux coups ». Bibliothécaire comme lui, je comprends mes fonctions avec moins de combativité ; je suis d’humeur plus pacifique. J’ai des livres et des manuscrits ; mais loin de les garder « jalousement » comme lui et de m’en vanter, je les mets à la disposition de tout le monde ; il le sait et tous mes confrères en peuvent témoigner.
Depuis quelque temps, hélas ! M. Julien Tiersot donne des signes manifestes d’un mal qui risque de s’aggraver ; il parle, il écrit à tout propos et hors de propos ; il se fait le champion de ceux que personne n’attaque et découvre des vérités que chacun connaît ; il finit par ressembler au fameux solitaire de Carafa,
Qui voit tout,
Qui sait tout,
Entend tout,
Est partout.
Ce besoin de publicité est la conséquence d’une pléthore d’amour-propre, d’une « égotite » aiguë. Mais, puisqu’il a fait, nous apprend-il, ses études médicales, sans doute afin d’avoir un trait commun avec Berlioz, je souhaite qu’il trouve de lui-même un remède, et se guérisse tout seul. La crise passée, il reviendra ce qu’il était jadis, et nous serons peut-être encore amis.
Pardonnez-moi, mon cher directeur, cette réponse trop longue à mon gré comme au vôtre, et croyez-moi toujours votre cordialement dévoué.
CH. MALHERBE.
![]()
![]() Le
Ménestrel, 26 Août 1906, p. 264
Le
Ménestrel, 26 Août 1906, p. 264
[Courte réponse de Tiersot à la lettre de Malherbe du 19 août]
Journans (par Ceyzériat), Ain,
le 20 août 1906.
Monsieur Charles Malherbe a écrit, dans le dernier numéro du Ménestrel, que je l’ai dénoncé en haut lieu afin d’attirer sur lui les foudres de ses chefs.
Je lui donne, sur cette parole que je m’abstiens de qualifier, le démenti le plus formel.
JULIEN TIERSOT.
![]()
[Lettre d’Adolphe Boschot au rédacteur du journal]
LA « MARCHE AU SUPPLICE »
CONTINUE A VENIR DES « FRANCS-JUGES »
________
CHER MONSIEUR HEUGEL,
Je reçois aujourd’hui, devant les flots bleus du lac d’Annecy, le dernier Ménestrel.
Pendant quatre colonnes, M. Tiersot essaye de me passer à tabac. Quand il a fini, il déclare qu’il est encore prêt à porter de nouveaux coups.
Tel est l’aimable don Quichotte dont Berlioz est la Dulcinée et qui ne voit plus que du feu dès qu’on prononce le nom fatal.
En une seule séance de savate, il attaque M. Prod’homme, il attaque (comme à l’ordinaire) M. Malherbe ; bien plus, il prétend que dans une collection publique de bretelles (?) on prépare des étrivières pour le seul M. Tiersot (?!)…
Symptômes inquiétants : la folie de la persécution est imminente et cet incontinent paladin devient dangereux.
Relisez (si vous le pouvez !) les derniers factums de M. Tiersot : il raisonne avec une logique qui appelle la douche. Par exemple, il proclame que, dans les Francs-Juges, il n’y a aucune Marche des Gardes, mais qu’on entend cette Marche une deuxième fois.
Je m’occuperai, peut-être, de telles divagations quand le soleil sera moins radieux : c’est un ennuyeux sujet qu’il faut réserver pour un jour de pluie.
D’ailleurs, mieux vaut le prendre en gaieté : on aurait trop l’air de jouer les Vadius, si l’on voulait relever les raisonnements que M. Tiersot tient.
Malgré leur logique inquiétante (ou funambulesque), vous pouvez rassurer l’hagiographe « agenouillé » de saint Berlioz : la Marche au supplice continue à venir des Francs-Juges.
Et ainsi, contre toute évidence, M. Tiersot pourra écrire encore, grâce à d’inconscients raisonnements par l’absurde, d’innombrables Berlioziana : il y démontrera qu’il est un aveugle volontaire, et qu’il déraisonne avec béatitude. — Il ne démontrera rien de plus.
Vous pouvez également lui dire que le manuscrit de la Marche au supplice continue à être aussi explicite. Mais, quand M. Tiersot l’a vu, il a bondi (comme il l’avoue) vers la coda : sans aucun doute, il a dû tourner, à l’endroit fatidique, deux pages à la fois, ou plutôt il a fermé les yeux pour ne pas voir. — Mais, s’attardant aux bagatelles de la coda et aux ratures voisines de l’idée fixe, pourquoi n’a-t-il pas vu que…
Réservons cela.
Quand la température aura baissé, peut-être M. Tiersot sera-t-il un Don Quichotte moins furieux.
Veuillez croire que les algarades de votre bouillant collaborateur (c’est déjà la troisième, mais elles ne font que commencer) n’altèrent ni mon ironique indulgence à son égard, ni la vive sympathie, cher Monsieur Heugel, que j’ai pour vous et pour les collaborateurs du Ménestrel.
ADOLPHE BOSCHOT.
Post-scriptum indispensable. — Si vos lecteurs, qui s’intéressent à Beethoven, ne connaissent pas encore les Valses pour marmottes découvertes par M. Tiersot, je les engage à relire le Ménestrel du 27 mai 1906. A. B.
![]()
![]() Le
Ménestrel, 2 Septembre 1906, p.
271-272
Le
Ménestrel, 2 Septembre 1906, p.
271-272
[Lettre de Charles Malherbe au rédacteur du journal]
CORRESPONDANCE
______
MON CHER DIRECTEUR,
En termes d’une aménité toute parlementaire, M. Julien Tiersot se défend de m’avoir dénoncé en haut lieu, pour attirer sur moi les foudres de mes chefs. Je l’en remercie, et ne demande pas mieux que de le croire, bien que les propos de mes chefs m’eussent permis, à tort, soit ! de supposer le contraire. Il ne niera pas, du moins, qu’il s’est vanté, l’an dernier, non de l’avoir fait, mais de le faire ; car il parlait à haute et intelligible voix, devant témoins que je pourrais produire, dans la bibliothèque même de l’Opéra. Sans doute l’intention ne saurait être réputée pour le fait ; mais une telle menace ne pouvait cependant passer pour un témoignage de bonne camaraderie.
Au surplus, nous voilà bien loin de Berlioz et des Francs-Juges, qui seuls intéressent les lecteurs du Ménestrel, et encore ! Après les Berlioziana, il ne faut pas leur offrir une série de Tiersotina. Ce serait s’exposer à la pluie des désabonnements. Je mériterais alors, pour de bon, les foudres de l’hospitalier directeur, auquel j’adresse mes compliments amicaux et dévoués.
CHARLES MALHERBE.
Cormeilles (Eure), 26 août 1906.
![]()
![]() Le
Ménestrel, 9 Septembre 1906, p. 279-280
Le
Ménestrel, 9 Septembre 1906, p. 279-280
[Réponse de Tiersot à la lettre de Malherbe du 26 août]
M. Ch. Malherbe, répondant à ma rectification, écrit, de Normandie, qu’il l’accepte sans l’accepter, mais il ne l’accepte guère, tout en l’acceptant. En l’espèce, cela me paraît suffire ; par conséquent je renonce à faire usage de certains documents qui auraient fait ressortir les raisons, vraiment décisives, qu’aurait pu avoir M. Malherbe de ne pas écrire, à la date du 13 août 1906, que je l’ai dénoncé à ses chefs. Ceux-ci, qui sont aussi les miens, savent d’ailleurs à quoi s’en tenir ; n’ayant jamais reçu de moi aucune « dénonciation », pas même une simple réclamation que j’étais parfaitement en droit de faire, ils apprendront par la même, et sans que j’y sois pour rien, quelle créance il convient d’accorder aux paroles et accusations formulées par M. Malherbe, et ç’aura été le plus beau résultat de son zèle. Quant à l’incident de la Bibliothèque de l’Opéra auquel il fait allusion, je pense comme lui que ce n’est pas ici le lieu d’en parler ; mais j’ajoute que, si cela devait être, je n’aurais nul besoin de ses témoins pour le raconter dans toute son exactitude ; je saurais fort bien le faire tout seul ; l’on verrait alors lequel de nous deux est fondé à reprocher à l’autre de mauvais procédés confraternels.
Puisque cette querelle toute personnelle m’a obligé à rentrer dans ce débat (ce que je n’aurais certes pas fait sans cela), efforçons-nous d’en dégager les grandes lignes et d’en tirer les conclusions. Je ne recommence pas la discussion, on peut le croire. Je me bornerai à rappeler qu’après avoir étudié la question en cause avec tout le soin possible, je n’ai reçu de mes deux contradicteurs aucune réponse directe, si ce n’est l’annonce de révélations sensationnelles, plus tard, beaucoup plus tard ! Je ne sais pourquoi cette menace, qui me laisse très tranquille, me fait penser à cette inscription ironique qu’on lit parfois sur les boutiques de nos villages de la vieille France : « Ici on rase gratis demain. » Tout le reste ne fut que personnalités, peu décisives d’ailleurs. On entend parfois, dans les rues, des disputes de gens du peuple ; et quand l’un est à court d’arguments, il dit à l’autre : « T’es pas malade ? » C’est tout ce que les deux collaborateurs, toujours d’accord en tout, ont su trouver pour me confondre : ils l’ont dit en d’autres termes, plus littéraires, oh ! combien, — mais la pensée est restée la même, si tant est que cela puisse être appelé une pensée. L’un d’eux a professé dédaigner de jouer les Vadius ; il se vante, car il n’est pas de taille à assumer un si noble rôle ; il suffit de lire les lignes de lui que le Ménestrel a insérées il y a quinze jours pour savoir que l’emploi pour lequel il est fait est celui des Turlupins. Au reste, sa prétention même n’est pas justifiée. Il est facile d’apercevoir que, dès qu’il trouve la moindre possibilité de discuter, il le fait avec empressement. Le malheur est qu’il ne l’ait pu qu’en prenant la contre-partie de la vérité. C’est ainsi qu’il me fait dire généreusement que « dans les Francs-Juges il n’y a aucune Marche des Gardes, mais qu’on entend cette Marche une deuxième fois », alors que j’ai écrit tout le contraire, à savoir qu’il n’y a pas de rappel d’un morceau qui n’a pas existé, et que j’ai donné de cela les preuves les plus péremptoires. Il a aussi beaucoup de facilité pour changer de système. C’est ainsi qu’après avoir déclaré très nettement à l’origine que le cahier inséré dans la Symphonie est pris dans les Francs-Juges sans que Berlioz y ait fait d’autres changements que d’y introduire, à la fin, l’idée fixe, écrite sur une collette, il dit (maintenant que j’ai établi la preuve que cela n’est pas exact) que c’est à un autre endroit qu’il faut chercher la fameuse preuve (1). Tout cela est plus que suffisant pour nous édifier.
Quant aux « faits nouveaux » annoncés, si jamais ils sont produits, ai-je besoin de dire qu’ils ne pourront être reconnus comme valables que s’il est donné la plus large publicité aux documents d’où ils seront tirés ? Au commencement de cette discussion, j’avais demandé que ceux que l’on disait probants fussent soumis à l’examen de personnes compétentes, et j’avais d’ores et déjà désigné ceux de mes confrères que je choisissais pour cet arbitrage. Cela fut refusé. M. Malherbe a répondu tout d’abord que cette demande constituait pour lui la plus grave des injures ; plus récemment, il a écrit que c’était un piège que je lui tendais. Je laisse au lecteur impartial le soin d’apprécier ces raisons, gardant, quant à moi, ma première manière de voir parfaitement intacte, et, en définitive, déclarant que je considérerais comme nulle et non avenue toute communication postérieure qui serait faite autrement que dans la pleine lumière.
J’adresse au directeur du Ménestrel tous mes remerciements pour la large place qu’il a faite dans ses colonnes à cette discussion d’art : il sait qu’ils sont très sincères.
JULIEN TIERSOT.
___________________________________
(1) A propos de changement de système, il en est un dont je prévois
l’éventualité : celui qui ferait de la Marche au supplice un
morceau composé sur un thème des Francs-Juges. Cela ne me paraît
nullement inadmissible, étant d’accord avec la déclaration de Berlioz, qu’il a
utilisé les meilleures idées de cet opéra dans quelques-unes de ses
œuvres postérieures. Mais le cas est tout différent de celui d’un morceau
entier mis d’une partition dans une autre, avec une simple collette pour tout
changement. Si donc il venait à être reconnu véritable, il ne faudrait pas
que mes contradicteurs s’avisassent d’en triompher : ce sont eux, au
contraire, qui se trouveraient « vaincus, défaits », suivants leurs
aimables expressions. Au resté, rien n’est encore venu à l’appui de cette
hypothèse.![]()
![]()
![]() Le
Ménestrel, 16 Septembre 1906, p. 288
Le
Ménestrel, 16 Septembre 1906, p. 288
[Lettre de Charles Malherbe au rédacteur du journal, en réponse à celle de Tiersot du 9 septembre]
CORRESPONDANCE
______
Cormeilles (Eure), 13 septembre 1906.
Si l’on en juge au ton de ses polémiques, M. Julien Tiersot dédaigne, comme artifices surannés, l’élégance et la courtoisie. Il faut le plaindre et non le blâmer ; l’éducation est un enviable trésor, et ne le possède pas qui veut.
La concession que je lui faisais dans le Ménestrel, il y a quinze jours, était celle de tout homme du monde qui, dans un salon où l’on discute, s’abstient de donner des démentis aux convives de son hôte. Voici que M. Julien Tiersot en profite pour revenir à la charge, et sortir de nouvelles menaces de son sac à malices, inépuisable, paraît-il, comme la bouteille de Robert Houdin. Il voudrait bien me dire que je suis un menteur ; il le dit sans le dire, et ne le dit pas tout en le disant, son injure ne prouvera rien ; ce sont les arguments ou les témoignages qui lui donneront raison. Qu’il les produise donc, et, si j’ai tort, je l’avouerai sans peine, estimant qu’on s’honore soi-même à reconnaître ses erreurs.
Jusque-là, j’aurai le droit de dire à M. Julien Tiersot : Vous êtes venu dans la Bibliothèque de l’Opéra, et là, devant tous, vous avez déclaré que vous iriez trouver M. le ministre de l’instruction publique, afin d’obtenir réparation d’un fait dont j’étais bien innocent, mais que vous considériez comme digne de blâme. Cette simple menace contre un camarade qui, depuis vingt ans, avait prouvé son amitié par ses services, est-elle un acte de bonne confraternité ? Si oui, c’est qu’alors les mots ont changé de sens, et que nous parlons désormais deux langues différentes : lui, le français, et moi, l’iroquois.
Excusez, mon cher directeur, cette brève réponse, encore trop longue à votre gré sans doute, comme à celui des lecteurs, et croyez-moi votre bien amicalement dévoué.
CHARLES MALHERBE.
![]()
![]() Le Ménestrel, 7 Octobre 1906, p. 310-312
Le Ménestrel, 7 Octobre 1906, p. 310-312
OUVERTURE DE ROB ROY
L’ouverture de Rob Roy est, avec quelques pages du Retour à la vie, le seul envoi de Rome que Berlioz ait vraiment composé à Rome, ou du moins en Italie. En voici le titre, d’après la partition autographe contenue dans un volume comprenant, en outre, deux autres ouvrages précédemment étudiés (1) :
Intrata
di
ROB ROY MAC GREGOR
da
HECTOR BERLIOZ
Roma, 1832.
Berlioz a tracé l’esquisse de cette œuvre à Nice, en mai 1831, et achevé de l’écrire et de l’instrumenter quelques mois plus tard dans les montagnes de Subiaco (lettres à Th. Gounet du 14 juin 1831 [CG no. 231], et à F. Hiller du 1er janvier 1832 [CG no. 256]). La Société des Concerts, par un choix peu heureux, l’inscrivit, première œuvre du grand symphoniste admise à cet honneur, sur un de ses programmes, presque aussitôt après le retour du compositeur en France, le 14 avril 1833. Elwart parle en ces termes de cette exécution, dans son Histoire de la Société des Concerts :
« C’était la première fois qu’une œuvre de l’élève de Lesueur, de l’auteur de la Symphonie fantastique, se produisait au sein de la Société. Le succès du jeune compositeur fut très flatteur pour son amour-propre. »
Quelle que puisse être la valeur de cette attestation, Berlioz ne fut pas satisfait de la réalisation de son œuvre, de laquelle, dans ses Mémoires, il a dit ce simple mot : « Une Ouverture de Rob Roy, longue et diffuse,… fort mal reçue du public, et que je brûlai le même jour en sortant du concert ».
S’il détruisit, en effet, le matériel de cette œuvre qui était sa propriété particulière, il ne pouvait, nous l’avons dit, faire disparaître même le manuscrit qu’il avait, suivant le règlement, envoyé à l’Institut ; c’est ce manuscrit que nous retrouvons aujourd’hui sur les rayons de la Bibliothèque du Conservatoire.
Dans ce travail où la critique ne doit occuper que peu de place, ce document ne peut nous inspirer aucune observation spéciale : signalons simplement que son exécution matérielle est des plus soignées, que l’écriture est superbe, et qu’on ne trouve pas une seule rature à relever d’un bout à l’autre de la partition. Enfin rappelons que l’ouverture de Rob Roy contient deux motifs que Berlioz a repris pour les introduire dans Harold en Italie : joués tous deux par le cor anglais dans l’ouverture, ils sont devenus dans la symphonie, l’un le solo d’alto qui, traversant toute l’œuvre, en est devenu le motif principal, l’autre un thème du finale, où il est exécuté à plein orchestre.
ERIGONE
Voici une œuvre dont je ne crois pas que l’existence même ait été jamais signalée. Il est vrai que l’exécution en a été peu avancée, si du moins nous nous en référons au seul document connu qui la concerne : un manuscrit autographe de la Bibliothèque du Conservatoire.
Ce manuscrit se compose de deux parties distinctes : d’une part cinq pages de texte, de grand format, d’une écriture d’auteur que nous n’avons pas su identifier ; d’autre part deux cahiers de musique, où nous reconnaissons l’écriture de Berlioz.
Le premier document est un poème à mettre en musique. En voici l’intitulé :
ERIGONE
Intermède antique
(Un bois sacré dans la Thrace)
|
A droite le péristyle d’un Temple de Mars. — Colonnes de fer. — Au fond, des routes tortueuses et montantes sous les arbres avec une échappée de vue sur la mer (praticable). |
PERSONNAGES
|
ERIGONE |
Mme Stoltz. |
|
THAMIRIS, compagnon d’Orphée |
M. Alizard. |
|
PHARÈS, roi de Thrace |
M. Massol. |
|
LE GRAND PRÊTRE DE MARS |
M. Serda. |
Chœur de Bacchantes chantant et dansant.
8 Disciples d’Orphée de la suite de Thamiris, etc.
Pas d’autre indication, ni d’origine, ni d’époque, ni d’auteur.
Serait-il possible cependant de savoir quelque chose sur l’histoire de ce projet d’œuvre lyrique entrepris par Berlioz ? Essayons-le.
Dans une lettre de lui à son ami Gounet, datée de Montmartre, 10 avril 1834, on lit ces mots :
« Je vous remercie de votre Ballanche, cela me parait bien mystico-amphigourique ; c’est trop au-dessus de moi. » [CG no. 389]
Ballanche, écrivain aujourd’hui bien oublié, et qui ne connut ni ne rechercha jamais le succès populaire, contemporain et ami de Chateaubriand avec lequel son style n’est pas sans analogie, a, au cours d’une longue vie de méditation et d’étude, publié des « poèmes en prose » qui témoignent de tendances symboliques et sociales fort différentes de celles des temps romantiques. C’était un isolé. On a vu par l’extrait ci-dessus que le premier contact de son œuvre avec l’esprit de Berlioz ne fut pas sympathique. Mais, ainsi qu’il arrive souvent entre génies supérieurs, l’incompréhension première fit bientôt place à une parfaite intelligence et une véritable admiration. Une lettre d’une seule année postérieure à la précédente nous montre déjà le revirement : Berlioz écrit à Humbert Ferrand, dans le courant de 1835 :
« Dernièrement, Ballanche, — l’immortel auteur d’Orphée et d’Antigone, deux sublimes poèmes en prose, grands et simples et beaux comme l’antique — ce pauvre Ballanche a failli être emprisonné pour un billet de deux cents francs qu’il ne pouvait payer ! Songez donc à ça, Ferrand, etc. » [CG no. 440]
Enfin, trois ans après (8 février 1838), une lettre de Berlioz à Liszt (inédite) nous fait part du projet de composition que voici :
« Il y a longtemps que je cherche à écrire quelque chose sur Erigone de Ballanche (admirable poète !). C’est là ce que je voudrais présenter à Mme d’A[goult] ; si j’en viens à bout, ou si j’en trouve le temps, tu auras de mes nouvelles. » [CG no. 538]
Nous y voilà : l’Erigone dont nous étudions l’ébauche est ce poème lyrique que, en 1838, Berlioz songeait à écrire pour en offrir la dédicace à l’amie de Liszt, future belle-mère de Richard Wagner, — et son sujet était emprunté à ce Ballanche, d’abord jugé trop nébuleux, pour être qualifié bientôt « admirable poète ».
Erigone est, en effet, le titre du cinquième livre du vaste poème cosmogonique dont Ballanche a pris pour héros Orphée. Modifiant la légende, il fait survivre Orphée à Euridice, « sa sœur et compagne mystique ». Erigone, « jeune et belle ménade dont un amour sans égal causa la fin lamentable », s’était à son tour éprise d’Orphée en écoutant les sons de sa lyre civilisatrice. Mais il partit, et elle mourut, « comme la fleur chargée de trop de rosée. Elle fut punie d’avoir voulu changer la destinée d’un homme que les dieux s’étaient réservé. » Elle expira disant : « Je vais trouver Euridice, et j’attendrai auprès d’elle le poète divin dans les bocages de l’Elysée. » Les ménades, ses sœurs, menèrent un grand deuil autour de son tombeau. Elles voulurent la venger : mais Orphée leur échappa. Elles chantèrent des hymnes et instituèrent une fête où elles représentèrent par leurs danses Orphée déchiré et jeté dans l’Hèbre. Malheur alors au téméraire qui viendrait troubler leurs mystères ! Il subirait le sort du chantre divin !
C’est sur cette trame, dont on ne saurait méconnaître la pure et noble poésie, que Berlioz entreprit d’écrire. Il n’adapta pas sa musique au texte de Ballanche, qui est en prose, mais en fit faire une adaptation versifiée dont rien, dans les documents, n’indique l’auteur.
Pour l’époque, la lettre à Liszt et les premières indications que nous a déjà données le manuscrit permettent de la fixer d’une façon approximative. Erigone était en projet au commencement de l’année 1838. Ce projet fut-il exécuté sur-le-champ ? On en peut douter, car l’année 1838, occupée par l’achèvement et la mise en scène de Benvenuto Cellini, par les événements qui suivirent, est peut-être, de toute la vie de Berlioz, celle où il fut le moins libre de son temps. Notons en outre que les chanteurs dont les noms sont inscrits sur le manuscrit sont ceux des artistes de l’Opéra à la même époque et pendant les années suivantes : tous ont pris part à l’exécution de Benvenuto Cellini. Relevons enfin le mot « praticable » inscrit à la fin des indications scéniques. De tout cela nous pouvons induire que, postérieurement à l’échec de Benvenuto, Berlioz, désireux d’avoir, sur le même théâtre, une revanche, si modeste fût-elle, se décida à écrire cet « intermède antique », qui, de la sorte, ne serait pas une simple composition lyrique, mais une véritable œuvre dramatique.
La composition en serait ainsi placée aux environs de 1840.
La première scène est un chœur de Bacchantes. Le texte spécifie : « Lorsque la toile se lève, après l’introduction instrumentale qui se liera au premier chœur, les Bacchantes sont en danse et chantent (fête Bacchanale). Erigone y prend part et s’enivre des jeux de Bacchus. » Nous ne connaissons pas cette introduction instrumentale qui devait se lier au premier chœur ; mais la vocale de ce chœur même est entièrement contenue dans le double cahier de musique écrit de la main de Berlioz. C’est un morceau à trois parties, pour voix de femmes, toutes trois écrites en clef d’ut première ligne ; au-dessus est une portée destinée à noter une partie en solo ; mais aussitôt après la première mesure, la notation musicale y est remplacée par les mots : « Avec les lrs dessus », et dès lors il n’est plus question de cette partie. Le morceau est à six-huit, dans un mouvement qui n’est pas indiqué, mais que nous devons supposer animé puisqu’il s’agit d’une Bacchanale ; il commence en ré mineur ; la ligne mélodique principale est simple, et ne renferme pas de ces rythmes heurtés dont Berlioz était coutumier dans les morceaux de cette nature ; il semble qu’il ait voulu s’astreindre ici à écrire un chœur d’opéra suivant la formule habituelle. Par endroits pourtant se révèle ce sentiment de poésie antique qu’il avait à un si haut degré. On retrouve des formules analogues dans les Troyens : le premier chœur de la Prise de Troie, par exemple, renferme six mesures d’un dessin trois fois répété sur les mots : « Que le cri des batailles ne va plus déchirer », qui se chante identiquement, dans Erigone, sur ces autres paroles :
Chantons sans rivales,
Frappons les cymbales
Dans nos Bacchanales.
Après cette première partie du chœur, terminée par l’invocation Évohè ! que, par deux fois, clament toutes les voix réunies sur la tonique aiguë, un second épisode commence, chanté en larges notes, dans le ton de sol majeur, par les premiers dessus seulement. Cette mélodie se déroule longuement, prenant un peu plus d’animation à la fin, et ramenant la reprise du premier chœur, lequel est chanté une seconde fois tel qu’il avait été exposé la première, et terminé par une coda brillante et sonore.
Cette vocale est notée, à sa place normale dans la partition, sur un papier tout préparé pour recevoir une orchestration complète : mais cette orchestration n’est pas écrite, et le reste des pages est blanc. Le morceau, bien que la ligne principale en soit développée dans son entier, reste donc incomplet : étant donné l’art de Berlioz, il y manque sans doute la partie principale. Nous ne pouvons douter notamment qu’il en soit ainsi pour l’épisode du milieu, où un chant formé de notes soutenues parfois pendant des mesures entières était certainement destiné à être combiné avec quelque rythme animé et dansant de l’orchestre, suivant un procédé familier à Berlioz.
Et c’est là tout ce que nous savons de sa musique d’Erigone.
La suite du poème va cependant nous révéler encore une particularité curieuse. Au chœur succédait un air dont les paroles étaient composées de cinq strophes en quatrains de huit syllabes, commençant ainsi :
Reviens, reviens, sublime Orphée !
Viens essuyer mes pleurs amers !
Ma voix de sanglots étouffée
Te demande aux brises des mers.
Mais nous connaissons une mélodie de Berlioz dont les paroles sont bien ressemblantes à celle-ci, et dont la coupe est identique : c’est l’Absence, sur les vers de Théophile Gautier :
Reviens, reviens, ma bien aimée !
Nous relevons donc ici la même préoccupation déjà observée à propos des Francs-Juges, où nous avons vu Berlioz s’efforcer de coudre ensemble, pour en former un acte d’opéra, des morceaux pris de côté et d’autre dans son œuvre, y compris la jolie romance qu’il avait écrite sur les vers de Brizeux : le Jeune pâtre breton. Ici, c’était à Théophile Gautier qu’il avait demandé l’inspiration. Cette particularité concorde avec quelques autres pour nous confirmer ce que devait être cette œuvre laissée de côté à peine commencée. L’Absence fait partie du recueil des Nuits d’été qui parut vers 1841 : « c’est précisément l’époque que d’autres indices nous avaient permis de désigner comme correspondant à l’entreprise de cet intermède antique ». Si peu avancée qu’en ait été l’ébauche, il importait cependant de signaler son l’existence, et de montrer quelle place exacte l’œuvre qu’elle annonçait aurait pu tenir dans la production et la vie artistique de Berlioz.
___________________________________
(1) En résumé, la série des envois de Rome de Berlioz dont les manuscrits sont conservés au Conservatoire se compose des œuvres suivantes :
Resurrexit ;
Les cinq premières parties du Retour à la vie (morceaux séparés,
sans titre général) ;
L’Ouverture de Rob-Roy ;
Le Quartetto e Coro dei Maggi ;
La Tempête (devenue 6me et dernière partie du Retour à la vie).
Cette dernière partition, écrite sur un papier du format ordinaire des
partitions d’orchestre, et chargée de ratures et de collettes, est certainement
le manuscrit original écrit par Berlioz à Paris en 1830 ; elle forme un
volume relié à part. Les quatre précédentes sont écrites en très grosses
notes, avec un souci visible de calligraphie, sur un papier de grand format
in-folio ; il est évident que Berlioz les a recopiées en vue de l’envoi
à l’Académie. Le Resurrexit est relié en un volume ; les trois
œuvres suivantes, dans l’ordre énoncé, sont réunies en un autre volume.![]()
![]()
![]() Le Ménestrel,
14 Octobre 1906, p. 319-320
Le Ménestrel,
14 Octobre 1906, p. 319-320
LA NONNE SANGLANTE
Après l’échec de Benvenuto Cellini, Berlioz fut un moment abattu, terrassé. Sa carrière eût été finie, il n’en faut pas douter, lui-même serait probablement bientôt mort, tué par l’inconscience malveillante de ses contemporains, sans le geste de Paganini, à la fois généreux et hautain, qui le sauva. Il se releva donc, et reprit sa tâche. Il écrivit coup sur coup Roméo et Juliette et la Symphonie funèbre et triomphale. Il n’était donc pas mort, on n’en pouvait décidément douter ! L’Opéra sentit qu’il fallait encore compter avec lui. Il y eut des pourparlers, très compliqués, en suite desquels il fut décidé en principe qu’un poème de Scribe lui serait confié : c’était lui témoigner que sa coopération était prise au sérieux ; Scribe s’imposait par tant de chefs-d’œuvre ! La supériorité de ce poète sur Alfred de Vigny et Auguste Barbier, précédents collaborateurs de Berlioz, était si écrasante !… C’était vrai pourtant : la collaboration de Scribe, dans l’opinion des coulisses, c’était une première garantie du succès.
Au reste, dans le même temps, le compositeur participait activement à la vie du théâtre. Il composait les récitatifs du Freischütz et dirigeait les études de l’œuvre de Weber ; il était, par une rare dérogation, admis à prendre place à la tête de l’orchestre pour l’exécution de ses grands festivals (1). Et déjà ses collaborateurs et lui se mettaient à la besogne. Une de ses lettres de la fin de 1840 [CG no 739, à sa sœur Adèle Suat] parle de ce projet d’opéra, annonçant qu’il est « occupé d’adjoindre Scribe à Soulié » pour le terminer. A la vérité, le nom de Frédéric Soulié n’a jamais plus été prononcé comme faisant partie de la combinaison ; cependant on ne peut douter qu’il s’agisse d’ores et déjà de la Nonne sanglante, dont il n’existait alors que le plan ; la même lettre le spécifie, ajoutant : « Je l’ai lu à Henriette, qui en est enthousiasmée. » Une lettre qu’il écrivait à Eugène Delacroix, vraisemblablement pendant l’été de 1841 [CG no. 716, entre mai et juillet], parle d’une partie de campagne faite avec Scribe « pour y réfléchir à l’aise et chercher un dénouement ». Le 3 octobre 1841, il mande à Humbert Ferrand [CG no 755] : « J’écris une grande partition en quatre actes sur un livret de Scribe, intitulée la Nonne sanglante. Il s’agit de l’épisode du Moine de Lewis que vous connaissez ; je crois que cette fois on ne se plaindra pas du défaut d’intérêt de la pièce. Scribe a tiré, ce me semble, un très grand parti de la fameuse légende ; il a, en outre, terminé le drame par un terrible dénouement emprunté à un ouvrage de M. de Keratry, et du plus grand effet scénique. » Le 6 octobre, à sa sœur Adèle [CG no 756] : « Je suis et serai assez longtemps absorbé par la composition de mon grand diable d’opéra. Scribe me fait attendre le deuxième acte. » Le 10 août 1842, il écrit encore [CG no 772] : « Scribe ne me donne toujours pas les deux derniers actes de mon opéra ». Puis, à la fin de l’année, il part pour l’Allemagne, rentre en France dans l’été de 1843, multiplie pendant deux ans les festivals et accumule les besognes sans gloire, repart pour l’Autriche, compose la Damnation de Faust, la fait exécuter, s’y ruine, va en Russie et en revient au printemps de 1847. Pendant ces cinq années, il n’a guère songé à la Nonne sanglante, qui ne l’a occupé, en somme, que dans les premiers temps où l’ouvrage fut en projet. Enfin eurent lieu, dans l’été de 1847, les pourparlers, dont le détail est exposé dans les Mémoires, pour la nomination des directeurs de l’Opéra, et au cours desquels Berlioz fut cruellement joué par ceux qui, pour obtenir ses bons offices, l’avaient leurré de leurs promesses ; il rompit avec eux, et rendit à Scribe son poème. « Celui-ci l’offrit à Halévy, à Verdi, à Grisar, qui tous eurent la délicatesse de refuser son offre. Gounod enfin l’accepta… » On a dit aussi que Félicien David, Meyerbeer même, avaient dû travailler sur ce chimérique livret, qui, enfin de compte, « a paru, dit Berlioz, si platement monotone que je dois m’estimer heureux de ne l’avoir pas conservé. »
Nous verrons tout à l’heure ce qui a subsisté de la composition musicale de Berlioz.
Mais d’abord, cherchons à connaître ce que devait être l’œuvre. Nous avons pour cela trois sortes d’éléments : le roman d’où le sujet est tiré, le poème tel qu’il fut postérieurement mis en scène à l’Opéra, enfin les fragments musicaux qui ont été conservés.
Le Moine est un roman anglais datant des dernières années du XVIIIe siècle. Son auteur, Lewis, voyageant à ce moment à travers l’Europe, s’était trouvé à Paris pendant la tourmente de quatre-vingt-douze ; il avait ensuite passé en Allemagne, où il vécut quelque temps dans le milieu weimarien de Gœthe et Schiller. L’on a dit parfois que l’idylle est la littérature propre aux époques de bouleversement, lesquelles y trouvent un repos. Le roman de Lewis donne un démenti à cette thèse : c’est un récit dont les horreurs imaginaires renchérissaient notablement sur celles qu’offrait dans le même temps le spectacle réel des révolutions et des guerres. Tel qu’il fut, il obtint à son apparition un succès considérable et universel. On y a vu, non sans raison, une manifestation anticipée de l’esprit romantique : non le romantisme passionnel qui, pour son coup d’essai, avait fourni déjà un chef-d’œuvre, Werther, mais ce romantisme extérieur qui a produit les drames et les romans français de 1830, sombre de couleurs, égaré dans l’excessif, avec les accessoires du moyen âge tel qu’on le concevait en ce temps-là, architectures gothiques, vieux châteaux forts, souterrains, armures, moines licencieux, fantômes…
Le sujet de l’opéra est tiré d’un simple chapitre épisodique ; le principal personnage du roman y reste étranger. Cependant, il a bien fallu, pour satisfaire un public informé que le poème était tiré d’un livre intitulé le Moine, que Scribe mit un moine dans son libretto : c’était d’ailleurs chose tout à fait conforme à la poétique de l’opéra d’alors. Ce moine, dans l’opéra commencé par Berlioz, s’appelait Hubert ; dans celui de Gounod, il est devenu Pierre l’Ermite en personne, ce qui a, sans contredit, beaucoup plus d’envergure. Au reste, d’une part comme de l’autre, le personnage n’a aucun rapport avec le moine de Lewis, de même qu’il est parfaitement inutile à l’action.
Résumons brièvement le récit porté à la scène.
Un jeune seigneur, que l’opéra appelle Rodolphe, est épris et aimé d’une jeune fille noble, nommée Agnès, dont, pour des raisons inutiles à expliquer, il ne peut devenir l’époux. La belle habite un château hanté, où parfois apparaît le fantôme d’une ancienne nonne, appelée aussi Agnès, et qui, pour d’autres raisons également inutiles à développer, parcourt pendant certaines nuits, à des dates connues d’avance, les tours, les corridors et les escaliers du château : elle sort, et, à la clarté de la lune, erre quelques instants au dehors. Les gens du pays, les habitants mêmes du château, connaissant ses habitudes et sachant qu’il leur en coûterait s’ils s’avisaient d’y contredire, laissent les portes ouvertes, de façon que le fantôme peut exécuter en tout repos ses promenades nocturnes.
Rodolphe, qui est un esprit fort, ne croit pas à ces contes ; mais il voit dans la superstition qui s’y attache une circonstance favorable à ses désirs. Il décide Agnès à se laisser enlever ; celle-ci prendra le costume du fantôme, suivra le chemin ordinaire, et, ayant franchi le seuil du château, s’enfuira avec lui.
Il est fidèle au rendez-vous. La nonne apparaît ; il la reçoit dans ses bras, froide et tremblante, et lui renouvelle ses serments d’amour. Dans le roman, ils montent ensemble dans un carrosse dont les chevaux s’élancent soudain avec la rapidité frénétique des coursiers de la ballade : « Hurrah ! les morts vont vite !… » C’est qu’en effet ils traînent la mort : c’est la véritable Agnès, la nonne, le fantôme, qui est venue au rendez-vous ! Après un galop fantastique, dans le fracas de la tempête la voiture se brise, tout disparaît, Rodolphe reste seul, évanoui sur la route. On le recueille, on le transporte dans la ville voisine ; mais chaque nuit le fantôme lui apparaît, et vient lui rappeler son serment. Dans l’opéra, la course qui suit l’enlèvement est remplacée par un autre épisode, plus scénique : après que Rodolphe avait adressé à la nonne des paroles d’amour, celle-ci exigeait que leurs noces fussent immédiatement célébrées. Elle l’entraînait donc dans un vieux cimetière en ruines, où les morts, sortant de leurs tombeaux, leur formaient cortège, et assistaient, témoins sinistres, à la fantasque cérémonie. Certes, la scène, si elle eût été traitée adroitement et avec un véritable sentiment poétique, aurait pu servir de cadre à un beau tableau musical, et inspirer dignement l’auteur de la Symphonie fantastique et du Requiem. Mais d’abord, il est fort à craindre que Scribe n’eût pas été l’homme capable de la traiter avec la sincérité nécessaire, qu’il n’en eût pas su exprimer le frisson mystérieux, qu’il se fût borné à y trouver prétexte à une simple réédition du ballet des nonnes de Robert le Diable, dont le souvenir s’impose par la seule analyse. Et Berlioz n’avait rien à gagner à recommencer Meyerbeer. En outre, la scène que nous venons de décrire ne pouvait former qu’un seul acte, et il en fallait remplir quatre autres (2) : l’opéra de Gounod nous a suffisamment édifiés sur la manière dont a été opéré ce remplissage pour que nous n’ayons à éprouver aucun regret que Berlioz n’ait décidément pas eu à se charger de cette besogne. Que d’anathèmes et que d’airs à boire ! Il l’a constaté lui-même dans le compte rendu qu’il eut à faire après la représentation de la Nonne sanglante sur une autre musique. Et que d’épisodes à côté, de romances et de petits airs ! Il y a, à un moment, deux personnages, Fritz, jeune fermier, et Anna sa fiancée, qui dansent la valse, et Anna chante les paroles suivantes :
La lune brille,
L’herbe scintille,
La jeune fille…
Il me semble que nous connaissons ces vers ? Ils sont dans les Deux aveugles, chantés par Giraffier, à moins que ce soit par Patachon… Je reconnais très volontiers qu’ils convenaient beaucoup mieux à la muse d’Offenbach qu’à celle de Berlioz.
Il y a aussi, dans la Nonne sanglante de 1854, un coquin de petit page qui ne le cède en rien au Stefano de Roméo et Juliette : « Gardez bien la belle… votre tourterelle », etc.
Enfin, l’on ne saurait négliger de signaler avec l’admiration qui convient le final guerrier par lequel, suivant la plaisante autant que juste observation de notre confrère Michel Brenet (qui a, le premier, appelé l’attention sur l’opéra inachevé de Berlioz), Pierre l’Ermite avait pour mission de faire vibrer la corde patriotique chez les spectateurs de l’Opéra sous le second Empire : « car, dit-il, la guerre de Crimée était depuis plusieurs mois commencée, et des auteurs habiles ne se fussent jamais pardonné de n’y point faire allusion ».
Quant aux parties prétendues dramatiques, elles appartiennent au style du plus vil mélodrame.
Félicitons-nous donc que Berlioz n’ait pas eu à achever la composition de la Nonne sanglante, car, l’eût-il menée jusqu’au bout, cette œuvre n’aurait pu que lui procurer de nouveaux déboires, sans ajouter à son bagage un chef-d’œuvre vraiment digne de sa haute personnalité.
Il était cependant, lorsqu’il l’entreprit, à l’époque de la pleine possession de son génie et de sa technique : au lendemain de Roméo et Juliette, à la veille de la Damnation de Faust ; c’est tout dire ! Aussi, les fragments conservés offrent-ils des pages dont le style est d’une réelle beauté, et dont l’examen ne saurait être tenu pour négligeable.
Ces fragments autographes sont déposés à la Bibliothèque Nationale dans la même série où nous avons déjà trouvé les fragments analogues des Francs-Juges et de Sardanapale. Quelques pages détachées d’un morceau sont, en outre, restées entre les mains de M. Edouard Petit, inspecteur général de l’instruction publique, qui les tient de Pacini, le collaborateur de Berlioz dans l’adaptation du Freischütz, auquel il est apparenté. Tout cela est complètement écrit de la main de Berlioz et instrumenté.
___________________________________
(1) C’est la même période à laquelle nous avons pu déjà rattacher le
projet d’Erigone ; mais, pour ce dernier, la correspondance de
Berlioz donnait ses premières indications deux ans environ avant celles qu’elle
fournit par la Nonne sanglante.![]()
(2) D’après les lettres de Berlioz, il semble que la Nonne sanglante
ne devait compter primitivement que quatre actes ; elle en a cinq dans
l’opéra de Gounod. Pour ce dernier, où le texte mis en musique par Berlioz a
été notablement remanié, Scribe s’est adjoint pour collaborateur Germain
Delavigne.![]()
![]()
![]() Le Ménestrel,
21 Octobre 1906, p. 327-328
Le Ménestrel,
21 Octobre 1906, p. 327-328
LA NONNE SANGLANTE
(Suite)
Les Mémoires donnent les explications suivantes sur l’état de la composition au moment où l’auteur l’abandonna. « J’en ai fait, dit-il, deux actes seulement. En tête des morceaux que je crois bons dans ma musique, je mettrai le grand duo contenant la légende de la Nonne sanglante, et le finale suivant. Ce duo et deux airs sont entièrement instrumentés ; le finale ne l’est pas. Cela ne sera jamais connu très probablement. » Une note ajoute : « Tout cela est détruit aujourd’hui, à l’exception de deux airs. » Cette dernière affirmation n’est pas tout à fait exacte : le manuscrit de la Bibliothèque Nationale renferme en effet les deux airs signalés, encadrés de quelques développements scéniques parfois non sans importance ; mais il contient aussi le duo, pour la destruction duquel Berlioz s’en est tenu à une simple intention, manifestée par cette note au crayon qu’on lit sur la première page : « Fragmens de la Nonne sanglante. A consulter. A brûler après ma mort. » Mais sa volonté n’a pas été exécutée, et j’avoue ne le point regretter, car le duo renferme le meilleur fragment musical qui nous ait été conservé de l’opéra. Quant au finale signalé comme resté à l’état d’ébauche, le manuscrit de la Bibliothèque Nationale n’en garde aucune trace. D’après l’indication donnée par la phrase des Mémoires ci-dessus rapportée (que ce finale suivait le duo) et la comparaison avec le poème représenté plus tard à l’Opéra, il résulte que ce finale appartenait encore au premier acte. Berlioz semble donc s’être arrêté là, et n’avoir composé qu’une faible partie, sinon rien, du second acte, qui, renfermant la scène de l’apparition, de l’enlèvement et des noces funèbres, était celui qui aurait pu l’inspirer le mieux.
En résumé, le manuscrit de la Bibliothèque Nationale renferme trois morceaux de la partition. Le premier, Récitatif et air d’Hubert, commence par une exposition du drame, dialoguée entre Rodolphe et le moine, où les paroles ont toute la banalité inhérente au genre, et où la musique a des accents d’une belle et énergique déclamation bien mal à propos appliquée à des fadaises. Puis le moine, — voix de basse, cela va sans dire, — chante un air développé, en un seul mouvement lent et soutenu, d’un caractère noble, évoquant le souvenir des chants du Père Laurence à la fin de Roméo et Juliette ou de l’entrée, si pleine d’onction, du Cardinal dans Benvenuto Cellini. Je ne sais pourtant si cette belle musique, dans le large développement de laquelle on reconnaît la nature du symphoniste plutôt que celle de l’homme de théâtre, eût, aux environs de 1845, trouvé grâce devant le public de l’Opéra, qui eût préféré sans aucun doute les cavatines du cardinal Brogni ou de Balthazar, prieur de Saint-Jacques de Compostelle. Ce n’en est pas moins une belle page de musique, et parfaitement digne du génie de Berlioz.
Le no. 2 de la partition porte en titre : Air de Rodolphe et récitatif avant le duo. L’air, exprimant le désespoir d’un amant qui croit avoir tout perdu, est dans une forme déclamée qui eût paru certainement incohérente au public, auprès duquel le succès aurait été plus assuré si le ténor lui eût chanté une simple romance. Comme nous l’avons vu dès le début, cette déclamation, qui rappelle plutôt les accents d’Enée dans les Troyens que les intonations familières aux héros du répertoire, est mise sur des paroles qui ne méritaient pas tant d’honneur. En voici quelques échantillons :
Sur la rive étrangère
Est-il un climat rigoureux,
Une retraite solitaire
Où tous les deux nous ne soyons heureux ?
Comme cela est neuf et digne de recevoir la musique d’un vrai poète de sons ! Tandis que, lisant cette scène, je songeais, par suite de certains rapprochements, qu’il était inutile de faire refaire la Favorite par Berlioz, j’aperçus sur le manuscrit, en regard de vers plus particulièrement connus, ces mots écrits au crayon de sa main : « A changer à cause de la Juive ». Et c’est vrai : Juive, Favorite, Robert le Diable, tout cela se confond et se mélange dans ce livret que Scribe, par grande faveur, avait bien voulu consentir à commencer pour Berlioz, collaborateur ordinaire de Shakespeare, de Gœthe et de Virgile !
Cette forme conventionnelle et fausse se continue dans le duo, à tel point qu’elle semble s’imposer à la musique même : il y a, au début de l’exposition du morceau, un mouvement général qui rappelle celui du duo analogue de la Juive : « Lorsqu’à toi je me suis donnée ». Les paroles sont tellement semblables ! « Braver l’autorité d’un père !… — Je meurs si je vous suis ravie… — Tous deux fuyons ce soir, » etc.
Fort heureusement nous arrivons à un épisode ou il est enfin permis à Berlioz de se retrouver soi-même. Ce n’est pas que la légende de la Nonne sanglante doive compter parmi les produits les plus significatifs de son génie : mais du moins le maître échappe ici aux obligations et aux conventions qui l’étreignaient.
Cette légende se déroule en trois couplets interrompus par le développement de la scène ; les deux premiers sont chantés par Agnès, sous la même forme vocale, avec des modifications à la partie instrumentale ; le troisième est dit par Rodolphe, qui, pour persuader à la jeune fille de le suivre en jouant elle-même le personnage du fantôme, reprend le chant en le transposant à l’aigu et en modifiant l’accent.
N’ayant trouvé dans le reste de cette partition inédite aucun autre fragment musical qu’il fût opportun de reproduire (l’air de basse, supérieur comme musique, eût été trop développé pour trouver place dans cette étude), nous donnerons une idée suffisante du style de la Nonne sanglante de Berlioz en transcrivant ici le premier couplet de la légende.
LÉGENDE DE LA NONNE SANGLANTE

Le duo s’achève par un développement du thème de la légende que le ténor reprend en troisième couplet. Les dernières pages ont été arrachées.
D’une façon générale, nous devons répéter la constatation faite au sujet du premier air : que le développement de cette musique est beaucoup plus étendu que celui des opéras du même temps. Continués dans les mêmes proportions, les quatre actes de la Nonne sanglante eussent atteint à des proportions considérables. Le public y aurait certainement trouvé « des longueurs » et renvoyé Berlioz à ses symphonies.
![]()
![]() Le Ménestrel,
27 Octobre 1906, p. 335-336
Le Ménestrel,
27 Octobre 1906, p. 335-336
APPENDICE
SUR LES TROYENS ET BÉATRICE ET BÉNÉDICT
De nouvelles trouvailles, récemment faites dans la famille de Berlioz parmi les papiers partagés entre ses divers héritiers, et dont a hien voulu me faire part M. Henri Chapot, petit-neveu du maître, me permettent d’ajouter quelques derniers détails documentaires à ceux que j’ai donnés en leur temps sur ses deux derniers opéras. [Voyez aussi Notes additionelles sur les Troyens.]
Si le bon ordre dans lequel Berlioz a laissé le manuscrit des Troyens n’a pas permis d’y découvrir les traces de remaniements intéressants, certaines épaves ont été retrouvées par ailleurs qui pourront nous donner d’autres satisfactions. C’est ainsi qu’un cahier dans les papiers conservés par sa famille ne renferme rien moins qu’un épilogue inédit des Troyens, entièrement composé et instrumenté, et, en définitive, resté inutilisé. Il se compose de vingt-trois pages de papier à musique de grand format, écrites, non de la main de Berlioz, mais de celle de son copiste, bien connue et reconnaissable dans tant d’autres parties de la partition originale. Une large déchirure sépare le cahier en deux parties, sur un peu plus des deux tiers de la largeur : c’est le signe de la condamnation d’un projet qui pourtant s’était avancé très loin dans la voie de l’exécution. Aussi bien, le fait que la destruction n’a pas été plus complète atteste que Berlioz ne le désavouait point et n’éprouvait aucun repentir pour l’avoir conçu.
Plusieurs de ses lettres nous ont mis au courant de ses hésitations en présence du dénouement de la tragédie. On connaît celui qu’il adopta : Didon mourante a la vision de l’avenir ; elle croit d’abord apercevoir ses descendants vainqueurs de la race d’Enée, et salue avec joie le nom vengeur d’Annibal ; mais au moment suprême, et quand déjà elle est frappée du coup fatal, la vérité implacable ne peut plus lui être voilée par le Destin : elle expire désespérée en proclamant Rome immortelle, cependant qu’aux sons des fanfares de la Marche Troyenne, auxquels se mêle, comme une malédiction, l’âpre dissonance des voix carthaginoises, le Capitole apparaît au loin dans une splendeur triomphale. Cette conclusion suffirait à nous convaincre, n’eussions-nous pas d’autres raisons, que c’est bien une épopée, non une simple tragédie, que Berlioz a rêvé de faire : le sujet des Troyens, ce n’était pas seulement, à ses yeux, une histoire d’amour ; c’est le drame de deux peuples. N’en faudrait-il pas rapprocher cette autre conception épique qui, de même, fait apparaître au dénouement d’une œuvre plus grande encore le tableau du Walhalla s’écroulant aussi dans les flammes d’un bûcher funèbre ? Et ici, comme en plusieurs cas semblables, en regard de l’extérieure analogie de la réalisation, il conviendrait de montrer la différence fondamentale de la conception des deux maîtres, l’un, optimiste malgré tout, couronnant son œuvre par une apparition lumineuse et triomphale, l’autre l’achevant dans un tableau de destruction, y ajoutant, il est vrai, la vision d’un au delà régénérateur, jusqu’où n’avait pu se hausser la clairvoyance toute terrestre de Berlioz.
Mais ce n’est pas du premier coup que cette conclusion des Troyens fut imaginée. Avant d’y aboutir, Berlioz avait formé plusieurs autres projets, dont certains, il faut l’avouer, sont un peu faits pour nous déconcerter. N’eut-il pas un jour l’idée de faire prophétiser par Didon la conquête de l’Algérie par les Français ?… Rendant compte à la princesse Wittgenstein de l’effet produit par une lecture du poème qu’il avait faite chez Ed. Bertin « devant une assez redoutable assemblée de gens de lettres Virgiliens-Shakespeariens », il lui avoue qu’ « on a trouvé absurde de faire prédire par Didon la domination française en Afrique… Il faut, ajoute-t-il, se rendre à la raison… du plus fort (1) ». C’était même prêter à la reine de Carthage une faculté de divination incomplète : Berlioz n’aurait-il pas dû, dès 1857, lui faire annoncer Jules Ferry et le protectorat de la Tunisie ?…
Une autre lettre du même à la même confirme que l’idée de ce dénouement tourmentait Berlioz depuis plusieurs semaines : « Je retouche toujours et toujours le poème. Il m’a semblé dernièrement que l’allusion de Didon mourante à la domination française en Afrique était une pure puérilité chauvinique, et qu’il était beaucoup plus digne et grand de rester dans l’idée indiquée par Virgile, etc. » (2). En dernière analyse, nous voyons donc qu’il s’était fort bien aperçu lui-même de la faiblesse de cette conception.
Même une année plus tard, il ne s’était pas encore résolu à prendre un parti. Le 20 janvier 1858, il écrivait à Hans de Bülow :
« J’ai ajouté une fin au drame, fin bien plus grandiose et plus concluante que celle dont je m’étais contenté jusqu’à présent. Le spectateur verra ainsi la tâche d’Enée accomplie, et Clio s’écrie à la dernière scène, pendant que le Capitole romain rayonne à l’horizon :
Fuit Troja !… Stat Roma…
« Il y a là, en outre, une grande pompe musicale, dont il serait trop long de vous expliquer le sujet (3) ».
C’est précisément cette fin « plus grandiose et concluante » (à laquelle il renonça cependant aussi) dont le cahier retrouvé nous apporte la réalisation.
Le document vaut que nous en tentions l’analyse.
Comme titre, ce seul mot : Epilogue. Rien d’écrit n’indique qu’il s’agit des Troyens. La partition comprend l’orchestre complet, avec quatre harpes ; elle ne donne place à aucune partie chorale ; cependant trois portées sont réservées aux voix, la première désignant la Muse de l’histoire, CLIO, ayant à son côté une Renommée, la seconde Un soprano au fond du théâtre, la troisième Un ténor encore plus loin.
Ce sont d’abord, dans une nuance mystérieusement douce, cinq mesure d’un trémolo des violons, que ponctuent des accords des harpes additionnés de la légère vibration des cymbales pianissimo ; un point d’orgue prolonge le dernier accord. Ce murmure de foule lointaine va grandissant par la répétition successive des mêmes cinq mesures s’élevant par cinq fois d’un degré ; puis soudain les trompettes attaquent la fanfare bien connue de la Marche Troyenne, dont les notes tenues sont enrichies par la sonorité des harpes bondissant en arpèges ; enfin l’orchestre entier fait entendre la première reprise du thème, « sur le mode triomphal », comme il est dit en un antre endroit de la partition.
A la cadence, les instruments d’harmonie se taisent, et les cordes restent seules, maintenant le mouvement de la marche par un ample dessin à l’unisson et à l’octave, tandis que Clio (prédisant aussi, semble-t-il, l’avenir de la langue latine), proclame d’une voix large :
Scipioni Africano Gloria (4).
Les trompettes et toute l’harmonie répondent, et les violons, soutenus par les arpèges des harpes, auxquels se mêle le nasillement des hautbois marquant la mesure en deux notes monotones, déroulent ce chant, dont le contour, au rythme de saltation, offre une si pénétrante suggestion d’antiquité, et que, dans la marche chantée, les voix des femmes disent sur ces paroles : « Que la trompette phrygienne — unie à la lyre troyenne — te porte nos pieux concerts. » Puis la reprise principale revient. Au même endroit que précédemment, sur le même dessin des violons que, cette fois, vient préciser le doublage des harpes, Clio déclame de nouveau :
Imperatori Augusto et Divo Virgilio Gloria ! Gloria ! (5).
Les violons, avec les flûtes, — toujours accompagnés des hautbois et des harpes, — jouent maintenant le second motif sous sa forme mineure : « Souriante guirlande ». La première reprise est redite une dernière fois à plein orchestre ; enfin, sur un nouveau dessin des flûtes, Clio achève :
Fuit Troja ! Stat Roma (6).
Une voix lointaine lui répond, répétant ses dernières paroles comme un écho, — puis une autre encore plus éloignée, — comme si la rumeur de la grandeur de Rome se répandait déjà à travers l’univers tout entier. Enfin une brève conclusion, à larges traits, reproduisant encore une fois, pendant les trois premières mesures, le dessin initial de la marche à l’unisson de tout l’orchestre, conduit rapidement à la cadence finale et à la conclusion définitive de l’épopée.
*
* *
Lorsqu’en 1890 on représenta à Paris Béatrice et Bénédict, l’embarras fut grand pour trouver le matériel complet de cet opéra-comique. Point de difficultés pour la musique ; mais, le poème n’ayant pas été publié en même temps que la partition, le dialogue parlé, œuvre de Berlioz, avait disparu sans qu’il en restât aucune trace chez l’éditeur. Il fallut donc, pour la représentation, en faire écrire un autre, dût-il ressembler fort peu à l’original : ce fut, détail généralement ignoré, Charles Bannelier, le distingué rédacteur de la Revue et Gazette musicale (aujourd’hui défunte, comme lui-même) à qui fut dévolue la tâche de fournir à Berlioz l’appoint de cette collaboration posthume.
Et pourtant, il n’était pas perdu, ce poème. Une copie, sur laquelle se trouvent des traces de l’écriture de Berlioz, était, à sa mort, échue à sa nièce, Mme de Colonjon, seconde fille de sa sœur Adèle. Sans entrer dans des détails inutiles, qu’il nous suffise de dire que, par suite de circonstances fortuites, ce manuscrit resta égaré pendant trente ans et plus — jusqu’au jour récent où M. Henri Chapot le retrouva. L’éditeur de la partition s’est empressé de le faire paraître en brochure, — de telle sorte qu’il ne manque plus maintenant qu’un théâtre pour que l’œuvre d’Hector Berlioz puisse être, pour la première fois en France, donnée complète et sous sa forme entièrement originale.
Berlioz constate dans ses Mémoires qu’à la première représentation, à Bade, les critiques trouvèrent que le dialogue parlé manquait d’esprit. « Ce dialogue, ajoute-t-il, est presque entièrement copié dans Shakespeare. » C’est peut-être bien pour cela que les critiques ont exprimé cette opinion, car l’esprit anglo-saxon des comédies de Shakespeare n’a que peu de rapports avec celui de l’opéra-comique, genre essentiellement français. Le rôle de Béatrice est en effet imprégné d’une saveur assez particulière, un peu rude.
Mais il y a dans la pièce quelques scènes où l’esprit français a repris ses droits, car c’est l’esprit de Berlioz ! L’auteur de l’Amen de la Damnation de Faust ne pouvait manquer d’introduire, dans sa pièce quelques unes de ces facéties musicales auxquelles il se délectait : il a imaginé le personnage de Somarone, maître de chapelle non imaginaire, comme Pierre Ducré, mais si vivant que, pour en tracer la silhouette, il n’a pas craint d’emprunter quelques traits comiques à un musicien réel qui, par un comble d’ironie, fut un de ceux qu’il admira entre tous : Spontini !
Berlioz s’est chargé lui-même de nous donner tous renseignements à cet égard. Dans une lettre à la Princesse Wittgenstein [CG no. 2361] où il rapporte des mots historiques de musiciens, il cite ce « mot superbe » de Spontini qui, dirigeant la répétition générale d’Olympie à Berlin, le bras déjà levé pour l’attaque de l’ouverture, apostropha l’orchestre en ces termes : « Messieurs, Olympie est un chef-d’œuvre. Commençons ! »
Or, dans le livret de Béatrice et Bénédict, nous lisons cette réplique de Somarone :
« Je ne ferai pas de longs discours sur ma musique (Il lève son bâton de conducteur en l’air comme pour marquer la première mesure, et, parcourant d’un regard superbe les rangs des exécutants) : Mesdames et Messieurs, le morceau que vous allez avoir l’honneur d’exécuter est un chef-d’œuvre ! Commençons. ».
Ailleurs, c’est Wagner qui va nous documenter. Il a conté, dans ses souvenirs si curieux, voire amusants, sur Spontini, que lorsque celui-ci vint à Dresde pour diriger la Vestale, sa première préoccupation fut de demander un bâton d’ébène d’une longueur et d’une épaisseur extraordinairement apparentes, et portant, adaptées à chaque bout, deux pommes d’ivoire assez grosses : il s’en servait en l’empoignant par le milieu, comme un bâton de maréchal, « non pour battre la mesure, mais pour commander ».
Revenons maintenant à Béatrice : nous y voyons Somarone, à l’arrivée d’un grand personnage, remettre à un valet son bâton ordinaire, et lui donner cet ordre : « Apportez-moi le bâton numéro 37, le bâton ducal !… » Et quand le domestique revient, tendant respectueusement au maître le nouveau bâton sur un plat d’argent, Somarone s’en saisit, et dit : « Ivoire et ébène, Monseigneur ; noir et blanc ! Cela imprime à l’exécution un caractère à la fois riant et sombre ».
Complimentant un musicien, il lui dit : « J’écrirai pour toi un joli saltarello dans ma nouvelle messe ». Ici ce n’est plus du Spontini : c’est d’un italianisme plus récent. Par contre, il nous semble entendre quelque vieux Kapellmeister en perruque, quand Somarone, ayant, en manière de cantate nuptiale, fait exécuter une fugue, commente ainsi ses intentions profondes :
« Le mot fugue veut dire fuite, et j’ai fait une fugue à deux sujets, à deux thèmes, pour faire songer les deux époux à la fuite du temps. »
Un interlocuteur réplique : « Musique symbolique ! » Déjà ?…
Enfin, ayant reçu l’assurance qu’il ne serait rien ménagé pour assure une exécution excellente de son œuvre, le maître de chapelle opère sa sortie en disant fièrement : « Cela sera superbe ! » Cette dernière parole, c’est un mot de Gluck. Et qui sait si, en cherchant bien dans le dialogue, nous ne surprendrions pas Berlioz en posture de se railler soi-même ? En vérité, quand ces hommes de génie se mettent à faire de l’opéra-comique, on ne les reconnaît pas : il n’y a plus de respect qui les retienne !…
___________________________________
(1) Briefe von Hector Berlioz an die Fürstin Caroline Sayn-Wittgenslein,
p. 52 (du 18 mars 1857 [CG no 2216]). Quelle aubaine pour les bons
confrères dont le généreux idéal est de tourner incessamment en ridicule
Berlioz et son œuvre si c’eût été en leurs mains que ces documents fussent
tombés ! Avec quelle joie ils auraient dit son fait au détestable
biographe dont l’admiration sans réserve n’admet pas d’ombre au tableau, qui
proclame la parole du maître un Évangile hors duquel tout n’est qu’erreur impie,
et qui, en définitive, passe sa vie à refuser de voir la lumière ! Il
est vrai que ces documents-ci sont authentiques…![]()
(2) Lettre du 25 ou 26 décembre 1856, même recueil, p. 42 [CG no
2195].![]()
(3) Correspondance inédite de Berlioz, page 256 [CG no
2273].![]()
(4) A Scipion l’Africain, gloire !![]()
(5) A l’empereur Auguste et au Divin Virgile, gloire ! gloire !![]()
(6) Troie n’est plus ! Rome est debout![]()
![]()
![]() Le Ménestrel, 10 novembre
1906, p. 351-352
Le Ménestrel, 10 novembre
1906, p. 351-352
PIÈCES POUR HARMONIUM — ALBUM DE NOTES — FEUILLES ÉPARSES
Parmi les autographes de Berlioz en feuilles détachées que possède la Bibliothèque du Conservatoire, il se trouve trois morceaux pour harmonium, entièrement écrits de sa main et revêtus de sa signature, dont voici les titres et descriptions sommaires :
1° Sérénade agreste à la madone, sur le thème des Pifferari Romains. 3 pages de format oblong. Le morceau commence par un Andantino à six-huit, registré pour la musette et le basson, et suivi d’un Allegro assai sur un autre thème, avec des sonorités plus claires ; l’Andantino est repris ensuite, puis l’Allegro, dans des tonalités et avec un développement différents. — La quatrième page du papier est remplie de notes dans lesquelles nous avons reconnu un brouillon du Te Deum.
2° Hymne pour l’Élévation, Larghetto fugato. 2 pages et demie, 99 mesures, plus 6 mesures biffées en trois fois ; le reste du papier est laissé en blanc.
3° Toccata, Allo non troppo. 68 mesures notées sur deux pages ; plusieurs ratures ; 5 mesures effacées.
Ces manuscrits portent des traces du travail préparatoire de la gravure ; cependant nous n’avons pas la connaissance qu’aucun des morceaux ait été publié du vivant de Berlioz. Le nom et l’adresse du facteur Alexandre sont inscrits au crayon rouge à la fin de la troisième page de l’Hymne : c’en est assez pour nous assurer que ces pièces pour harmonium ont été écrites par Berlioz par complaisance pour le facteur de ces instruments, qui fut pour lui un ami fidèle et dévoué.
Il serait donc injuste d’exiger de ces menues compositions des qualités leur méritant d’être mises en parallèle avec les chefs-d’œuvre de Berlioz. Encore n’en sont-elles pas complètement dénuées. Si la Toccata est vraiment une composition presque enfantine, l’Hymme pour l’Élévation, sans avoir beaucoup de relief, est d’un style soutenu qui ne manque pas d’une certaine grandeur. Quant à la Sérénade agreste, elle nous offre un intérêt tout particulier si, comme l’indique son titre, elle est faite sur le thème des Pifferari romains : elle constitue un document pour la mélodie populaire italienne remarquable à un triple point de vue : la forme musicale, la date déjà reculée de la notation, et le fait d’avoir été recueillie par Berlioz. Nous reproduirions certainement ici cet air rustique si nous ne préférions le réserver pour un autre chapitre, que nous comptons consacrer au goût de Berlioz pour les mélodies populaires, et aux témoignages qu’il en a donnés.
Nous allons terminer cette étude des autographes musicaux de Berlioz en parcourant un album de poche qu’il dut porter sur lui pendant plusieurs années, et sur lequel il a jeté, durant ce laps, les notes et les idées les plus diverses. Conservé dans sa famille, ce document intime m’a été communiqué par elle, avec cette obligeance dont j’ai reçu tant de témoignages, que je ne la saurais plus reconnaître par de nouveaux remerciements, en ayant dès longtemps épuisé les formules.
A en juger par le contenu, cet album, qui comprend actuellement 45 feuillets de papier à musique de petit format oblong (plusieurs autres ont été déchirés, l’on en voit les traces), a été commencé en Italie, vraisemblablement à la fin du séjour de Berlioz, c’est-à-dire en 1832 ; il a été utilisé ensuite à Paris jusqu’à la fin de 1836.
Commencé par les deux bouts à la fois, quelques feuillets inutilisés restant en blanc au milieu, il contient un peu de tout : d’abord des notes de ménage, que l’artiste, les ayant tracées d’abord sur le revers du cartonnage et sur les feuilles de garde, a continuées par-ci par-là sur le papier réglé, mélangeant de la façon la plus inattendue les notations musicales et les inspirations de premier jet avec des indications de la nature la plus prosaïque. C’est ainsi qu’ouvrant le cahier nous lisons d’abord : 2. s. crème, soir ; 4 s. id. matin ; 5 s. oeufs ; 12 côtelette ; 4 s. haricots ; 4. s. eau ; 2 s. salade = 33 s. Et en tournant la page nous trouvons des vers de Victor Hugo, transcrits par la main de Berlioz, et accompagnés de quelques notes jetées en hâte sur les portées.
Quelquefois Berlioz rédige ses comptes en italien, par exemple :
Di Firense a Bologna ho dato 2 paoli al facchino — Ho dato 3 scudi al vetturino. — A la dogana 3 scudi di deposito — Alla scariga l’asino 5 baïochi, etc.
Puis ce sont des déboursés pour l’élégance : 2 francs 50 de sous-pieds en chaîne de laiton ; 1 col à Turin, 3 francs ; bottes, 6 francs ; 3 francs déjeuner et barbe ; 10 sous barbe et cheveux. A ces derniers articles, qui pourrait reconnaître les habitudes de l’artiste échevelé ?
Les dépenses pour les spectacles sont peu de chose : à Florence, 50 baïochi, Spectacle ; à Milan, 2 fr. 50, Théâtre della Canobiana ; Théâtre d’Angennes à Turin, 1,50.
Mais il y a le chapitre des chapeaux : chapitre vraiment inédit, auquel ni Aristote, ni Molière n’a jamais songé. Plutôt Labiche. Il s’agit de chapeaux de paille d’Italie, que les sœurs de Berlioz avaient demandé au pensionnaire de l’Académie de Rome de leur rapporter pour faire les fashionables en Dauphiné. Terrible corvée qu’elles imposèrent à leur obligeant frère ! A chaque passage de frontière — et l’on sait s’il y en avait en Italie en 1832 — il lui faut, pour ces chapeaux achetés à Florence, payer des frais de douane : à Bologne, à Modène, à Parme, à Lodi, à Milan, à San-Martino, à Turin, en d’autres lieux encore qui ne sont pas désignés, jusques et y compris Chapareillan-sur-l’Isère, douane française en arrivant de Savoie ; et nous voyons inscrit à chaque page : Pour les chapeaux, 30 baïochi ; 2 fr. 50 pour les chapeaux ; pour les chapeaux, 4 francs, etc., etc. Total exorbitant ! Il fallait être millionnaire, en ce temps-là, pour porter en France des chapeaux de paille d’Italie ! (1)
Parfois, dans ce pêle-mêle, on trouve quelques impressions de voyage notées sous le coup de la vision immédiate : Narni, délicieux paysage poussinien. — Papigario : Cascata. Cosa stupenda, più bella mille volte che le cadute di Tivoli e d’Isola di Sora. — Perugia, gran superba città sopra d’una montagna. Cattiva gente. — Laggo di Passigniano ou de Trasimène : le matin les vagues roulaient avec un bruit prétentieux. Petit marin d’eau douce !!!
Puis des réflexions humoristiques comme :
« Dice ? Capite ? Sapete ? E vero ? Éléments de la conversation italienne. »
Et au dessous, sur la même page, l’adresse suivante :
« Duprez, via dei Pianellai conto alle Rondini, no 6990. »
En effet, Duprez, que Berlioz avait connu, élève comme lui, à l’école de Choron, qui ensuite chanta pour lui à son premier concert, qui enfin devait lui prêter un si fâcheux concours dans Benvenuto Cellini, était à ce moment à Florence, où il préludait à ses grands succès dans la carrière de fort ténor.
Plus avant dans le corps de l’album, on retrouve des notes analogues concernant le séjour postérieur de Berlioz à Paris. Nous y reviendrons en leur temps. Mais examinons d’abord les notations musicales, en étudiant un des côtés de l’album dont les premiers feuillets furent manifestement écrits pendant le séjour de Berlioz en Italie. Nous y trouverons encore un peu de Berlioz inédit.
Voici d’abord des vers dont rien, sur l’album, ne désigne la provenance ni l’auteur, mais qu’il nous est facile de reconnaître : c’est la jolie pièce intime des Feuilles d’automne : « Dans l’alcôve sombre », que les actrices du Théâtre-Français avaient à leur répertoire il y a quelque vingt-cinq ans, alors que le goût du monologue n’avait pas encore supplanté, dans la faveur du public, celui des poèmes de Victor Hugo ; Berlioz a écrit de sa main, à l’encre, le long des portées, les neuf strophes, en les entremêlant de quelques notations musicales. Bien qu’il n’y ait ici rien d’italien, les pages qui entourent ce morceau nous attestent que c’est bien à Rome que Berlioz a pris ces notes. C’est pendant son séjour à la villa Médicis que parut le livre de Victor Hugo, daté de novembre 1831 ; c’est à la même époque aussi qu’il écrivit pour le poète, au sujet de Notre-Dame de Paris, le brouillon d’une lettre enthousiaste [CG no 254], que l’on a qualifiée d’extravagante, à cause que, dans le siècle où nous sommes, admiration et extravagance sont choses à peu près synonymes. C’est enfin dans le même moment qu’il mit en musique une autre de ses poésies, la Captive. Mais s’il a fait de ce dernier morceau une de ses meilleures compositions vocales et un de ses principaux succès mondains, il semble avoir renoncé à pousser plus loin l’ébauche musicale qu’il avait tracée de « Dans l’alcôve sombre », ne la trouvant pas sans doute assez bien réussie. N’y cherchons donc pas un chef-d’œuvre inconnu. Pourtant, à titre de curiosité, il nous sera bien permis de la reproduire ; la gloire de Berlioz, essayant d’unir son inspiration à celle de Victor Hugo, n’en saurait assurément souffrir.
___________________________________
(1) Sur l’incident des chapeaux, voir une lettre de Berlioz à sa mère
datée de Milan, 21 mai 1832 [CG no 271].![]()
![]()
![]() Le Ménestrel,
17 novembre
1906, p. 361-362
Le Ménestrel,
17 novembre
1906, p. 361-362
[PIÈCES POUR HARMONIUM — ALBUM DE NOTES — FEUILLES ÉPARSES]
(Suite)
La première strophe est notée au crayon, avec quelques notes précisées à l’encre ; il y a quelques indécisions dans l’écriture, notamment aux mesures 4, 7 et 8.

Rien n’est indiqué pour la second strophe : mais la troisième et la quatrième ont une musique particulière, et toute différente, que voici :
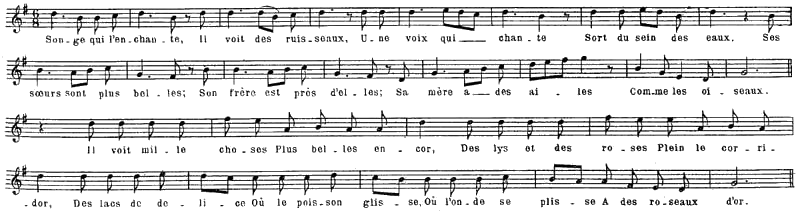
A la suite on lit ces mots : « 5e mineur comme le 1er » ; puis la transcription des vers se poursuit jusqu’à la 9e et dernière strophe sans aucune autre indication musicale.
A la page d’après commencent les notes de voyage, en italien et en français, dont nous avons donné quelques échantillons, et qui se rapportent sans aucun doute au retour de Berlioz en France, en mai 1832. Au milieu est jetée cette notation d’un couplet italien, quelque chanson populaire, entendue entre Florence et Bologne, dont la tournure aura piqué la curiosité du musicien, lequel se trouve ainsi précurseur de nous tous, modernes folkloristes musicaux : c’est un patronage dont nous devons être très fiers !

Parmi d’autres inscriptions d’intérêt divers et quelques notes musicales biffées à grands coups de crayon et dans lesquelles nous n’avons rien reconnu que Berlioz ait utilisé dans ses œuvres, nous trouvons, écrits sur deux pages, ce titre et cette déclaration qui méritent de nous arrêter :
Le Retour de l’armée d’Italie.
Symphonie militaire en 2 parties
1° Adieu du haut des Alpes aux braves tombés dans les champs d’Italie.
2° Entrée triomphale des vainqueurs à Paris.
L’idée de (Le retour de l’armée d’Italie)
Symphonie en 2 parties
|
m’est venue à Turin le 25 mai 1832 en revoyant les Alpes, le cœur plein des souvenirs Napoléoniens que le pays que je venais de parcourir avait réveillés. |
Puis l’album redevient carnet de dépense (Suze, 3 f. coucher et souper — Lans le bourg, 0 (heureux pays, hospitalité savoyarde !) — Modane, 3.50, Chapareillan, 24 sous) ; et maintenant le voilà en France, dans l’Isère, à la Côte-Saint-André, où il va séjourner tout l’été. C’est là, sans aucun doute, que sont prises les notes suivantes, par lesquelles Berlioz a tracé la première ébauche de cette nouvelle Eroïca non achevée.
En effet, 8 pages de l’album, en cet endroit, sont remplies de notations de motifs au rythme tour à tour guerrier et triomphal, dont nous allons donner quelques exemples.
![]()
![]() Le Ménestrel, 24 November 1906, p. 367-368
Le Ménestrel, 24 November 1906, p. 367-368
[PIÈCES POUR HARMONIUM — ALBUM DE NOTES — FEUILLES ÉPARSES]
(Suite)
D’abord quelques mesures, rapidement tracées au crayon, et précédées de cette abréviation : « Simph », — simple embryon auquel les pages suivantes essaient de donner une forme plus précise.

Voici maintenant un thème plus développé, donnant l’impression d’une marche militaire de l’ancien temps, avec des fifres ; il y en a trente-six mesures, écrites à l’encre : nous ne reproduisons que les huit premières, exposant le motif principal.

Les quatre pages suivantes nous font assister aux indécisions du compositeur pour trouver la forme d’un autre thème, évidemment préparé pour le final triomphal de la symphonie : après maintes retouches, il paraît enfin satisfait, ainsi qu’en témoigne le mot « bon » tracé au crayon dans la marge ; encore, sous cette dernière forme, le dessin a-t-il subi nombre de ratures au crayon et à l’encre. Le voici dans tout son développement.

Ce dernier thème n’est pas resté complètement inutilisé : Berlioz en a replacé la forme rythmique générale et les premières mesures textuelles dans le final d’Harold en Italie : « Orgie de brigands », où il ne fait que passer, ajoutant au tableau une touche brillante. Soit dit en passant, n’est-il pas piquant de constater que le compositeur a repris un chant trouvé pour glorifier les héros de l’épopée française pour en faire un élément constitutif d’une composition d’esprit si différent ? Serait-ce par hasard qu’il aurait aperçu quelque analogie entré le sentiment des brigands des Abruzzes, glorieux de leurs dépouilles, et celui des héros de l’armée napoléonienne rentrant dans leur patrie après la victoire ? Insolente hypothèse !…
En tout cas, la place de ces notations ne permet pas de supposer qu’elles soient étrangères à la symphonie militaire, car l’idée exposée dans les pages qui les précèdent se poursuit et continue à se développer à leur suite. Voici en effet que, la page terminée, nous lisons des paroles qui révèlent une intention analogue : c’est le projet d’une ode, moitié vers, moitié prose, sur la mort de Napoléon, que Berlioz écrivit certainement dans l’intention de la mettre en musique :
Inclinez-vous, brillants faisceaux ;
Drapeaux, voilez vos couleurs éclatantes ;
Soldats, baissez vos armes triomphantes ;
O France, mère des héros,
pleure,
pleure,
Napoléon n’est plus !
Terre, tu ne trembleras plus sous les pas du géant.
La mort vient d’arrêter sa course.
Monts orgueilleux, vous ne frémirez plus à ses accents
terribles.
La mort vient d’éteindre sa voix.
Inclinez-vous, etc.
O Rois, ne craignez plus ses armes invincibles, la mort a
brisé son épée.
&nb
Soldats, ne cherchez plus au ciel son astre étincelant,
L’étoile a disparu sous l’aile de la mort.
Aucun de ces projets n’a été réalisé, au moins sous la forme proposée dans cet album de notes : l’ode sur la mort de Napoléon est devenue le Cinq mai, où les paroles cadencées de Berlioz ont été remplacées par les couplets de Béranger ; quant à la Symphonie militaire, sans doute l’auteur y pensait encore lorsqu’il songeait à composer une Fête musicale funèbre à la mémoire des hommes illustres de la France dont il parle dans ses lettres de 1835 [CG no. 440], disant dans l’une d’elles : « J’ai déjà fait deux morceaux, il y en aura sept » ; mais on sait que cette œuvre non plus n’a pas été terminée. Celle de ses compositions qui se rapproche le plus de cet idéal musical entrevu à Turin, devant le spectacle des Alpes — le cadre même de la « Profession de foi du vicaire savoyard », de Jean-Jacques Rousseau— est la Symphonie funèbre et triomphale, destinée à commémorer les héros de juillet 1830 ; mais les notations reproduites ci-dessus montrent que Berlioz n’a rien conservé de ces premiers matériaux dans l’édifice qu’il a définitivement construit.
La suite de l’album nous montre que Berlioz est rentré, suivant son expression, dans le vortex de la vie parisienne ; une première page remplie d’adresses l’atteste. Puis revient une page d’un brouillon musical, de simples dessins d’accompagnement, semble-t-il, où nous n’avons rien trouvé de connu. Enfin, douze pages sont remplies d’ébauches pour Benvenuto Cellini : deux seules sont au crayon, les dix autres à l’encre. C’est d’abord l’exposition fuguée de la première scène : le thème et les trois premières entrées sont d’ores et déjà à leur place, — en ré au lieu du ton d’ut définitivement adopté ; puis deux pages du premier air de Teresa, la première appartenant aux parties coupées ; tout le reste (huit pages) consacré à la scène de la taverne et au chœur des ciseleurs. Nous avons vu, en étudiant Benvenuto Cellini, que ce chœur devait, dans l’origine, quand l’ouvrage devait être un opéra-comique, être placé au début de l’action, et qu’en outre il fut exécuté, longtemps avant la représentation, dès 1834, dans les concerts de Berlioz. C’est sans doute à cette première forme du morceau que se rattachent ces notes, dans lesquelles nous trouvons plusieurs parties qui ne figurent pas dans la partition. Nous lisons aussi sur une page des vers transcrits sans musique — puis avec leur musique dans les pages suivantes, — ce qui peut faire supposer qu’ils sont de la façon de Berlioz, d’autant qu’ils expriment bien ses idées familières :
CHŒUR : A boire !
BERNARDINO : Chantons.
CELLINI : Soit, mais pour Dieu ! pas de chanson à boire ;
Pas d’ignoble refrain — sentant la cuisine et le vin.
Chantons : mais que nos chants soient un hymne à la gloire
Des ciseleurs et de notre art divin.
Cette partie des notes s’arrête là ; les pages laissées en blanc viennent à la suite. Mais nous avons dit que l’album a été commencé par les deux bouts : retournons-le, et voyons l’autre partie. Celle-ci est moins importante, et ne nous révélera, en fait de musique, que des ébauches d’œuvres connues.
![]()
![]() Le
Ménestrel, 1er décembre 1906, p. 375-376
Le
Ménestrel, 1er décembre 1906, p. 375-376
[PIÈCES POUR HARMONIUM — ALBUM DE NOTES — FEUILLES ÉPARSES]
(Suite)
Ce sont d’abord, comme de l’autre côté, les notes du voyage en Italie ; puis une page d’un griffonnage musical où je n’ai rien reconnu, et la place d’un feuillet déchiré, puis ensuite, trois pages consacrées à la Captive : il en à été parlé dans la précédente étude consacrée à cette mélodie ; puis encore huit mesures pour la Marche des pèlerins d’Harold, également signalées dans le chapitre relatif à cette symphonie, et aussi, au crayon, quelques mesures d’un allegro en sol mineur, premier jet du thème initial du final : « Orgie de brigands », dont nous avons trouvé un second thème dans une autre partie de l’album.
Après cela, trois pages sont consacrées à des essais pour la mélodie « Je crois en vous », dont, nous le savons, Berlioz a fait un thème important de l’ouverture et de la scène du Carnaval de Benvenuto Cellini. Il est curieux de surprendre ici les hésitations du compositeur, qui a trouvé du premier coup l’accent définitif du mot principal : « je prie », mais qui a longuement tâtonné avant de s’arrêter à une forme de mélodie : trois fois au moins nous lisons des notes sur les mêmes paroles, et toujours ces notes constituent un dessin absolument différent, jusqu’à ce qu’enfin un troisième effort aboutisse à la formation de la ligne pure et vraiment mélodique adoptée pour la romance. Et nous avons vu d’autre part que ce n’est pas sans y introduire de nouvelles modifications que Berlioz l’a transportée dans son opéra.
Après un feuillet contenant huit mesures d’un motif en mouvement de vieille marche française, dont nous ne saurions dire s’il est ou non de Berlioz (cela n’est pas impossible, car, depuis la phrase empanachée composée dans son enfance et remise dans l’ouverture des Francs-Juges, jusqu’à quelques coins plus ou moins ignorés des Troyens, il fut assez coutumier du fait), nous retombons encore dans la première ébauche de Benvenuto Cellini : c’est maintenant le fragment du discours de Balducci à sa fille, au début de l’opéra, resté inachevé, et dont nous avons retrouvé quelques bribes dans le matériel de l’opéra ; nous en avons cité en leur lieu quelques vers d’un amusant comique.
Et c’est tout, comme musique notée, dans cet album ; les quelques pages qui suivent ne sont plus remplies que d’indications d’un ordre tout positif : Aller chez Liszt ; — chez Schlesinger prendre de l’argent ; — chez M. Mantoue pour le droit des pauvres ; — aller chez Mlle Bertin ; — envoyer des billets à Ch. Maurice, etc. Trois pages sont consacrées à la comptabilité du concert du 4 décembre 1836 ; neuf autres sont couvertes de notes au crayon visiblement prises à l’audition d’une messe en musique, appréciée avec bienveillance, mais dont l’auteur n’est pas désigné. Puis nous retombons dans les feuillets de papier blanc : il n’y a plus rien dans le reste du cahier.
Loin de penser que nous nous sommes arrêtés trop longtemps sur ce document tout intime, nous ne pouvons qu’exprimer le regret de n’en pas connaître d’autres, pour les soumettre à un semblable examen. Ne serait-il pas du plus haut intérêt, maintenant que nous avons assisté au spectacle de cette formation embryonnaire de l’œuvre de Berlioz pendant une période, active, mais courte, de sa carrière de producteur, de le voir encore au travail alors qu’il composa le Requiem, pour la notation duquel, dans sa hâte à réaliser l’œuvre grandiose, il s’était, nous dit-il, façonné une sorte de sténographie musicale, — et Roméo et Juliette, écrit à tête reposée dans le calme passager d’une période heureuse,— et la Damnation de Faust, griffonnée à tous les coins de l’Europe, — et les Troyens, mûrement pensés, et qui l’occupèrent plusieurs années de suite, chose rare dans sa production fiévreuse ? Contentons-nous cependant de ce qui nous a été conservé, et qui est d’un grand intérêt. N’ayons pas, surtout, la crainte de le diminuer parce que nous avons été témoins de ses hésitations, que nous l’avons vu aux prises avec les difficultés avant de parvenir à former l’œuvre définitive. Ces difficultés sont inhérentes à la création : tous les génies les ont connues. Faut-il rappeler qu’un travail analogue a été fait avec les carnets de Beethoven, et a abouti à des constatations toutes semblables ? Je pense qu’un tel rapprochement suffirait, s’il le fallait, pour justifier Berlioz.
Nous aurons complètement épuisé nos documents quand nous aurons reproduit une dernière notation musicale, qui nous permettra de finir sur une impression de bonne et franche cordialité. C’est une improvisation à un dîner, entre amis, et, qui plus est, à Marseille ! Méry, enfant de la cité phocéenne, et Berlioz, né aux confins du midi, étaient réunis en des agapes sympathiques, auxquelles prirent certainement part Auguste Morel et Lecourt, ces deux excellents et dévoués amis du maître. Un poète et un musicien assis à la même table : quelle aubaine pour les convives ! Il fallut qu’ils donnassent des preuves immédiates de leurs « petits talents », comme disait le grand Bach : Méry écrivit des vers sur un coin de la table, Berlioz en fit la musique, et, bien entendu la chanta au dessert. Semblable à son Benvenuto, il ne voulut pas de chanson à boire : l’impromptu fut une romance, une sorte de paysage poétique et musical, élégiaque et sentimental, ainsi qu’il convenait. Berlioz a gardé dans ses papiers, sans doute en souvenir de cette réunion, le double manuscrit de Méry, couvert de ratures, et le sien, écrit tout d’un trait ; donnons ce dernier échantillon de Berlioz inédit : s’il n’ajoute rien à sa gloire, il n’en peut rien retrancher, et nous montrera le noble et infortuné artiste sous l’aspect affectueux et cordial qui est celui sous lequel nous aimons à le voir et à le présenter.

Nous pouvons dire maintenant que nous avons fait le tour complet de Berlioz, non au point de vue critique, qui fera l’objet d’un autre ouvrage, mais au point de vue documentaire. A cet égard, c’est-à-dire si l’on considère les origines et les formes diverses de son œuvre, connue et inédite, nous ne pensons pas que rien d’important nous ait échappé.
Il nous eût été facile de donner à cet ensemble d’observations la forme rigoureuse d’un catalogue. Nous avons pensé faire œuvre plus vivante en étudiant la production du maître suivant son organisme normal, en nous conformant tour à tour à l’ordre méthodique et chronologique, en tenant compte de l’importance et du genre de chaque ouvrage, et en distinguant nettement les compositions bien et dûment reconnues par lui de celles qu’il a volontairement négligées. Mais en réalité, et quelle qu’en soit la forme, ce long chapitre constitue un catalogue complet (1), car l’œuvre de Berlioz y a passé tout entière, jusque dans ses moindres détails ; et, à moins de nouvelles découvertes, qui nous paraissent improbables, nous espérons qu’on pourra le tenir pour définitif.
Après ce long voyage de découverte à travers l’œuvre inconnue de Berlioz, il nous paraît utile de reprendre quelque temps haleine. Nous arrêtons donc momentanément la série de ces Berlioziana, nous réservant de la reprendre dans quelques mois, et de la mener à son entier achèvement à l’aide de nouveaux documents inédits, dont nous avons encore un grand nombre à produire.
___________________________________
(1) J’aurais pu relever au passage maintes fautes de détail (erreurs de
dates, lacunes, etc.), commises dans les précédents catalogues qui ont
été
dressés de l’œuvre de Berlioz, en en désignant les auteurs. Mais je suis de
ceux qui jugent inutiles et stériles, sinon mesquines et fâcheuses, ces
petites attaques qui n’ont ordinairement d’autre objet que d’être
désagréables à des confrères, ou de vanter soi-même des mérites qu’il vaut
mieux laisser reconnaître à la perspicacité des lecteurs.![]()
![]()
![]()
Site Hector Berlioz créé par Monir Tayeb et Michel Austin le 18 juillet 1997; page Julien Tiersot: Berlioziana créée le 1er mai 2012; cette page créée le 15 mai 2013.
© Monir Tayeb et Michel Austin. Tous droits de reproduction réservés.
![]() Retour à la page Julien
Tiersot: Berlioziana
Retour à la page Julien
Tiersot: Berlioziana
![]() Retour à la page Exécutions et articles contemporains
Retour à la page Exécutions et articles contemporains
![]() Retour à la Page d’accueil
Retour à la Page d’accueil
![]() Back to Julien Tiersot: Berlioziana
page
Back to Julien Tiersot: Berlioziana
page
![]() Back to Contemporary Performances and Articles page
Back to Contemporary Performances and Articles page
![]() Back to Home Page
Back to Home Page