1. AU MUSÉE BERLIOZ
Cette page présente les dix articles publiés par Julien Tiersot dans la série Berlioziana avec le sous-titre “Au Musée Berlioz”, série inaugurée avec l’article du 3 janvier 1904 ci-dessous. Voir la page principale Julien Tiersot: Berlioziana.
Note: pour les lettres de Berlioz citées par Tiersot on a ajouté entre crochets des renvois au numérotage de la Correspondance Générale, par exemple [CG no. 11].
![]()
![]() Le Ménestrel, 3 Janvier 1904,
p. 3-4
Le Ménestrel, 3 Janvier 1904,
p. 3-4
Nous nous proposons, dans les articles qui vont suivre, d’étudier de façon circonstanciée un certain nombre de particularités relatives à la vie et à l’œuvre de Berlioz, dont l’examen détaillé, intéressant à coup sûr et nécessaire pour bien connaître par tous les côtés la nature du grand musicien, n’eût point été à sa place dans l’étude d’ensemble que nous avons donnée d’autre part.
I
AU MUSÉE BERLIOZ
Le vrai « Musée Berlioz » à la Côte-Saint-André, ce n’est pas seulement la collection de souvenirs, bien restreinte encore, que des hommes dévoués ont réunie dans une des chambres de sa maison natale : c’est la ville entière de la Côte-Saint-André, et toute la campagne environnante.
Il n’y a plus grand monde aujourd’hui, dans le pays, qui ait vu Hector Berlioz, car voilà bientôt cinquante ans qu’il n’y est plus jamais revenu. Mais, depuis qu’il est devenu la grande gloire de la petite cité, chacun, faisant appel à la mémoire des anciens, cherche à évoquer les souvenirs divers qu’il y a laissés.
Je ne veux pas refaire une description qui fut, je m’en souviens, le sujet du premier article par lequel je me présentai aux lecteurs du Ménestrel, il y a déjà plus de dix-huit ans (1). Bien des choses pourtant se sont modifiées depuis cette époque. Je rappellerai simplement que sa maison familiale occupe le centre même de la ville, en façade sur la rue principale, et que, bien négligée au temps de ma première visite, elle est (encore qu’occupée aujourd’hui par un épicier en gros) devenue comme un sanctuaire offert à la vénération des habitants, lesquels, par une plaque commémorative apposée devant la chambre où Hector Berlioz est né, se sont proclamés « fiers de son génie ! »
Malgré les remaniements nombreux qu’elle a subis, cette maison, d’aspect peu attrayant au dehors, mais dont les appartements intérieurs sont vastes, commodément distribués et de belle apparence, a conservé d’assez nombreuses traces d’objets existant dès avant la venue au monde du grand musicien. C’est ainsi que, dans une chambre donnant sur la galerie intérieure du premier étage, on peut voir encore une peinture sur toile, aux tons fanés, appliquée sur le mur, représentant une scène de bergerie dans le goût de Boucher, comme on en trouve encore beaucoup dans les anciennes maisons bourgeoises de cette région. Dans le vaste salon à alcôve, éclairé par deux hautes fenêtres ayant vue sur la rue, — là même où, vers 1818, prenaient place devant les pupitres alignés les amateurs et artistes de la Côte-Saint-André réunis pour exécuter les œuvres de musique de chambre de leur homme de génie en herbe, — on voit, sculptés dans le panneau qui surmonte la cheminée, les flambeaux de l’Amour, les carquois et les flèches, et autres attributs mythologiques dont le goût dénote une époque remontant au moins aux grands-parents d’Hector Berlioz.
Dans la ville, c’est à qui peut montrer au visiteur les endroits où il a passé. En bas, devant les vieilles murailles de l’enceinte fortifiée qui protègent aujourd’hui de pacifiques jardins, s’étend l’Esplanade où s’élève sa statue : on l’y voyait souvent, autrefois, sous les grands arbres, faisant avec entrain la partie de boules avec les camarades, alors que, joyeux compagnon, il n’avait pas encore le cœur meurtri par tant de coups redoublés.
Le long de la Grande-Rue, en retournant vers Grenoble, on passe devant la façade du séminaire où il a été en pension quelque temps, banale construction d’architecture religieuse du XVIIe siècle, qui porte les marques d’un abandon déjà ancien.
La ville, autrefois, finissait là : elle s’est étendue, et un nouveau quartier s’est construit, le faubourg du Chuzeau. Mais le Chuzeau, c’était simplement, jadis, le nom d’un domaine de la famille Berlioz, situé en pleine campagne, sur une hauteur d’où l’on a une splendide vue d’ensemble sur la plaine et les Alpes dauphinoises. L’établissement agricole semble avoir gardé son aspect d’autrefois : on en vend des vues, sur des cartes postales, avec la mention obligée du maître, qui, dans sa jeunesse, devait trouver dans ce séjour toute la satisfaction désirable à ses goûts rustiques.
A l’autre extrémité de la ville, vers le couchant, est le couvent de la Visitation, où il fit sa première communion au chant des romances de Dalayrac arrangées en cantiques. Plus près de la maison, en descendant vers la plaine, c’est le pré où il allait cacher ses chagrins virgiliens, et où, levé en même temps que le soleil de mai, il voyait, pénétré d’une poétique émotion, passer la procession des Rogations, et entendait se perdre en un lointain vaporeux la mélopée mélancolique des Litanies.
Voici encore, en revenant dans la Grande-Rue, la pharmacie de son ami Charbonnel, son camarade du quartier latin quand ils partirent pour être étudiants à Paris. Nous sommes, sur ce premier voyage de Berlioz, renseignés de façon assez particulière. Il avait subi les épreuves du baccalauréat ès lettres, à l’âge de dix-sept ans et trois mois, le 22 mars 1821, devant la Faculté de Grenoble ; il partit pour Paris au moment de la rentrée des écoles, ainsi qu’en témoigne le passeport dont il fut porteur pour accomplir le trajet. La pièce paraîtra sans doute assez curieuse pour mériter d’être reproduite. On verra, par le signalement, que Berlioz était blond (point d’histoire qui avait été contesté), qu’il avait le front ordinaire, et, de signes particuliers, aucun (2).
POLICE GÉNÉRALE DE FRANCE
_________
PASSE-PORT POUR L’INTÉRIEUR
_________
Département de l’Isère.
_________
Sous-Préfecture de Vienne.
Commune de la Côte.
Registre 46 — no 51.
SIGNALEMENT
LE SIEUR Berlioz
(Louis-Hector).
Profession d’étudiant médecin.
Natif de la Côte-Saint-André,
département de l’Isère
demeurant au même lieu.
Allant à Paris, département de la Seine, âgé de 18 ans,
taille d’un mètre soixante trois centimètres
|
cheveux blonds
|
front ordinaire yeux gris bouche moyenne menton rond teint coloré Signes particuliers aucun. |
_________
PIÈCES DÉPOSÉES
Aucune
Fait à la Côte-Saint-André, le 26 octobre 1821.
Signature des témoins |
Signature du porteur Hector BERLIOZ. |
Charbonnel, son premier compagnon de voyage, dont il resta l’ami jusqu’à sa mort, le rattachait, par sa présence, aux souvenirs et aux traditions de la commune patrie : ce qui n’empêchait pas les deux étudiants de mener, dans la grand’ville, une vie assez… parisienne. « Charbonnel courait les grisettes », disent les Mémoires de Berlioz, cependant que lui-même s’en allait, pour gagner sa vie, chanter sur les planches une partie de chœur dans des flonflons de vaudevilles. Des souvenirs de leur vie commune ont été conservés par le petit-fils de cet ami des jours heureux. Hector et lui, revenus aux vacances, voulurent s’amuser à des farces de rapins aux dépens des Côtois. Pendant l’année, Berlioz, pour se mettre à la mode des « Jeunes Frances », avait laissé pousser ses cheveux, « cette monstrueuse chevelure antédiluvienne, a dit Henri Heine, toison hérissée qui se dressait sur son front comme une forêt primitive sur une roche escarpée ». Charbonnel, de son côté, s’était grimé de son mieux : ainsi méconnaissable, ils s’en allèrent un soir devant la fontaine de Cuissein, — toujours dans la Grande-Rue, — placèrent sur la margelle trois chandelles allumées, et se mirent en devoir de donner une sérénade aux habitants : Berlioz jouait de la guitare, Charbonnel chantait des romances troubadour ; le public s’amassait, ahuri, se demandant ce que cela voulait dire, — jusqu’au moment où le charme fut rompu par la subtilité d’un indigène qui s’écria soudain : « Je creye bian que y est l’grand Charbounè ! » La fontaine de Cuissein est toujours là : c’est encore un des souvenirs de ce grand Musée Berlioz qu’est la ville entière de la Côte-Saint-André !
____________________________________
(1) Un pèlerinage au pays de Berlioz,
nos des 4, 11 et 18
octobre 1885.![]()
(2) Ce document, ainsi que quelques autres pièces qu’on lira par la suite,
nous a été obligeamment communiqué par M. Maignien, Bibliothécaire de la
ville de Grenoble, à qui il appartient. Pour les diplômes des baccalauréats (dont
on jugera sans doute inutile que nous reproduisions ici la teneur), ils m’ont
été montrés à Paris par Mme Chapot, nièce de Berlioz, et ses
fils, qui, après avoir conservé eux-mêmes ces souvenirs de famille, les ont
déposés au Musée Berlioz, avec d’autres objets du même genre. Nous avons
donné ci-dessus la date de l’examen du baccalauréat ès lettres (signé le 26
avril) ; quant au diplôme de bachelier ès sciences physiques, obtenu
devant la Faculté de Paris, il est postérieur de près de trois années :
il est daté du 22 janvier 1824 ; l’examen avait été passé le 12 du
même mois.![]()
![]()
![]() Le Ménestrel, 10 Janvier 1904,
p. 11-12
Le Ménestrel, 10 Janvier 1904,
p. 11-12
Entrons, pourtant dans le sanctuaire où sont exposées,les reliques, — je veux dire dans la petite chambre de la maison Berlioz où ont pris place les objets qui constituent le musée proprement dit. Nous en avons déjà dit un mot au lendemain de l’inauguration ; nous ne reviendrons donc ni sur la description du lieu, ni sur l’examen des principales pièces conservées : portraits, couronnes, éditions des œuvres, ouvrages sur l’auteur, — et, comme souvenirs plus directs, quelques objets d’usage personnel, tels que les deux petits verres et la salière conservés par l’ami Charbonnel, humbles épaves de leur ménage d’étudiants, — et encore des autographes (peu nombreux) de lettres et de musique.
Mais nous voudrions considérer au moins avec quelque attention ce qui rappelle le premier séjour d’Hector Berlioz à la Côte-Saint-André, c’est-à-dire les objets qui datent de son enfance.
A ce point de vue, le Musée offre dès maintenant un grand intérêt.
L’on voit dans les vitrines des flûtes et des clarinettes remontant à cette même époque. Les clarinettes étaient, sans aucun doute, les instruments de la musique de la garde nationale, achetés par la commune et gardés par elle après la dissolution de la société. Quant aux flûtes, il est d’autant plus probable qu’il se trouve parmi elles celle qui fut le premier instrument de Berlioz, — sur laquelle, dans le salon de la Côte, il faisait sa partie dans ses œuvres de musique de chambre, et, dans le cadre pastoral de Meylan, jouait à son père la musette de Nina, — que cette collection instrumentale a été enrichie par des dons provenant directement de la famille d’un de ses anciens amis, un voisin, en la compagnie de qui il avait aimé faire de la musique, et auquel, en partant, il fit plusieurs cadeaux d’objets ayant servi à leurs exécutions enfantines.
Par contre, on ne retrouvera pas au Musée sa première guitare. Si l’on veut voir une guitare de Berlioz, il faut aller à un autre musée, où l’on en conserve une plus intéressante encore que ne serait celle qui a servi à ses études, car c’est une guitare autographe, — que dis-je ? doublement autographe ! C’est la guitare de Paganini donnée par lui à Berlioz et qui porte leurs deux signatures. L’auteur de la Fantastique en a fait hommage au Musée du Conservatoire.
Passons vite sur d’autres objets qui lui ont appartenu dans son enfance, — la grande sphère terrestre sur laquelle il perdait son temps à combiner des voyages au long cours, — des livres de classe, parmi lesquels un seul aurait eu vraiment de l’intérêt, si on avait pu le retrouver : son Virgile, mais il est absent, — et arrivons-en sans plus tarder aux cahiers de musique.
C’est ici qu’est la partie intéressante et vraiment précieuse de la collection. Peu nombreuse cependant, elle comprend au moins une pièce d’un intérêt de premier ordre.
De ces cahiers, cinq ont principalement retenu mon attention. Tous sont manuscrits. Je les énumérerai et en résumerai le contenu, en commençant par ceux qui offrent le moins d’intérêt.
C’est d’abord un cahier (sans titre) de morceaux pour chant seul, contenant des airs connus de romances ou d’opéras : Quand le bien-aimé reviendra, — Je l’ai planté, je l’ai vu naître (de Jean-Jacques Rousseau), — On nous dit qu’dans le mariage, — Colinette au bois s’en alla, — Mon Dieu, comme à c’te fête, — enfin des préludes pour un instrument non désigné, qui pourrait être la flûte.
Un autre cahier, renfermant des mélodies instrumentales, commence par : Ah ! ça ira ! air qui, à ce qu’il paraît, n’était pas interdit, sous la Restauration même, dans un endroit écarté comme la Côte-Saint-André. Il se continue par des airs de pas redoublés (probablement ceux qui formaient le répertoire de la musique de la garde nationale).
Un troisième porte ce titre : 32 valses et allemandes, par F.-X. Dorant, maître de musique à la Côte. Sont-ce vraiment des compositions originales de ce musicien, l’un des premiers éducateurs de Berlioz ? Cela pourrait être : je n’y ai retrouvé aucun air connu.
Voici un autre cahier signé Dorant. Mais cette fois ce ne sont pas ses compositions qu’il contient : ce sont des romances, dont quelques-unes sont connues, et qui d’ailleurs sont transcrites par plusieurs mains différentes. A la dernière page, nous lisons un morceau, noté avec soin, suivi de la signature de Dorant, avec un beau paraphe, et précédé de ce titre :
Fleuve du Tage, accompagnement de guitarre par M. Hector Berlioz.
Nous y reviendrons.
Mais voici le morceau capital. C’est un cahier de musique, du grand format des morceaux séparés de chant ou d’instruments (les précédents étaient tous de dimensions moindres, quelques-uns pas plus grands qu’un carnet de poche), recouvert d’un cartonnage noir. Sur le plat est collée une étiquette de papier blanc sur laquelle est tracé ce titre, d’une écriture qui nous est bien connue :
Recueil de romances avec accompagnement de guitarre, par M… (Ici sont des mots effacés).
Ouvrons le cahier : il renferme des morceaux de musique, avec paroles, entièrement copiées de la même main qui avait écrit le titre extérieur ; et cette écriture est celle d’Hector Berlioz : elle n’a pas changé depuis que, sûrement avant d’avoir atteint sa dix-huitième année, peut-être encore plus tôt, il nota ces airs, jusqu’au jour où il écrivit la dernière note de Béatrice et Bénédict, sa dernière œuvre, dont on peut voir la partition autographe à la Bibliothèque du Conservatoire.
Voici quelle est l’histoire de ce cahier. Berlioz l’écrivit pendant son premier séjour à la Côte-Saint-André. Il avait pour camarade ce voisin dont il a été déjà parlé, à qui le Musée Berlioz a dû la conservation de quelques-uns de ses plus intéressants souvenirs. Il se nommait Favre (Joseph). Ce n’était pas un bourgeois, mais un fils d’artisan, artisan lui-même toute sa vie ; mais — et c’est là un trait du caractère de Berlioz qui ne nous surprend pas, mais qu’il faut noter, — il n’en était pas moins en relations familières avec le fils du médecin, qui le tenait pour son ami, sans s’inquiéter des propos de la petite ville. La raison de cette intimité, c’est qu’ils avaient tous les deux l’amour de la musique. M. H. Favre, fils de ce camarade des jeunes années du grand musicien, aime à raconter les détails qu’il tient de son père à ce sujet. Il s’accuse en même temps lui-même avec amertume d’avoir détruit autrefois, avec une légèreté évidemment fâcheuse, un document qui serait précieux aujourd’hui, car ce n’eût été rien moins que la première lettre autographe de Berlioz ; écrite au temps où celui-ci était en pension au séminaire, cette lettre témoigne en effet de la communauté de leur goût musical : Hector y disait à peu près à son ami Joseph : « C’est dimanche la procession de la Fête-Dieu ; nous voulons accompagner le Saint-Sacrement en musique ; viens te joindre à nous et apporte ta clarinette ». Ce dut être une bien remarquable symphonie !
Bref, quand Berlioz partit pour Paris, il avait laissé à la maison les divers papiers qui témoignaient de sa première activité musicale. Quand il revint, ces essais informes lui firent pitié, et il voulut les faire disparaître. Et il est bien vrai qu’on n’a retrouvé aucune trace de ses compositions de musique de chambre, ni des romances avec accompagnement de piano, — que, dès le printemps de 1819, il proposait successivement à deux grandes maisons d’édition parisiennes, parfaitement d’accord l’une et l’autre pour décliner ses offres. Il est donc certain qu’aucune de ces productions enfantines ne trouva grâce devant sa censure. Mais quand vint le tour du cahier des romances avec guitare, l’ami avec lequel il les avait chantées autrefois demanda grâce pour lui, et le pria de lui en faire cadeau plutôt que de le détruire. Berlioz y consentit ; mais, voulant affirmer qu’il n’était pour rien dans cette production, il en enleva son nom que, dans sa vanité enfantine, il y avait inscrit autrefois ; nous avons en effet constaté sur le titre des traces de grattage : les mots effacés, dont quelques traits sont encore perceptibles, n’étaient autres que son nom et son prénom : Hector Berlioz.
![]()
![]() Le Ménestrel, 14
Février 1904,
p. 51-52
Le Ménestrel, 14
Février 1904,
p. 51-52
Nous reprenons notre étude interrompue sur le cahier de romances avec accompagnement de guitare, écrit de la main de Berlioz enfant, que conserve le musée de la Côte-Saint-André.
Avant d’aborder le problème qui concerne la participation de Berlioz à la composition de ces romances, achevons la description du manuscrit.
Au-dessous du titre, le jeune musicien, esprit méthodique, et déjà conscient de l’importance de la partie technique dans son art, a inscrit l’énumération suivante :
6 en ut. — 1 en ré. — 2 en mi. — 4 en fa. — 8 en sol.— 7 en la. — En tout 25. Les noms des auteurs sont placés en regard de chaque ton correspondant.
Ces vingt-cinq morceaux se succèdent dans l’ordre suivant :
N° 3 (1) Romance
de Florian, musique de M. *** (A Toulouse il fut une belle).
N° 4. Air de Philippe et Georgette, musique de d’Aleyrac.
N° 5. Fleuve du Tage, musique de Pollet.
N° 6. Romance de Florian, musique de *** (Amour, on doit bénir tes
chaînes).
N° 7. La Simpathie, de l’opéra de Félicie, musique de Catrufo.
N° 8. Romance de Gulnare ou l’Esclave persane, musique de d’Aleyrac.
N° 9. Romance de ***, musique de Bédart (Fais mon bonheur, tranquille
indifférence).
N° 10. Romance du Chaperon-Rouge, musique de Boieldieu.
N° 11. Romance de l’Opéra-Comique, musique de Della-Maria.
N° 12. Autre romance du même ouvrage.
N° 13. Objet charmant, romance, musique de ***.
N° 14. Romance de Plantade, paroles de M. *** (Bocage que l’aurore embellit
de ses pleurs).
N° 15. Romance, musique de *** (Depuis une heure je l’attends).
N° 16. Couplets de l’Opéra, la Romance, musique de Berton.
N° 17. Romance, musique de Berton (Du tendre amour je chérissais l’empire).
N° 18. Air du Petit Jokei, musique de Solié.
N° 19. Romance de Blaise et Babet, musique de Dezède:
Lise chantait dans la prairie
En faisant paître son troupeau.
N° 20. Romance de Nadermann (Je pense à vous).
N° 21. Faut l’oublier, romance de ***.
N° 22. Viens, Aurore, musique de Lelu.
N° 23. Le Rivage de Vaucluse, romance d’A. Boieldieu.
N° 24. Le Sentiment d’amour, musique de Meissonnier.
N° 25. Minverne au tombeau de Ryno. Paroles de Chénier, musique de ***.
N° 1. La trompette appelle aux allarmes, paroles de Florian, musique de
Lintau.
N° 2. Romance de Florian, mise en musique par Martini (Vous qui loin d’une
amante).
Ce choix de romances Empire fera sourire bien des lecteurs, qui y trouveront de singuliers disparates avec ce qui devait être la véritable tendance de Berlioz. A tout prendre, il n’est pas si vulgaire. On ne s’attendait pas, apparemment, à y trouver du Gluck transcrit pour la guitare, non plus que du Spontini ou du Méhul, du Cherubini ou du Lesueur, du Mozart ou de l’Haydn. Le recueil de Berlioz résume donc ce que le genre où il était nécessairement confiné lui offrait de mieux. La comparaison que j’ai dû faire de quelques-uns des morceaux qu’il contient avec les originaux m’a procuré l’occasion de me familiariser de nouveau avec l’ensemble de ce répertoire de romances qui eut en France une vogue presque populaire durant le premier quart du XIXe siècle : j’ai pu me rendre compte ainsi une fois de plus de l’accumulation de niaiseries qu’il comprend, soit comme paroles, soit comme musique. Or, Berlioz n’a admis qu’un très petit nombre de ces compositions d’ordre inférieur ; on ne trouve dans son recueil ni chansons grivoises, ni prétentieuses romances troubadour, — les deux genres principaux qui ont eu les préférences de l’esprit essentiellement français. Son goût naturel l’a incliné à porter son choix sur des airs d’opéras-comiques dont les auteurs sont Dalayrac, Boieldieu, Berton, Della-Maria, etc., ou sur des romances qui comptent parmi ce que le genre a produit de meilleur, celles où le faux goût a la moindre part.
Notons aussi la prédisposition dont témoigne le choix des poésies. Les romances de Florian, qui lui rappelaient Estelle, sont parmi ses favorites.
Mais voici un nom bien plus surprenant encore, celui d’un poète que nous sommes presque étonnés de voir connu dans les provinces à l’époque où Berlioz écrivit son cahier : Chénier, dont l’œuvre véritable fût révélée si longtemps après sa mort. Et c’est bien d’André Chénier qu’il s’agit : cela nous est attesté par une note inscrite par la main de Berlioz en tête de la romance, et que voici :
« L’auteur de ces paroles était un jeune homme qui a été victime de la révolution française ; ce malheureux, en montant sur l’échafaud, ne put s’empêcher de dire en se frappant le front : « Mourir ! J’avais quelque chose là ! » C’était la muse qui lui révélait son talent au moment de la mort. »
Le talent ! la muse ! voilà déjà les idées dont était rempli le cerveau du petit Berlioz !
J’ai annoncé qu’il y aurait un problème à résoudre. Il a été posé par ceux mêmes aux mains de qui appartient la garde du précieux dépôt, et a déjà donné lieu à quelques discussions, un peu confuses, comme il arrive toujours lorsqu’on traite une question avant de l’avoir suffisamment approfondie. J’ai pris moi-même une certaine part à ces discussions, et j’ai promis de donner mes soins à la recherche de la vérité, s’il est possible qu’elle soit découverte de façon positive : voici le moment venu de m’exécuter.
La question est double.
1° Parmi les romances contenues dans le cahier autographe de Berlioz, en est-il quelques-unes dont la composition entière doive être attribuée au futur auteur de la Damnation de Faust ?
2° Les accompagnements de guitare sont-ils de lui ?
L’on devine que les possesseurs du manuscrit voudraient bien que l’on pût répondre à ces deux questions par l’affirmative, car la valeur du document en serait notablement accrue. La question même n’est pas sans importance pour l’histoire de l’art, puisqu’elle ne consiste en rien moins qu’à savoir si ce manuscrit est une simple copie, ou s’il doit être considéré comme une œuvre de jeunesse du plus grand musicien français du XIXe siècle.
Tout d’abord, il faut nous défier des illusions que produit trop souvent le mirage de l’autographe. De ce qu’un ouvrage a été noté par la main d’un producteur, il en résulte une présomption première qu’il doit être de lui. Cela est loin d’être toujours une vérité : bien des erreurs plaisantes ont été causées par l’absolu de cette manière de voir. C’est ainsi que l’on a attribué à Bach, pour les avoir retrouvées parmi ses manuscrits, des compositions qui ont été reconnues ensuite être de Vivaldi, ou de Couperin, ou encore de ses fils : il s’était simplement donné la peine de les copier.
Mais, objecte-t-on, quelles raisons Berlioz aurait-il eu de copier ces romances ? — Il les copiait, répondrai-je, tout simplement pour les avoir, et c’était le moyen le plus usité en ce temps-là pour se procurer de la musique, surtout en province. La musique était coûteuse, plus qu’aujourd’hui ; avec les difficultés des communications d’alors, il était malaisé de la faire venir des grands centres ; enfin l’on avait beaucoup de temps à perdre. Aussi, dès qu’un morceau nouveau arrivait dans une ville, il circulait de main en main parmi les amateurs, qui en prenaient copie. Bien des collections, parfois intéressantes, ont été formées ainsi. S’il m’est permis de parler d’objets que j’ai les meilleures raisons de connaître, je dirai que je possède des cahiers de musique de chant provenant de ma grand’mère et de mon arrière-grand’mère, et copiés par elles : dans l’un, on retrouve les morceaux des opéras-comiques de la fin du XVIIIe siècle ; dans l’autre, les romances de l’époque 1830, — et, parmi ces dernières, notées par la même main tranquille qui transcrivit aussi Ma Normandie, de Bérat, et la Grâce de Dieu, de Loïsa Puget, j’ai remarqué avec satisfaction la présence de la Captive, Orientale de Victor Hugo, et du Jeune pâtre breton, poésie de Brizeux, toutes deux mises en musique par Hector Berlioz, la première avec accompagnement de violoncelle, la seconde avec une partie de cor. Si donc, vers 1820, notre auteur a pris la peine de copier pour lui les romances de Boieldieu et de Dalayrac, il n’a pas fait autre chose que ce que faisaient quelques années plus tard, pour sa propre musique, les dames de Saint-Claude, ville dont les récréations artistiques me paraissent avoir été sensiblement équivalentes à celles de la Côte-Saint-André.
Donc, étudiant le cahier sans nous laisser influencer par aucune de ces considérations, nous remarquons d’abord que, sur les vingt-cinq romances qu’il contient, dix-neuf portent un nom d’auteur. Il en reste six, où ce nom est remplacé par trois étoiles. En résulte-t-il qu’elles sont de Berlioz ? S’il en était ainsi, je crois bien que ce ne sont pas des étoiles que nous verrions en tête de ces morceaux, mais que le jeune compositeur n’aurait pas hésité à inscrire à la place les deux mots : « Hector Berlioz », que déjà, dans son empressement, il avait mis sur le titre extérieur, pour les effacer ensuite !
Mais écartons les suppositions. Sur les six morceaux sans nom d’auteur, il en est un très connu : c’est la romance « Faut l’oublier, disait Colette », qui est dans la Clef du caveau, et a servi de timbre à des chansons de Béranger. Bien mieux : je l’ai retrouvée parmi des romances avec accompagnement de guitare, où elle porte un nom d’auteur, qui est Romagnesi ; Berlioz l’aura transcrite d’après un de ces exemplaires manuscrits, souvent fautifs, et surtout incomplets, qui couraient les provinces ; n’y ayant pas trouvé de nom, il aura mis les étoiles : rien n’est plus simple, ni plus certain. Et il ne l’est pas moins, ce me semble, que ce qui s’est produit pour ce morceau fut parfaitement identique pour les cinq autres, et que si Berlioz n’y a pas inscrit les noms des compositeurs, c’est qu’il les ignorait. Au reste, un grand nombre de romances de ce temps-là étaient publiées sous le couvert de l’anonyme : il a donc fort bien pu trouver les étoiles sur les exemplaires authentiques d’après lesquels il a fait ses transcriptions.
Mais voici une autre particularité dont il convient de tenir compte. Sur les six romances anonymes — mettons qu’il en reste cinq, — deux sont de Florian, et l’on sait les raisons qu’avait Berlioz enfant de s’intéresser aux vers de ce poète. Mais d’abord il y a dans son cahier deux autres romances de Florian dont les musiciens sont nommés, et déjà cela nous révèle que l’usage des vers de Florian n’implique aucunement la collaboration musicale de Berlioz.
Pénétrons davantage au cœur du sujet. Berlioz, amoureux précoce de la belle Estelle de Meylan, a composé dès son enfance des romances sur des vers d’Estelle et Némorin. Nous en connaissons une : il l’a reprise pour former le thème initial de la Symphonie fantastique ; elle s’adapte admirablement aux vers de Florian, et, déjà si expressive, si désolée sous sa forme instrumentale, elle a un accent encore plus intense quand on l’associe de nouveau aux paroles qui l’ont inspirée.
Cette romance ne figure pas dans le recueil manuscrit. N’est-ce pas déjà une indication significative, d’où l’on peut conclure dès l’abord que ce recueil n’a pas été fait pour contenir les œuvres de Berlioz ?
Mais examinons les deux romances de Florian sans noms d’auteurs dont nous avons noté la présence. La première est encore tirée d’Estelle et Némorin. De tout le poème, c’est la moins sentimentale. En voici les premiers vers :
A Toulouse il fut une belle :
Clémence Isaure était son nom.
Le beau Lautrec brûla pour elle…
C’est, par exception dans le recueil, le genre troubadour dans toute sa banalité. La musique de l’auteur anonyme (2) est en accord parfait avec la poésie : c’est ce que je puis dire de mieux pour la caractériser. Ce style n’était pas celui de Berlioz, même enfant. Je sais bien qu’il a trouvé aussi, dans le même temps, un air à panache assez conforme à la mode régnante : celui qu’il a replacé dans l’ouverture des Francs Juges. Mais d’abord rappelons-nous que ce thème fut unique dans sa production, puisque son père lui donna une approbation toute particulière, disant : « Enfin ! voilà de la musique ! » Ce cri du cœur paternel témoigne que le jeune Berlioz n’avait pas l’habitude de faire de cette musique-là. Mais encore il y a dans le thème des Francs Juges quelque chose de plus vivant, plus vraiment musical et expressif, que ce chant sec et vide d’un auteur anonyme et quelconque. Les deux derniers vers du couplet sont les suivants :
Ainsi, toujours les cœurs sensibles
Sont nés pour être malheureux.
Sur cette conclusion, le compositeur reprend purement et simplement sa première phrase sautillante, agrémentée de petites notes. Croit-on que si Berlioz, même à douze ans, avait mis ces paroles en musique, il aurait commis un pareil contre-sens ? Que, lui qui, dans sa romance à Estelle, avait su donner tant d’ampleur expressive au vers : « Dans les pleurs et dans les regrets », sur lequel la voix monte comme en un cri de désespoir poignant, il aurait terminé par une telle platitude un couplet qui appelait si impérieusement un accent sentimental ?
L’autre romance de Florian : « Amour, on doit bénir tes chaînes » est une agréable mélodie, faite sur le modèle de certains chants classiques, et contenant un dessin qui est une réminiscence directe d’Iphigénie en Tauride de Gluck. Berlioz ne connaissait pas Iphigénie en Tauride alors qu’il n’était pas encore sorti de la Côte-Saint-André. Deux vers au milieu du couplet appellent une réflexion semblable à la précédente ; les voici :
Jamais nous ne verrions briller un jour serein ;
Toujours par la douleur l’âme serait flétrie…
Là-dessus, la musique marche toujours son petit train, doux et calme, avec grâce. Berlioz aurait trouvé autre chose à mettre sur de tels vers.
Ce ne sont pas là de simples hypothèses. Nous verrons bientôt, à des signes certains, combien impérieusement déjà son instinct le poussait à chercher l’accent expressif. Cet accent, nous ne le trouvons pas une seule fois dans les romances, anonymes ou non, de son cahier. Toutes ces mélodies sont très bien faites — trop bien faites pour être d’un enfant qui ne sait rien du métier, — trop jolies pour être de Berlioz !… Si elles étaient de lui, on y remarquerait des maladresses qui n’y sont pas, — mais aussi des traits personnels, qui manquent tout aussi complètement.
En résumé, à la première partie du problème je crois devoir répondre nettement :
« Non, il n’y a pas une seule mélodie du cahier autographe de la Côte-Saint-André qui soit de la composition de Berlioz. »
____________________________________
(1)
Ainsi qu’on le voit par cette énumération, les morceaux sont numérotés en
commençant par le no 3, les nos 1 et 2 étant renvoyés à la suite
du no 25 et dernier.![]()
(2) Cette musique n’est pas celle de Devienne, qui fut
populaire en son temps et qu’on trouve notée dans le Clef du Caveau.![]()
![]()
![]() Le Ménestrel, 21
Février 1904,
p. 59-60
Le Ménestrel, 21
Février 1904,
p. 59-60
Passons à la seconde question. Berlioz est-il auteur des accompagnements de guitare ?
Ceci est plus complexe, et je n’éprouve aucune honte à confesser les hésitations par lesquelles j’ai passé avant d’arriver à ce que je pense être maintenant une certitude, et à déclarer, sans plus tarder, que j’ai modifié une opinion prématurément exprimée il y a peu de temps.
Au premier abord, en effet, rien n’autorisait à croire que ces accompagnements ne fussent pas de simples copies, tout comme les mélodies. Les romances avec guitare étaient en grande vogue en ce temps-là, et circulaient partout en petites feuilles gravées sur deux portées, l’une pour le chant, l’autre pour l’instrument : Berlioz s’étant fait copiste pour la première partie, il y avait toute raison d’en inférer qu’il en était de même pour la seconde.
« Mais, objectait-on, voyez son nom inscrit sur le titre : Romances avec accompagnement de guitare, PAR M. HECTOR BERLIOZ.
—
Pardon, ce nom a été effacé, et par lui-même.
— Il l’a effacé parce qu’il jugeait l’œuvre indigne de lui et en reniait
la paternité.
— Il l’a effacé parce qu’il ne voulait pas s’attribuer une
paternité qui
n’avait jamais été sienne.
— Pourquoi donc aurait-il commencé par mettre son nom sur le titre ?
— Simple caprice de vanité enfantine : le cahier étant entièrement
de sa main, il a pu se croire autorisé par cela seul à y inscrire son nom.
Plus tard, devenu un homme, il fit lui-même justice de cette prétention ».
Telles étaient les raisons pour et contre que pouvait suggérer un premier examen.
Les documents du Musée Berlioz nous fournissaient en outre un rapprochement qui semblait probant.
Le cahier autographe contient la romance Fleuve du Tage. D’autre part, nous le savons déjà, un autre cahier portant la signature de Dorant renferme la même romance, précédée de ce titre, sans rature, et dont la clarté, cette fois, ne laisse rien à désirer :
Fleuve du Tage, accompagnement de guitare par M. H. Berlioz.
Or, si nous comparons les deux versions, nous trouvons entre elles de notables différences.
Que pouvait-on conclure de là, si ce n’est que, la seconde étant de Berlioz, l’autre n’en était pas ?
Pour toutes ces raisons, j’avais pensé d’abord que, pas plus que les mélodies, les accompagnements des romances notées dans le cahier autographe de Berlioz n’étaient son œuvre.
Il restait cependant une autre preuve à chercher ; mais ce n’était pas à la Côte-Saint-André qu’on en pouvait avoir les éléments. Il s’agissait de remonter aux originaux, et de retrouver les éditions anciennes des romances avec accompagnement de guitare d’après lesquelles Berlioz avait exécuté sa copie. Si ces originaux avaient donné les accompagnements semblables à ceux du cahier, la question eût été définitivement tranchée.
Si particulier que soit le genre de la romance accompagnée par la guitare, il a pourtant laissé ses monuments. C’est ainsi que la Bibliothèque du Conservatoire possède une importante collection de morceaux de ce genre, reliés en volumes d’un nombre et de dimensions respectables.
D’autre part, on avait bien voulu me communiquer, de la Côte, la photographie de plusieurs romances du cahier Berlioz (les anonymes particulièrement) et la copie de la partie de guitare de quelques autres morceaux d’auteurs connus.
Bien que n’étant pas encore tout à fait complète, cette première confrontation a suffi à amener un résultat qui, je dois le reconnaître, n’a pas été favorable à ma première thèse.
Ayant entre les mains quatorze romances du manuscrit Berlioz, plus la version double de Fleuve du Tage, j’en ai trouvé huit dans les anciennes collections (1).
Or, dans aucun de ces huit cas l’accompagnement de guitare du manuscrit n’est semblable à celui des morceaux gravés.
Voilà une présomption sérieuse en faveur de l’attribution de ces accompagnements à Berlioz.
Si, étendant les observations au delà de ces huit morceaux, nous tentions une comparaison d’ensemble entre le style de la partie instrumentale des romances gravées d’une part et du cahier Berlioz d’autre part, nous ne tarderions guère à être frappés par les notables différences que nous révèle cette confrontation. Les accompagnements des premières, écrits par des professionnels, sont en général corrects, faciles, coulants — et plats. Ceux du manuscrit sont surchargés de notes, pleins de rythmes variés et changeants, compliqués autant que le genre peut admettre la complication, riches en harmonies, ou du moins en intentions harmoniques, — enfin très incorrects. C’est bien là un style de jeune compositeur, et à ces traits nous reconnaissons Berlioz enfant. Quand, plusieurs années après l’époque de cette transcription, il présenta à Lesueur des essais de composition qu’il avait soignés de son mieux, le maître, qui n’était pourtant pas un bien grand puriste, lui dit : « Vous ne savez pas encore écrire, et votre harmonie est entachée de fautes si nombreuses qu’il serait inutile de vous les signaler. » Que devait-ce être donc alors qu’il n’avait rien entendu ni lu en fait de musique sérieuse, qu’il était livré exclusivement à son instinct et à ses dispositions naissantes?
Ce que c’était, c’est-à-dire comment Berlioz écrivait quand, avant toute étude, il obéissait à la seule nature, son manuscrit va nous le dire, — car nous admettons dès maintenant que, pour cette seconde partie, la cause est gagnée en sa faveur.
Tout d’abord, ses accompagnements de guitare témoignent d’un sentiment de la basse très personnel et assez complexe. Nous voyons souvent cette partie, base de l’édifice harmonique, présentée de façon maladroite, lourde, incertaine, — et nous ne pouvons nous empêcher de songer que ce défaut n’est pas toujours absent des meilleures œuvres de Berlioz. Puis, en d’autres endroits, nous observons qu’elle se détache avec netteté, devient un chant presque indépendant, bien distinct de la mélodie, lui donnant un aspect tout nouveau, — préoccupation que n’eurent jamais les auteurs des pauvres accompagnements selon la formule. Voyez, par exemple, dans la seconde partie de la romance de Florian : « Amour, on doit bénir tes chaînes », les mesures 9 à 12, puis 13 à 16 : la basse procède ici, de façon vraiment inattendue, par un mouvement mélodique qui descend diatoniquement du sixième degré à la tonique : fa mi ré do si la mi la. Il y a là le germe de certaines combinaisons dont les symphonies postérieures nous apporteront la réalisation complète : je ne puis m’empêcher, en présence de cette disposition, de songer à ce contre-chant formé d’une descente analogue de sept degrés par mouvements conjoints en notes égales, quatre mesures que divers instruments, puis les basses, font entendre quatorze fois de suite vers la fin de la fête de Roméo et Juliette, soutenant de leur martellement obstiné le développement symphonique le plus varié et le plus riche. Certes, nous sommes encore bien loin de là, — de même que l’enfant à peine formé est loin de ce que sera l’homme dans toute la vigueur de ses vingt-cinq ans : c’est cependant le même individu, et c’est le même principe d’invention musicale.
Mais à côté de ces qualités naissantes, que d’incorrections dans le même passage ! Accords de sixte et quarte employés à tout propos et hors de propos, sur les plus mauvais degrés ; octaves successives entre la basse et le chant… Cette dernière faute est perpétuelle dans le manuscrit. Berlioz n’en avait pas le sentiment inné. Il y devint pourtant très sensible par la suite : on en trouve un témoignage dans l’observation qu’il fit, dans ses études sur Gluck, à propos des doublages habituels de la partie d’alto à l’octave des basses, qui parfois, s’il advenait que l’alto montât au-dessus des violons, lui donnait la sensation de la faute (2). Il n’en éprouvait pas le désagrément dans son enfance : son écriture d’alors en témoigne assez. Et cela seul suffirait à nous convaincre que les accompagnements notés dans son cahier ne sont pas pris sur les partitions des auteurs, car dans ces dernières on trouve, avec beaucoup moins d’intentions, une correction beaucoup plus grande, N’oublions pas que l’époque était celle où Panseron se vantait de n’avoir jamais de sa vie laissé passer dans ses œuvres une faute de quintes ; et comme un jour, par exception, il s’était trouvé amené à en écrire (je ne sais pourquoi, par exemple, car il est toujours possible d’éviter de faire des quintes, quand on y tient tant !) il fit un renvoi et inscrivit au bas de la page cette note : « Je le sais ». Ce souci de petite correction formelle était alors celui de tout le monde. On n’en trouve aucune influence dans le manuscrit de Berlioz, tout au contraire. Et de là il apparaît que, si nous avons refusé à cet homme de génie de le reconnaître auteur des mélodies, parce qu’elles sont trop jolies, nous lui accordons maintenant la paternité des accompagnements, parce qu’ils sont incorrects (3) !
D’ailleurs, ils ne sont pas que cela ; à une nouvelle qualité, que nous allons dire, nous reconnaîtrons cette fois notre Berlioz : ils sont expressifs. Encore une préoccupation qui n’était pas celle des faiseurs de romances sur mesure. Rouvrons le cahier. S’agit-il d’accompagner ces mots : « La trompette appelle aux alarmes » ? La guitare de Berlioz se donne des airs d’instrument guerrier, soulignant le chant en style de fanfare, jusqu’au moment où les paroles cessent de parler de trompette : le dessin est alors modifié. Sont-ce ces vers :
Bocage que l’Aurore
Embellit de ses fleurs,
Gazon naissant que Flore
Pare de mille fleurs ?
l’harmonisateur trouve un dessin ouduleux, commencé à l’aigu, descendant progressivement de la 5e position à la 3e, puis à la première (tous ces détails spécifiés dans le manuscrit), et ces préoccupations nous font sentir que Berlioz était né pour comprendre du premier coup la poésie éthérée des tableaux bocagers d’Armide et des Champs-Elysées d’Orphée.
____________________________________
(1) Les morceaux qui nous ont été communiqués de
la Côte-St-André
correspondent aux nos suivants du manuscrit : 1, 3, 4, 5, 6, 8,
11, 12, 13, 14, 15, 21, 23, 25. Les nos 1, 3, 6, 13, 15 et 25 sont
ceux dont nous n’avons pu retrouver les éditions gravées. Tous les autres nous
sont connus sous forme de morceaux détachés avec accompagnement de guitare, à
l’exception du no 4, air de Philippe et Georgette, de
Dalayrac,
dont nous avons lu l’accompagnement original dans la partition, mais dont nous
n’avons pas trouvé de transcription ancienne. La romance de Gulnare, du
même, et les deux romances de l’Opéra-Comique, de Della-Maria, nous sont enfin
connues à la fois par leur forme originale et par des transcriptions pour
guitare, piano, et même harpe (Gulnare). Tous ces documents ont été
utilisés pour notre travail de confrontation.![]()
(2) A travers chants, p. 201.![]()
(3) Dans quelques-uns des morceaux dont nous avons retrouvé des
transcriptions différentes, c’est-à-dire les morceaux d’opéras-comiques
connus, nous avons constaté que les accompagnements de Berlioz présentaient
plus d’analogies avec les accompagnements de piano qu’avec les accompagnements
de guitare, sans que d’ailleurs il y eût jamais complète identité d’harmonies
et de dessins. En outre, les mélodies de son manuscrit présentent, dans le
détail, de nombreuses différences de notations avec celles des éditions
originales. On pourrait conclure de là que ces morceaux sont des
reconstitutions, faites de mémoire et adaptées à un autre instrument, de
romances entendues avec accompagnement de piano.![]()
![]()
![]() Le Ménestrel, 28
Février 1904,
p. 66-68
Le Ménestrel, 28
Février 1904,
p. 66-68
Mais voici un morceau plus caractéristique encore, qui mérite de nous arrêter pour plusieurs raisons. C’est la romance dont les paroles sont indiquées dans le manuscrit comme étant d’André Chénier. Pour le dire tout d’abord, elles n’en sont pas. Il suffirait de les lire, de lire le titre seul, pour en être convaincu : Minverne au tombeau de Ryno : cela a un air ossianique bien différent du sentiment grec dont l’auteur de la Jeune Tarentine a toujours su merveilleusement s’inspirer. Au reste, la versification en est médiocre, ce qui est déjà un indice suffisant. Par acquit de conscience, nous avons cherché ces vers dans les éditions d’André Chénier : la première, celle de Latouche, la seule que Berlioz aurait pu connaître alors, ainsi que l’édition postérieure, si précieuse, de Becq de Fouquières : ils ne sont ni dans l’une ni dans l’autre. Il faut noter une coïncidence d’époque intéressante à signaler : c’est à la fin de 1819 (la préface de Latouche est datée du 14 août, et les imprimeurs d’autrefois n’allaient pas vite en besogne) que les poésies d’André Chénier, à peine connues jusqu’alors par quelques rares morceaux épars, furent pour la première fois réunis en volume ; or, c’est peut-être en cette année même ou dans la suivante, en tout cas avant l’automne de 1821, que fut écrit le cahier de Berlioz. C’était donc un nom nouveau dans la littérature qu’il y inscrivait, et il est probable que le livre n’avait pas encore pénétré jusqu’à lui. Aussi la fausse attribution que nous avons constatée ne doit pas nous étonner ; mais elle est une preuve que le nom d’André Chénier était devenu vite à la mode, puisque des faiseurs de romances, pensant faire bon effet auprès de leur public, et sachant qu’il ne protesterait pas, le rendaient responsable de méfaits imaginaires, auxquels sa muse avait toujours été étrangère !
De Chénier ou d’un autre, ces vers sont profondément tristes, avec cet accent tragique et sombre qui est celui de toute la poésie ossianique. N’eût-ce pas été pour le jeune Berlioz une occasion d’y adapter une mélodie appropriée, lui qui a dit de lui-même : « Les essais de composition de mon adolescence portaient l’empreinte d’une mélancolie profonde. Presque toutes mes mélodies étaient dans le mode mineur. Je sentais le défaut sans pouvoir l’éviter ».
Or, lisons la romance : c’est un majeur douceâtre, dont les premières notes sont prises à Femme sensible, et dont l’ensemble n’a rien du caractère défini ci-dessus.
Mais reportons-nous à l’accompagnement. Chose étrange, il est en mineur ! Nous sommes en ut, et s’il n’a pas été possible au compositeur d’altérer le mi, par contre, il nous présente un la obstinément bémol, qui se répète avec une insistance marquant une intention des mieux arrêtées. Plus loin, il multiplie sous le chant, toujours majeur, les accords du relatif mineur, adaptés tant bien que mal. Pourquoi cela ? Parce que les paroles chantées sont celles-ci :
En vain la mort a fermé ta paupière,
O mon héros, je marcherai sans bruit
Pour me glisser en ta couche dernière
Dans le silence et l’ombre de la nuit.
De telles idées pouvaient-elles être traduites autrement que par des harmonies lugubres ? Berlioz n’en a pas douté. De sorte que l’examen de ce seul morceau suffirait à nous apprendre que les accompagnements de guitare sont de sa composition, tandis que les mélodies sont des produits des faiseurs ordinaires.
Au reste, pour en faire juge le lecteur et lui montrer avec quelle adresse, faite exclusivement de sincérité, Berlioz, ignorant des secrets de l’art, a su combiner les accents expressifs de son accompagnement avec les formes indifférentes de la romance Empire, nous en reproduirons les deux premiers vers :

Bien que cet examen ait été déjà fort long, nous voudrions le compléter par une triple confrontation qui lèvera les derniers doutes et fera ressortir le rôle de chacun dans l’élaboration du manuscrit et la composition des romances même.
Nous avons vu que la romance Fleuve du Tage est présentée, dans les documents manuscrits de la Côte-Saint-André, sous deux formes instrumentales différentes, et cette constatation m’avait fait supposer tout d’abord qu’un seul de ces accompagnements était de Berlioz ; car comment comprendre la raison pour laquelle il aurait pris la peine d’écrire deux accompagnements pour cet air connu ?
Mais quand il m’a été donné de les comparer tous deux avec celui de la romance originale (dont l’auteur se nommait Pollet), j’ai reconnu que, si dissemblables qu’ils fussent entre eux, ils l’étaient encore bien davantage avec ce dernier.
Je pense avoir trouvé l’explication de ce qui m’avait paru d’abord une anomalie.
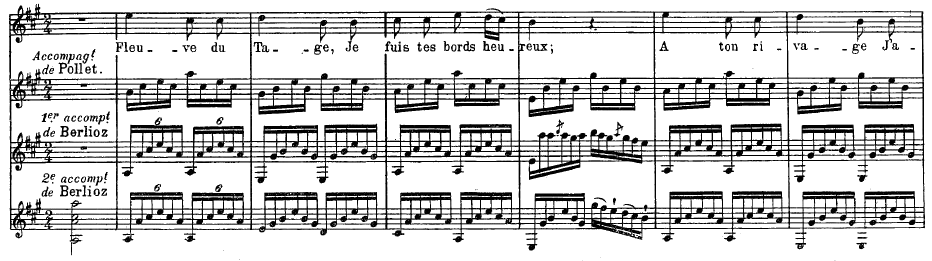
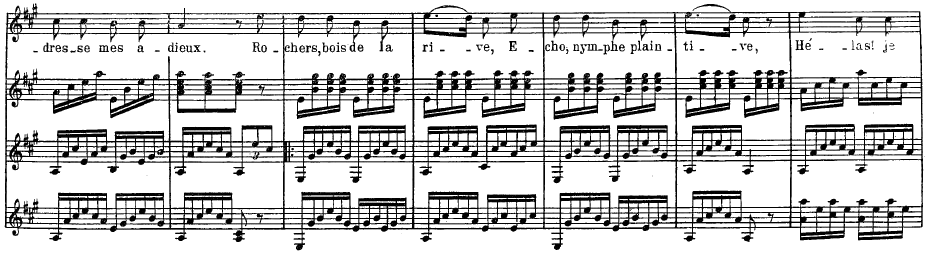

L’un des deux accompagnements manuscrits de la Côte est dans le cahier de Berlioz, tandis que l’autre figure dans un cahier signé Dorant. Ils se ressemblent tous deux, au début, par le rythme commun en sextolets (l’accompagnement de Pollet est dans le vulgaire rythme binaire), et leur caractère général est assez semblable ; mais le second porte les marques d’un travail plus soigné que le premier. La raison ? C’est que ces deux accompagnements sont du même auteur, qui est Berlioz, et que le second est un « corrigé » du premier, exécuté probablement avec les conseils du professeur, qui, le « chef-d’œuvre » achevé, lui fit les honneurs de son cahier. En effet, les quelques imperfections de la première forme ont disparu ; ce second accompagnement, seul entre tous, est parfaitement correct : il a même une certaine élégance classique, une recherche de notes de passage, d’accords renversés, de dessins formant rentrée, qui le rendent beaucoup plus intéressant que n’est l’accompagnement original, lequel ne sait que plaquer platement l’accord de tonique à côté de celui de dominante. La dernière reprise, même, forme comme une petite variation qui témoigne d’une louable préoccupation de diversifier les formes et de les rendre artistiques.
Par la transcription ci-dessus, le lecteur pourra se rendre compte de ces diverses observations, et connaître, sous ses deux formes successives et perfectionnées, cette première œuvre de Berlioz : l’accompagnement de la romance Fleuve du Tage (1).
Quelles conclusions aurons-nous à tirer de l’étude de ces documents au point de vue de l’évolution du génie et du développement de la nature de Berlioz ? Car c’est là principalement que devaient aboutir des observations si minutieuses. Et d’abord, quelle est, au point de vue chronologique, la place qu’occupe dans sa vie la transcription de ces cahiers et la composition des accompagnements ?
Cela, il nous est facile de le savoir à très peu de chose près. Reportons nous aux récits des Mémoires, précisés, quant aux dates, par les documents retrouvés à la Côte-Saint-André, ainsi que par les premières lettres connues de Berlioz. Celui-ci, tout enfant, avait commencé par apprendre, à peu près seul, à jouer de la flûte ; il avait continué l’étude de cet instrument sous la direction d’Imbert. Cet Imbert (on le verra par des documents conservés au Musée Berlioz, sur lesquels nous reviendrons tout à l’heure) était venu habiter à la Côte-Saint-André en mai 1817, et y était resté deux ans environ. Il enseigna à Berlioz le solfège, perfectionna son jeune talent de flûtiste, et l’exerça à chanter. Il fut remplacé en juillet 1819 par Dorant, qui lui donna principalement des leçons de guitare. Berlioz a gardé un souvenir sympathique à cet artiste de talent, qui fut en réalité son premier guide. Il le revit beaucoup plus tard, alors que lui-même était devenu célèbre : il a rapporté avec une visible satisfaction les circonstances dans lesquelles eut lieu cette rencontre. C’était en 1845 : Berlioz était allé donner à Lyon un concert pour l’exécution duquel il avait convoqué tous les musiciens de la contrée. Son vieux professeur, alors fixé à Vienne, ne manqua pas au rendez-vous ; aussi, pour le remercier, à la première répétition à laquelle il assista, le compositeur voulut lui faire les honneurs d’une présentation toute spéciale :
« Messieurs, dit-il aux artistes réunis, j’ai l’honneur de vous présenter un très habile professeur de Vienne, M. Dorant. Il a parmi vous un élève reconnaissant ; cet élève, c’est moi. Vous jugerez peut être tout à l’heure que je ne lui fais pas grand honneur ; cependant, veuillez accueillir M. Dorant comme si vous pensiez le contraire et comme il le mérite. »
« On peut se faire une idée de la surprise et des applaudissements, continue Berlioz. Dorant n’en fut que plus intimidé ; mais une fois plongé dans la symphonie, le démon musical le posséda tout entier ; bientôt je le vis rougir, en s’escrimant de l’archet, et j’éprouvai à mon tour une singulière émotion en dirigeant la Marche au supplice et la Scène aux champs exécutées par mon vieux maître de guitare que je n’avais pas vu depuis vingt ans (2). »
Maître de guitare : comme tel en effet, tout concorde à nous l’assurer, Dorant fut le seul guide qu’ait jamais eu Berlioz. Il a conté qu’après quelques mois de travail, le professeur s’en vint dire un jour à son père : « Il m’est impossible de continuer mes leçons à votre fils, il est aussi fort que moi. » Cependant, quelle que fût la facilité du jeune artiste, il lui fallut bien quelque temps avant d’être « passé maître », suivant son expression, et l’écriture de ses accompagnements témoigne qu’ils sont faits par quelqu’un qui sait se jouer des principales difficultés de la technique. Or, il n’eut les leçons de Dorant que pendant les deux années qui vont de juillet 1819, date de l’arrivée du professeur à la Côte, à octobre 1821, époque de son départ pour Paris. Je serais donc tenté de fixer pour date du cahier la fin de cette période, c’est-à-dire le courant de 1821, entre le mois de mars, où Berlioz passa son baccalauréat, et celui d’octobre, où il partit : libre de tout souci pendant ces mois d’été (les quelques études médicales que lui imposait son père n’ayant pas dû être bien absorbantes), il dut se livrer sans contrainte à son penchant ; le cahier de romances avec guitare est probablement la manifestation de son activité musicale durant ces jours heureux.
Berlioz venait d’atteindre sa dix-septième année.
Mais cet essai n’était pas le premier qu’il tentât : il y avait longtemps qu’il avait commencé de produire et écrit des compositions plus importantes et personnelles que ces simples accompagnements de guitare. Nous savons l’histoire de ses œuvres de musique de chambre, pot-pourri concertant à six parties, quintettes pour flûte et instruments à cordes ; nous connaissons aussi l’existence de ses romances en l’honneur d’Estelle, et n’ignorons pas que des thèmes extraits de ces productions de son inspiration juvénile ont pris place plus tard dans deux de ses grandes œuvres orchestrales. Or, des documents certains nous attestent que ces diverses œuvres sont bien antérieures à l’époque des romances avec guitare, antérieures même au moment où Berlioz commença l’étude de cet instrument : ce sont les deux lettres aux éditeurs parisiens Janet et Cotelle, puis Ignace Pleyel, l’une du 25 mars 1819, l’autre du 6 avril suivant, tendant à négocier la publication du pot-pourri concertant, des « romances avec accompagnement de piano et divers autres ». Tout cela était donc achevé à une époque où Berlioz venait d’accomplir sa quinzième année, et sans doute ce bagage déjà important était commencé depuis longtemps.
Les accompagnements de guitare représenteraient donc déjà une deuxième période de l’activité productrice de Berlioz. Cela même nous permet d’entrevoir la véritable nature et la raison d’être de ce travail. Ce qu’étaient ses premières compositions, nous l’ignorerons toujours, puisqu’elles sont détruites ; mais nous devinons sans peine que, si peut-être elles fourmillaient d’idées (le principal de ces chants que nous connaissons, premier thème de la Symphonie fantastique, est une inspiration admirable), elles devaient être, dans l’ensemble, absolument informes. Mais comment entreprendre des études méthodiques de composition dans un pays privé de toute ressource ? Le jeune homme, conscient de ce qu’il lui fallait apprendre, l’aurait bien voulu sans doute. Le talent qu’il acquit rapidement sur la guitare vint à propos lui en fournir quelque moyen : l’instrument, malgré des ressources si limitées, est, en somme, plus harmonique que mélodique : il essaya de le faire servir au progrès qu’il rêvait de réaliser, et entreprit d’écrire pour lui des accompagnements sous des airs connus. S’il en est ainsi, ces accompagnements devront donc être considérés comme des exercices pratiques d’harmonie, les premières études de ce genre auxquelles se soit adonné Berlioz. Il s’y livra seul, sans direction comme sans modèle : les incorrections dont l’écriture abonde en témoignent surabondamment. Une fois pourtant nous lui avons vu trouver un guide, Dorant, ce brave professeur de province, qui ne devait pas être bien savant en harmonie, mais qui paraît avoir aimé son art et en avoir acquis l’expérience : par des retouches indiquées à propos, il parvint à faire disparaître, dans un morceau, les fautes habituelles ; et c’est ainsi que nous avons vu, pour la première fois, l’harmonie de Berlioz se présenter sous des formes correctes, même élégantes.
Il se pourrait que cette première direction suivie nécessairement par le futur auteur de la Damnation de Faust ait eu sur lui une action plus efficace qu’on ne le croirait au premier abord. L’influence de la guitare sur le style harmonique de Berlioz, même sur certaines formes de son instrumentation, n’est pas douteuse, et peut être observée en de nombreux endroits de son œuvre. Ce n’est pas la meilleure qu’il ait subie en sa vie. Le piano, pour lequel il a affecté un dédain injuste et dont il a méconnu les précieuses qualités pratiques, l’aurait servi bien plus efficacement lorsqu’il cherchait seul à découvrir le secret et le principe de l’harmonie. La guitare, au contraire, instrument incomplet, ne pouvait que lui donner de mauvaises habitudes harmoniques, et il faut avouer que quelques-unes de ces habitudes, contractées dès l’enfance, lui sont restées.
Cette étude du cahier de la Côte-Saint-André aura donc eu l’avantage de nous aider à surprendre les causes de certaines particularités du style de Berlioz et de nous en révéler les origines lointaines, remontant à l’époque de la première formation de sa personnalité, et antérieures à toute étude classique et à toute influence extérieure.
____________________________________
(1) La romance originale est
gravée dans le ton de fa ; les deux accompagnements de Berlioz sont
en la. Nous adoptons ce dernier ton, et transposons en conséquence
l’accompagnement de l’auteur. Nous conservons également les quelques variantes
du chant qui se trouvent dans les manuscrits de la Côte-Saint-André, et que je
croirais plus volontiers provenir de copies défectueuses ou d’une tradition
incertaine que d’une intention arrêtée de Berlioz. Nous appelons :
« 1er accompagnement de Berlioz » celui de son cahier
autographe, et « 2e accompagnement de Berlioz » celui du
cahier de Dorant. Nous pensons enfin avoir indiqué avec une clarté suffisante
les différences que présentent les trois versions quant aux reprises du second
membre de phrase. Dans la romance originale, le chant est encadré par une
ritournelle que nous n’avons pas transcrite, les harmonisations de Berlioz n’en
offrant pas l’équivalent.![]()
(2) Les Grotesques de la
musique, p. 279.![]()
![]()
![]() Le Ménestrel, 13
Mars 1904,
p. 83-84
Le Ménestrel, 13
Mars 1904,
p. 83-84
Passons plus rapidement sur les autres séries d’objets qui nous restent à examiner au Musée Berlioz. Pourtant il en est une qui mérite de retenir encore notre attention, car elle se développe en quelque sorte parallèlement à celle des documents musicaux que nous venons d’étudier. Ce sont les pièces qu’on a trouvées daus les archives de la Côte-Saint-André, et desquelles il ressort qu’un mouvement musical inaccoutumé se produisit dans la petite ville, exactement pendant la période où Berlioz enfant grandissait et s’ouvrait aux premières impressions musicales, puis s’arrêta subitement, pour ne plus reprendre jamais, au moment même où le futur grand homme quitta le pays. Tout l’honneur de la découverte et de la présentation méthodique de ces documents revient à M. Jean Celle, le dévoué et très compétent secrétaire-archiviste du Musée Berlioz ; c’est d’après lui qu’il en sera fait mention ici, rien ne devant être omis des particularités susceptibles de jeter quelques lumières sur la formation du génie du grand musicien (1).
Ces documents sont compris exactement entre les années 1805 et 1821. En 1805, Berlioz était né depuis deux ans ; il partit pour Paris à la fin de 1821.
En 1805, les Côtois, pour la première fois sans doute depuis la naissance de leur vieille cité, éprouvent le besoin d’avoir une musique militaire. Le maire, M. de Buffevent, traite avec un marchand de musique de Lyon, nommé Bernard, pour l’acquisition d’instruments : clarinettes, bassons, cors, un bonnet chinois et « une bonne paire de cymbales de Constantinople ou de Smyrne, mais vraiment turques, qui valent quinze louis », enfin un serpent. Ce dernier instrument donne lieu à une négociation formulée en ces termes (2) :
Vous me demandez le prix du serpent. Je l’échangerai contre 16 bouteilles, c’est-à-dire chopines, d’eau de Canel des frères Durocher de la Côte. Ainsi le particulier jour sera favorisé dans le pays. Mais je veux de la bonne eau de Canel, et surfine, et de la plus vieille distillée.
Deux ans plus tard, le fournisseur des instruments procure aux Côtois le professeur de musique nécessaire à la direction de la troupe instrumentale. Voici comme il le présente au maire, par une lettre du 21 avril 1807 :
Je vous adresse avec la présente M. Bouchmann, professeur de musique, ayant été chef de musique dans différents corps, jouissant d’une honneur, et probité, connaissant parfaitement son état, jouant de la clarinette, donnant du cor, jouant de la flûte, basson et violon. C’est un sujet qui vous convient pour faire marcher votre musique et y mettre du zèle. Je lui ai fait part de la somme que vous lui donniez, qui est de cent francs par mois, et je l’ai décidé à partir de suite.
Le 6 mai suivant, ledit Bouchmann, en une lettre d’une écriture moulée, écrit à son tour :
M. le Mère, Je suis charmai da lai abithe Permis vos amateur…
Berlioz allait alors sur quatre ans : c’est un âge où les enfants sont sensibles aux sons éclatants et aux évolutions de la musique militaire. Maître Bouchmann fut donc l’homme qui lui donna la première idée de ce qui constitue l’art du chef d’orchestre. Les annales de la Côte-Saint-André ne disent pas s’il lui donna aussi des leçons d’orthographe. Il semble que non.
Sauf une liste de souscription signée de trente-six-noms, en août 1808, ayant pour objet de payer les appointements dudit Bouchmann, « qui est un homme à talents, les bons élèves qu’il a faits dans cette commune ne laissant aucun doute à cet égard », l’on ne trouve plus aucun document concernant la musique à la Côte jusqu’en 1817.
C’est à ce moment que nous voyons paraître celui que Berlioz a nommé comme son premier professeur de musique, Imbert. Le 20 mai 1817 (le futur auteur des Troyens allait alors avoir treize ans et demi), la convention suivante fut dressée entre cet artiste et le maire de la Côte-Saint-André :
1° M. Imbert s’engage à donner des leçons de musique vocale et instrumentale à douze écoliers de la ville pour le prix de huit francs par mois ;
2° Il instruira la musique de la Garde nationale en la conduisant et en lui faisant faire deux répétitions par semaine ;
3° Si quelques-uns des musiciens peu fortunés de cette garde désirent prendre des leçons particulières, il les leur donnera pour le prix de cinq francs par mois ;
4° Le maire lui fournira, à ces conditions, un logement dans la maison commune, et lui assurera la somme de cent francs par mois dans le cas où les douze écoliers de la ville ne puissent pas la remplir ;
5° Les présentes compteront pendant une année à compter de ce jour vingt mai 1817.
Ce traité, signé des deux seuls noms du maire, de Buffevent, et d’Imbert, fut renouvelé l’année suivante à pareille date ; mais cette fois les appointements du professeur de musique furent garantis, non par le maire seul (devenu alors Adolphe de Monts), mais par quelques notables habitants, au nombre desquels est compté le médecin Louis Berlioz.
Imbert avait un fils, dont parlent les Mémoires. Il en est aussi question dans un des documents du Musée : une demande du « capitaine de musique » de la Garde Nationale adressée au commandant du bataillon à l’effet de faire confectionner un petit habit d’uniforme « au fils de M. Imbert, qui joue assez bien de la clarinette pour sortir avec la Garde nationale ».
On sait par les Mémoires que cet enfant se suicida. Le père quitta la ville, où il fut remplacé par Dorant. Voici le texte du traité qui fut conclu avec ce dernier, non plus cette fois par le maire, mais par des particuliers, en tête desquels figure le père d’Hector Berlioz :
Entre les soussignés :
MM. Berlioz, Bert, Rocher Antoine et Rocher fils, d’une part ;
Et M. Doran (3), maître de musique, d’autre part :Il a été convenu que M. Doran donnera des leçons de musique vocale et instrumentale à huit élèves au moins, au prix de dix francs par mois chacun, pendant une année, à dater du 24 juillet 1819.
Les soussignés répondent de ces huit élèves, de manière que si au bout de l’année (un mois compensant l’autre) M. Doran ne recevait pas le prix qui devrait lui revenir des leçons des huit élèves promis, les soussignés s’engagent à le lui compter, et dans le cas où M. Doran aurait plus de huit élèves pendant la dite année, le surplus sera pour lui.
En conséquence, M. Doran voudra bien donner à l’un des soussignés le compte de ses recettes de chaque mois, pour constater les compensations à faire dans le cas d’un déficit.
Fait en double à la Côte-Saint-André, le 24 juillet 1819.Signé : Louis BERLIOZ, médecin, BERT, LOUIS ROCHER fils, ANTOINE ROCHER.
Le dernier de ces documents est un « Inventaire des instruments de musique de la garde nationale de la Côte-Saint-André appartenant à la commune », dressé le 1er avril 1821. Il comprend : 2 premières clarinettes en fa, 7 clarinettes en ut, une petite flûte quinte, une petite flûte octave, 1 basson, 3 cors, une trompette à pistons, grosse caisse, cymbales. Chacun de ces instruments porte en regard la mention de son titulaire ; Dorant a la lre clarinette, et l’on trouve sur la liste bien des noms encore répandus dans le pays : Paillet, Faure, Jacquier, etc. C’étaient les amateurs de musique de 1821, grands-pères de ceux d’aujourd’hui. L’inventaire est complété par l’indication de quelques instruments sans titulaires : 1 trombone, 1 triangle, 1 vieux cor, une vieille trompette, des pupitres et « 8 Beaubêches ».
Six mois après qu’on eut établi ce dénombrement des forces musicales de la Côte-Saint-André, — forces peu imposantes en vérité, — Hector Berlioz partait pour Paris. Presque aussitôt après, Dorant, n’ayant plus rien à faire, à ce qu’il semble, après la perte d’un tel élève, retournait à Vienne. Et la petite ville fut dès lors privée de musique, — jusqu’au jour où la commémoration de l’enfant devenu un maître illustre y fit renaître et progresser un goût qui n’a jamais existé qu’à cause de lui dans son pays natal.
____________________________________
(1) J’ai résumé brièvement ces documents et en ai
reproduit quelques traits caractéristiques dans mon livre : Hector
Berlioz et la société de son temps ; je les donne ici de façon plus
détaillée.![]()
(2) Nous respectons l’orthographe de tous ces documents,
si peu respectable qu’elle soit !![]()
(3) Toutes les signatures, ainsi que les divers écrits de
Berlioz, sont d’accord pour orthographier ce nom : Dorant. Nous conservons
néanmoins au document cité sa forme authentique, jusque dans ce détail fautif.![]()
![]()
![]() Le Ménestrel, 27
Mars 1904,
p. 99-100
Le Ménestrel, 27
Mars 1904,
p. 99-100
Le Musée Berlioz est encore peu riche en autographes musicaux, ou en lettres originales. Il a peu de chances d’acquérir les premiers, dont le nombre est limité, et que leurs possesseurs (bibliothèques publiques ou collections particulières) conservent avec un soin jaloux et bien légitime. Par contre, il peut espérer accroître sa collection de lettres, dont on découvre chaque jour des séries nouvelles, parfois du plus haut intérêt. Celles que nous aimerions y voir un jour sont principalement celles qui rappellent les relations de Berlioz avec son pays, envoyées d’ici même à divers correspondants, ou écrites de loin à ceux qui étaient restés. Une telle collection serait doublement précieuse en un tel lieu et à côté de tant d’autres souvenirs vivants de sa présence.
La première lettre serait, nécessairement, la plus ancienne : celle qui, portant en tête cette indication : La Côte, le 25 mars 1819, fut adressée par lui aux éditeurs Janet et Gotelle, pour leur proposer d’éditer ses premières œuvres. Cette précieuse relique appartient à M. Charles Malherbe, si riche en souvenirs autographes de Berlioz. L’original de la seconde, écrite une quinzaine de jours après, pour le même objet, à un autre éditeur, Ignace Pleyel, est exposé en place d’honneur dans les salons de la maison Pleyel.
Mais voici une série du plus grand intérêt pour la connaissance de la vie intime d’Hector Berlioz : ce sont les lettres que le jeune étudiant en médecine écrivit aux siens pour leur donner des nouvelles de sa vie parisienne, et qui se continuèrent sans arrêt pendant toute la durée de sa carrière d’artiste. La première qui nous soit connue, adressée à sa sœur Nancy (plus jeune que lui de trois années environ), nous est parvenue en assez piteux état [CG no. 11]. Le papier a été visiblement utilisé comme patron pour un ouvrage de femme, exécuté sans nul doute dans la calme maison familiale de la Côte : il est tout criblé de piqûres d’aiguille, coupé aux ciseaux sur un des bords, et a perdu son second feuillet. La lettre est datée du 20 février 1822 : il y avait donc à peine quatre mois qu’Hector, âgé de dix-huit ans, était parti pour la capitale. Les souvenirs de la vie de famille lui reviennent en foule, et il y compare les plaisirs de Paris :
Paris, ce 20 février 1822.
Comment passes-tu ton carnaval, ma chère sœur ? Comme un carême, je gage ; le passage de l’un dans l’autre ne sera pas bien brusque, n’est-ce pas ?… Je t’en puis bien dire autant ; j’ai pourtant reçu ces derniers jours 4 invitations de bal de la part de M. Teisseyre, tant pour aller chez lui que chez des personnes de sa connaissance. Nous (1) avons refusé les deux premières, mais lui étant allé faire une visite et ayant avoué que nous savions danser, il nous engagea pour le vendredi et le dimanche gras de manière à ne pas pouvoir refuser. Nous y allâmes donc. Tu crois peut-être que les bals de Paris sont bien différents des nôtres, et tu te trompes : toute la différence consiste en ce qu’on est beaucoup plus nombreux, qu’on danse à 60 au lieu de danser à 16 comme chez nous, que malgré la grandeur des salons on est tellement jonché que les danseurs sont obligés de se tenir derrière les danseuses faute de place ; et de faire continuellement attention où on met les pieds pour ne marcher (sur) personne. Le costume est uniformément blanc pour les dames et noir pour les hommes. L’orchestre ! Tu croiras peut-être qu’il est superbe ? Eh bien il n’est pas même comparable aux nôtres ; figure-toi deux violons et un flageolet ; s’il n’y a pas de quoi faire pitié, deux violons et un flageolet ! Oh ! Je n’en revenais pas. Encore ces 3 malheureux jouèrent presque toute la soirée des contredanses tirées des ballets que j’ai entendus à l’Opéra ; tu peux penser quel joli parallèle. Enfin nous n’y tînmes plus, nous partîmes à une heure en cherchant le moyen d’éviter la soirée de dimanche. L’occasion se présenta bientôt. Nous allâmes voir mon oncle, qui nous dit qu’il fallait que nous dînassions ensemble le lendemain ; en conséquence nous écrivîmes à M. Teisseyre, comme si mon oncle ne faisait que passer, qu’il désirait passer la soirée avec nous, ce qui nous dégagea très bien.
Nous fîmes un diner charmant avec le cousin Raymond et mon oncle ; après nous allâmes à Feydeau entendre Martin ; on jouait ce soir-là Azemia et les Voitures versées ; ah ! comme je me dédommageais ! J’absorbais la musique. Je pensais à toi ma sœur, quel plaisir tu aurais à entendre cela. L’Opéra te ferait peut-être moins de plaisir, c’est trop savant pour toi, au lieu que cette musique touchante, enchanteresse, de Dalayrac, la gaîté de celle de Boieldieu, les inconcevables tours de force des actrices, la perfection de Martin et de Ponchard… Oh ! tiens, je me serais jeté au cou de Dalayrac si je m’étais trouvé à côté de sa statue, quand j’ai entendu cet air auquel on ne peut point donner d’épithète : « Ton amour, oh ! fille chérie ». C’est à peu près la même sensation que celle que j’ai éprouvée à l’Opéra en entendant dans Stratonice celui de « Versez tous vos chagrins dans le sein paternel ». Mais je n’entreprends pas de te décrire encore cette musique…
La fin manque (2).
Trois autres lettres sont adressées à sa sœur Adèle, née en 1814 ; elles ne sont pas datées, mais aucune ne paraît être postérieure à la grande secousse shakespearienne de 1827, et nous savons par d’autres documents que, dès 1824, peut-être même 1823, Berlioz était déjà reçu dans l’intimité de la famille Lesueur, dont il est fait là plusieurs mentions. Il est question encore de bals : Berlioz apparaît mélancolique à son ordinaire, déjà semblable au ténébreux personnage qui bientôt promènera son « idée fixe » à travers la danse de la Symphonie fantastique. Et le tableau de la vie de la famille semble se préciser quand nous lisons, par exemple, les encouragements du grand frère à sa petite sœur qui, déjà rêveuse, comme il est lui-même, — tous enfants du siècle ! — s’isole dans la grande maison bourgeoise, et se dépite de ne pas pouvoir partager les plaisirs mondains de la sœur aînée.
Voici des fragments de ces trois lettres [CG nos. 101, 20, 39] :
Je ne t’écris qu’une toute petite lettre pour te remercier des tiennes. J’apprends avec bien du plaisir que mon oncle soit venu rompre un peu l’uniformité de votre existence à La Côte ; mais je suis peiné de te voir triste comme tu le parais dans tes lettres. Je pense que l’espèce d’isolement que tu te crées à toi-même est la cause de ton ennui. Je voudrais bien connaître quelque moyen de distraction pour t’offrir. Ne cherche pas toujours à comparer ta manière de vivre avec celle de Nanci ; songe que la différence d’âge en établit nécessairement une dans tous les rapports que vous avez l’une et l’autre avec la société.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ma pauvre Adèle, ta lettre a bien failli être perdue ; tu l’avais si bien cachée dans un livre que j’ai demeuré persuadé pendant trois jours qu’elle était égarée ; c’est en cherchant de nouveau que j’ai fini par la découvrir. J’ai fait ta commission à Mlle Clémentine Lesueur ; elle te remercie et me charge de te dire mille choses de sa part.
J’ai été obligé d’aller au bal il y a trois semaines, j’étais l’un des chevaliers de ces dames. Tu peux penser comme je me suis ennuyé. Aussi en arrivant, M. Schlösser (3) et moi avons dansé la première contredanse avec les demoiselles Lesueur, puis, ayant été demander la demoiselle de la maison, elle nous a répondu qu’elle était engagée pour quatorze ; nous nous sommes donc retirés du monde, et je n’ai été que spectateur toute la soirée ; il y avait dix fois plus de danseurs qu’il n’en fallait.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tu as donc été malade, ma pauvre Adèle ? Je suis bien aise d’apprendre que ton malaise n’a pas duré assez longtemps pour t’empêcher de bien t’amuser. Il paraît que la Côte s’est un peu dégourdie cet hiver ; tant mieux. On commence à te trouver assez grande personne pour t’admettre volontiers dans les brillantes réunions ? Allons, tout n’est pas perdu, puisque chez vous
L’on rit, l’on jase et l’on raisonne
Et l’on s’amuse un moment (4).Tu me demandes si je suis allé au bal cet hiver avec les dames Lesueur. J’y suis allé une fois, mais elles ont eu la bonté de me dispenser des autres réunions où elles auraient pu me conduire ; elles savent combien je m’y ennuie.
Je ne vais presque jamais dans ce qu’on appelle le monde. Le vendredi soir je vais assez ordinairement dans une maison où l’on fait de la musique ; je m’y plais assez, parce qu’on y boit du bon thé, et que j’ai une passion pour cette boisson ; cela m’aide à avaler la musique qu’on y fait.
Finalement, je m’amuse beaucoup.
Voilà plus d’une demi-heure que je me creuse la tête pour te dire quelque chose d’intéressant. Je ne puis rien trouver. Embrasse Prosper (5) pour moi. Qu’a-t-il fait de son terrible sabre ? A-t-il toujours d’aussi belles dispositions pour faire des grimaces ?
Sois sans inquiétude sur les moyens de te faire parvenir mes lettres quand je serai dans les pays étrangers, je t’assure qu’on peut s’écrire partout ; il n’y a qu’un pays où les lettres ne parviennent pas : c’est celui d’où personne ne revient.
Enfin… Adieu.
H. BERLIOZ.
On peut rapprocher de ces extraits la phrase suivante d’une lettre à Humbert Ferrand, écrite pendant un séjour de Berlioz en Dauphiné, le 16 septembre 1828 [CG no. 99] : « Le désir de mes sœurs et de nos demoiselles est peut-être un peu intéressé ; il est question de bals, de goûters à la campagne; on cherche des cavaliers aimables, ils ne sont pas communs ici, et quoique ce soit peut-être un peu pour moi que ce remue-ménage se prépare, je ne suis pas le moins du monde fait pour y répandre de l’entrain ni de la gaieté. » Ophélie avait alors fait son apparition, et l’humeur sombre du jeune artiste s’en était accrue ; mais n’importe : il fallait que l’on organisât toujours des bals et des goûters sur l’herbe à la Côte-Saint-André.
Déjà d’ailleurs la correspondance porte des traces des difficultés qui devaient altérer pour un temps la bonne entente qui régnait entre Hector et tous les autres membres de la famille. Il n’y a que sa jeune sœur, tendrement chérie, qui lui soit restée fidèle jusque dans les moments les plus critiques. Mais voici une lettre écrite de Paris à la sœur aînée, le 12 décembre 1825, d’où il apparaît que la situation commence à se tendre [CG no. 50]. Le jeune artiste, après une déclaration vibrante de ses aspirations, y entreprend une discussion qui tournerait facilement à l’aigre ; on en jugera par le paragraphe suivant :
Ta lettre est venue bien mal à propos ; et, en effet, ce que tu m’apprends n’est pas propre à me calmer. D’abord la mort de M. Rocher et le conseil que tu me donnes de ne pas oublier d’écrire à Edouard. As-tu pu penser, ma chère sœur, que je négligerais de m’acquitter d’un devoir que la liaison la plus légère imposerait ? Ou bien t’es-tu persuadée avec quelques personnes que, mon amitié pour Edouard étant devenue moins démonstrative que dans le temps où j’en ressentais pour la première fois le charme, elle avait réellement diminué ? Dans l’un et l’autre cas tu te trompes actuellement.
Les noms des différents membres de la famille Rocher, qui n’a pas cessé d’être honorablement connue depuis un siècle et plus à la Côte-Saint-André (un de ses descendants, M. Fernand Rocher, est aujourd’hui un des plus actifs propagateurs de l’œuvre du Musée Berlioz) paraissent fréquemment dans les lettres de la jeunesse de Berlioz ainsi que dans les documents qui le concernent. Nous en avons déjà trouvé deux sur l’acte d’engagement du professeur Dorant. Écrivant à Hiller, en 1831, pendant l’arrêt qu’il fit à la Côte en allant de Paris à Rome, Berlioz spécifie [CG no. 203] : « Je vous écris dans le salon de Rocher, qui me charge de le rappeler à votre souvenir. » Pourtant on n’a retrouvé aucune des lettres qu’il adressa sûrement à ces amis d’enfance.
Nous ne saurions passer en revue toutes les lettres de Berlioz qui rappellent ses relations avec son pays. Mentionnons simplement, comme présentant un intérêt particulier, la lettre du 16 septembre 1828 écrite de Grenoble à Humbert Ferrand, où il dit que, pendant un voyage en voiture fait de la Côte à cette ville, il a composé la ballade du Roi de Thulé, la même qui, dix-huit ans plus tard, a pris place dans la Damnation de Faust ; plusieurs lettres de 1831, à Ferdinand Hiller, dans lesquelles, si loin de Paris, et si vite oublié, il discute sur la fidélité de Mlle Camille Moke, et l’affirme avec autant de résolution que de témérité ; la lettre à Mme Horace Vernet, au retour de Rome (25 juillet 1832), où il se révèle homme du monde, et trace un tableau charmant de sa chère vallée de l’Isère au printemps [CG no. 282] : « Je l’ai revue dans son meilleur moment ; la coquette semblait s’être mise en frais d’atours extraordinaires pour me prouver, à mon retour, qu’elle n’avait rien à envier aux beautés étrangères. » A son ami Gounet, il écrivait plus prosaïquement, quinze jours auparavant (10 juillet) [CG no. 280] : « Ici je fais mon métier ordinaire de vagabond, de campagne en campagne, oncles et tantes et cousines et amis mariés, d’autres se mariant, noces et festins, parties de boules, baignades, sottes réflexions, tambours en troupes nombreuses que j’aime à suivre comme les enfants. » Au reste il ne ménage pas ses sarcasmes à ces provinciaux quand ils veulent se mêler de littérature ou d’art : « Malgré mes supplications de n’en rien faire, on se plaît, on s’obstine à me parler sans cesse musique, art, haute poésie ; ces gens-là emploient ces termes avec le plus grand sang-froid ; on dirait qu’ils parlent vin, femmes, émeute ou autres cochonneries. Mon beau-frère surtout, qui est d’une loquacité effrayante, me tue. » (13 juillet, à Humbert Ferrand [CG no. 281]). Heureusement il trouve des compensations dans l’affection des siens : « Je suis en effet avec ma famille, écrit-il le 7 août à F. Hiller [CG no. 284] ; mais je n’ai que ma sœur cadette qui m’adore, et je me laisse adorer d’une manière fort édifiante. » C’est sans doute pendant ce même séjour à la Côte-Saint-André qu’eut lieu l’aimable scène idyllique de leur promenade bras dessus bras dessous sous la pluie, épisode que racontent les Mémoires, et dont on retrouve un autre récit dans les lettres à la Princesse Wittgenstein. Cette dernière série de la correspondance de Berlioz, bien que datant d’une époque très postérieure, contient aussi maints retours au passé et récits de jeunesse, impressions de nature, souvenirs virgiliens, etc.
Mais voici une lettre d’une bien autre nature : elle est relative aux plus graves difficultés qu’ait eues Berlioz avec les habitants de la Côte-Saint-Àndré, celles auxquelles donna lieu son projet de mariage avec miss Smithson. On y verra que cette union avec une actrice ruinée fit un tel scandale dans la petite ville de province que ses plus anciens amis l’abandonnèrent. La lettre, dont l’original appartient à M. Maignien, bibliothécaire de la ville de Grenoble, est adressée à un M. Charavel, juge de paix à La Tour-du-Pin [CG no. 331].
Paris, 29 mars (1833).
Monsieur,
Quoique je n’aie pas l’honneur d’être connu de vous, Duchadoz, notre ami commun, m’engage à vous demander un service qui est d’un très grand prix à mes yeux. Seriez-vous assez bon pour accepter ma procuration et présenter avec M. Simian, notaire à la Côte-Saint-André, deux actes respectueux à mes parents ? Le mariage que je veux contracter ne leur convenant pas, je me suis vu forcé d’employer ce moyen. La première sommation a été faite à la fin de février dernier ; mais des considérations de famille empêchant mon ancien ami M. Edouard Rocher de continuer, je vous prie instamment, Monsieur, de vouloir bien le remplacer. C’est un service que je ne pourrai jamais assez reconnaître ; Duchadoz et moi nous pensons que, les raisons qui arrêtent M. Rocher n’existant pas pour vous, il vous sera facile de me tirer d’embarras.
Veuillez, Monsieur, recevoir d’avance tous mes remerciements, et mes excuses pour mon indiscrétion.
Votre dévoué serviteur,
HECTOR
BERLIOZ,
Rue Neuve-Saint-Marc, n° 1.
____________________________________
(1)
Nous, c’est, outre Berlioz, son cousin Alphonse Robert, avec qui il était venu
de la Côte-Saint-André à Paris pour étudier la médecine (voy. Mémoires,
chap. IV, V). Ce parent est souvent mentionné, par son simple prénom, dans les
lettres d’Hector à sa famille. — Rectifions une erreur de mémoire commise
dès les premières pages de ces Berlioziana (Ménestrel du 3
janvier 1904) : ce n’est pas Charbonnel,
c’est Robert qui fut le premier
compagnon de voyage de Berlioz : c’est seulement quelques années plus tard
qu’eut lieu entre Charbonnel et lui l’association amicale dont il est parlé
dans les Mémoires.![]()
(2) Le dernier paragraphe de
cette lettre avait déjà été reproduit, avec des inexactitudes,
dans
l’Appendice de la Correspondance inédite (2e et 3e
éditions) ; tout le reste est inédit. L’original de la lettre est plein
de fautes d’orthographe, ou d’orthographes surannées, qu’il ne nous a pas paru
nécessaire de reproduire.![]()
(3) Louis Schlösser
(1800-1886), concertmeister, puis kapellmeister à Darmstadt, avait été
élève du Conservatoire de Paris (classe Lesueur et Kreutzer), et, comme tel,
camarade de Berlioz ; son nom est mentionné dans les Mémoires (Premier
voyage en Allemagne). Son fils, M. Adolphe Schlösser, ancien professeur de
piano à la Royal Academy of Music de Londres, prépare à son tour des
Mémoires qui contiendront plusieurs lettres inédites de Berlioz.![]()
(4) Citation par à peu près
d’une chanson intercalée dans les Visitandines.![]() nbsp;
nbsp;
(5)
Prosper Berlioz, le dernier enfant de la famille, né en 1820. Il en est
toujours parlé dans les lettres de Berlioz sur le ton le plus affectueux,
contrairement aux hypothèses prématurées d’un biographe.![]()
![]()
![]() Le Ménestrel, 3
Avril 1904,
p. 107-8
Le Ménestrel, 3
Avril 1904,
p. 107-8
Aussi, même quand le calme fut revenu et la famille dispersée, c’est presque toujours sur le ton du sarcasme que Berlioz parle des gens de son pays. En 1847, à la veille de partir pour le Dauphiné qu’il n’a pas revu depuis quinze ans, il écrit à d’Ortigue [CG no. 1127] : « Je m’attends à être passablement assommé par les conversations côtoises, viennoises et grenobloises ; mais je suis bronzé… Je vois d’ailleurs, d’après ce que tu me narres, que nous sommes beaucoup moins melons en Dauphiné qu’en Provence… »
Puis ce sont les deuils, et à leur suite les partages de successions, les ventes de biens : « Figure-toi, écrit-il à son fils en novembre 1865 [CG no. 3061], que l’acquéreur de mon domaine du Jacquet qui devait me payer ces jours-ci vingt mille francs, qui s’y était engagé par écrit dans le contrat, me fait dire tout simplement qu’il n’est pas en mesure et qu’il me paiera une forte somme à Pâques, c’est-à-dire dans six mois et demi. Mon beau-frère me dit qu’il n’y a pas d’inquiétudes à avoir, parce que ce monsieur est riche. Mais j’aimerais mieux un pauvre qui paye qu’un riche qui ne paye pas… Ce serait curieux si la Banque de France, qui, elle aussi, est riche, s’avisait, quand on lui présente un billet, de dire quelle n’est pas en mesure. »
Le désenchantement est venu avec la vieillesse. Et voici quel tableau, pris sur le vif, mais dépouillé de toute illusion, trace à la fin celui qui, du pays natal, ne voyait naguère que les plus beaux aspects. C’est dans une des dernières lettres de Berlioz à son fils, lequel, las de voyager sur mer sans relâche, aspirait au repos d’une vie sédentaire ; sur le ton de la satire, le père écrit [CG no. 3066] : « Il faut rester à terre, à Grenoble, à Glaix, être juge de paix, bon citoyen, savoir vendre son blé, ses moutons, son vin, etc. Alors on est un homme calé, on joue aux boules le dimanche, on a un tas de sales enfants que les grands-parents trouvent fort mal élevés ; on s’ennuie à devenir huître ; on a une femme qui grossit, qui devient obèse, et qu’on finit par ne plus pouvoir souffrir, et l’on se dit : « Ah ! si c’était à recommencer ! »
C’est ainsi que Berlioz comprenait la vie de province.
Je ne sais si, parmi ses compatriotes, il s’en trouverait aujourd’hui qu’offenseraient ces sarcasmes. Je pense qu’aucun ne devrait s’en sentir atteint. Ces derniers traits sont d’ailleurs largement compensés par tant d’autres endroits où Berlioz déclare ses sentiments aux personnes aimées, dit son attachement au pays, et célèbre le charme de la nature, dont nul aussi bien que lui n’a su pénétrer la poésie. Et ce serait vraiment un document du plus haut intérêt que celui qui réunirait, dans la maison même où son esprit s’est formé, les écrits originaux exprimant sa pensée intime sur tout ce qui a vécu là, et sur le milieu ambiant considéré dans ce qu’il a d’encore vivant, encore réel. Une telle collection, en un tel lieu, serait ce qui pourrait être obtenu de plus précieux, et nous exprimons bien volontiers le vœu — tout platonique d’ailleurs, et probablement irréalisable — qu’elle puisse être rassemblée quelque jour et déposée au Musée Berlioz.
Les habitants de la Côte-Saint-André ont, depuis une quinzaine d’années, dignement rendu à leur compatriote les hommages qui lui sont dus. Ils lui ont élevé une statue, ont placé une plaque commémorative sur la façade de sa maison, et ont célébré son centenaire avec une joie sincère. Et voici qu’aujourd’hui ils songent à faire une œuvre durable en fondant une Association Berlioz, dont les premiers articles des statuts définissent le rôle en ces termes :
ARTICLE PREMIER.
Il est fondé une association dans le but :
1° De maintenir, entretenir et développer le Musée récemment créé à la Côte-Saint-André dans la maison natale d’Hector Berlioz ;
2° De poursuivre l’acquisition de cette maison, pour la conserver au culte des admirateurs du Maître, et y installer convenablement les souvenirs et collections qui se rattachent à sa personne et à ses œuvres.
ART. 2.
L’Association prend le nom d’Association Berlioz.
Elle a son siège social à l’hôtel de ville de la Côte-Saint-André, en attendant qu’elle le puisse transporter dans la maison Berlioz.
ART. 3.
L’Association se compose de Membres actifs et de Membres d’honneur.
Sont Membres actifs les adhérentes et adhérents agréés par le Bureau, qui versent une cotisation annuelle de dix francs ou s’en libèrent par un versement unique de cent francs.
Les Membres d’honneur sont choisis parmi les personnalités ou les généreux donateurs qui ont apporté moralement ou matériellement un concours efficace à l’Association.
Rien ne fait plus d’honneur à un pays que le souci qu’il prend de consacrer ainsi le souvenir de ses gloires. La Maison Berlioz deviendra donc bientôt, nous voulons l’espérer, un centre d’activité artistique et intellectuelle auquel la ville de la Côte-Saint-André ne sera pas seule intéressée, mais sur lequel se porteront les regards de la France entière, et, j’ose le dire, de tout l’univers pensant.
Cela dit, et ce juste hommage rendu aux bonnes intentions et aux actes louables du temps présent, retournons encore au passé et cherchons à nous remémorer la place que Berlioz tenait dans les préoccupations de ses compatriotes avant qu’il fût reconnu pour une gloire mondiale.
Il faut l’avouer : cette place était mince.
Nul n’est prophète en son pays ; il est trop vrai que Berlioz le fut moins que personne. Il y demeura incompris non seulement pendant sa vie entière, mais, il faut bien le dire, alors que le succès était pourtant venu à son œuvre. Il a passé parmi les siens comme un phénomène curieux, qu’on était plus tenté de railler que d’admirer. Je croirais volontiers que plusieurs de ses compatriotes ont été un peu surpris de tant d’hommages rendus à un homme qui, dans leur esprit, n’a rendu aucun service à son pays, puisqu’il n’a rien fait que de composer de la musique.
C’est en 1883 que, tout vibrant de l’enthousiasme causé depuis sept ans et plus par la révélation triomphale de ses chefs-d’œuvre, j’allai pour la première fois à la Côte-Saint-André. J’étais donc enfin dans le sanctuaire ! Désirant être guidé dans mon pèlerinage, j’allai voir le maire, qui n’était pas encore M. Henri Meyer, si actif pour l’organisation des honneurs rendus aujourd’hui à l’enfant de sa commune, mais un vénérable vieillard, M. Paret, qui avait bien connu les différents membres de la famille Berlioz. J’en reçus l’accueil le plus bienveillant, et il commença ainsi :
« Monsieur Hector a eu environ cent mille francs au décès de ses parents. Il possédait une vigne par ici ; il l’a vendue pour tant d’argent, à telle personne. Son beau-frère, qui était notaire, administra sagement les biens indivis… » Tel était l’intérêt des souvenirs que savaient rappeler sur l’artiste les habitants les plus éclairés de sa ville natale.
Sur quoi, l’honorable magistrat prit la peine de me conduire devant la maison où était né « monsieur Hector », mais nous n’en pûmes guère voir que les murs, son appropriation d’alors à une industrie quelconque n’en permettant pas la visite.
Le soir, j’entendis, en passant, répéter la fanfare du lieu, et je déclare que ce qu’elle tentait d’exécuter ne ressemblait en rien à du Berlioz.
De mauvaises langues ont blasonné ses compatriotes en contant l’anecdote suivante. Un régiment en marche passait par la Côte-Saint-André et y faisait séjour. Le chef de corps, suivant l’usage, prescrivit que la musique jouerait sur la grande place ; puis, mandant le chef, il lui donna l’ordre spécial d’inscrire sur le programme un morceau de Berlioz. L’officier dit : « Oui, mon colonel », fit le salut militaire, et sortit. Mais son embarras était grand, car sa compagnie musicale n’avait, naturellement, pas une note de Berlioz à son répertoire. Un trait de génie l’illumina soudain : se conformant à l’ordre donné, il mit au programme ces mots :
Marche Hongroise . . . . . . . . HECTOR BERLIOZ.
Puis il fit placer sur les pupitres la Marche Indienne de Sellenick. Les Côtois accoururent en foule, écoutèrent avec la plus grande attention, applaudirent, et se retirèrent en convenant qu’en effet monsieur Hector avait un grand génie…
L’histoire est évidemment inventée à plaisir. Mais, comme a dit un homme d’esprit, qu’y a-t-il souvent de plus vrai que ce qui n’est pas arrivé ?
Plusieurs années après le voyage dont je viens d’évoquer le souvenir, j’en fis un autre à Grenoble, capitale du Dauphiné, et centre intellectuel. Les personnes avec qui je m’entretins de Berlioz n’osèrent pas trop m’avouer que le bruit public disait qu’il était un peu fou… Un ami (qui n’est pas de Grenoble) me conduisit au Musée, et, me faisant entrer dans une galerie renfermant les portraits des grands hommes du Dauphiné, dit en toute confiance : « Allons voir Berlioz ». Nous vîmes Bayard, et Lesdiguières, et Condillac, et Vaucanson, et Barnave, et Stendhal, et Mme de Tencin, et d’autres célébrités moins éclatantes ; mais de Berlioz, pas la moindre trace. Depuis ce temps, on a représenté à la Comédie-Française une pièce où Grenoble est caractérisé par ces mots : « Ville où l’on a élevé une statue à un fabricant de gants, mais où Berlioz et Stendhal attendent encore la leur ». On sait qu’aujourd’hui ce desideratum est comblé pour moitié, et le musée de Grenoble est plein de souvenirs consacrés au grand homme. Mais je parle d’il y a dix ans.
![]()
![]() Le Ménestrel, 10
Avril 1904,
p. 116
Le Ménestrel, 10
Avril 1904,
p. 116
J’ai fait en ma vie trois voyages à Meylan. J’ai raconté ailleurs mes deux premières visites dans ce « romantique séjour » (1). Je me rappelle notamment avec un vif plaisir la « lecture populaire » improvisée que je fis, à l’auberge, d’une des pages les plus poétiques des Mémoires, et l’émotion qu’elle causa : car le peuple est le meilleur des publics, le plus vibrant, le plus sincère, le plus sensible aux impressions spontanées ; il s’agit seulement de savoir le prendre. Mais je m’en tiens à la troisième visite, que je fis en août 1903, quelques jours avant la célébration du centenaire à Grenoble. Je voulais revoir la maison du grand-père de Berlioz, où avait commencé le roman d’Estelle. Meylan est formé d’un grand nombre de hameaux très disséminés sur le flanc de la montagne. J’étais dans la principale agglomération, celle où se trouve l’église ; ne sachant comment me diriger, je pensai à aller voir l’instituteur, qui aurait pu sans doute me donner d’utiles indications sur la topographie et sur les souvenirs mêmes qui m’intéressaient. Avisant donc devant une porte un bambin de cinq à six ans, je lui demandai où était l’école. Je transcris la suite du dialogue.
L’ENFANT. — J’sais pas.
Moi. — Tu n’es donc pas de Meylan ?
L’ENFANT. —Si.
Moi. — Tu es de Meylan et tu ne sais pas où est l’école ? Faudra apprendre ça, mon garçon (il ne faut jamais négliger de donner de bons conseils à la jeunesse).
Sur ces entrefaites, survient une jeune femme, la mère de l’enfant ; elle m’apprend que l’école est loin d’ici, mais elle pourra peut-être me donner les renseignements que je désire : elle connaît le nom de Berlioz, et sait qu’on va célébrer son centenaire ; pourtant elle n’est pas du pays, et elle ignorait qu’il y eût laissé des souvenirs.
Mais voici que passent deux naturels de Meylan, mari et femme, revenant de la foire. Ma gracieuse interprète s’adresse à eux et leur demande s’ils connaissent la maison de la famille Berlioz. Je retranscris le dialogue.
LE MARI. — Berlioz ? Qué qu’c’est qu’ça, Berlioz ? (A sa femme) Tu connais ça, Berlioz ?
LA FEMME. — Berlioz ? Non, j’connais pas ça…
J’interviens et explique que Berlioz venait à Meylan pour voir son grand-père, qui se nommait Marmion. Le couple se consulte.
LE MARI. — Marmion ? Attendez voir… Oui, c’est à la ville (Il m’indique le chemin, et s’en va en disant, sur un ton d’affirmation triomphale) : Marmion, j’connais ça, mais j’connais pas Berlioz. Ah ! non ! J’connais pas Berlioz !…
Je n’oublierai jamais l’air de supériorité railleuse avec lequel cet indigène répondait à l’étranger assez naïf pour penser qu’on pouvait savoir, à Meylan, ce que c’est que Berlioz !
Mais revenons à Grenoble. On sait que c’est dans cette ville que Berlioz, invité par ses compatriotes à présider une fête musicale, fit son dernier voyage, après lequel il revint à Paris et ne se releva plus. Un témoin oculaire a fait du principal épisode de ce séjour un récit émouvant, qui a sa place marquée pour être reproduit dans ce travail documentaire :
Le 14 août 1868, à Grenoble, au soir d’un concours musical qui avait été l’une des manifestations les plus éloquentes de l’art populaire par excellence, alors que la vieille capitale du Dauphiné était toute vibrante et bruissante, en son cirque de monts altiers, d’acclamations, de vivats, de chœurs et de fanfares, de nombreux compositeurs ou artistes parisiens, juges du camp : — François Bazin, Besozzi, Elwart, Boulanger, L. de Rillé, Jonas, J. Monestier, Paulus, Dauverné, Couder, Kokken, Thibaut, bien d’autres encore, — se trouvaient réunis aux notabilités de la région, dans la galerie des fêtes de l’Hôtel de Ville.
Le convive que l’on attendait pour prendre place aux tables du banquet entra bientôt, soutenu par deux amis, et ce fut à sa vue, dans l’assistance joyeuse, un saisissement douloureux, une pitié profonde. Cet homme, au corps chétif, au pas incertain, le regard perdu et les cheveux retombant sur les tempes en larges plaques blanches ; cette tête médullaire, si fine et si accentuée, maintenant fruste sous les outrages de la maladie et des tourments de l’âme, ce cerveau brisé et cette intelligence presque éteinte par un accident affreux, c’était Hector Berlioz.
On le fit asseoir. Je le vois encore. L’expression de sa physionomie était celle d’un homme qui veut se rappeler, rattacher les liens épars de sa mémoire. Essayait-il de réveiller l’écho des applaudissements enthousiastes de la Russie ? Ou bien, pleurant sur son œuvre de prédilection, sur ses Troyens meurtris, répétait-il, comme Didon : « J’ai vécu ; j’ai rempli la carrière que les destins m’avaient ouverte » ? Sa pensée, où était-elle ? Était-elle seulement ? Parfois, ses lèvres frémissaient, et d’un geste indécis il y portait le verre dans lequel, instinctivement, il semblait vouloir retrouver et le souvenir et la force…..
L’heure des toasts venue, au nom de ses concitoyens, de ses admirateurs, au nom de deux cents Sociétés musicales accourues à Grenoble de tous les points de la France, au nom du Dauphiné fier de son glorieux enfant, le premier magistrat de la ville ceignit le front de Berlioz d’une couronne d’or. Il se laissa faire, inconscient, et se leva….. A ce moment l’orage, qui menaçait depuis plusieurs heures, éclate avec une violence inouïe, une rafale s’engouffre par les fenêtres ouvertes, déchirant les draperies, dispersant les fleurs, éteignant les lustres. Le tonnerre gronde ; l’éclair illumine les Alpes, de la base au sommet, et dans la pénombre, à la lumière d’un candélabre épargné par le vent, nous apparaît debout, dans sa pâleur marmoréenne, comme transfiguré, l’œil profond, les traits inspirés, avec cette noblesse particulière que la mort prochaine leur imprime, l’auteur de la Symphonie fantastique.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quelques instants après, Berlioz, replongé dans sa torpeur, quittait la salle comme il y était entré ; un silence religieux, solennel, suivit son départ. Évidemment, c’était là un homme foudroyé, et qu’on ne devait plus revoir. Le hasard avait voulu que cette fête devînt pour lui une apothéose et comme des funérailles anticipées. Rien n’y manqua, rien, pas même les discours d’apparat. Aussi, le 8 mars 1869, la mort ne prit-elle dans Berlioz qu’un cadavre vivant. C’était à Grenoble, à cette suprême apparition en public, que le dernier rayon d’intelligence, d’esprit, de génie, avait brillé et s’était éteint au front du créateur de l’École romantique musicale, de ce patricien de la pensée, auquel la France doit une gloire artistique : la Symphonie (2).
Si affaibli qu’il fût, Berlioz fut cependant touché par les témoignages d’admiration que lui donnaient pour la première fois ses compatriotes ; il écrivait bientôt à un russe, le critique Wladimir Stassoff, dans la dernière de ses lettres qui ait été retrouvée (du 21 août 1868) [CG no. 3373] : « Le maire de Grenoble m’a comblé de gracieusetés, il m’a donné une couronne de vermeil… »
Nous faisons ici l’envers de l’histoire : rapportons donc l’anecdote véridique de cette couronne de vermeil posée si à propos sur le front du vieux maître. Elle ne pourra qu’accuser le côté romantique de la scène, puisqu’un des principes du romantisme est le mélange du grotesque au sublime.
Quelque illusion qu’ait conservée Berlioz, il n’est pas vrai que la couronne qu’on lui décerna ait été commandée en son honneur : personne à l’avance n’aurait songé à cela ! Mais quand il fut assis à la table du banquet et que les toasts commencèrent, célébrant sa gloire, le maire comprit qu’il manquait quelque chose à la mise en scène. Avisant donc dans un écrin une couronne destinée au concours orphéonique — prix d’honneur, grand module, — il fit le geste de la poser sur la tête auguste du vieillard et l’y laissa un moment. Mais ce moment avait été assez long pour que Berlioz retirât de lui-même l’objet qui consacrait sa royauté artistique ; après quoi, se levant de table, il la mit sous son bras et l’emporta.
Le malheur est que cette couronne avait été gagnée, dans la journée même, par quelque Orphéon de la Tronche ou Écho du Grésivaudan, et qu’elle devait être remise, le lendemain, au cours de la distribution des récompenses à la Société victorieuse. Grand émoi dans la commission d’organisation du concours. On ne pouvait pourtant pas aller redemander la couronne à Berlioz ! D’autre part, qu’allait dire la Société primée ? Car on sait que les orphéons ne badinent pas avec ces choses. En effet, il y eut des explications plutôt orageuses ; la Société revendiqua énergiquement son droit et exigea sa couronne ; je ne jurerais même pas que Berlioz n’ait pas été accusé de l’avoir volée. En désespoir de cause, les organisateurs confièrent leur peine au généreux donateur, lequel n’était autre que l’ordre de la Grande Chartreuse. Le père procureur, auquel le cas fut soumis, sourit doucement, et ordonna que l’on achetât une seconde couronne. Ce fut ainsi que Berlioz put, sans être inquiété, rester légitime possesseur d’un objet destiné, dans l’origine, à récompenser les mérites d’un vulgaire orphéon.
Cette historiette est bien aussi intéressante à rapporter, je pense, qu’une citation de Scudo ! Ce sont choses d’ailleurs assez équivalentes quant à l’esprit.
____________________________________
(1) Julien Tiersot. Chansons
populaires des Alpes françaises, Préface.![]()
(2) Mathieu de Monter, Hector
Berlioz (étude biographique et critique entreprise au lendemain de sa mort),
Revue et Gazette musicale du 13 juin 1869.![]()
![]()
![]() Le Ménestrel, 17
Avril 1904,
p. 123-4
Le Ménestrel, 17
Avril 1904,
p. 123-4
Plus tard, l’ouragan fit encore rage au moment où, sur la plus belle place de Grenoble, fut découverte aux yeux du public la statue de Berlioz. L’ordre prévu pour la cérémonie d’inauguration en fut gravement dérangé ; mais, ce qu’on n’a pas dit encore, c’est que cet orage est venu fort à point pour sauver une situation qui, sans lui, eût été fort compromise. Voici les faits : après plusieurs mois, ils peuvent être racontés sans indiscrétion.
L’on sait que le centenaire de Berlioz fut célébré à Grenoble par un grand concours orphéonique. Sans doute, il y eut quelques petites choses à côté, mais le concours resta toujours l’essentiel pour la population. Ceux que le désir de rendre hommage à la mémoire du maître attira purent se rendre compte ainsi du degré d’abaissement auquel est tombée aujourd’hui l’institution orphéonique, sur laquelle on avait fondé jadis de si grandes espérances ; mais passons. La politique ne fut pas non plus sans jouer son rôle, ce qui ne fut pas sans altérer le caractère auguste qu’aurait dû conserver une telle solennité. Je ne rappellerai à ce sujet qu’un simple détail, qui a de la saveur. Le comité d’organisation des fêtes aurait désiré qu’un membre du gouvernement eût la présidence ; mais le gouvernement avait des raisons pour ne pas se rendre à Grenoble à ce moment-là : le ministre de l’instruction publique, voulant, très sagement, laisser à la commémoration de Berlioz un caractère purement artistique, délégua donc pour le représenter un inspecteur de l’enseignement musical, et il désigna tout d’abord M. Gabriel Fauré. Ce fut un beau tapage dans Grenoble ! Le gouvernement se dérobait !… Et voici en quels termes pleins d’un superbe mépris le journal de l’opposition annonça la nouvelle :
Le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts a fait savoir officiellement qu’il n’assisterait pas aux fêtes du centenaire de Berlioz.
Il a délégué, pour le représenter, M. Gabriel Fauré, inspecteur de l’enseignement musical, bien connu par ses manuels de solfège à l’usage des écoles primaires.
C’est ainsi que l’auteur de tant d’œuvres hautes et raffinées fut présenté aux Grenoblois comme un simple pédagogue à l’usage de l’enfance laïque !
Mais revenons à Berlioz. Le programme des fêtes de son centenaire comprenant l’inauguration d’une statue, quelques personnes pensèrent qu’il conviendrait de donner à la cérémonie un caractère qui sortît un peu de la banalité des fêtes officielles de province, et d’en faire une manifestation d’art qui ressemblât le moins possible à l’habituel et inoubliable comice agricole de Madame Bovary. En l’honneur d’un maître tel que Berlioz, il semblait surtout que la participation de la musique — de sa musique — s’imposât, et l’idée d’une grande exécution populaire venait d’autant plus naturellement à l’esprit que, bien conforme à ses goûts, elle aurait pu être facilitée par la présence d’un si grand nombre de musiciens dans la ville.
C’eût été pourtant se faire de cruelles illusions que de supposer que des orphéons pouvaient coopérer à une grande exécution d’ensemble en l’honneur de Berlioz, et personne ne s’arrêta à cette idée. L’on ne songea donc à faire appel qu’aux ressources locales, pensant qu’une ville de soixante mille habitants y pourrait suffire.
Après bien des pourparlers, qui donnèrent lieu parfois à des scènes de haute comédie (nous ne les raconterons pas, ce serait trop long), on put enfin constituer un chœur formé d’environ trois cents voix de jeunes filles et d’enfants des écoles, auxquels s’étaient jointes volontairement quelques dames, et de deux Sociétés chorales donnant un ensemble de plus de cent voix d’hommes. Deux musiques militaires, réunies sous le même chef, devaient jouer l’ouverture des Francs Juges et la Marche hongroise, et accompagner au chœur la Marseillaise harmonisée par Berlioz ; enfin, l’hymne d’apothéose transcrit de la Symphonie funèbre et triomphale éclaterait au moment où tomberait le voile couvrant la statue ; pour ce dernier morceau, les tambours de la garnison avaient été commandés, et une Société civile de trompettes avait promis de sonner la splendide fanfare d’introduction. Tout s’annonçait à merveille, et les répétitions d’ensemble firent grand effet. Pourtant, les orphéonistes composant le chœur d’hommes étaient indécis. La musique de Berlioz, ce n’était pas mal ; mais le concours d’orphéons, c’était mieux : allait-il donc être possible de s’en laisser distraire pendant toute une heure ! Les trompettes aussi faisaient valoir hautement leurs précieux services ; pour les décider, il n’avait pas fallu moins qu’une espèce de proclamation, que les journaux publièrent en leur honneur :
Le Comité vient de prier notre excellente Société de prêter son concours à l’exécution d’une cantate en l’honneur de Berlioz (1). Cette cantate comporte quelques entrées de trompettes assez difficiles d’interprétation.
Les Trompettes grenobloises se sont chargées de cette partie de l’œuvre.
Aussi doivent-elles, désormais, s’appliquer à d’assez nombreuses répétitions ; nos concitoyens sauront donc gré à nos dévoués trompettes d’avoir sacrifié une petite satisfaction d’amour-propre à leur collaboration aux fêtes du centenaire.
Le style « comice agricole » n’avait, on le voit, décidément pu être évité !
Le jour vint enfin. La pluie tomba sans relâche toute la matinée : l’inauguration, qui devait avoir lieu à onze heures, fut remise à cinq heures du soir. Le beau temps était revenu dans la journée ; mais d’épais nuages qui se formaient rapidement sous un vent violent donnaient des inquiétudes aux assistants.
Cependant il y avait lieu à d’autres inquiétudes encore, et c’étaient les organisateurs de la partie musicale qui les avaient. Les enfants et les dames du chœur étaient à leur poste, les musiciens militaires aussi. Mais, absence presque complète de voix d’hommes (seuls étaient venus quelques membres d’une Société restée fidèle), et défection absolue de la plus importante Société chorale ainsi que du groupe entier des trompettes. Le concours orphéonique avait décidément trop d’attraits et imposait de trop impérieux devoirs !
Aussi la bourrasque qui éclata soudain fut-elle un excellent prétexte pour supprimer l’exécution musicale. Le soleil eût été radieux qu’elle n’aurait pas pu avoir lieu davantage.
Berlioz, de son vivant, avait été victime d’un abandon analogue le soir où, un concert s’étant prolongé trop longtemps au gré des musiciens, ceux-ci quittèrent leurs pupitres et s’en allèrent, le laissant à la tête de cinq violons, trois basses et un trombone pour exécuter la Symphonie fantastique. Je ne puis, en écrivant ceci, m’empêcher de me remémorer les épithètes dont il s’est servi pour qualifier leur conduite. Les deux situations ont beaucoup d’analogies…
Il résulte de ces dernières observations que l’éducation du peuple de France a encore besoin de se perfectionner grandement avant qu’il se rende vraiment compte du culte qu’il doit à ses grands hommes. A cet égard, on ne saurait trop multiplier les hommages extérieurs et permanents, ceux qui frappent les sens et réveillent à tout instant le souvenir. Parmi eux, nous n’en connaissons pas de plus efficace que celui dont la Côte-Saint-André a donné l’exemple en fondant le Musée Berlioz. Grâce à cette heureuse initiative, les habitants du Dauphiné sauront qu’il y a sur leur territoire une simple maison d’où est sorti l’homme qui fut l’honneur de l’art français, que cet homme est un des leurs, et ils finiront bien un jour par se pénétrer sincèrement de cette parole qu’on a inscrite en leur nom sur la plaque commémorative : « A Hector Berlioz, ses compatriotes fiers de son génie. »
____________________________________
(1) Il n’a jamais été possible de faire entrer dans la
tête des Grenoblois que l’apothéose de la Symphonie funèbre et triomphale
n’est pas une cantate.![]()
![]()
![]()
Site Hector Berlioz créé par Monir Tayeb et Michel Austin le 18 juillet 1997; page Julien Tiersot: Berlioziana créée le 1er mai 2012; cette page créée le 1er mai 2012.
© Monir Tayeb et Michel Austin. Tous droits de reproduction réservés.
![]() Retour à la page Julien
Tiersot: Berlioziana
Retour à la page Julien
Tiersot: Berlioziana
![]() Retour à la page Exécutions et articles contemporains
Retour à la page Exécutions et articles contemporains
![]() Retour à la Page d’accueil
Retour à la Page d’accueil
![]() Back to Julien Tiersot: Berlioziana
page
Back to Julien Tiersot: Berlioziana
page
![]() Back to Contemporary Performances and Articles page
Back to Contemporary Performances and Articles page
![]() Back to Home Page
Back to Home Page