![]()
Par
Ernest Legouvé
(Paris, 1886)
CHAPITRE XVI
![]()
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
![]()
Le domaine de l’art ressemble au paradis de Dante. Il se compose de cercles de lumière s’étageant l’un au-dessus de l’autre, heureux comme moi, ceux qui trouvent sur le seuil de chaque cercle, ainsi que dans la Divine Comédie, un guide nouveau qui leur tend la main et les aide à s’élever dans une sphère supérieure.
Maria Malibran m’avait initié à la musique dramatique, à la musique italienne et à Rossini; Berlioz m’initia à la musique instrumentale et à Glück. Mais, Dieu merci, s’il me fit adorer ce que j’ignorais, il ne me fit pas brûler ce que j’avais adoré. Je n’ai jamais compris que l’admiration tuât l’admiration, que le présent ne pût vivre qu’aux dépens du passé, et que notre âme ne fût pas assez puissante pour s’élargir à mesure que l’horizon de nos enthousiasmes s’agrandit, de façon à trouver toujours en elle-même une place nouvelle pour un dieu nouveau.
La véritable religion de l’art est le polythéisme. A Dieu donc ne plaise que je renie la musique italienne parce qu’on ne l’aime plus. On lui reproche trop de grâce, on l’accuse de mettre de l’élégance jusque dans la tristesse, soit! mais elle a le plus beau de tous les dons, elle est faite de lumière. Puis, comme elle se marie bien à la voix humaine! comme elle se prête à toutes ses souplesses, à toutes ses délicatesses, voire à tous ses caprices! Lablache, en mourant, a dit un mot qui caractérise ce charmant art italien. Sa fille était près de lui... il ouvre la bouche pour lui parler... le son s’éteint à demi sur ses lèvres... « Oh! dit-il, non ho più voce, moro. Je n’ai plus de voix, je meurs. »
Le nom de Lablache, qui se rencontre sous ma plume, m’oblige à dire à Berlioz : « Mon ami, il faut que vous attendiez! » En effet, je serais un ingrat si je ne saluais d’un mot d’adieu les deux artistes qui ont enchanté ma jeunesse, les deux illustres représentants du style italien, de la tradition italienne, Lablache et Rubini. Parler d’eux, ce sera faire revivre pour un moment un art disparu et ce sera du même coup commencer le portrait de Berlioz; car cette époque est la sienne, elle a fortement agi sur lui; notre digression deviendra donc ainsi une transition.
![]()
On dit souvent d’un artiste qu’il est aimé du public; ce mot banal était rigoureusement vrai appliqué à Lablache. A son premier son, un tel courant de sympathie s’établissait entre lui et ses auditeurs, qu’il n’y en avait pas un seul qui ne l’aimât. La voix de Lablache résonne encore dans l’oreille de ceux qui l’ont entendue. La figure de Lablache resplendit encore dans l’imagination de tous ceux qui l’ont vue. Cette voix colossale avait de telles douceurs, ce visage de colosse avait un tel aspect de bonté, qu’il semblait deux fois olympien, tout à la fois Jupiter tonnant et Jupiter souriant. Touchant et terrible dans les passages pathétiques, il avait en outre une telle puissance de rythme, qu’il semblait soutenir à lui seul tous les morceaux d’ensemble, il en était l’architecture vivante. Enfin Lablache a emporté avec lui ce fruit charmant et tout à fait personnel du génie italien: la musique bouffe. Cimarosa est mort avec Lablache! La Cenerentola, l’Italienne à Alger, le Barbier même, sont morts avec Lablache. Personne n’a su rire en musique depuis Lablache. On trouvera peut-être encore des bouffons, on ne trouvera plus de bouffes. Cette gaieté saine et partant du cœur, ce goût jusque dans la farce, cette grâce jusque dans la charge, cette beauté de son mêlée à tout ce pétillement d’esprit, nous n’entendrons plus cela! Lablache avait, du reste, reçu comme acteur d’excellentes leçons d’un ancien artiste remarquable lui-même, son beau-père. Il m’a conté à ce propos un fait vraiement significatif.
Chargé, étant encore jeune homme, du rôle de Frédéric II dans un opéra nouveau, il lut tout ce qui a rapport au roi de Prusse, tâcha de se figurer et de figurer sa démarche, ses gestes, ses attitudes, et le soir de la répétition générale, il convia son beau-père. « C’est bien, lui dit celui-ci après la pièce, tu as bien porté la tête de côté comme Frédéric, tu as bien plié les genoux comme Frédéric, tu as même bien reproduit le masque de Frédéric; mais pourquoi n’as-tu pas pris de tabac? C’était une de ses habitudes. — Pas pris de tabac! répondit Lablache, j’en avais rempli les poches de mon gilet et j’en ai pris à tout moment. — C’est cela, mon garçon, lui dit en souriant son beau-père, tu en as pris à tout moment, mais tu n’en as pas pris au bon moment. Il y a dans le second acte, une situation capitale; c’est celle où la femme de l’officier coupable de désobéissance vient se jeter aux pieds du roi pour demander sa grâce. A cet instant, tous les regards sont tournés vers Frédéric, on se demande avec anxiété ce qu’il va faire! Si à ce moment, avant de répondre, tu avais pris une prise de tabac, elle t’aurait compté pour tout le reste de la pièce. Au lieu de cela, tu as prisé à tort et à travers, quand on ne te regardait pas. Cela ne t’a servi à rien. Tu as reproduit l’habitude du roi, mais tu ne l’as pas fait revivre. »
Il fallait entendre Lablache contant ce fait, car le conteur, chez lui, était presque l’égal du chanteur; mérite assez rare chez un homme aussi distrait. Sa distraction, qui était devenue proverbiale, donna lieu à plusieurs histoires comiques, et à une observation théâtrale fort curieuse. C’est lui qui, à Naples, un matin, oublia dans un café sa petite fille âgée de cinq ans, et ne songea à aller la rechercher que dans l’après-midi, quand sa femme, le voyant revenir seul à la maison, lui dit : « Et ta fille! » Le prince Albert aimait à raconter qu’ayant donné audience à Lablache qui venait lui demander la grâce d’un malheureux, il ne put réprimer, en le voyant entrer, une forte envie de rire. Un peu troublé, Lablache commence pourtant son récit avec l’accent le plus touchant, mais plus il s’attendrissait, plus la gaieté du prince semblait redoubler, jusqu’à ce qu’enfin, prenant l’artiste par la main, il l’amena devant la glace en lui disant : « Regardez-vous! » Lablache avait deux chapeaux, l’un sur la tête, l’autre à la main, lequel autre appartenait à un des solliciteurs qui attendaient avec lui dans la salle voisine. Lablache, s’entendant appeler par l’huissier, avait saisi vivement ledit couvre-chef, déposé sur une chaise, et arrivé devant le prince, il en gesticula si pathétiquement, qu’il obtint tout ce qu’il voulut; non pas, comme il l’espérait, en faisant pleurer le prince, mais en le faisant rire. Or, un auteur dramatique italien crut faire merveille en lui composant un rôle de distrait; mais qu’arriva-t-il ? Que Lablache ne put jamais le représenter. « Il me fut impossible, me dit-il, de me jouer moi-même. J’en éprouvais une sorte de honte. Puis, comment travailler ? Dès que je me mettais à m’observer, je cessais d’être distrait, je n’avais plus rien du distrait; aussitôt que je commençais mon étude, l’objet de mon étude disparaissait. »
Rubini complète Lablache parce qu’il représente autre chose que lui. Une partie de l’art italien est morte aussi avec Rubini. La grande école de chant de Crescentini, l’école de virtuosité, a perdu en lui son dernier interprète.
Rien de plus rare aujourd’hui que la virtuosité chez les ténors italiens; ils n’en ont pas besoin. La musique italienne moderne, la musique de Verdi, ne leur demande que de l’âme et du son. Il n’en était pas ainsi du temps de Rubini. Un chanteur ne pouvait pas plus se passer de virtuosité, qu’un pianiste. Les traits, les trilles, les gammes, étaient imposés au gosier comme au clavier, et les artistes supérieurs, tels que Rubini, y trouvaient non seulement une grâce et un ornement pour le chant, mais un puissant moyen d’expression. Certains artistes, Berlioz entre autres, blâment dans le chant les vocalises comme incompatibles avec la vérité et la force du sentiment. Mais que font donc Mozart, Beethoven, Weber dans leurs compositions de piano ? Est-ce qu’ils ne vous émeuvent pas avec des gammes? Est-ce qu’ils ne vous électrisent pas avec des traits ? Otez au concerto Stuck et à la sonate pathétique leurs virtuosités, et vous leur enlevez du même coup la moitié de leur puissance expressive. Pourquoi donc ce qui convient à une sonate, ne conviendrait-il pas à un air ? Pourquoi ce qui est touchant sous les doigts du pianiste, serait-il froid sur les lèvres du chanteur ? Il faut seulement qu’il sache donner aux traits le caractère du morceau, et pour le chanter, il n’a qu’à être aussi habile exécutant qu’un instrumentiste. Rubini se jouait de cette difficulté. Sa voix, plus moelleuse qu’éclatante, et couverte même d’un léger voile, avait des souplesses de couleuvre, et se prêtait, sans un effort, sans un cri, sans une contraction du visage, à toutes les audaces des plus merveilleux maîtres du clavier ou de l’archet. C’est lui qui, un jour, à une répétition de Don Giovanni, pendant la ritournelle d’Il mio tesoro, se pencha vers l’orchestre et dit à la clarinette qui venait d’exécuter un passage plein d’éclat : « Monsieur, voudriez-vous me prêter ce trait-là ? » Et il l’introduisit à la fin de son air, à la stupéfaction et aux applaudissements de l’orchestre et du public. Sans doute, c’était altérer Mozart, mais avec Mozart même, et Rubini seul était capable de cette faute haureuse. Les ténors qui l’ont suivi, ont voulu l’imiter et ne font que le parodier. Le charmant violoncelliste Braga, m’a raconté qu’allant voir à Bergame Rubini retiré du théâtre, il lui marque quelque étonnement du grand effet d’émotion qu’il produisait, disait-on, dans la cavatine du second acte de Marino Faliero, un air à roulades. « A roulades! répondit en souriant Rubini, voulez-vous me l’accompagner ? » Et dix minutes après Braga se levait du piano, pleurant, applaudissant, stupéfait d’avoir entendu ces traits, ces gammes se transformer sur les lèvres vibrantes de l’artiste, en cris de rage et en accents de désespoir.
Voici un exemple plus frappant encore de cet emploi de la virtuosité.
Rubini, dans le célèbre duo du défi de Tancredi, avait pour partenaire Bordogni, artiste froid, mais virtuose consommé; Bordogni, ennuyé d’être toujours vaincu dans ce duo par Rubini, imagina, pour avoir au moins son jour de triomphe, de lancer un soir à son adversaire, sans en être convenu avec lui, un trait nouveau et un trait d’une telle longueur, d’un tel éclat, que la salle y répondit par un tollé d’applaudissements fort inaccoutumé pour Bordogni. Rubini le regarde, sourit et commence une roulade à la Garcia, c’est-à-dire une roulade improvisée, où les gammes, les gruppetti, les trilles se succédèrent sans interruption, avec une telle rapidité et pendant un si long temps, que le public éclata de rire, émerveillé qu’une poitrine humaine pût contenir une telle provision de souffle, qu’un gosier humain pût lancer de telles fusées musicales. Ajoutons que ce jour-là, on applaudissait aussi l’homme d’esprit dans le virtuose, car cette roulade était en situation puisque c’était une riposte; cet air de bravoure était un air de bravade, ce choc de vocalises ressemblait à un choc d’épées, ce duo de rossignols devenait un duel de chevaliers.
Chose remarquable! Cet incomparable exécutant se montrait, dans les morceaux d’expression, le plus touchant, le plus simple, le plus ému des chanteurs.
Quel artiste a su mieux pleurer en musique que Rubini ? Il semblait que le hasard l’eût créé tout exprès pour cette musique élégiaque qui sépare Otello du Trovatore, je veux dire la musique de Bellini. Quand la situation devenait pathétique, il y devenait grand acteur. Dieu sait pourtant que si jamais comédien médiocre parut sur la scène, ce fut lui. Indifférent, froid, court de taille, commun de visage, voire même gauche, il se promenait dans l’action avec une insouciance du geste, de l’allure, du costume, qui arrivait parfois jusqu’au comique. Je le vois encore à la première représentation des Puritains, entrant en scène avec une perruque si singulière qu’elle excita l’hilarité de toute la salle. Sans se troubler, il regarde le public en riant aussi. Il semblait dire : « N’est-ce pas qu’ils m’ont mis sur la tête quelque chose de bien extraordinaire ? » Puis, son morceau achevé, il rentre dans la coulisse, se débarrasse de la malencontreuse perruque, et reparaît avec ses cheveux naturels en souriant encore. Eh bien, ce même homme, dans le finale de Lucia, dans la scène de reproches de la Somnambule, dans le troisième acte des Puritains, se transformait tout à coup en un tragédien admirable à force d’être un chanteur sublime. Peu de gestes, mais d’une vérité saisissante; une mimique sobre, mais qui était la pantomime même du chant, une voix dont les vibrations vous remuaient si fort à la fois le cœur et les nerfs, qu’en l’entendant nous frémissions tous comme des fils électriques. Il exerçait une action absolument magnétique. Je puis en citer un exemple touchant.
Une vieille dame, une amie de ma famille, atteinte d’une maladie mortelle, était en proie depuis quatre jours à des douleurs qu’on pouvait appeler des tortures. Nul remède ne pouvait les adoucir. Tout à coup, au milieu d’une effroyable crise elle s’écrie : « Allez chercher Rubini! Allez chercher Rubini! Qu’il chante dans la chambre à côté, l’air de la Somnambule, et je suis sûre que je cesserai un moment de souffrir! »
— « Ah! monsieur, me dit Rubini, quand je lui racontai ce mot, pourquoi n’est-on pas venu me chercher ?
— Parce qu’elle n’aurait pas pu vous entendre. Deux heures après elle était morte. »
Ce fait en dit plus que beaucoup de paroles. C’était bien l’âge d’or de la musique italienne! Dans le ciel de l’art, brillaient à la fois, différents de grandeur et de lumière, Cimarosa au couchant, Rossini au zénith, Bellini au levant, et un si rare assemblage de compositeurs et d’interprètes, avait créé un public dont les salles de théâtre d’aujourd’hui ne nous offrent pas l’analogue.
L’Opéra compte un grand nombre d’abonnés, mais que sont ces abonnés ? Des gens riches. Où vont-ils ? Dans les loges, aux fauteuils d’orchestre. A quelle heure arrivent-ils ? A tous les moments de la représentation, sauf au commencement. Il y a tel abonné qui n’a jamais entendu l’ouverture de Guillaume Tell. Que viennent-ils faire? Voir, se faire voir, écouter un acte, causer dans les entr’actes, applaudir un air, acclamer un pas de danse; mais combien y en a-t-il parmi eux qui entendent la première mesure d’un opéra et ne partent qu’après la dernière ?
Au théâtre Italien, de 1829 à 1831, une soixantaine d’hommes, différents d’âges, de professions, avocats, magistrats, écrivains, formaient au milieu du parterre, sous le lustre, une phalange de Romains volontaires dont la première loi était de ne jamais manquer une seule représentation. J’ai vu, pour ma part, soixante fois Othello. Pas de privilèges d’entrée! On se battait à la porte s’il y avait foule; les premiers venus gardaient la place des autres, on arrivait une heure avant le commencement, et cette heure d’attente, on l’employait à se préparer à la représentation. Les plus vieux, qui avaient vu Garcia, Pellegrini, la Pasta, les comparaient à nos trois grands artistes actuels, et nous marquaient les traits caractéristiques de leur talent; un jeune magistrat, aujourd’hui conseiller à la cour de cassation, fort bon musicien, avait noté sur un calepin les plus beaux passages de virtuosité des grands artistes qu’il avait entendus, et nous les chantait à mi-voix. Nous formions, non seulement un auditoire, mais un jury; le public acceptait nos jugements, suivait nos applaudissements, imitait nos silences; les artistes mêmes comptaient avec nous. La première fois que j’ai vu Lablache, il me dit : « Ah! monsieur, je vous connais bien! Second rang du parterre, à la sixième place. Oh! j’ai bien souvent chanté pour vous. » Je me rappelle qu’un soir une cantatrice nouvelle ayant hasardé un trait de fort mauvais goût, et un bravo étant parti du fond du parterre, un des soixante, nommé Tillos, grand jeune homme à la mine fière, se leva et se tournant vers l’endroit d’où était parti l’applaudissement, dit tout haut, avec un accent de dédain incomparable : « Est-ce qu’il y a ici un habitué de l’Opéra-Comique ? » Tout cela était, il faut en convenir, un peu fou, un peu excessif, mais on y retrouve bien cet enthousiasme, cette passion pour l’art, qui caractérisent 1830. Or, Berlioz est l’image même de 1830; nous voilà donc amenés naturellement par la musique italienne à Berlioz qui la détestait; nous le comprendrons mieux maintenant: sa figure est replacée dans son cadre.
![]()
La première fois que j’entendis prononcer le nom de Berlioz, c’est à Rome, en 1832, à l’académie de France. Il venait de la quitter et y laissait le souvenir d’un artiste de talent, d’un homme d’esprit mais bizarre et se plaisant à l’être; on prononçait volontiers à son sujet le mot de poseur. Mme Vernet et sa fille le défendaient et le vantaient beaucoup; les femmes sont plus perspicaces que nous à deviner les hommes supérieurs. Mlle Louise Vernet me chanta, un jour, une mélodie composée pour elle par Berlioz dans les montagnes de Subiaco, la Captive. Ce qu’il y avait dans ce chant de poétique et de triste m’émut profondément. Je sentis se créer en moi un lien mystérieux de sympathie avec cet inconnu. Je demandai à Mme Vernet une lettre pour lui, et, une fois de retour à Paris, je n’eus pas de soin plus pressé que de le chercher. Mais où le trouver ? Il était si inconnu alors! J’en désespérais, quand un matin, chez un coiffeur italien, nommé Decandia, qui demeurait place de la Bourse, j’entends un garçon dire au patron : « Cette canne est à M. Berlioz. – M. Berlioz ? dis-je vivement au coiffeur, vous connaissez M. Berlioz ? — C’est un de mes meilleurs clients; il doit venir aujourd’hui. — Eh bien, remettez-lui ce mot. » C’était la lettre de Mme Vernet. Le soir j’allai entendre Freischütz, la salle était comble et je n’avais pu trouver place que dans le couloir de la seconde galerie. Tout à coup, au milieu de la ritournelle de l’air de Gaspard, un de mes voisins se lève, se penche vers l’orchestre et s’écrie d’une voix tonnante: « Ce ne sont pas deux flûtes, misérables! Ce sont deux petites flûtes! Deux petites flûtes! Oh! quelles brutes! » Et il se rassied indigné. Au milieu du tumulte général, je me retourne et je vois à mes côtés un jeune homme tout tremblant de colère, les mains crispées, les yeux étincelants, et une coiffure, une coiffure!... On eût dit un immense parapluie de cheveux, surplombant, en auvent mobile, au-dessus d’un bec d’oiseau de proie. C’était à la fois comique et diabolique! Le lendemain matin, j’entends sonner à ma porte; je vais ouvrir et à peine la figure de mon visiteur entrevue :
« Monsieur, lui dis-je, n’étiez-vous pas hier soir à Freischütz ?
— Oui, monsieur.
— Aux secondes galeries ?
— Oui, monsieur.
— N’est-ce pas vous qui vous êtes écrié :: « Ce sont deux petites flûtes ? »
— Sans doute! Comprenez-vous des sauvages pareils qui ne conçoivent pas la différence qui existe...
— C’est vous, mon cher Berlioz!
— Oui, mon cher Legouvé. » Et nous voilà, pour début de connaissance, nous embrassant comme du pain.
Oh! l’intimité ne fut pas longue à établir. Tout nous rapprochait! Notre âge, nos goûts, notre passion commune pour les arts. Nous appartenions tous deux à ce que Préault appelait la tribu des pathétiques. Il adorait Shakespeare comme moi, j’adorais Mozart comme lui; quand il ne composait pas de musique, il lisait des vers; quand je ne faisais pas de vers, je faisais de la musique. Enfin, dernier lien, j’avais traduit d’enthousiasme Roméo et Juliette, et il était, lui, éperdument épris de la célèbre artiste qui jouait Juliette, miss Smithson. Son amour mit le feu à notre amitié. C’était un amour plein d’orages. D’abord, il savait à peine quelques mots d’anglais, et miss Smithson savait encore moins de français, ce qui jetait un peu de décousu dans leurs dialogues. Puis, elle avait quelque peur de son farouche adorateur. Enfin, le père de Berlioz opposait un véto absolu à tout projet de mariage. En voilà plus qu’il ne fallait pour avoir besoin d’un confident. Il m’éleva donc à la dignité de son conseiller ordinaire, et comme c’était une fonction très occupante et qui pouvait suffire à deux personnes, il m’associa, à titre de confesseur adjoint, un de mes amis pour qui il avait une grande admiration, Eugène Süe [cf. Correspondance générale no. 293].
Nos réunions étaient des plus étranges, et un accident arrivé à miss Smithson (elle s’était démis le pied en descendant de voiture) donna lieu un jour, entre nous, à une conversation caractéristique. Le matin je reçois un mot de Berlioz écrit d’une main crispée [Correspondance générale no. 325]:
« Il faut absolument que je vous parle. Avertissez Süe! O mes amis, que de douleur! »
Là-dessus, lettre de moi à Eugène Süe :
« Tempête! Berlioz nous convoque! Ce soir, à souper, chez moi, à minuit. »
A minuit, arrive Berlioz les yeux tout chargés de nuages, les cheveux retombant sur son front en saule pleureur, et poussant des soupirs qu’il semblait tirer de ses talons.
« Eh bien, qu’y a-t-il donc ?
— O mes amis, ce n’est pas vivre!
— Est-ce que votre père est toujours inflexible ?
— Mon père! s’écria Berlioz avec rage, mon père dit oui! Il me l’a écrit ce matin.
— Eh bien, il me semble...
— Attendez! Attendez! Fou de joie en recevant cette lettre, je cours chez elle, j’arrive éperdu, fondant en larmes et je lui crie: « Mon père consent! Mon père consent! » Savez-vous ce qu’elle m’a répondu ? « Not yet, Hector! not yet! (Pas maintenant, Hector, pas maintenant). Mon pied me fait trop de mal. » Qu’en dites-vous ?
— Nous disons, mon ami, que cette pauvre femme souffrait sans doute beaucoup. — Est-ce qu’on souffre ? répliqua-t-il. Est-ce que la douleur existe quand on est dans l’ivresse ? Mais moi, moi, si l’on m’avait donné un coup de couteau en pleine poitrine au moment où elle m’a dit qu’elle m’aimait, je ne l’aurais pas senti. Et elle!... Elle a pu... elle a osé... » Puis, tout à coup, s’interrompant: « Comment l’a-t-elle osé ?... Comment n’a-t-elle pas pensé que j’allais l’étrangler ? » A cette phrase, dite avec autant de simplicité que de conviction, Eugène Süe et moi nous partîmes d’un éclat de rire. Berlioz nous regarda d’un air stupéfait. Il lui semblait avoir dit la chose la plus naturelle du monde, et nous eûmes grand’peine à lui faire comprendre qu’il n’y avait aucune liaison d’idées entre une femme qui se plaint de souffrir du pied et une femme qu’on étrangle, et que miss Smithson eût été au comble de l’étonnement s’il lui avait sauté à la gorge, à la façon d’Othello. Le pauvre homme nous écoutait sans comprendre, la tête baissée; des larmes ruisselaient le long de ses joues, et il nous disait... « C’est égal, elle ne m’aime pas! Elle ne m’aime pas!
— Elle ne vous aime pas comme vous l’aimez, répondait Süe! c’est évident, et c’est bien heureux, car deux amoureux pareils à vous feraient un singulier ménage! » Il ne put s’empêcher de sourire. « Voyez vous, mon cher ami, ajoutai-je à mon tour, vous avez la tête pleine de la Portia de Shakespeare, qui se donne un coup de couteau à la cuisse pour décider Brutus à lui accorder sa confiance. Mais miss Smithson ne joue pas les Portia, elle joue les Ophélie, les Desdémone, les Juliette, c’est-à-dire des créatures faibles, tendres, craintives, essentiellement féminines enfin! et je suis sûr que son caractère ressemble à ses rôles!
— C’est vrai!
— Qu’elle a une âme délicate comme les personnages qu’elle représente.
— Oui, c’est vrai!... Oh! délicate, c’est bien le mot.
— Et si vous aviez été digne d’elle, ou pour mieux dire, digne de vous, au lieu de lui jeter violemment cette joie au visage, vous l’auriez posée doucement sur sa souffrance comme un baume. Votre divin Shakespeare n’y eût pas manqué, lui, s’il eût eu cette scène à faire.
— Vous avez raison! Vous avez raison! s’écria alors le pauvre garçon. Je suis un brutal! je suis un sauvage! Je ne mérite pas d’être aimé d’un tel cœur! Si vous saviez tout ce qu’il y a en elle de trésors d’affection... Oh! comme je lui demanderai pardon demain! Mais voyez donc, mes amis, si j’ai bien fait de vous consulter!... Je suis arrivé désespéré, exaspéré, et me voilà confiant, heureux, riant! »
Et soudain, avec la naïveté d’un enfant, avec la mobilité d’un enfant, il se lançait dans la joie de son mariage prochain. Ce que voyant, j’ajoutai:
« Eh bien, célébrons le mariage tout de suite. Faisons de la musique. »
Il accepte avec enthousiasme. Mais comment faire de la musique ? Je n’avais pas de piano dans mon ménage de garçon, et en eussé-je eu un, à quoi m’eût-il servi ? Berlioz ne jouait que d’un doigt. Heureusement, il nous restait une ressource triomphante, la guitare. La guitare résumait pour lui tous les instruments, et il en jouait très bien. Il la prit donc et se mit à chanter. Quoi ? des boléros, des airs de danse, des médolies ? Du tout. Le finale du second acte de la Vestale! Le grand prêtre, les vestales, Julia, il chantait tout, tous les personnages, toutes les parties! Malheureusement, il n’avait pas de voix. Qu’importe, il s’en faisait une! Grâce au système de chant à bouche fermée qu’il pratiquait avec une habileté extraordinaire, grâce à la passion et au génie musical qui l’animaient tout entier, il tirait de sa poitrine, de son gosier et de sa guitare, des sons inconnus, des plaintes pénétrantes, qui, mêlées çà et là de paroles d’admiration, d’interruptions d’enthousiasme, voire même de commentaires éloquents, produisaient un effet d’ensemble si extraordinaire, un si incroyable tourbillon de verve et de passion, qu’aucune exécution de ce chef-d’œuvre, même au Conservatoire, ne m’a autant ému, autant transporté que ce chanteur sans voix avec sa guitare.
Après la Vestale, venait quelque morceau de sa Symphonie fantastique.
C’était sa première grande création. Elle n’avait été exécutée qu’une fois encore en public et j’avais écrit sur l’œuvre et sur l’auteur un article plein d’espérance enthousiaste. Enfin, à la suite de tous ces chants, et comme emportés par eux, nous nous lancions tous les trois dans nos idées d’avenir. Eugène Süe nous racontait ses plans de romans; moi, mes projets dramatiques, Berlioz ses rêves d’opéra. Nous lui cherchions des sujets, nous lui bâtissions un scénario sur les Brigands de Schiller qu’il adorait, et nous nous séparions à quatre heures du matin, enivrés de poésie, de musique, frissonnant de la belle fièvre de l’art; et, le lendemain, miss Smithson voyait arriver chez elle, tout rayonnant de joie et tout tremblant de repentir, cet être étrange qu’elle avait vu partir, la veille, furieux et désolé.
![]()
Si j’ai raconté cette scène de jeunesse, ce n’est pas seulement pour le seul plaisir de rappeler un souvenir qui me touche, c’est surtout parce qu’elle représente au vif le Berlioz ressemblant, que je voudrais peindre; c’est qu’en écrivant ces lignes, il me semble voir encore cette créature, pathétique, excessive, ingénue, violente, insensée, sensible, mais avant tout, sincère. On a dit qu’il posait. Mais poser, c’est cacher ce qui est et montrer ce qui n’est pas, c’est feindre, c’est calculer, c’est être maître de soi! Et où aurait-il trouvé la force de jouer un tel rôle, cet être qui vivait à la merci de ses nerfs, qui était l’esclave de toutes ses impressions, qui passait subitement d’un sentiment à un autre, qui pâlissait, tressaillait, pleurait malgré lui, et ne pouvait pas plus commander à ses paroles qu’aux muscles de sa face? Lui reprocher d’être poseur! autant l’accuser, comme on l’a fait, d’être envieux! Il était fort admirateur de ses œuvres, j’en conviens, mais il était aussi très enthousiaste des œuvres des autres. Qu’on relise ses admirables articles sur Beethoven, sur Weber, sur Mozart, et, pour ne pas laisser à l’envie le droit de dire qu’il écrasait les vivants sous ses éloges pour les morts, qu’on se rappelle les acclamations dont il a salué le Désert de Félicien David et la Sapho de Gounod. Seulement ses antipathies étaient aussi vigoureuses que ses adorations. Il ne pouvait pas plus cacher les unes que les autres. A côté des expressions de flamme dont il saluait ce qu’il adorait, partaient, comme autant de flèches barbelées, les sarcasmes impitoyables dont il poursuivait ce qu’il n’aimait pas! Deux faits curieux mettront en lumière ces deux côtés de sa nature.
Un soir, j’avais réuni chez moi quelques amis, Liszt, Goubaux, Schœlcher, Süe, et cinq ou six autres. Berlioz était des nôtres. « Liszt, lui dit-il, joue-nous donc une sonate de Beethoven. » Nous passons de mon cabinet dans le salon; j’avais un salon alors, et un piano. La lumière était éteinte, et le feu de la cheminée couvert. Goubaux apporte la lampe de mon cabinet, pendant que Liszt se dirige vers le piano, et que chacun de nous cherche un siège pour s’y installer.
« Montez donc la mèche, dis-je à Goubaux, on n’y voit pas assez clair. » Au lieu de la remonter, il la baisse, nous voilà dans l’obscurité, je pourrais dire dans les ténèbres, et ce passage subit de la clarté à la nuit, se mêlant aux premiers accords du piano, nous saisit tous au cœur. On eût dit la scène des ténèbres de Mosè. Liszt, soit hasard, soit influence involontaire, commence le funèbre et déchirant andante de la sonate en ut dièse [Sonate n°14, op.27, n°2 (“Moonlight”)]. Chacun reste cloué à la place où il se trouve, et ne remue plus. De temps en temps, le feu mal couvert perçait soudainement la couche de cendres, et jetait dans la chambre des lueurs étranges, fugitives, qui nous dessinaient tous avec des formes de fantômes. Je m’étais laissé tomber dans un fauteuil, et j’entendais au-dessus de ma tête des sanglots et des plaintes étouffées; c’était Berlioz. Le morceau fini, nous restâmes un moment muets; Goubaux rallume une bougie, et pendant qu’on repassait du salon dans mon cabinet, Liszt m’arrête par le bras, et me montrant Berlioz, les joues toutes ruisselantes de larmes:
« Regardez-le, me dit-il tout bas, il a écouté cela en héritier présomptif. »
Voilà le Berlioz enthousiaste, voici l’autre.
Nous étions ensemble au théâtre Italien, on jouait Othello. Le finale du second acte contient un passage célèbre, c’est celui où Desdemona aux pieds de son père, s’écrie :
Se il padre m’abbandona,
Che mai più mi restera ?
[Si mon père m’abandonne, que me restera-t-il ?]
Le premier vers se répète deux fois, et traduit la douleur de Desdemona par une phrase musicale, lente, expressive, et vraiment poignante. Puis tout à coup, quand arrive le second vers, éclatent, pour peindre le désespoir, des gammes, des vocalises, des roulades qui me semblaient à moi très entraînantes, mais qui exaspéraient Berlioz. L’acte terminé, il se penche à mon oreille et d’une voix émue comme la mélodie elle-même, me chante tout bas:
Si mon père m’abandonne,
Si mon père m’abandonne,
Puis avec un éclat de rire sardonique, et en reproduisant toutes les roulades du texte:
Je m’en fiche pas mal!
Je m’en fiche pas mal!
Je m’en fiche pas mal!
Voilà les deux Berlioz, l’enthousiaste et le moqueur. En voici un troisième, où se montrera le trait le plus caractéristique peut-être de cette figure singulière; je parle du rôle immense et étrange que l’amour a joué dans sa vie.
![]()
On se rappelle la page admirable qu’il a consacrée à sa première passion (il avait alors douze ans) pour une jeune fille de dix-huit, nommée Estelle:
« Elle avait une taille élégante et élevée, de grands yeux noirs armés en guerre, bien que toujours souriants, et une chevelure digne d’orner le casque d’Achille. En l’apercevant, je sentis une secousse électrique, je l’aimais, c’est tout dire, Le vertige me prit et ne me quitta plus. Je n’espérais rien, je ne savais rien, mais j’éprouvais au cœur une douleur profonde. Je me cachais le jour dans les champs de maïs, dans les réduits secrets du verger de mon grand-père, comme un oiseau blessé, muet et souffrant. La jalousie, cette pâle compagne des plus pures amours, me torturait au moindre mot adressé par un homme à mon idole, et tout le monde, dans le voisinage, s’amusait de ce pauvre enfant, brisé par un amour au-dessus de ses forces. »
Eh bien, ce qu’il fut à douze ans, il le fut toujours. Toujours blessé, toujours souffrant, mais pas toujours muet. On conçoit qu’une telle nature devait difficilement se plier à la régularité du ménage et à la fidélité conjugale. Aussi son mariage avec miss Smithson fut-il semblable à la Symphonie pastorale, débutant comme la plus pure matinée de printemps, et finissant par le plus effroyable orage. Le désaccord se produisit assez vite, et sous une forme assez singulière. Quand Berlioz épousa miss Smithson, il l’aimait comme un fou; mais quant à elle, pour me servir d’un mot qui le jetait dans une sorte de fureur, elle l’aimait bien: c’était une tendresse blonde. Peu à peu cependant, la vie commune l’apprivoisa aux farouches transports de son lion, peu à peu, elle y trouva du charme, et bientôt enfin, ce qu’il avait d’original dans l’esprit, de séduisant dans l’imagination, de communicatif dans le cœur, gagna si bien la froide fiancée, qu’elle devint une épouse ardente, et passa de la tendresse à l’amour, de l’amour à la passion, et de la passion à la jalousie. Malheureusement il en est souvent d’un mari et d’une femme comme des deux plateaux d’une balance; ils se maintiennent rarement de niveau; quand l’un monte, l’autre descend. Ainsi en arriva-t-il dans le nouveau ménage. A mesure que le thermomètre Smithson s’élevait, le thermomètre Berlioz baissait. Ses sentiments se changèrent en une bonne amitié, correcte et calme; mais en même temps éclatèrent chez sa femme des exigences impérieuses, des récriminations violentes et malheureusement trop légitimes. Berlioz, mêlé par l’exécution de ses œuvres et par sa position de critique musical, à tout le monde des théâtres, y trouvait des occasions de faillir qui auraient troublé de plus fortes têtes que la sienne; en outre, son titre de grand artiste méconnu, était un prestige qui changeait facilement ses interprètes en consolatrices. Mme Berlioz cherchait dans les feuilletons de son mari, les traces de ses infidélités; elle les cherchait même ailleurs, et des fragments de lettres interceptées, des tiroirs indiscrètement ouverts, lui faisaient des révélations incomplètes, qui suffisaient pour la mettre hors d’elle-même, mais ne l’éclairaient qu’à demi. Sa jalousie retardait toujours. Le cœur de Berlioz allait si vite qu’elle ne pouvait pas le suivre; quand, à force de recherches, elle était tombée sur l’objet de la passion de son mari, cette passion avait changé, il en aimait une autre, et alors, son innocence actuelle lui étant facile à prouver, la pauvre femme restait confuse comme un limier, qui, après avoir couru une demi-heure sur une piste, arrive au gîte quand l’oiseau est envolé. Il est vrai que quelque autre découverte la faisait bientôt repartir sur une autre trace, et de là, des scènes de ménage effroyables. Miss Smithson était déjà trop âgée pour Berlioz quand il l’avait épousée; le chagrin précipita pour elle les ravages du temps; elle vieillit jour à jour au lieu de vieillir année à année; et malheureusement plus elle vieillissait de visage, plus aussi elle rajeunissait de cœur, plus son amour s’accroissait, s’aigrissait, devenait une torture pour elle et pour lui, si bien qu’une nuit leur jeune enfant, qui couchait dans leur chambre, fut éveillé par de si terribles éclats d’indignation et d’emportement de la part de sa mère, qu’il se jeta à bas de son lit, et courant à elle : « Maman! maman! ne fait pas comme Mme Lafrage! »
Il fallut se séparer. Celle qui s’appelait jadis Miss Smithson, usée avant l’âge, obèse, malade, alla chercher le repos dans un petit logis obscur à Montmartre, où Berlioz, qui, tout pauvre qu’il fût, lui servit toujours fidèlement une pension honorable, continuait à aller la voir comme ami; car il l’aimait toujours, il l’aimait autant, mais il l’aimait autrement, et c’est cet autrement-là qui creusait entre eux un abîme.
Alors commença pour Berlioz la seconde et la plus douloureuse époque de sa vie! Lutte contre tout et pour tout! lutte contre le public! lutte pour l’existence journalière! lutte contre les difficultés d’une position fausse! lutte contre son génie même qui cherchait encore sa voie. De ce moment date aussi la seconde phrase de notre amitié, qui se transforma sans s’affaiblir, fit de lui pour moi un véritable initiateur, et me permettra de montrer ce rare esprit sous une forme nouvelle et curieuse.
![]()
Un événement important pour moi avait modifié nos relations. Je m’étais marié comme lui, et dans les mêmes dispositions de sentiments que lui; mais j’avais compris le mariage autrement que lui. Mon état nouveau me créa ce que Dante appelle éloquemment vita nuova, une vie nouvelle. Mes enfants, leur mère, le soin de leur éducation, avaient fait de moi un homme de famille (domestic-man), comme disent les Anglais. Ce n’était guère le fait de Berlioz et je lui disais en riant:
« Mon cher ami, vous ressemblez à Mlle Mars.
— Comment cela ?
— Quand on lui offrait un rôle de mère, elle le refusait en disant : « Je ne suis faite que pour les rôles jeunes », et elle avait raison. Son extrait de naissance marquait déjà soixante ans que son talent n’en marquait que trente tout au plus. Ses yeux, sa physionomie, sa voie n’étaient propres qu’à peindre l’amour. Interrogée au tribunal sur son âge, elle répondit spirituellement : « Vingt-neuf ans passés. »
— Mais que diable, mon cher, me répondit Berlioz, ai-je de commun avec Mlle Mars ?
— C’est, lui dis-je, que vous n’êtes fait, comme elle, que pour les rôles jeunes. Vous êtes condamné à l’amour à perpétuité. Vous aurez toujours l’âge que nous avions quand nous nous sommes connus, à vingt-cinq ans, et en 1830 encore! Circonstance très aggravante. Vous êtes un Desgrieux éternel, un Desgrieux qui change souvent de Manon... Moi, j’ai pris l’emploi des Tiberge! »
Notre affection, devenue ainsi plus sérieuse, mais restée aussi cordiale, établit entre lui et moi, je devrais dire entre lui et nous, des relations musicales qui aidèrent fort à mon éducation. Sûr de trouver chez moi un piano et une interprète, il venait causer avec nous de Glück, de Beethoven et de lui-même. J’ai entre les mains, et en ce moment sous les yeux, un exemplaire d’Alceste dans la version française, tout chargé de notes marginales et d’indications de la main de Berlioz. Glück corrigeait fort mal ses épreuves; Berlioz les corrigea de nouveau sur cet exemplaire d’après l’édition italienne, qui, comme on le sait, est la première. Il rétablit les mouvements. Dans l’air, Non, ce n’est pas un sacrifice; au-dessus de cette phrase : Mes chers enfants, je ne vous verrai plus, un « double plus lent », il écrivit en lettres énormes et d’une écriture nerveuse, qui sent la colère et peut se traduire par: Imbéciles de traducteurs! Le début du fameux air: Divinités du Styx, excitait surtout son indignation et lui inspira les plus intéressantes corrections. La figuration matérielle de cette phrase musicale expliquera sa pensée.
Voici la traduction française :
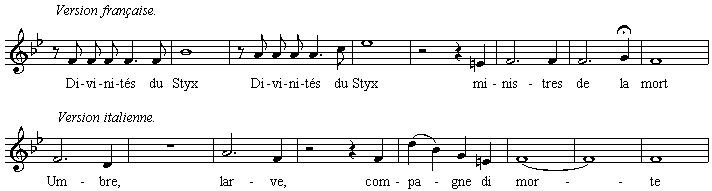
Tout en biffant, en raturant, en rétablissant les paroles italiennes au-dessus des paroles françaises :
« Comprenez-vous, me disait-il avec rage, des sauvages pareils à ces traducteurs! Et faut-il que ce grand génie appelé Glück, ait été le négligent, l’indifférent correcteur que nous connaissons, pour avoir imaginé ou accepté une telle mutilation ? Umbre, larve, compagne di morte, représentent successivement deux blanches et une ronde, puis deux blanches pointées retombant sur une blanche, et, par conséquent, constituent une succession de notes larges, sombres, qui produisent un puissant effet de terreur religieuse. Au lieu de cela, le traducteur français, avec son affreux : Divinités du Styx! qu’il répète deux fois, le misérable! nous donne cinq petites notes sautillantes, qui se terminent par cet horrible vocable: Styx! Je conviens qu’il est bien infernal, mais infernal pour le chanteur, pour l’auditeur, et il détruit comme avec le cri aigu d’un sifflet, l’impression funèbre de cette invocation aux dieux de l’Érèbe. »
Le morceau ainsi corrigé, il priait la maîtresse du logis de le lui chanter. Alors, aux corrections purement matérielles, succédaient les plus délicates indications artistiques. Il entrait et nous faisait entrer dans tout le mystère des intentions de l’auteur, dans toutes les nuances de l’accent, de la prononciation, avec un art qui nous rendait visible la pensée de Glück, et était capable de changer un simple amateur en véritable artiste.
Plus poétique encore était Berlioz expliquant la Symphonie avec chœurs. Ses articles mêmes, si admirables qu’ils soient, n’en donnent qu’une idée imparfaite, car dans ses articles il n’y a que son opinion; dans sa parole, il y avait lui tout entier. A l’éloquence des mots, s’ajoutaient la physionomie, le geste, l’accent, les larmes, les exclamations d’enthousiasme, et ces trouvailles d’expression, ces audaces d’images que donne à celui qui parle le regard de celui qui écoute, le frémissement du visage répondant à la vibration de la parole. Une heure passée ainsi, m’en apprenait plus sur la musique instrumentale, qu’un concert du Conservatoire, ou, pour mieux dire, quand j’arrivais le dimanche suivant au Conservatoire, l’esprit encore tout plein des commentaires de Berlioz, l’œuvre de Beethoven s’ouvrait tout à coup devant moi comme un vaste temple plein de lumière; j’en saisissais du regard toute l’ordonnance, j’y marchais librement comme dans un domaine connu; j’en parcourais d’un pied sûr tous les détours. Berlioz m’avait donné la clef du sanctuaire.
Je lui dus une autre grande joie musicale.
Un soir, il arrive chez moi : « Venez, me dit-il, je vais vous faire voir quelque chose que vous n’avez jamais vu, et quelqu’un que vous n’oublierez pas. » Nous montons au second étage d’un petit hôtel meublé, et je me trouve vis-à-vis d’un jeune homme pâle, triste, élégant, ayant un léger accent étranger, des yeux bruns d’une douceur limpide incomparable, des cheveux châtains, presque aussi longs que ceux de Berlioz et retombant aussi en gerbe sur son front.
« Mon cher Chopin, je vous présente mon ami Legouvé. » C’était Chopin, en effet, arrivé depuis quelques jours à Paris. Son premier aspect m’avait ému, sa musique me troubla comme quelque chose d’inconnu.
Je ne puis mieux définir Chopin, qu’en disant que c’était une trinité charmante. Il y avait entre sa personne, son jeu et ses ouvrages, un tel accord, qu’on ne peut pas plus les séparer, ce semble, que les divers traits d’un même visage. Le son si particulier qu’il tirait du piano ressemblait au regard qui partait de ses yeux; la délicatesse un peu maladive de sa figure s’alliait à la poétique mélancolie de ses nocturnes; et le soin et la recherche de sa toilette faisaient comprendre l’élégance toute mondaine de certaines parties de ses œuvres; il me faisait l’effet d’un fils naturel de Weber et d’une duchesse; ce que j’appelais ses trois lui n’en formaient qu’un.
Son génie ne s’éveillait guère qu’à une heure du matin. Jusque-là, il n’était qu’un pianiste charmant. La nuit venue, il entrait dans le groupe des esprits aériens, des êtres ailés, de tout ce qui vole et brille au sein des demi-ténèbres d’une nuit d’été. Il lui fallait alors un auditoire très restreint et très choisi. La moindre figure un peu déplaisante suffisait pour le déconcerter. Je l’entends encore, un jour où son jeu me semblait un peu agacé, me dire tout bas en me désignant du regard une dame assise en face de lui : « C’est la plume de cette dame! Si cette plume-là ne s’en va pas, je ne pourrai pas continuer! » Une fois au piano, il jouait jusqu’à épuisement. Atteint d’une maladie qui ne pardonne pas, ses yeux se cerclaient de noir, ses regards s’animaient d’un éclat fébrile, ses lèvres s’empourpraient d’un rouge sanglant, son souffle devenait plus court! Il sentait, nous sentions que quelque chose de sa vie s’écoulait avec les sons, et il ne voulait pas s’arrêter, et nous n’avions pas la force de l’arrêter! la fièvre qui le brûlait nous envahissait tous! Pourtant, il y avait un moyen certain de l’arracher au piano, c’était de lui demander la marche funèbre qu’il a composée après les désastres de la Pologne. Jamais il ne se refusait à la jouer; mais à peine la dernière mesure achevée, il prenait son chapeau et partait. Ce morceau, qui était comme le chant d’agonie de sa patrie, lui faisait trop de mal; il ne pouvait plus rien dire après l’avoir dit, car ce grand artiste était un grand patriote, et les notes fières qui éclatent dans ses mazurkas comme des cris de clairon, racontent tout ce qui vibrait d’héroïque derrière ce pâle visage, qui n’a jamais dépassé la juvénilité; Chopin est mort à quarante ans, encore adolescent. Enfin, comme dernier trait de sa figure, ajoutez une finesse légèrement railleuse qui sentait son gentilhomme. Je ne puis oublier sa réponse après le seul concert public qu’il ait donné. Il m’avait prié d’en rendre compte. Liszt en réclama l’honneur. Je cours annoncer cette bonne nouvelle à Chopin, qui me dit doucement :
« J’aurais mieux aimé que ce fût vous.
— Vous n’y pensez pas, mon cher ami! Un article de Liszt, c’est une bonne fortune pour le public et pour vous. Fiez-vous à son admiration pour votre talent. Je vous promets qu’il vous fera un beau royaume.
— Oui, me dit-il en souriant, dans son empire! »
Liszt lui-même, dont Chopin se défiait à tort, car il écrivit un article charmant de sympathie sur ce concert, n’est devenu pour moi presque un ami, que grâce à mon amitié avec Berlioz. Mais le plus grand bien que j’aie retiré de cette amitié, c’est d’avoir pénétré dans le secret de ce génie et de ce caractère, et de pouvoir aujourd’hui l’expliquer et le défendre. Soyons sincères. Berlioz est admiré, acclamé, il n’est pas aimé. L’éclat de sa gloire n’a pas rejailli sur sa personne; on le juge mal comme homme, et on le connaît mal comme artiste; tout illustre qu’il soit, il est resté à l’état de sphinx; tâchons de déchiffrer l’énigme.
![]()
Trois reproches principaux sont adressés à Berlioz. On l’accuse d’être, comme compositeur, trop savant, c’est-à-dire d’avoir plus d’habileté que d’inspiration, d’être trop descriptif, de chercher avant tout l’imitation des bruits naturels; comme homme on lui reproche d’être égoïste, et comme critique, d’être méchant.
Une soirée de trois heures me convainquit qu’il n’était pas assez savant, que sa musique était avant tout psychologique, et que ce méchant était plein de cœur.
Voilà, on en conviendra, une soirée bien employée.
Sa Damnation de Faust venait d’étre réduite pour le piano.
« J’arriverai chez vous demain, à huit heures, me dit-il un jour, avec ma partition et mon exécutant; il n’a que douze ans, c’est un prodige qui deviendra un jour une merveille; il s’appelle Théodore Ritter. » [cf. Correspondance générale no. 1887]
Le lendemain, à l’heure dite, Ritter était au piano. Berlioz se place à côté de lui, l’interrompant souvent ou le faisant recommencer pour m’expliquer l’intention de tel ou tel passage, le sens de tel ou tel mouvement, de telle ou telle note, et à mesure qu’il parlait, m’apparaissait clairement le double but qu’il a toujours poursuivi, les deux objets contradictoires qu’il s’est toujours proposés: la grandeur dans l’ensemble et la minutie dans le détail; Michel-Ange et Meissonier. L’avouerai-je ? J’éprouvais une sorte de vertige à voir tout ce qu’il voulait faire dire à la musique, non seulement dans le domaine de la nature extérieure, mais surtout dans le domaine bien autrement mystérieux de l’âme. Nos émotions n’ont rien de si intime, nos sentiments n’ont rien de si secret, nos sensations n’ont rien de si fugitif, qu’il ne cherchât à le rendre par la langue des sons. Il voulait que sa musique fût l’écho des mille vibrations de son mobile cœur. Noble ambition, sans doute, mais au-dessus, je le crois, de sa puissance artistique. Je touche là un point très délicat. La famille des grands artistes se partage en deux classes: d’un côté les génies simples, clairs, lumineux, Haydn, Mozart, Rossini, et de notre temps Gounod. De l’autre les génies touffus, complexes Beethoven, Meyerbeer, et en face d’eux, Berlioz. Ces derniers créateurs ont peut-être, plus que les autres, besoin d’une très forte science; la multiplicité de leurs idées, la puissance de leurs conceptions, la profondeur mystérieuse de leurs aspirations, demandent un talent de mise en œuvre, une souplesse d’exécution, qui exigent à leur tour un travail auquel la plus heureuse nature ne peut suppléer. Quand on voit à quel immense labeur s’est livré Meyerbeer, quand on examine par quelle solide éducation il a commencé, quelle rude discipline il a subie, quelles études successives il a faites du génie allemand et du génie italien, de la musique vocale et de la musique instrumentale, quelles recherches infatigables l’ont mis au courant de toutes les inventions mécaniques, industrielles, relatives à la musique, quelle poursuite obstinée lui a fait connaître toutes les combinaisons mélodiques ou orchestrales trouvées par tous les artistes de tous les pays, on se rend compte que sa puissance de contrastes et d’effets n’était que le résultat de prodigieux efforts; on comprend à quel prix il a pu ajouter une octave au clavier de la musique dramatique. Eh bien, voilà ce qui a manqué à Berlioz. La résistance de son père lui a fait commencer ses études musicales trop tard. La pauvreté l’a empêché de les poursuivre à fond. Il lui a fallu chanter dans les chœurs et donner des leçons de guitare pour vivre, au lieu de travailler; il n’a pas pu acquérir assez de talent pour son génie. De là, dans son œuvre, à côté des plus ingénieuses et des plus délicates recherches d’exécution, des maladresses, des obscurités, des lacunes, des bizarreries qui sont des gaucheries. Sans doute, il était beaucoup plus habile que presque tous les autres, mais il ne l’était pas assez pour lui. Le talent d’exécution chez l’artiste doit être en rapport avec la nature et la richesse de sa conception. La plume de Lamartine, si brillante qu’elle fût, n’aurait pas suffi à l’imagination de Victor Hugo. La Fontaine ne s’est créé, qu’à force de travail, cet instrument merveilleux, qui se prêtait à exprimer les mille nuances de sa pensée. Berlioz, pour être tout lui-même, aurait eu besoin d’avoir la science et l’habileté de Beethoven. Du reste, qu’il se console! Weber se plaignait, lui aussi, de n’être pas assez savant! Freischütz n’en est pas moins immortel, et la Damnation de Faust aussi.
Viennent enfin ces deux terribles épithètes qu’on a accolées à son nom: égoïste et méchant. Égoïste comme homme, méchant comme critique.
Examinons ce grand et double reproche. Oui, sans doute, il était très occupé de lui-même, mais il trouvait le temps, j’en parle par expérience, de s’occuper ardemment des autres, de s’intéresser à tout ce qui intéressait ses amis, de s’émouvoir de leurs chagrins, de s’associer à leurs joies; c’était le plus reconnaissant des hommes, et s’il se souvenait quelquefois du mal, il se souvenait toujours du bien. Hetzel et moi, nous eûmes le plaisir de lui rendre un léger bon office. Il l’écrit dans ses mémoires en lettres d’or comme s’il s’agissait d’une bonne action, et il nous a donné, en remerciements, cent pour cent de notre argent, comme s’il ne nous l’avait pas remboursé. Sa reconnaissance a été un jour jusqu’à l’héroïsme. En 1848, M. Ch. Blanc, chargé de la direction des beaux-arts, fait donner à Berlioz par le ministère une marque de sympathie et d’estime. Vingt ans après, vingt ans pendant lesquels le protégé et le protecteur s’étaient à peine rencontrés, M. Ch. Blanc, candidat au titre d’académicien libre, se présente chez Berlioz. Il le trouve mourant.
« Je sais pourquoi vous venez, lui dit Berlioz.
— Ne parlons pas de cela, reprit vivement le candidat, j’ignorais absolument votre état de souffrance; ne parlons pas de cela, je me retire.
— Restez, et parlons-en. J’irai à l’Académie pour vous.
— Malade comme vous l’êtes... mon cher Berlioz... permettez-moi de vous dire que je vous le défends!
— Malade ? Oui, je le suis très gravement! mes jours sont comptés; mon médecin me l’a dit, il m’en a même dit le compte, ajouta-t-il avec un demi-sourire; mais l’élection a bien lieu le 16. J’ai le temps. J’aurai même, ajouta-t-il avec ce mélange de raillerie qui lui était habituel, j’aurai même encore quelques jours pour me préparer. » Une semaine plus tard, l’élection avait lieu; Berlioz s’y faisait porter, et quinze jours après, il était mort.
La pitié, chez lui, s’étendait même aux animaux, et arrivait jusqu’à la sensibilité. Je le vois encore un jour, pendant un dîner, où un des convives racontait en grand détail je ne sais quel exploit de chasse, cesser tout à coup de manger, détourner la tête, puis nous dire, tout tremblant... « C’est cruel! C’est lâche! Des hommes comme vous, parler gaiement d’oiseaux tombés tout sanglants sous le plomb, d’animaux blessés, et se débattant sur le sol, de créatures vivantes, qu’on achève à coups de crosse, ou à coups de talon... vous êtes des bourreaux! »
En l’entendant, et en le voyant saisi d’une émotion si réelle, je ne pus me défendre de penser à ces deux vers charmants de La Fontaine :
Les animaux périr!
Baucis en répandit en secret quelques larmes.
J’ai bien de la peine à voir un méchant homme dans celui qui m’a fait penser à Baucis.
Reste le critique. Celui-là était rude, j’en conviens, parfois même amer et injuste. Je ne veux pas l’excuser, mais je tiens à l’expliquer. D’abord il était aigri par la lutte et l’injustice; ses plus vives attaques ne sont souvent que des revanches. Puis son métier de critique lui était insupportable, il ne l’avait pris que pour vivre, et ne se mettait jamais devant son papier qu’avec un mouvement de colère, comme on reprend sa chaîne. L’argent même qu’il y gagnait lui était pénible, son orgueil de compositeur s’indignait que ses articles lui rapportassent plus que sa musique. Ajoutons qu’il était violemment exclusif comme tous les novateurs, comme Beethoven qui voulait qu’on donnât le fouet à Rossini, comme Michel-Ange qui parlait avec dédain de Rafaël, comme Corneille qui ne trouvait aucun talent dramatique à Racine. La jalousie n’a rien à faire dans ces dénis de justice; ce sont des antipathies de génies qui ne prouvent que le génie même; plus un esprit est original, plus souvent il est inique; si Rossini, Auber et Hérold avaient écrit ce qu’ils pensaient de Berlioz, ils en auraient dit bien plus long contre lui, que lui contre eux.
Enfin, terrible qualité qui devient bien vite un défaut! Berlioz avait énormément d’esprit. Une fois la plume à la main, il lui partait, d’entre les doigts, des traits de moquerie si plaisants, qu’il éclatait de rire en les écrivant, mais sa raillerie, pour être souvent de la pure gaieté, n’en était pas moins redoutable et redoutée. Peu de personnes étaient à l’aise avec lui. Les artistes les plus éminents, ses pairs, subissaient en sa présence une sorte de gêne. Gounod m’a souvent parlé de l’état de contrainte où le mettait Berlioz. J’ai vu Adolphe Nourrit, chez moi, un matin, lancé avec enthousiasme dans l’interprétation d’une mélodie de Schubert, se troubler tout à coup en voyant entrer Berlioz, et achever comme un écolier un morceau qu’il avait commencé comme un maître. Berlioz ne se doutait pas qu’il inspirât de tels sentiments, et s’il l’eût su, il en eût souffert! car toute sa malice sardonique tombait à l’instant devant la crainte d’affliger même un homme obscur.
Je ne sais quel pianiste étranger, inventeur de je ne sais quelle méthode de piano, vient trouver Berlioz et lui demande un article. Berlioz le congédie assez brutalement. Insistance du pianiste.
« Mettez ma méthode à l’épreuve, monsieur Berlioz.
— Eh bien, soit! j’accepte. Je vous enverrai un enfant qui veut être pianiste, malgré moi, malgré ses parents, malgré la musique! Si vous réussissez avec lui, je vous fais un article. »
Qui lui envoie-t-il ? Ritter! Ritter à qui il recommande bien de cacher son talent. Au bout de deux leçons, Berlioz rencontre l’inventeur :
« Eh bien, votre élève ?
— Oh! il a la tête bien dure, les doigts bien lourds, pourtant, je n’en désespère pas! »
Bientôt nouvelle rencontre :
« Hé bien ?
— Cela marche! cela marche!
— J’irai l’entendre chez vous demain. »
Le lendemain, arrive Berlioz qui dit tout bas à Ritter :
« Joue tout ton jeu! »
Le morceau commence, et voilà les gammes, les trilles, les traits qui partent à toute volée! Vous vous imaginez la stupéfaction du pauvre inventeur, et les éclats de rire de Berlioz, et sa joie vraiment diabolique en lui disant:
« C’est Ritter! c’est Ritter! »
Là-dessus, le malheureux suffoqué, les bras tombants, n’a que la force de dire :
« Oh! monsieur Berlioz! comment avez-vous pu vous moquer si cruellement d’un pauvre homme qui ne vous demandait que de l’aider à gagner sa vie! » Et il fond en larmes. Que fait Berlioz! Il fond en larmes à son tour; il se jette au cou du pauvre homme; il l’embrasse; il lui demande pardon, et, le lendemain, il lui écrit un article admirable. Voilà l’homme! Plume acérée! cœur tendre!
![]()
Avec Berlioz, il faut toujours en revenir à l’amour, c’est l’alpha et l’oméga de sa vie! Le hasard a voulu que je fusse son dernier comme son premier confident. En vain le mouvement de la vie séparait-il souvent nos deux existences : à la première rencontre, la confiance renaissait comme si nous nous étions vus la veille; je rentrais immédiatement dans mon rôle, et un carrefour, une porte cochère, un angle un peu obscur dans une place, tout lui était bon comme confessionnal.
Voici trois récits de passion qu’il m’a faits à quelques années de distance l’un de l’autre, et qui achèveront mieux ce portrait que tous les discours.
Un jour, une ondée de printemps m’avait surpris dans la rue Vivienne; je me réfugiai sous les colonnes placées devant le théâtre du Palais-Royal et j’y trouvai Berlioz. Il me prend le bras, son air était sombre, sa voix brève, et il marchait la tête basse. Tout à coup, se retournant vers moi:
« Mon ami, me dit-il, il y a en enfer des gens qui l’ont moins mérité que moi! »
Je sursautai, tout habitué que je fusse avec lui à l’inattendu:
« Eh! bon Dieu, qu’y a-t-il donc ?
— Vous savez que ma pauvre femme s’est retirée dans un petit logis à Montmartre.
— Où vous allez la voir souvent, je le sais aussi, et où votre sollicitude la suit comme votre respect.
— Beau mérite! reprit-il vivement; pour ne pas l’aimer et la vénérer, il faudrait être un monstre! »
Puis, avec une incroyable amertume :
« Eh bien, je suis un monstre!
— Encore quelque maladie de conscience!
— Jugez-en. Je ne vis pas seul.
— Je le sais!
— Une autre a pris sa place chez moi... Que voulez-vous? Je suis faible! Or, il y a quelques jours, ma femme entend sonner à sa porte. Elle va ouvrir et se trouve en face d’une jeune dame, élégante, jolie, qui, le sourire sur les lèvres, lui dit:
— Madame Berlioz, s’il vous plaît ? madame. — C’est moi, madame, répond ma femme. — Vous vous trompez, reprit l’autre, je vous demande Mme Berlioz. — C’est moi, madame!
— Non, ce n’est pas vous! Vous me parlez, vous, de la vieille Mme Berlioz, de la délaissée!... moi je parle de la jeune, de la jolie, de la préférée! Eh bien, celle-là, c’est moi. » Et elle sort en fermant brusquement la porte sur la pauvre créature, qui tomba à demi évanouie de douleur!
Berlioz s’arrête à ce mot, puis après un moment de silence, il reprit:
« Eh bien, voyons, n’est-ce pas atroce ? n’avais-je pas raison de dire...
— Qui vous a raconté cette action abominable? m’écriai-je vivement. Celle qui l’a faite, sans doute. Elle s’en est vantée, j’en suis sûr. Et vous ne l’avez pas jetée à la porte?
— Comment l’aurais-je pu ? me répondit-il d’une voix brisée, je l’aime! »
Son accent m’ôta la force de lui répondre, et le reste de sa confidence acheva de me désarmer en me montrant que sa femme était bien vengée. Celle qui la remplaçait, avait une voix assez jolie mais faible, et elle était mordue de la rage de chanter sur un théâtre. Eh bien, il fallut que Berlioz employât son influence de feuilletoniste pour lui obtenir un engagement, il fallut que cette plume honnête, inflexible, farouche, se pliât à ménager, à flatter des directeurs et des auteurs pour lui procurer, à elle, un rôle de début! Elle fut sifflée; il fallut qu’il écrivît un article où il transforma sa chute en succès. Écartée du théâtre, elle voulut chanter dans les concerts organisés par Berlioz, et chanter quoi ? Sa musique à lui! Des mélodies de lui! Et il fallut encore qu’il cédât, il fallut que lui, qui était exaspéré par une fausse note, et malade d’un mouvement mal compris, il consentît à entendre chanter faux ses propres œuvres, à diriger lui-même, comme chef d’orchestre, le morceau où il était assassiné comme compositeur!
« Voyons, ajouta-t-il, après m’avoir énuméré ses tortures, n’est-ce pas vraiment diabolique, c’est-à-dire tout à la fois tragique et grotesque ? je dis que je mériterais d’aller en enfer... mais j’y suis! Et ce terrible gouailleur de Méphisto rit, je le gage, de me crucifier ainsi dans mes nerfs de musicien! En vérité, je suis quelquefois tenté d’en rire aussi. »
Et, en effet, tandis que des larmes de rage roulaient dans ses yeux, je ne sais quelle expression de moquerie amère contractait son visage.
Le second récit est plus caractéristique encore, et nous fera faire un pas de plus dans la connaissance de cette créature étrange, car l’amour, chez lui, prenait tant de formes, que chaque passion nouvelle nous montrait en lui quelque chose d’inconnu.
![]()
La faculté dominante de Berlioz était la faculté de souffrir. Toutes ses sensations allaient jusqu’à la douleur. Le plaisir même touchait chez lui à la peine. Quand il fut pris de sa première passion, quel fut son premier sentiment ? Il l’a écrit lui-même :
« Je me sentis au cœur une profonde douleur. »
On se rappelle sa réponse à un de ses voisins de spectacle qui, le voyant pleurer à sanglots pendant une symphonie de Beethoven, lui dit affectueusement:
« Vous paraissez beaucoup souffrir, monsieur ? Vous devrier vous retirer.
— Est-ce que vous croyez que je suis ici pour mon plaisir ? » lui répondit brusquement Berlioz.
J’avais souvent remarqué en lui cette disposition fatale; je prétendais qu’on ne pouvait pas le toucher sans le faire crier, et je l’appelais quelquefois en riant, mon cher écorché.
Un automne, vers 1865, je crois [1862 ou 1863], les répétitions de son opéra de Béatrice et Bénédict le conduisirent à Bade où un hasard de voyage m’avait amené. Un matin, je le rencontre dans les bois qui mènent au vieux château. Il me parut vieilli, changé et triste. Nous nous assîmes sur un banc, car l’ascension le fatiguait. Il tenait à la main une lettre qu’il froissait convulsivement.
« Encore une lettre! lui dis-je gaiement pour tâcher de le désassombrir.
— Toujours.
— Ah!... est-elle jeune ?
— Hélas! oui.
— Jolie ?
— Trop jolie! Et avec cela une intelligence, une âme!
— Et elle vous aime ?
— Elle me le dit... Elle me l’écrit...
— Il me semble que si, en outre, elle vous le prouve...
— Eh! sans doute, elle me le prouve... Mais qu’est-ce que cela prouve, des preuves ?
— Oh! nous voilà dans le cinquième acte d’Othello!
— Tenez, prenez cette lettre... ne craignez pas d’être indiscret en la lisant, elle ne porte pas de signature; lisez et jugez. »
La lettre lue, je ne pus m’empêcher de lui dire :
« Ah çà, où trouvez-vous là un sujet de vous affliger ? Cette lettre part d’une femme supérieure; de plus, elle est pleine de tendresse, de passion... Qu’y a-t-il donc ?...
— Il y a, s’écria-t-il en m’interrompant avec désespoir... il y a que j’ai soixante ans!
— Qu’importe, si elle ne vous en voit que trente!
— Mais regardez-moi donc! Voyez ces joues creuses, ces cheveux gris, ce front ridé!
— Les rides des hommes de génie ne comptent pas. Les femmes sont fort différentes de nous. Nous ne comprenons guère, nous, l’amour sans la beauté. Mais elles s’éprennent dans un homme de toutes sortes de choses. Tantôt c’est le courage, tantôt la gloire, tantôt le malheur! Elles aiment parfois en nous ce qui nous manque.
— C’est ce qu’elle me dit, quand elle voit mes désespoirs!...
— Vous lui en parlez donc ?
— Comment les lui cacher ? Parfois, tout à coup, sans cause, je tombe assis sur un siège en sanglotant! C’est cette affreuse pensée qui m’assaille; elle le devine! Et alors avec une angélique tendresse... elle me dit : « Malheureux ingrat, qui puis-je faire pour vous convaincre ? Voyons!... Est-ce que j’ai aucun intérêt à vous dire que je vous aime ? Est-ce que je n’ai pas tout oublié pour vous ? Est-ce que je ne m’expose pas à mille périls pour vous ? » Et elle me prend la tête entre ses mains; et je sens ses larmes qui tombent dans mon cou. Et pourtant, malgré cela, toujours retentit au fond de mon cœur cet affreux mot : J’ai soixante ans! Elle ne peut pas m’aimer! Elle ne m’aime pas! » Ah! mon ami, quel supplice! se créer un enfer avec un paradis! »
Je le quittai sans avoir pu le consoler, et très ému, je l’avoue, non seulement de son chagrin, mais de son humilité. Comme nous voilà loin des puérils orgueils de Chateaubriand et de Gœthe, qui, si béatement, se croyaient revêtus par leur génie d’une jeunesse éternelle, qu’aucune adoration ne les surprenait. Que j’aime mieux Berlioz! Comme il est bien plus humain! Et comme je suis touché de le voir, cet orgueilleux prétendu, oublier si bien qu’il est un grand artiste, pour se souvenir seulement qu’il est un vieil homme!
Enfin me voici à notre dernière étape dans cette excursion à travers l’âme et le génie de Berlioz, car son âme et son génie se tiennent étroitement et s’expliquent l’un l’autre.
Gounod venait d’être nommé membre de l’Institut; Berlioz avait cordialement, chaudement, fraternellement travaillé à son élection. Encore une réponse à sa réputation d’égoïste. Gounod nous réunit à dîner chez lui pour fêter sa nomination. On se sépare à minuit. Berlioz, fatigué, avait peine à marcher; je lui donne le bras pour remonter chez lui, rue de Calais, et nous voilà au milieu des rues désertes, recommençant une de ces promenades nocturnes, comme nous en avions tant fait dans notre jeunesse. Il était silencieux, marchait courbé, et, de temps en temps, tirait de sa poitrine quelqu’un de ces soupirs que je connaissais si bien. Je lui adressai mon éternelle question :
« Qu’y a-t-il encore ?
— Quelques lignes d’elle que j’ai reçues ce matin.
— Qui, elle ? la dame de Bade ou une autre ?
— Une autre, me répondit-il. Ah! je vais vous paraître bien étrange. Vous rappelez-vous Estelle ?
— Qui, Estelle ?
— La jeune fille de Meylan.
— Celle que vous avez aimée à douze ans ?
— Oui, je l’ai revue il y a quelque temps, et en la revoyant... O mon ami! comme Virgile a raison! Quel cri parti du cœur que ce vers:
....Agnosco veteris vestigia flammæ.
[Je reconnais les traces de mon ancienne flamme!]
— Votre ancienne flamme ? Comment ?
— Oh! c’est absurde! c’est ridicule... je le sais bien!... Mais qu’importe? il y a plus de choses dans l’âme humaine, Horatio, comme dit Hamlet, qu’il n’en peut tenir dans votre philosophie! La vérité est qu’à sa vue toute mon enfance, toute ma jeunesse me sont remontées au cœur!... Cette secousse électrique que j’ai ressentie jadis, à sa vue, m’a encore traversé le cœur entier, comme il y a plus de cinquante ans!
— Mais quel âge a-t-elle donc ?
— Six ans de plus que moi, et j’en ai plus de soixante!
— C’est donc une merveille! Une Ninon!
— Je n’en sais rien. Je ne crois pas. Mais que me font et sa figure et son âge ? Il n’y a rien de réel dans ce monde, mon cher ami, que ce qui se passe là, dans ce petit coin de l’être humain qu’on appelle le cœur. Eh bien, sachez que moi, vieux, veuf, presque seul dans le monde, j’ai concentré ma vie tout entière dans cet obscur petit village de Meylan où elle vit ? Je ne supporte l’existence qu’en me disant: Cet automne, j’irai passer un mois auprès d’elle. Je mourrais dans cet enfer de Paris, si elle ne m’avait pas permis de lui écrire, et si de temps en temps il ne m’arrivait quelques lettres d’elle!
— Lui avez-vous dit que vous l’aimez ?
— Oui.
— Qu’a-t-elle répondu?
— Elle est restée stupéfaite, un peu effrayée d’abord, je lui faisais l’effet d’un fou; mais peu à peu j’ai fini par la toucher. Je demande si peu! Mon pauvre amour a besoin de si peu de chose pour subsister! M’asseoir près d’elle, la regarder filer, car elle file... ramasser ses lunettes, car elle porte des lunettes... entendre le son de sa voix... lui lire quelques passages de Shakespeare... la consulter sur ce qui me touche, m’entendre gronder par elle... Oh! mon ami! mon ami!... Les premières amours!... Elles ont une force que rien n’égale! »
Et suffoqué par l’émotion, il s’assit sur une borne au coin de la rue Mansard. La lueur d’un bec de gaz tombait sur ce pâle visage, et y jetait une blancheur de spectre, et je voyais ruisseler sur ses joues ces mêmes larmes de jeune homme qui m’avaient si souvent touché autrefois! Une compassion profonde, pleine de tendresse, me saisissait en face de ce grand artiste, condamné à la passion, et mon émotion s’accroissait par un antique et glorieux souvenir: je pensais à Michel-Ange septuagénaire, et agenouillé tout en pleurs devant le corps de celle qu’il aimait, la marquise de Pescaire.
Ne jugeons pas ces êtres exceptionnels à la mesure des hommes ordinaires. Ce sont des astres qui ont leurs lois à part. Ils ne ressemblent pas à ces étoiles pures et sereines qui luisent doucement et régulièrement pendant les belles nuits; ce sont des comètes. L’orbite qu’ils parcourent, la forme qu’ils revêtent, la lumière qu’ils répandent, l’influence qu’ils exercent, le lieu d’où ils viennent, le lieu où ils vont, tout est étrange en eux, et tout est conséquent. Est-ce le génie de Berlioz qui lui a donné son cœur ?... Est-ce son cœur qui lui a donné son génie? Nul ne peut le dire, mais ils sont le portrait l’un de l’autre. Il faut peut-être avoir aimé ainsi, pour avoir chanté ainsi. Ces passions orageuses, insensées, désespérées, n’expliquent-elles pas ce que ses œuvres ont de mélancolique, de bizarre, de tourmenté, et ajoutons, d’irrésistiblement tendre! Il ne faut pas l’oublier. Personne n’a trouvé des accents plus adorablement doux que Berlioz. La partie la plus durable de son œuvre est peut-être, non dans ses conceptions les plus grandioses, mais dans ses chefs-d’œuvre d’exquise et intime poésie, le septuor des Troyens, le duo de Béatrice et Bénédict, la seconde partie de l’Enfance du Christ, la Danse des Sylphes. Ce génie si amoureux des éclats de trompette et des coups de foudre, n’est peut-être jamais si sublime que quand il fait très peu de bruit. De cette richesse de contrastes naissait le charme incroyable de Berlioz. M. Guizot, qui se connaissait en hommes, me dit un jour :
« J’ai vu chez vous bien des artistes illustres; celui qui m’a le plus frappé, c’est M. Berlioz; voilà une créature vraiment originale! »
M. Guizot avait dit le mot vrai. Tout était original dans Berlioz. Un mélange extraordinaire d’enthousiasme et de sarcasme! Un esprit toujours imprévu! Une conversation qui vous tenait toujours en éveil par son inégalité même! Parfois de longs silences, avec de sombres regards penchés en bas, et qui semblaient plonger au fond de je ne sais quels abîmes. Puis des réveils soudains, éblouissants! Un jaillissement de mots spirituels, comiques, touchants! Des éclats de rire homériques! Des joies d’enfant! Il n’était pas très instruit et il n’avait guère que deux livres de chevet; mais quels livres! Virgile et Shakespeare. Il les savait par cœur. Le bibliothécaire de l’Institut, le savant M. Tardieu, m’a dit que Berlioz arrivait volontiers les jours de séance de son Académie, les samedis, un peu avant l’heure, et il demandait toujours un livre, et toujours le même, Virgile! Comme les hommes unius libri, les hommes d’un seul livre, ainsi que disaient nos pères, il enchâssait naturellement, sans apprêt, des mots, des lignes de ses deux amis dans la conversation, et en tirait mille aperçus nouveaux et piquants. Je lis dans une lettre de lui à propos des Troyens, cette phrase significative [Correspondance générale no. 2136] : « Je viens d’achever le duo du quatrième acte; c’est une scène que j’ai volée à Shakespeare dans le Marchand de Venise, et je l’ai virgilianisée. Ces délicieux radotages d’amour entre Jessica et Lorenzo manquaient dans Virgile. Shakespeare a fait la scène, je la lui ai reprise et je tâche de les fondre tout deux ensemble. Quels chanteurs que ces deux! » Mais l’attrait le plus profond qu’inspirait Berlioz venait du sentiment qu’on avait de ses souffrances. Soyons sincère, il a vraiment été bien malheureux! Une santé misérable! Un corps ruiné dès sa jeunesse par les privations! Une pauvreté allant jusqu’à la faim. Une mélancolie native allant jusqu’au spleen! Les déboires du début se prolongeant dans les déceptions de l’âge mûr! Une lutte de quarante ans contre les dédains de Paris qu’il adorait, et qu’il injuriait avec la rage d’un amant repoussé! Des exils perpétuels pour aller chercher à l’étranger quelque peu de cette gloire que son pays lui refusait! Arrêté même dans le développement de son talent! Je le vois toujours entrant chez moi, encore plus pâle, encore plus sombre que de coutume, et se jetant dans un fauteuil, et me disant :
« Savez-vous ce qui m’est arrivé ? Depuis quatre jours, je suis poursuivi par une idée de symphonie, une idée féconde, originale, et depuis quatre jours je la chasse, je l’exorcise comme l’esprit du mal.
— Pourquoi ? Pourquoi ne l’écrivez-vous pas ?
— Parce que, si je l’écris, je voudrai la faire exécuter, et que l’exécution, les répétitions, les copies d’orchestre, la location de la salle, le prix des chanteurs, me coûteront quatre mille francs, et que je n’ai pas quatre mille francs! »
N’est-ce pas affreux ? Ce grand artiste, forcé d’étouffer le fruit de sa pensée au sein de sa pensée même, d’accomplir un infanticide moral! Sans doute bien d’autres hommes de génie, égaux et supérieurs à lui, ont souffert autant et plus que lui! Quoi de plus digne de pitié que Beethoven exilé de son royaume, le monde des sons, par la surdité, et condamné à ne pas entendre les accents sublimes dont il enchantait toutes les oreilles! De nos jours, nous avons vu Ingres, Delacroix, Corot méconnus, niés, bafoués; mais enfin, pour Beethoven, une gloire immense a été la compensation d’une immense douleur, et nos trois grands peintres sont entrés de leur vivant en possession de leur renommée! Mais Berlioz n’a été compris que le lendemain de sa mort, et sa gloire tardive ne semble qu’une nouvelle ironie du sort et comme une continuation de son mauvais destin. Aussi ai-je besoin de croire que là où il est (qu’on pardonne cette superstition, si c’en est une, à un ami), j’ai besoin de croire qu’il assiste de loin à son triomphe, que quelque chose lui apprend que son nom est associé à celui de Beethoven, que ses œuvres passionnent la foule, que ses symphonies font recette, qu’on décore des chefs d’orchestre rien que pour avoir fait exécuter sa musique! Comme il doit être étonné et heureux! Heureux, oui! Étonné ? je ne sais; il s’y attendait.
![]()
Site Hector Berlioz créé le 18 juillet 1997 par Michel Austin et Monir Tayeb; cette page créée le 19 septembre 2004, révisée le 1er mars 2023.
© Monir Tayeb et Michel Austin. Tous droits de reproduction réservés.
![]() Retour à la page Ernest Legouvé et Berlioz
Retour à la page Ernest Legouvé et Berlioz
![]() Retour à la page Exécutions et articles contemporains
Retour à la page Exécutions et articles contemporains
![]() Retour à la Page d’accueil
Retour à la Page d’accueil
![]() Back to Ernest Legouvé and Berlioz page
Back to Ernest Legouvé and Berlioz page
![]() Back to Contemporary Performances and Articles page
Back to Contemporary Performances and Articles page
![]() Back to Home Page
Back to Home Page