de
HECTOR BERLIOZ
XLIII
Florence. — Scène funèbre. — La bella sposina. — Le
Florentin gai. — Lodi. — Milan. —
Le théâtre de la Cannobiana. — Le public. — Préjugés
sur l’organisation musicale des Italiens. —
Leur amour invincible pour les platitudes brillantes et
les vocalisations. — Rentrée en France.
J’étais fort morose, bien que mon ardent désir de revoir la France fût sur le point d’être satisfait. Un tel adieu à l’Italie avait quelque chose de solennel, et sans pouvoir me rendre bien compte de mes sentiments, j’en avais l’âme oppressée. L’aspect de Florence, où je rentrais pour la quatrième fois, me causa surtout une impression accablante. Pendant les deux jours que je passai dans la cité reine des arts, quelqu’un m’avertit que le peintre Chenavard, cette grosse tête crevant d’intelligence, me cherchait avec empressement et ne pouvait parvenir à me rencontrer. Il m’avait manqué deux fois dans les galeries du palais Pitti, il était venu me demander à l’hôtel, il voulait me voir absolument. Je fus très-sensible à cette preuve de sympathie d’un artiste aussi distingué ; je le cherchai sans succès à mon tour, et je partis sans faire sa connaissance. Ce fut cinq ans plus tard seulement, que nous nous vîmes enfin à Paris et que je pus admirer la pénétration, la sagacité et la lucidité merveilleuse de son esprit, dès qu’il veut l’appliquer à l’étude des questions vitales des arts mêmes, tels que la musique et la poésie, les plus différents de l’art qu’il cultive.
Je venais de parcourir le Dôme, un soir en le poursuivant, et je m’étais assis près d’une colonne pour voir s’agiter les atomes dans un splendide rayon du soleil couchant qui traversait la naissante obscurité de l’église, quand une troupe de prêtres et de porte-flambeaux entra dans la nef pour une cérémonie funèbre. Je m’approchai ; je demandai à un Florentin quel était le personnage qui en était l’objet : È una sposina, morta al mezzo giorno ! me répondit-il d’un air gai. Les prières furent d’un laconisme extraordinaire, les prêtres semblaient, en commençant, avoir hâte de finir. Puis, le corps fut mis sur une sorte de brancard couvert, et le cortége s’achemina vers le lieu où la morte devait reposer jusqu’au lendemain, avant d’être définitivement inhumée. Je le suivis. Pendant le trajet les chantres porte-flambeaux grommelaient bien, pour la forme, quelques vagues oraisons entre leurs dents ; mais leur occupation principale était de faire fondre et couler autant de cire que possible, des cierges dont la famille de la défunte les avait armés. Et voici pourquoi : le restant des cierges devait, après la cérémonie, revenir à l’église, et comme on n’osait pas en voler des morceaux entiers, ces braves lucioli, d’accord avec une troupe de petits drôles qui ne les quittaient pas de l’œil, écarquillaient à chaque instant la mèche du cierge qu’ils inclinaient ensuite pour répandre la cire fondante sur le pavé. Aussitôt les polissons, se précipitant avec une avidité furieuse, détachaient la goutte de cire de la pierre avec un couteau et la roulaient en boule qui allait toujours grossissant. De sorte qu’à la fin du trajet, assez long (la morgue étant située à l’une des plus lointaines extrémités de Florence), ils se trouvaient avoir fait, indignes frelons, une assez bonne provision de cire mortuaire. Telle était la pieuse préoccupation des misérables par qui la pauvre sposina était portée à sa couche dernière.
Parvenu à la porte de la morgue, le même Florentin gai, qui m’avait répondu dans le dôme et qui faisait partie du cortége, voyant que j’observais avec anxiété le mouvement de cette scène, s’approcha de moi et me dit en espèce de français :
« — Volé-vous intrer ?
— Oui, comment faire ?
— Donnez-moi tré paoli. »
Je lui glisse dans la main les trois pièces d’argent qu’il me demandait ; il va s’entretenir un instant avec le concierge de la salle funèbre, et je suis introduit. La morte était déjà déposée sur une table. Une longue robe de percale blanche, nouée autour de son cou et au-dessous de ses pieds, la couvrait presque entièrement. Ses noirs cheveux à demi tressés coulaient à flots sur ses épaules, grands yeux bleus demi-clos, petite bouche, triste sourire, cou d’albâtre, air noble et candide... jeune !... jeune !... morte !... L’Italien toujours souriant, s’exclama : « È bella ! » Et, pour me faire mieux admirer ses traits, soulevant la tête de la pauvre jeune belle morte, il écarta de sa sale main les cheveux qui semblaient s’obstiner, par pudeur, à couvrir ce front et ces joues où régnait encore une grâce ineffable, et la laissa rudement retomber sur le bois. La salle retentit du choc... je crus que ma poitrine se brisait à cette impie et brutale résonance... N’y tenant plus, je me jette à genoux, je saisis la main de cette beauté profanée, je la couvre de baisers expiatoires, en proie à l’une des angoisses de cœur les plus intenses que j’aie ressenties de ma vie. Le Florentin riait toujours...
Mais je vins tout à coup à penser ceci : que dirait le mari, s’il pouvait voir la chaste main qui lui fut si chère, froide tout à l’heure, attiédie maintenant par les baisers d’un jeune homme inconnu ? dans son épouvante indignée, n’aurait-il pas lieu de croire que je suis l’amant clandestin de sa femme, qui vient, plus aimant et plus fidèle que lui, exhaler sur ce corps adoré un désespoir shakespearien ? Désabusez donc ce malheureux !... Mais n’a-t-il pas mérité de subir l’incommensurable torture d’une erreur pareille ?... Lymphatique époux ! laisse-t-on arracher de ses bras vivants la morte qu’on aime !...
Addio ! addio ! bella sposa abbandonata ! ombra dolente ! adesso, forse, consolata ! perdona ad un straniero le pie lagrime sulla pallida mano. Almen colui non ignora l’amore ostinato ne la religione della beltà.
Et je sortis tout bouleversé.
Ah ça ! mais, voici bien des histoires cadavéreuses ! les belles dames qui me liront, s’il en est qui me lisent, ont le droit de demander si c’est pour les tourmenter que je m’entête à leur mettre ainsi de hideuses images sous les yeux. Mon Dieu non ! je n’ai pas la moindre envie de les troubler de cette façon, ni de reproduire l’ironique apostrophe d’Hamlet. Je n’ai pas même de goût très-prononcé pour la mort ; j’aime mille fois mieux la vie. Je raconte une partie des choses qui m’ont frappé ; il se trouve dans le nombre quelques épisodes de couleur sombre, voilà tout. Cependant, je préviens les lectrices qui ne rient pas quand on leur rappelle qu’elles finiront aussi par faire cette figure-là, que je n’ai plus rien de vilain à leur narrer, et qu’elles peuvent continuer tranquillement à parcourir ces pages, à moins, ce qui est très-probable, qu’elles n’aiment mieux aller faire leur toilette, entendre de mauvaise musique, danser la polka, dire une foule de sottises et tourmenter leur amant.
En passant à Lodi, je n’eus garde de manquer de visiter le fameux pont. Il me sembla entendre encore le bruit foudroyant de la mitraille de Bonaparte et les cris de déroute des Autrichiens.
Il faisait un temps superbe, le pont était désert, un vieillard seulement, assis sur le bord du tablier, y pêchait à la ligne. — Sainte-Hélène !...
En arrivant à Milan, il fallut, pour l’acquit de ma conscience, aller voir le nouvel Opéra. On jouait alors à la Cannobiana l’Elisir d’amore de Donizetti. Je trouvai la salle pleine de gens qui parlaient tout haut et tournaient le dos au théâtre ; les chanteurs gesticulaient toutefois et s’époumonaient à qui mieux mieux ; du moins je dus le croire en les voyant ouvrir une bouche immense, car il était impossible, à cause du bruit des spectateurs, d’entendre un autre son que celui de la grosse-caisse. On jouait, on soupait dans les loges, etc., etc. En conséquence, voyant qu’il était inutile d’espérer entendre la moindre chose de cette partition, alors nouvelle pour moi, je me retirai. Il paraît cependant, plusieurs personnes me l’ont assuré, que les Italiens écoutent quelquefois. En tout cas, la musique pour les Milanais, comme pour les Napolitains, les Romains, les Florentins et les Génois, c’est un air, un duo, un trio, tels quels, bien chantés ; hors de là ils n’ont plus que de l’aversion ou de l’indifférence. Peut-être ces antipathies ne sont-elles que des préjugés et tiennent-elles surtout à ce que la faiblesse des masses d’exécution, chœurs ou orchestres, ne leur permet pas de connaître les chefs-d’œuvre placés en dehors de l’ornière circulaire qu’ils creusent depuis si longtemps. Peut-être aussi peuvent-ils suivre encore jusqu’à une certaine hauteur l’essor des hommes de génie, si ces derniers ont soin de ne pas choquer trop brusquement leurs habitudes enracinées. Le grand succès de Guillaume Tell à Florence viendrait à l’appui de cette opinion. La Vestale même, la sublime création de Spontini, obtint il y a vingt-cinq ans, à Naples, une suite de représentations brillantes. En outre, si l’on observe le peuple dans les villes soumises à la domination autrichienne, on le verra se ruer sur les pas des musiques militaires pour écouter avidement ces belles harmonies allemandes, si différentes des fades cavatines dont on le gorge habituellement. Mais, en général, cependant, il est impossible de se dissimuler que le peuple italien n’apprécie de la musique que son effet matériel, ne distingue que ses formes extérieures.
De tous les peuples de l’Europe, je penche fort à le regarder comme le plus inaccessible à la partie poétique de l’art ainsi qu’à toute conception excentrique un peu élevée. La musique n’est pour les Italiens qu’un plaisir des sens, rien autre. Ils n’ont guère pour cette belle manifestation de la pensée plus de respect que pour l’art culinaire. Ils veulent des partitions dont ils puissent du premier coup, sans réflexion, sans attention même, s’assimiler la substance ; comme ils feraient d’un plat de macaroni.
Nous autres Français, si petits, si
mesquins en musique, nous pourrons bien, comme les Italiens, faire retentir
le théâtre d’applaudissements furieux, pour un trille, une
gamme chromatique de la cantatrice à la mode, pendant qu’un chœur d’action,
un récitatif obligé du plus grand style passeront
inaperçus ; mais au moins nous écoutons, et, si nous ne comprenons
pas les idées du compositeur, ce n’est jamais notre faute. Au-delà
des Alpes, au contraire, on se comporte, pendant les représentations, d’une manière si humiliante pour
l’art et pour les artistes, que j’aimerais autant, je l’avoue
![]() , être
obligé de vendre du poivre et de la cannelle chez un épicier
de la rue Saint-Denis que d’écrire un opéra pour les Italiens.
Ajoutez à cela qu’ils sont routiniers et fanatiques comme on ne l’est plus, même à
l’Académie ; que la moindre innovation
imprévue dans le style mélodique, dans l’harmonie, le rhythme
ou l’instrumentation, les met en fureur ; au point que les
dilettanti de Rome, à l’apparition du Barbiere di Siviglia de Rossini,
si complétement italien cependant, voulurent assommer le jeune maestro,
pour avoir eu l’insolence de faire autrement que Paisiello.
, être
obligé de vendre du poivre et de la cannelle chez un épicier
de la rue Saint-Denis que d’écrire un opéra pour les Italiens.
Ajoutez à cela qu’ils sont routiniers et fanatiques comme on ne l’est plus, même à
l’Académie ; que la moindre innovation
imprévue dans le style mélodique, dans l’harmonie, le rhythme
ou l’instrumentation, les met en fureur ; au point que les
dilettanti de Rome, à l’apparition du Barbiere di Siviglia de Rossini,
si complétement italien cependant, voulurent assommer le jeune maestro,
pour avoir eu l’insolence de faire autrement que Paisiello.
Mais ce qui rend tout espoir d’amélioration
chimérique, ce qui peut faire considérer le sentiment musical
particulier aux Italiens comme un résultat nécessaire de
leur organisation, ainsi que l’ont pensé Gall et Spurzeim, c’est
leur amour exclusif pour tout ce qui est dansant, chatoyant, brillanté,
gai, en dépit des passions diverses qui animent les personnages,
en dépit des temps et des lieux, en un mot, en dépit du bon sens. Leur musique rit
toujours![]() , et quand
par hasard, dominé par le drame, le compositeur se permet un instant
de n’être pas absurde, vite il s’empresse de revenir au style obligé,
aux roulades, aux grupetti, aux trilles, aux mesquines frivolités
mélodiques, soit dans les voix, soit dans l’orchestre, qui, succédant
immédiatement à quelques accents vrais, ont l’air d’une raillerie
et donnent à l’opera seria toutes les allures de la parodie
et de la charge.
, et quand
par hasard, dominé par le drame, le compositeur se permet un instant
de n’être pas absurde, vite il s’empresse de revenir au style obligé,
aux roulades, aux grupetti, aux trilles, aux mesquines frivolités
mélodiques, soit dans les voix, soit dans l’orchestre, qui, succédant
immédiatement à quelques accents vrais, ont l’air d’une raillerie
et donnent à l’opera seria toutes les allures de la parodie
et de la charge.
Si je voulais citer, les exemples fameux ne me manqueraient pas ; mais, pour ne raisonner qu’en thèse générale et abstraction faite des hautes questions d’art, n’est-ce pas d’Italie que sont venues les formes conventionnelles et invariables, adoptées depuis par quelques compositeurs français, que Cherubini et Spontini, seuls entre tous leurs compatriotes, ont repoussées, et dont l’école allemande est restée pure ? Pouvait-il entrer dans les habitudes d’êtres bien organisés et sensibles à l’expression musicale d’entendre, dans un morceau d’ensemble, quatre personnages, animés de passions entièrement opposées, chanter successivement tous les quatre la même phrase mélodique, avec des paroles différentes, et employer le même chant pour dire : « O toi que j’adore... — Quelle terreur me glace... — Mon cœur bat de plaisir... — La fureur me transporte. » Supposer, comme le font certaines gens, que la musique est une langue assez vague pour que les inflexions de la fureur puissent convenir également à la crainte, à la joie et à l’amour, c’est prouver seulement qu’on est dépourvu du sens qui rend perceptibles à d’autres différents caractères de musique expressive, dont la réalité est pour ces derniers aussi incontestable que l’existence du soleil. Mais cette discussion, déjà mille fois soulevée, m’entraînerait trop loin. Pour en finir, je dirai seulement qu’après avoir étudié longuement, sans la moindre prévention, le sentiment musical de la nation italienne, je regarde la route suivie par ses compositeurs comme une conséquence forcée des instincts du public, instincts qui existent aussi, d’une façon plus ou moins évidente, chez les compositeurs ; qui se manifestaient déjà à l’époque de Pergolèse, et qui, dans son trop fameux Stabat, lui firent écrire une sorte d’air de bravoure sur le verset :
Et mœrebat,
Et tremebat,
Cum videbat,
Nati pœnas inclyti ;
instincts dont se plaignaient le savant Martini, Beccaria, Calzabigi et beaucoup d’autres esprits élevés ; instincts dont Gluck, avec son génie herculéen et malgré le succès colossal d’Orfeo, n’a pu triompher ; instincts qu’entretiennent les chanteurs, et que certains compositeurs ont développés à leur tour dans le public ; instincts, enfin, qu’on ne détruira pas plus, chez les Italiens, que, chez les Français, la passion innée du vaudeville. Quant au sentiment harmonique des ultramontains, dont on parle beaucoup, je puis assurer que les récits qu’on en a faits sont au moins exagérés. J’ai entendu, il est vrai, à Tivoli et à Subiaco, des gens du peuple chantant assez purement à deux voix ; dans le Midi de la France, qui n’a aucune réputation en ce genre, la chose est fort commune. A Rome, au contraire, il ne m’est pas arrivé de surprendre une intonation harmonieuse dans la bouche du peuple ; les pecorari (gardiens de troupeaux) de la plaine, ont une espèce de grognement étrange qui n’appartient à aucune échelle musicale et dont la notation est absolument impossible. On prétend que ce chant barbare offre beaucoup d’analogie avec celui des Turcs.
C’est à Turin que, pour la première fois, j’ai entendu chanter en chœur dans les rues. Mais ces choristes en plein vent sont, pour l’ordinaire, des amateurs pourvus d’une certaine éducation développée par la fréquentation des théâtres. Sous ce rapport, Paris est aussi riche que la capitale du Piémont, car il m’est arrivé maintes fois d’entendre, au milieu de la nuit, la rue Richelieu retentir d’accords assez supportables. Je dois dire, d’ailleurs, que les choristes piémontais entremêlaient leurs harmonies de quintes successives qui, présentées de la sorte, sont odieuses à toute oreille exercée.
Pour les villages d’Italie dont l’église est dépourvue d’orgue, et dont les habitants n’ont pas de relations avec les grandes villes, c’est folie d’y chercher ces harmonies tant vantées, il n’y en a pas la moindre trace. A Tivoli même, si deux jeunes gens me parurent avoir le sentiment des tierces et des sixtes en chantant de jolis couplets, le peuple réuni, quelques mois après, m’étonna par la manière burlesque dont il criait à l’unisson les litanies de la Vierge.
En outre, et sans vouloir faire en ce genre une réputation aux Dauphinois, que je tiens, au contraire, pour les plus innocents hommes du monde en tout ce qui se rattache à l’art musical, cependant je dois dire que chez eux la mélodie de ces mêmes litanies est douce, suppliante et triste, comme il convient à une prière adressée à la mère de Dieu, tandis qu’à Tivoli elle a l’air d’une chanson de corps de garde.
Voici l’une et l’autre ; on en jugera.
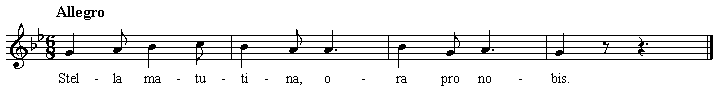
Chant de la Côte-Saint-André (Dauphiné), avec la mauvaise prosodie latine adoptée en France.
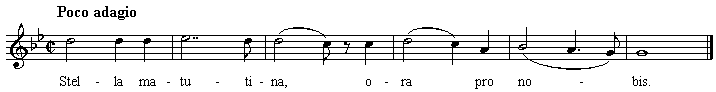
Ce qui est incontestablement plus commun en Italie que partout ailleurs, ce sont les belles voix ; les voix non seulement sonores et mordantes, mais souples et agiles, qui, en facilitant la vocalisation, ont dû, aidées de cet amour naturel du public pour le clinquant dont j’ai déjà parlé, faire naître et cette manie de fioritures qui dénature les plus belles mélodies, et les formules de chant commodes qui font que toutes les phrases italiennes se ressemblent, et ces cadences finales sur lesquelles le chanteur peut broder à son aise, mais qui torturent bien des gens par leur insipide et opiniâtre uniformité, et cette tendance incessante au genre bouffe, qui se fait sentir dans les scènes même les plus pathétiques ; et tous ces abus enfin, qui ont rendu la mélodie, l’harmonie, le mouvement, le rhythme, l’instrumentation, les modulations, le drame, la mise en scène, la poésie, le poëte et le compositeur, esclaves humiliés des chanteurs.
Et ce fut le 12 mai 1832 qu’en descendant le mont Cenis, je revis, parée de ses plus beaux atours de printemps, cette délicieuse vallée de Grésivaudan où serpente l’Isère, où j’ai passé les plus belles heures de mon enfance, où les premiers rêves passionnés sont venus m’agiter. Voilà le vieux rocher de Saint-Eynard... Voilà le gracieux réduit où brilla la Stella montis... là-bas, dans cette vapeur bleue, me sourit la maison de mon grand-père. Toutes ces villas, cette riche verdure,... c’est ravissant, c’est beau, il n’y a rien de pareil en Italie !... Mais mon élan de joie naïve fut brisé soudain par une douleur aiguë que je ressentis au cœur... Il m’avait semblé entendre gronder Paris dans le lointain.
___________________
1. J’aimerais mieux.2. Il faut en excepter une partie de celle
de Bellini et de ses imitateurs dont le caractère est au contraire
essentiellement désolé et l’accent gémissant ou hurlant.
Ces maîtres ne reviennent au style absurde que de temps en temps
et pour n’en pas laisser perdre entièrement la tradition. Je n’aurai
pas non plus l’injustice de comprendre dans la catégorie des œuvres
dont l’expression est fausse, plusieurs parties de la Lucia di Lammermoor de Donizetti.
Le grand morceau d’ensemble du final du deuxième
acte et la scène de la mort d’Edgard sont d’un pathétique
admirable. Je ne connais pas encore les œuvres de Verdi.
![]()
![]()