de
HECTOR BERLIOZ
XLI
Voyage à Naples. — Le soldat enthousiaste. — Excursion à
Nisita. — Les lazzaroni. —
Ils m’invitent à dîner. — Un coup de fouet. — Le théâtre
San-Carlo. — Retour pédestre à
Rome, à travers les Abruzzes. — Tivoli. — Encore Virgile.
Naples !!! ciel limpide et pur ! soleil de fêtes ! riche terre !
Tout le monde a décrit, et beaucoup mieux que je ne pourrais le faire, ce merveilleux jardin. Quel voyageur, en effet, n’a été frappé de la splendeur de son aspect ! Qui n’a admiré, à midi, la mer faisant la sieste, et les plis moelleux de sa robe azurée et le bruit flatteur avec lequel elle l’agite doucement ! Perdu, à minuit, dans le cratère du Vésuve, qui n’a senti un vague sentiment d’effroi aux sourds roulements de son tonnerre intérieur, aux cris de fureur qui s’échappent de sa bouche, à ces explosions, à ces myriades de roches fondantes, dirigées contre le ciel comme de brûlants blasphèmes, qui retombent ensuite, roulent sur le col de la montagne, et s’arrêtent pour former un ardent collier sur la vaste poitrine du volcan ! Qui n’a parcouru tristement le squelette de cette désolée Pompéi, et, spectateur unique, n’a attendu, sur les gradins de l’amphithéâtre, la tragédie d’Euripide ou de Sophocle pour laquelle la scène semble encore préparée ! Qui n’a accordé un peu d’indulgence aux mœurs des lazzaroni, ce charmant peuple d’enfants, si gai, si voleur, si spirituellement facétieux, et si naïvement bon quelquefois ?
Je me garderai donc d’aller sur les brisées de tant de descripteurs ; mais je ne puis résister au plaisir de raconter ici une anecdote qui peint on ne peut mieux le caractère des pêcheurs napolitains. Il s’agit d’un festin que des lazzaroni me donnèrent, trois jours après mon arrivée, et d’un présent qu’ils me firent au dessert. C’était par un beau jour d’automne, avec une fraîche brise, une atmosphère claire, transparente, à faire croire qu’on pourrait de Naples, sans trop étendre le bras, cueillir des oranges à Caprée. Je me promenais à la villa Reale ; j’avais prié mes camarades de l’Académie romaine de me laisser errer seul ce jour-là. En passant près d’un petit pavillon que je ne remarquais point, un soldat, en faction devant l’entrée, me dit brusquement en français :
« — Monsieur, levez votre chapeau !
— Pourquoi donc ?
— Voyez ! »
Et, me désignant du doigt une statue de marbre placée au centre du pavillon, je lus sur le socle ces deux mots qui me firent à l’instant faire le signe de respect que l’enthousiaste militaire me demandait : Torquato Tasso. Cela est bien ! cela est touchant !... mais j’en suis encore à me demander comment la sentinelle du poëte avait deviné que j’étais Français et artiste, et que j’obéirais avec empressement à son injonction. Savant physionomiste ! Je reviens à mes lazzaroni.
Je marchais donc nonchalamment au bord de
la mer, en songeant, tout ému, au pauvre Tasso, dont j’avais, avec
Mendelssohn, visité la modeste tombe à Rome, au couvent de Sant’Onofrio, quelques mois auparavant, philosophant, à part moi,
sur le malheur des poëtes qui sont poëtes par le cœur, etc.,
etc. Tout d’un coup, Tasso me fit penser à Cervantès, Cervantès
à sa charmante pastorale Galatée, Galatée à
une délicieuse figure qui brille à côté d’elle
dans le roman et qui se nomme Nisida, Nisida à l’île de la
baie de Pouzzoles qui porte ce joli nom, et je fus pris à l’improviste
d’un désir irrésistible de la visiter
![]() .
.
J’y cours ; me voilà dans la grotte du Pausilippe ; j’en sors, toujours courant ; j’arrive au rivage ; je vois une barque, je veux la louer ; je demande quatre rameurs, il en vient six ; je leur offre un prix raisonnable, en leur faisant observer que je n’avais pas besoin de six hommes pour nager dans une coquille de noix jusqu’à Nisida. Ils insistent en souriant et demandent à peu près trente francs pour une course qui en valait cinq tout au plus ; j’étais de bonne humeur, deux jeunes garçons se tenaient à l’écart sans rien dire, avec un air d’envie ; je trouvai bouffonne l’insolente prétention de mes rameurs, et désignant les deux lazzaronetti :
« — Eh bien ! oui, allons, trente francs, mais venez tous les huit et ramons vigoureusement. »
Cris de joie, gambades des petits et des grands ! nous sautons dans la barque, et en quelques minutes nous arrivons à Nisida. Laissant mon navire à la garde de l’équipage, je monte dans l’île, je la parcours dans tous les sens, je regarde le soleil descendre derrière le cap Misène poétisé par l’auteur de l’Énéide, pendant que la mer qui ne se souvient ni de Virgile, ni d’Énée, ni d’Ascagne, ni de Misène, ni de Palinure, chante gaiement dans le mode majeur mille accords scintillants...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comme je vaguais ainsi sans but, un militaire parlant fort bien le français s’avance vers moi et m’offre de me montrer les diverses curiosités de l’île, les plus beaux points de vue, etc. J’accepte son offre avec empressement. Au bout d’une heure, en le quittant, je faisais le geste de prendre ma bourse pour lui donner la buona mano d’usage, quand lui, se reculant d’un pas et prenant un air presque offensé, repousse ma main en disant :
« — Que faites-vous donc, monsieur ? je
ne vous demande rien... que de... prier le bon Dieu pour moi.
— Parbleu, je le ferai, me dis-je en remettant ma
bourse dans ma poche, l’idée est trop drôle, et que le diable m’emporte si
j’y manque. »
Le soir, en effet, au moment de me mettre au lit, je récitai très-sérieusement un premier Pater pour mon brave sergent, mais au second j’éclatai de rire. Aussi je crains bien que le pauvre homme n’ait pas fait fortune et qu’il soit resté sergent comme devant.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je serais demeuré à Nisida jusqu’au lendemain, je crois, si un de mes matelots, délégué par le capitaine, ne fût venu me héler et m’avertir que le vent fraîchissait, et que nous aurions de la peine à regagner la terre ferme, si nous tardions encore à lever l’ancre, à déraper. Je me rends à ce prudent avis. Je descends ; chacun reprend sa place sur le navire ; le capitaine, digne émule du héros troyen :
. . . . . . . . . . . . . Eripit ensem
Fulmineum
(ouvre son grand couteau)
strictoque ferit retinacula ferro.
(et coupe vivement la ficelle ;)
Idem omnes simul ardor habet ; rapiuntque, ruuntque ;
Littora deseruere ; latet sub classibus æquor ;
Adnixi torquent spumas, et cærula verrunt.
(tous, pleins d’ardeur et d’un peu de crainte, nous nous précipitons, nous fuyons le rivage ; nos rames font voler des flots d’écume, la mer disparaît sous notre...... canot). Traduction libre.
Cependant il y avait du danger, la coquille de noix frétillait d’une singulière façon à travers les crêtes blanches de vagues disproportionnées ; mes gaillards ne riaient plus et commençaient à chercher leurs chapelets. Tout cela me paraissait d’un ridicule atroce et je me disais : à propos de quoi vais-je me noyer ? A propos d’un soldat lettré qui admire Tasso ; pour moins encore, pour un chapeau ; car, si j’eusse marché tête nue, le soldat ne m’eût pas interpellé ; je n’aurais pas songé au chantre d’Armide, ni à l’auteur de Galatée, ni à Nisida ; je n’aurais pas fait cette sotte excursion insulaire, et je serais tranquillement assis à Saint-Charles en ce moment, à écouter la Brambilla et Tamburini ! Ces réflexions et les mouvements de la nef en perdition me faisaient grand mal au cœur, je l’avoue. Pourtant, le Dieu des mers, trouvant la plaisanterie suffisante comme cela, nous permit de gagner la terre, et les matelots, jusque-là muets comme des poissons, recommencèrent à crier comme des geais. Leur joie fut même si grande, qu’en recevant les trente francs que j’avais consenti à me laisser escroquer, ils eurent un remords, et me prièrent, avec une véritable bonhomie, de venir dîner avec eux. J’acceptai. Ils me conduisirent assez loin de là, au milieu d’un bois de peupliers, sur la route de Pouzzoles, en un lieu fort solitaire, et je commençais à calomnier leur candide intention (pauvres lazzaroni !), quand nous arrivâmes vers une chaumière à eux bien connue, où mes amphitryons se hâtèrent de donner des ordres pour le festin.
Bientôt apparut un petit monticule de fumants macaroni ; ils m’invitèrent à y plonger la main droite à leur exemple ; un grand pot de vin du Pausilippe fut placé sur la table, et chacun de nous y buvait à son tour, après, toutefois, un vieillard édenté, le seul de la bande qui devait boire avant moi, le respect pour l’âge l’emportant chez ces braves enfants, même sur la courtoisie qu’ils reconnaissaient devoir à leur hôte. Le vieux, après avoir bu déraisonnablement, commença à parler politique et à s’attendrir beaucoup au souvenir du roi Joachim, qu’il portait dans son cœur. Les jeunes lazzaroni, pour le distraire et me procurer un divertissement, lui demandèrent avec instance le récit d’un long et pénible voyage de mer qu’il avait fait autrefois, et dont l’histoire était célèbre.
Là-dessus, le vieux lazzarone raconta, au grand ébahissement de son auditoire, comment, embarqué à vingt ans sur un speronare, il avait demeuré en mer trois jours et deux nuits, et comme quoi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, il avait enfin été jeté dans une île lointaine où l’on prétend que Napoléon, depuis lors, a été exilé, et que les indigènes appellent Isola d’Elba. Je manifestai une grande émotion à cet incroyable récit, en félicitant de tout mon cœur le brave marin d’avoir échappé à des dangers aussi formidables. De là, profonde sympathie des lazzaroni pour mon excellence ; la reconnaissance les exalte, on se parle à l’oreille, on va, on vient dans la chaumière d’un air de mystère ; je vois qu’il s’agit des préparatifs de quelque surprise qui m’est destinée. En effet, au moment où je me levais pour prendre congé de la société, le plus grand des jeunes lazzaroni m’aborde d’un air embarrassé, et me prie, au nom de ses camarades et pour l’amour d’eux, d’accepter un souvenir, un présent, le plus magnifique qu’ils pouvaient m’offrir, et capable de faire pleurer l’homme le moins sensible. C’était un oignon monstrueux, une énorme ciboule, que je reçus avec une modestie et un sérieux dignes de la circonstance, et que j’emportai jusqu’au sommet du Pausilippe, après mille adieux, serrements de mains et protestations d’une amitié inaltérable.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je venais de quitter ces bonnes gens et je cheminais péniblement à cause d’un coup que je m’étais donné au pied droit en descendant de Nisida ; il faisait presque nuit. Une belle calèche passa sur la route de Naples. L’idée peu fashionable me vint de sauter sur la banquette de derrière, libre par l’absence du valet de pied, et de parvenir ainsi sans fatigue jusqu’à la ville. Mais j’avais compté sans la jolie petite Parisienne emmousselinée qui trônait à l’intérieur et qui, de sa voix aigre-douce appelant vivement le cocher : « Louis, il y a quelqu’un derrière ! » me fit administrer à travers la figure un ample coup de fouet. Ce fut le présent de ma gracieuse compatriote. O poupée française ! Si Crispino seulement s’était trouvé là, nous t’aurions fait passer un singulier quart d’heure !
Je revins donc, clopin-clopant, en songeant aux charmes de la vie de brigand, qui, malgré ses fatigues, serait vraiment aujourd’hui la seule digne d’un honnête homme, si dans la moindre bande ne se trouvaient toujours tant de misérables stupides et puants !
J’allai oublier mon chagrin et me reposer à Saint-Charles. Et là, pour la première fois depuis mon arrivée en Italie, j’entendis de la musique. L’orchestre, comparé à ceux que j’avais observés jusqu’alors, me parut excellent. Les instruments à vent peuvent être écoutés en sécurité ; on n’a rien à craindre de leur part ; les violons sont assez habiles, et les violoncelles chantent bien, mais ils sont en trop petit nombre. Le système général adopté en Italie de mettre toujours moins de violoncelles que de contre-basses, ne peut pas même être justifié par le genre de musique que les orchestres italiens exécutent habituellement. Je reprocherais bien aussi au maestro di capella le bruit souverainement désagréable de son archet dont il frappe un peu rudement son pupitre ; mais on m’a assuré que sans cela, les musiciens qu’il dirige seraient quelquefois embarrassés pour suivre la mesure... A cela il n’y a rien à répondre ; car enfin, dans un pays où la musique instrumentale est à peu près inconnue, on ne doit pas exiger des orchestres comme ceux de Berlin, de Dresde ou de Paris. Les choristes sont d’une faiblesse extrême ; je tiens d’un compositeur qui a écrit pour le théâtre Saint-Charles, qu’il est fort difficile, pour ne pas dire impossible, d’obtenir une bonne exécution des chœurs écrits à quatre parties. Les soprani ont beaucoup de peine à marcher isolés des ténors, et on est pour ainsi dire obligé de les leur faire continuellement doubler à l’octave.
Au Fondo on joue l’opera buffa, avec une verve, un feu, un brio, qui lui assurent une supériorité incontestable sur la plupart des théâtres d’opéra-comique. On y représentait, pendant mon séjour, une farce très-amusante de Donizetti, Les convenances et les inconvenances du théâtre.
On pense bien, néanmoins, que l’attrait musical des théâtres de Naples ne pouvait lutter avec avantage contre celui qui m’offrait l’exploration des environs de la ville, et que je me trouvais plus souvent dehors que dedans.
Déjeunant, un matin, à Castellamare, avec Munier, le peintre de marine, que nous avions surnommé Neptune : « Que faisons-nous ? me dit-il, en jetant sa serviette, Naples m’ennuie, n’y retournons pas...
— Allons en Sicile.
— C’est cela, allons en Sicile ; laissez-moi
seulement finir une étude que j’ai commencée, et, à
cinq heures, nous irons retenir notre place sur le bateau à vapeur.
— Volontiers, quelle est notre fortune ? »
Notre bourse visitée, il se trouva que nous avions bien assez pour aller jusqu’à Palerme, mais que, pour en revenir, il eût fallu, comme disent les moines, compter sur la Providence ; et, en Français totalement dépourvus de la vertu qui transporte les montagnes, jugeant qu’il ne fallait pas tenter Dieu, nous nous séparâmes, lui, pour aller portraire la mer, moi, pour retourner pédestrement à Rome.
Ce projet était arrêté dans ma tête depuis quelques jours. Rentré à Naples le même soir, après avoir dit adieu à Dufeu et à Dantan, le hasard me fit rencontrer deux officiers suédois de ma connaissance, qui me firent part de leur intention de se rendre à Rome à pied.
« — Parbleu ! leur dis-je, je pars demain pour Subiaco ; je veux y aller en droite ligne à travers les montagnes, franchissant rocs et torrents, comme le chasseur de chamois ; nous devrions faire le trajet ensemble. »
Malgré l’extravagance d’une pareille idée, ces messieurs l’adoptèrent. Nos effets furent aussitôt expédiés par un vetturino ; nous convînmes de nous diriger sur Subiaco à vol d’oiseau, et, après nous y être reposés un jour, de retourner à Rome par la grande route. Ainsi fut fait. Nous avions endossé tous les trois le costume obligé de toile grise ; M. B... portait son album et ses crayons ; deux cannes étaient toutes nos armes.
On vendangeait alors. D’excellents raisins (qui n’approchent pourtant pas de ceux du Vésuve) firent à peu près toute notre nourriture pendant la première journée ; les paysans n’acceptaient pas toujours notre argent, et nous nous abstenions quelquefois de nous enquérir des propriétaires.
Le soir, à Capoue, nous trouvâmes bon souper, bon gîte, et... un improvisateur.
Ce brave homme, après quelques préludes brillants sur sa grande mandoline, s’informa de quelle nation nous étions.
« — Français, répondit M. Kl...rn. »
J’avais entendu, un mois auparavant, les improvisations du Tyrtée campanien ; il avait fait la même question à mes compagnons de voyage, qui répondirent :
« — Polonais. »
A quoi, plein d’enthousiasme, il avait répliqué :
« — J’ai parcouru le monde entier, l’Italie, l’Espagne, la France, l’Allemagne, l’Angleterre, la Pologne, la Russie ; mais les plus braves sont les Polonais, sont les Polonais. »
Voici la cantate qu’il adressa, en musique également improvisée, et sans la moindre hésitation, aux trois prétendus Français :
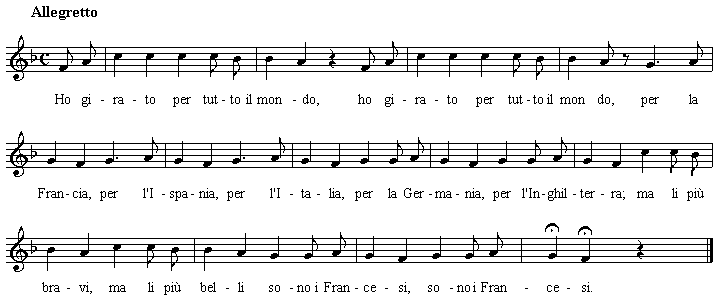
On conçoit combien je dus être flatté, et quelle fut la mortification des deux Suédois.
Avant de nous engager tout à fait dans les Abruzzes, nous nous arrêtâmes une journée à San Germano, pour visiter le fameux couvent du Monte-Cassino.
Ce monastère de bénédictins, situé, comme celui de Subiaco, sur une montagne, est loin de lui ressembler sous aucun rapport. Au lieu de cette simplicité naïve et originale qui charme à San Benedetto vous trouvez ici le luxe et les proportions d’un palais. L’imagination recule devant l’énormité des sommes qu’ont coûtées tous les objets précieux rassemblés dans la seule église. Il y a un orgue avec de petits anges fort ridicules, jouant de la trompette et des cymbales quand l’instrument est mis en action. Le parvis est des marbres les plus rares, et les amateurs peuvent admirer dans le chœur des stalles en bois, sculptées avec un art infini, représentant différentes scènes de la vie monacale.
Une marche forcée nous fit parvenir en un jour de San Germano à Isola di Sora, village situé sur la frontière du royaume de Naples et remarquable par une petite rivière qui forme une assez belle cascade, après avoir mis en jeu plusieurs établissements industriels. Une mystification d’un singulier genre nous y attendait. M. Kl...rn et moi nous avions les pieds en sang, et tous les trois furieux de soif, harassés, couverts d’une poussière brûlante, notre premier mot, en entrant dans la ville, fut pour demander la locanda (l’auberge).
« — E...... locanda... non ce n’è, »
nous répondaient les paysans avec un air de pitié railleuse. « Ma
peró per la notte dove si va ?
— E...... chi lo sa ?... »
Nous demandons à passer la nuit dans une mauvaise remise ; il n’y avait pas un brin de paille, et d’ailleurs le propriétaire s’y refusait. On n’a pas d’idée de notre impatience, augmentée encore par le sang-froid et les ricanements de ces manants. Se trouver dans un petit bourg commerçant comme celui-là, obligés de coucher dans la rue, faute d’une auberge ou d’une maison hospitalière... c’eût été fort, mais c’est pourtant ce qui nous serait arrivé indubitablement, sans un souvenir qui me frappa très à propos.
J’avais déjà passé de jour, une fois, à Isola di Sora ; je me rappelai heureusement le nom de M. Courrier, Français, propriétaire d’une papeterie. On nous montre son frère dans un groupe ; je lui expose notre embarras, et après un instant de réflexion, il me répond tranquillement en français, je pourrais même dire en dauphinois, car l’accent en fait presque un idiome :
« — Pardi ! on vous couchera ben.
— Ah ! nous sommes sauvés ! M. Courrier
est Dauphinois, je suis Dauphinois, et entre Dauphinois, comme dit Charlet,
l’affaire peut s’arranger. »
En effet, le papetier qui me reconnut exerça à notre égard la plus franche hospitalité. Après un souper très-confortable, un lit monstre, comme je n’en ai vu qu’en Italie, nous reçut tous les trois ; nous y reposâmes fort à l’aise, en réfléchissant qu’il serait bon, pour le reste de notre voyage, de connaître les villages qui ne sont pas sans locanda, pour ne pas courir une seconde fois le danger auquel nous venions d’échapper. Notre hôte nous tranquillisa un peu le lendemain, par l’assurance qu’en deux jours de marche nous pourrions arriver à Subiaco ; il n’y avait donc plus qu’une nuit chanceuse à passer. Un petit garçon nous guida à travers les vignes et les bois pendant une heure, après quoi, sur quelques indications assez vagues qu’il nous donna, nous poursuivîmes seuls notre route.
Veroli est un grand village qui, de loin, a l’air d’une ville et couvre le sommet d’une montagne. Nous y trouvâmes un mauvais dîner de pain et de jambon cru, à l’aide duquel nous parvînmes, avant la nuit, à un autre rocher habité, plus âpre et plus sauvage ; c’était Alatri. A peine parvenus à l’entrée de la rue principale, un groupe de femmes et d’enfants se forma derrière nous et nous suivit jusqu’à la place avec toutes les marques de la plus vive curiosité. On nous indiqua une maison, ou plutôt un chenil, qu’un vieil écriteau désignait comme la locanda ; malgré tout notre dégoût, ce fut là qu’il fallut passer la nuit. Dieu ! quelle nuit ! elle ne fut pas employée à dormir, je puis l’assurer ; les insectes de toute espèce qui foisonnaient dans nos draps rendirent tout repos impossible. Pour mon compte, ces myriades me tourmentèrent si cruellement que je fus pris au matin d’un violent accès de fièvre.
Que faire ?... ces messieurs ne voulaient pas me laisser à Alatri... il fallait arriver à Subiaco... séjourner dans cette bicoque était une triste perspective... Cependant, je tremblais tellement qu’on ne savait comment me réchauffer et que je ne me croyais guère capable de faire un pas. Mes compagnons d’infortune, pendant que je grelottais, se consultaient en langue suédoise, mais leur physionomie exprimait trop bien l’embarras extrême que je leur causais pour qu’il fût possible de s’y méprendre. Un effort de ma part était indispensable ; je le fis, et après deux heures de marche au pas de course, la fièvre avait disparu.
Avant de quitter Alatri, un conseil des géographes du pays fut tenu sur la place pour nous indiquer notre route. Bien des opinions émises et débattues, celle qui nous dirigeait sur Subiaco, par Arcino et Anticoli ayant prévalu, nous l’adoptâmes. Cette journée fut la plus pénible que nous eussions encore faite depuis le commencement du voyage. Il n’y avait plus de chemins frayés, nous suivions des lits de torrents, enjambant à grand-peine les quartiers de rochers dont ils sont à chaque instant encombrés.
Nous arrivâmes ainsi à un affreux village dont le nom m’est inconnu. Les bouges hideux qui le composent et que je n’ose appeler maisons, étaient ouverts mais entièrement vides. Nous ne trouvâmes d’autres habitants dans le village que deux jeunes porcs se vautrant dans la boue noire des roches déchirées qui servent de rues à ce repaire. Où était la population ? C’est le cas de dire : chi lo sa ?
Plusieurs fois nous nous sommes égarés dans les vallons de ce labyrinthe de rochers ; il fallait alors gravir de nouveau la colline que nous venions de descendre, ou, du fond d’un ravin, crier à quelque paysan :
« Ohe !!! la strada d’Anticoli ?... »
A quoi il répondait par un éclat de rire, ou par « via ! via ! » Ce qui nous rassurait médiocrement, on peut le penser. Nous y parvînmes cependant ; je me rappelle même avoir trouvé à Anticoli grande abondance d’œufs, de jambon et d’épis de maïs que nous fîmes rôtir, à l’exemple des pauvres habitants de ces terres stériles, et dont la saveur sauvage n’est pas désagréable. Le chirurgien d’Anticoli, gros homme rouge qui avait l’air d’un boucher, vint nous honorer de ses questions sur la garde nationale de Paris et nous proposer un livre imprimé qu’il avait à vendre.
D’immenses pâturages restaient à traverser avant la nuit : un guide fut indispensable. Celui que nous prîmes ne paraissait pas très-sûr de la route, il hésitait souvent. Un vieux berger, assis au bord d’un étang, et qui n’avait peut-être pas entendu de voix humaine depuis un mois, n’étant point prévenu de notre approche par le bruit de nos pas, que le gazon touffu rendait imperceptible, faillit tomber à l’eau quand nous lui demandâmes brusquement la direction d’Arcinasso, joli village (au dire de notre guide), où nous devions trouver toutes sortes de rafraîchissements.
Il se remit pourtant un peu de sa terreur, grâce à quelques baiocchi qui lui prouvèrent nos dispositions amicales ; mais il fut presque impossible de comprendre sa réponse qu’une voix gutturale, plus semblable à un gloussement qu’à un langage humain, rendait inintelligible. Le joli village d’Arcinasso n’est qu’une osteria (cabaret), au milieu de ces vastes et silencieuses steppes. Une vieille femme y vendait du vin et de l’eau fraîche. L’album de M. B....t ayant excité son attention, nous lui dîmes que c’était une bible ; là-dessus, se levant, pleine de joie, elle examina chaque dessin l’un après l’autre, et après avoir embrassé cordialement M. B....t, nous donna à tous les trois sa bénédiction.
Rien ne peut donner une idée du silence qui règne dans ces interminables prairies. Nous n’y trouvâmes d’autres habitants que le vieux berger avec son troupeau et un corbeau qui se promenait plein d’une gravité triste... A notre approche, il prit son vol vers le nord... Je le suivis longtemps des yeux... Puis ma pensée vola dans la même direction... vers l’Angleterre... et je m’abîmai dans une rêverie shakespearienne...
Mais il s’agissait bien de rêver et de bâiller aux corbeaux, il fallait absolument arriver cette nuit même à Subiaco. Le guide d’Anticoli était reparti, l’obscurité approchait rapidement ; nous marchions depuis trois heures, silencieux comme des spectres, quand un buisson, sur lequel j’avais tué une grive sept mois auparavant, me fit reconnaître notre position.
« — Allons, messieurs, dis-je aux Suédois, encore un effort ! je me retrouve en pays de connaissance, dans deux heures nous serons arrivés. »
Effectivement, quarante minutes s’étaient
à peine écoulées quand nous aperçûmes
à une grande profondeur sous nos pieds briller des lumières : c’était
Subiaco. J’y trouvai Gibert. Il me prêta du linge,
dont j’avais grand besoin. Je comptais aller me reposer, mais bientôt
les cris : Oh ! signor Sidoro
![]() ! Ecco
questo signore francese chi suona la chitarra
! Ecco
questo signore francese chi suona la chitarra
![]() ! »
Et Flacheron d’accourir avec la belle Mariucia
! »
Et Flacheron d’accourir avec la belle Mariucia
![]() ,
le tambour de basque à la main, et, bon gré, mal gré,
il fallut danser le saltarello jusqu’à minuit.
,
le tambour de basque à la main, et, bon gré, mal gré,
il fallut danser le saltarello jusqu’à minuit.
C’est en quittant Subiaco, deux jours après, que j’eus la spirituelle idée de l’expérience qu’on va lire.
MM. Bennet et Klinksporn, mes deux compagnons Suédois,
marchaient très-vite, et leur allure me fatiguait
beaucoup. Ne pouvant obtenir d’eux de s’arrêter de temps en temps,
ni de ralentir le pas, je les laissai prendre le devant et m’étendis
tranquillement à l’ombre, quitte à faire ensuite comme le
lièvre de la fable pour les rattraper. Ils étaient déjà
fort loin, quand je me demandai en me relevant : Serais-je capable de courir,
sans m’arrêter, d’ici à Tivoli (c’était bien un trajet
de six lieues) ? Essayons !... Et me voilà courant comme s’il se fût
agi d’atteindre une maîtresse enlevée. Je revois les Suédois,
je les dépasse ; je traverse un village, deux villages, poursuivi
par les aboiements de tous les chiens, faisant fuir en grognant les porcs
pleins d’épouvante, mais suivi du regard bienveillant des habitants
persuadés que je venais de faire un malheur![]() .
.
Bientôt, une douleur vive dans l’articulation du genou vint me rendre impossible la flexion de la jambe droite. Il fallut la laisser pendre et la traîner en sautant sur la gauche. C’était diabolique, mais je tins bon et je parvins à Tivoli sans avoir interrompu un instant cette course absurde. J’aurais mérité de mourir en arrivant d’une rupture du cœur. Il n’en résulta rien. Il faut croire que j’ai le cœur dur.
Quand les deux officiers suédois parvinrent à Tivoli, une heure après moi, ils me trouvèrent endormi ; me voyant ensuite, au réveil, parfaitement sain de corps et d’esprit (et je leur pardonne bien sincèrement d’avoir eu des doutes à cet égard), ils me prièrent d’être leur cicerone dans l’examen qu’ils avaient à faire des curiosités locales. En conséquence, nous allâmes visiter le joli petit temple de Vesta, qui a plutôt l’air d’un temple de l’Amour ; la grande cascade, les cascatelles, la grotte de Neptune ; il fallut admirer l’immense stalactite de cent pieds de haut, sous laquelle gît enfouie la maison d’Horace, sa célèbre villa de Tibur. Je laissai ces messieurs se reposer une heure sous les oliviers qui croissent au-dessus de la demeure du poëte, pour gravir seul la montagne voisine et couper à son sommet un jeune myrte. A cet égard je suis comme les chèvres, impossible de résister à mon humeur grimpante, auprès d’un monticule verdoyant. Puis, comme nous descendions dans la plaine, on voulut bien nous ouvrir la villa Mecena ; nous parcourûmes son grand salon voûté, que traverse maintenant un bras de l’Anio, donnant la vie à un atelier de forgeron, où retentit, sur d’énormes enclumes, le bruit cadencé de marteaux monstrueux. Cette même salle résonna jadis des strophes épicuriennes d’Horace, entendit s’élever, dans sa douce gravité, la voix mélancolique de Virgile, récitant, après les festins présidés par le ministre d’Auguste, quelque fragment magnifique de ses poëmes des champs :
Hactenus arvorum cultus et sidera cœli :
Nunc te, Bacche, canam, nec non silvestria tecum
Virgulta, et prolem tarde crescentis olivæ.
Plus bas, nous examinâmes en passant la villa d’Este, dont le nom rappelle celui de la princesse Eleonora, célèbre par Tasso et l’amour douloureux qu’elle lui inspira.
Au-dessous, à l’entrée de la plaine, je guidai ces messieurs dans le labyrinthe de la villa Adriana ; nous visitâmes ce qui reste de ses vastes jardins ; le vallon dont une fantaisie toute-puissante voulut créer une copie en miniature de la vallée de Tempé ; la salle des gardes, où veillent à cette heure des essaims d’oiseaux de proie ; et enfin l’emplacement où s’éleva le théâtre privé de l’empereur, et qu’une plantation de choux, le plus ignoble des légumes, occupe maintenant.
Comme le temps et la mort doivent rire de ces bizarres transformations !
___________________
1. Le vrai nom de l’île est Nisita, mais je l’ignorais alors.3. Faute de pouvoir prononcer mon nom, les
Subiacois me désignaient toujours de la sorte. ![]()
![]()