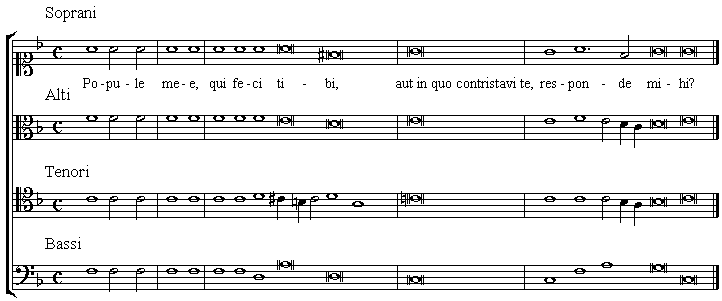
de
HECTOR BERLIOZ
XXXIX
La vie du musicien à Rome. — La musique dans l’église
de Saint-Pierre. — La chapelle Sixtine. —
Préjugé sur Palestrina. — La musique religeuse
moderne dans l’église de Saint-Louis. —
Les théâtres lyriques. — Mozart et Vaccaï.
— Les pifferari. — Mes compositions à Rome.
Il fallait bien toujours revenir dans cette éternelle ville de Rome, et s’y convaincre de plus en plus que, de toutes les existences d’artiste, il n’en est pas de plus triste que celle d’un musicien étranger, condamné à l’habiter, si l’amour de l’art est dans son cœur. Il y éprouve un supplice de tous les instants, dans les premiers temps, en voyant ses illusions poétiques tomber une à une, et le bel édifice musical élevé par son imagination, s’écrouler devant la plus désespérante des réalités ; ce sont, chaque jour, de nouvelles expériences qui amènent constamment de nouvelles déceptions. Au milieu de tous les autres arts pleins de vie, de grandeur, de majesté, éblouissants de l’éclat du génie, étalant fièrement leurs merveilles diverses, il voit la musique réduite au rôle d’une esclave dégradée, hébétée par la misère et chantant, d’une voix usée, de stupides poëmes pour lesquels le peuple lui jette à peine un morceau de pain. C’est ce que je reconnus facilement au bout de quelques semaines. A peine arrivé, je cours à Saint-Pierre... immense ! sublime ! écrasant !... voilà Michel-Ange, voilà Raphaël, voilà Canova ; je marche sur les marbres les plus précieux, les mosaïques les plus rares... Ce silence solennel... cette fraîche atmosphère... ces tons lumineux si riches et si harmonieusement fondus... Ce vieux pèlerin, agenouillé seul, dans la vaste enceinte... Un léger bruit, parti du coin le plus obscur du temple, et roulant sous ces voûtes colossales comme un tonnerre lointain... j’eus peur... il me sembla que c’était là réellement la maison de Dieu et que je n’avais pas le droit d’y entrer. Réfléchissant que de faibles créatures comme moi étaient parvenues cependant à élever un pareil monument de grandeur et d’audace, je sentis un mouvement de fierté, puis, songeant au rôle magnifique que devait y jouer l’art que je chéris, mon cœur commença à battre à coups redoublés. Oh ! oui, sans doute, me dis-je aussitôt, ces tableaux, ces statues, ces colonnes, cette architecture de géants, tout cela n’est que le corps du monument ; la musique en est l’âme ; c’est par elle qu’il manifeste son existence, c’est elle qui résume l’hymne incessant des autres arts, et de sa voix puissante, le porte brûlant aux pieds de l’Éternel. Où donc est l’orgue ?... L’orgue, un peu plus grand que celui de l’Opéra de Paris, était sur des roulettes ; un pilastre le dérobait à ma vue. N’importe, ce chétif instrument ne sert peut-être qu’à donner le ton aux voix, et tout effet instrumental étant proscrit, il doit suffire. Quel est le nombre des chanteurs ?... Me rappelant alors la petite salle du Conservatoire, que l’église de Saint-Pierre contiendrait cinquante ou soixante fois au moins, je pensai que si un chœur de quatre-vingt-dix voix y était employé journellement, les choristes de Saint-Pierre ne devaient se compter que par milliers.
Ils sont au nombre de dix-huit pour les jours ordinaires, et de trente-deux pour les fêtes solennelles. J’ai même entendu un Miserere à la chapelle Sixtine chanté par cinq voix. Un critique allemand de beaucoup de mérite s’est constitué tout récemment le défenseur de la chapelle Sixtine.
« La plupart des voyageurs, dit-il, en y entrant, s’attendent à une musique bien plus entraînante, je dirai même bien plus amusante que celle des opéras qui les avaient charmés dans leur patrie ; au lieu de cela, les chanteurs du Pape leur font entendre un plain-chant séculaire, simple, pieux, et sans le moindre accompagnement. Ces dilettanti désappointés ne manquent pas alors de jurer à leur retour que la chapelle Sixtine n’offre aucun intérêt musical, et que tous les beaux récits qu’on en fait sont autant de contes. »
Nous ne dirons pas à ce sujet absolument comme les observateurs superficiels dont parle cet écrivain. Bien au contraire, cette harmonie des siècles passés, venue jusqu’à nous sans la moindre altération de style ni de forme, offre aux musiciens le même intérêt que présentent aux peintres les fresques de Pompéi. Loin de regretter, sous ses accords, l’accompagnement de trompettes et de grosse caisse, aujourd’hui tellement mis à la mode par les compositeurs italiens, que chanteurs et danseurs ne croiraient pas, sans lui, pouvoir obtenir les applaudissements qu’ils méritent, nous avouerons que la chapelle Sixtine étant le seul lieu musical de l’Italie où cet abus déplorable n’ait point pénétré, on est heureux de pouvoir y trouver un refuge contre l’artillerie des fabricants de cavatines. Nous accorderons au critique allemand que les trente-deux chanteurs du pape, incapables de produire le moindre effet et même de se faire entendre dans la plus vaste église du monde, suffisent à l’exécution des œuvres de Palestrina dans l’enceinte bornée de la chapelle pontificale ; nous dirons avec lui que cette harmonie pure et calme jette dans une rêverie qui n’est pas sans charme. Mais ce charme est le propre de l’harmonie elle-même, et le prétendu génie des compositeurs n’en est pas la cause, si toutefois on peut donner le nom de compositeurs à des musiciens qui passaient leur vie à compiler des successions d’accords comme celle-ci qui fait partie des Improperia de Palestrina :
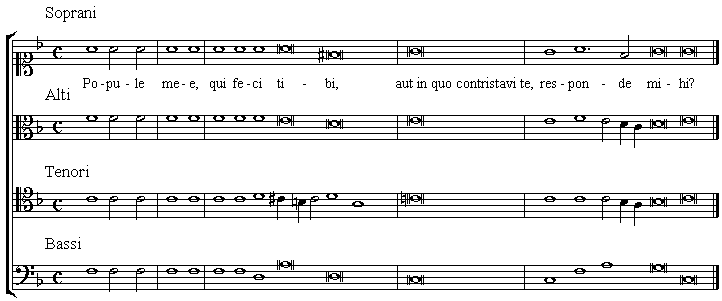
Dans ces psalmodies à quatre parties où la mélodie et le rhythme ne sont point employés, et dont l’harmonie se borne à l’emploi des accords parfaits entremêlés de quelques suspensions, on peut bien admettre que le goût et une certaine science aient guidé le musicien qui les écrivit ; mais le génie ! allons donc, c’est une plaisanterie.
En outre, les gens qui croient encore sincèrement que Palestrina composa ainsi à dessein sur les textes sacrés, et mû seulement par l’intention d’approcher le plus possible d’une pieuse idéalité, s’abusent étrangement. Ils ne connaissent pas, sans doute, ses madrigaux, dont les paroles frivoles et galantes sont accolées par lui, cependant, à une sorte de musique absolument semblable à celle dont il revêtit les paroles saintes. Il fait chanter par exemple Au bord du Tibre, je vis un beau pasteur, dont la plainte amoureuse, etc., par un chœur lent dont l’effet général et le style harmonique ne diffèrent en rien de ses compositions dites religieuses. Il ne savait pas faire d’autre musique, voilà la vérité ; et il était si loin de poursuivre un céleste idéal, qu’on retrouve dans ses écrits une foule de ces sortes de logogriphes que les contre-pointistes qui le précédèrent avaient mis à la mode et dont il passe pour avoir été l’antagoniste inspiré. Sa missa ad fugam en est la preuve.
Or, en quoi ces difficultés de contre-point, si habilement vaincues qu’on les suppose, contribuent-elles à l’expression du sentiment religieux ? En quoi cette preuve de la patience du tisseur d’accords annonce-t-elle en lui une simple préoccupation du véritable objet de son travail ? en rien, à coup sûr. L’accent expressif d’une composition musicale n’est ni plus puissant, ni plus vrai, parce qu’elle est écrite en canon perpétuel, par exemple ; et il n’importe à la beauté et à la vérité de l’expression que le compositeur ait vaincu une difficulté étrangère à leur recherche ; pas plus que si, en écrivant, il eût été gêné d’une façon quelconque par une douleur physique ou un obstacle matériel.
Si Palestrina, ayant perdu les deux mains, s’était vu forcé d’écrire avec le pied et y était parvenu, ses ouvrages n’en eussent pas acquis plus de valeur pour cela et n’en seraient ni plus ni moins religieux.
Le critique allemand, dont je parlais tout à l’heure, n’hésite pas cependant à appeler sublimes les improperiade Palestrina.
« Toute cette cérémonie, dit-il encore, le sujet en lui-même, la présence du Pape au milieu du corps des cardinaux, le mérite d’exécution des chanteurs qui déclament avec une précision et une intelligence admirables, tout cela forme de ce spectacle un des plus imposants et des plus touchants de la semaine sainte. » — Oui, certes, mais tout cela ne fait pas de cette musique une œuvre de génie et d’inspiration.
Par une de ces journées sombres qui attristent la fin de l’année, et que rend encore plus mélancoliques le souffle glacé du vent du Nord, écoutez, en lisant Ossian, la fantastique harmonie d’une harpe éolienne balancée au sommet d’un arbre dépouillé de verdure, et vous pourrez éprouver un sentiment profond de tristesse, un désir vague et infini d’une autre existence, un dégoût immense de celle-ci, en un mot une forte atteinte de spleen jointe à une tentation de suicide. Cet effet est encore plus prononcé que celui des harmonies vocales de la chapelle Sixtine ; on n’a jamais songé cependant à mettre les facteurs de harpes éoliennes au nombre des grands compositeurs.
Mais, au moins, le service musical de la chapelle Sixtine a-t-il conservé sa dignité et le caractère religieux qui lui convient, tandis que, infidèles aux anciennes traditions, les autres églises de Rome sont tombées, sous ce rapport, dans un état de dégradation, je dirai même de démoralisation, qui passe toute croyance. Plusieurs prêtres français, témoins de ce scandaleux abaissement de l’art religieux, en ont été indignés.
J’assistai, le jour de la fête du roi, à une messe solennelle à grands chœurs et à grand orchestre, pour laquelle notre ambassadeur, M. de Saint-Aulaire, avait demandé les meilleurs artistes de Rome. Un amphithéâtre assez vaste, élevé devant l’orgue, était occupé par une soixantaine d’exécutants. Ils commencèrent par s’accorder à grand bruit, comme ils l’eussent fait dans un foyer de théâtre ; le diapason de l’orgue, beaucoup trop bas, rendait, à cause des instruments à vent, son adjonction à l’orchestre impossible. Un seul parti restait à prendre, se passer de l’orgue. L’organiste ne l’entendait pas ainsi ; il voulait faire sa partie, dussent les oreilles des auditeurs être torturées jusqu’au sang ; il voulait gagner son argent, le brave homme, et il le gagna bien, je le jure, car de ma vie je n’ai ri d’aussi bon cœur. Suivant la louable coutume des organistes italiens, il n’employa, pendant toute la durée de la cérémonie, que les jeux aigus. L’orchestre, plus fort que cette harmonie de petites flûtes, la couvrait assez bien dans les tutti, mais quand la masse instrumentale venait à frapper un accord sec, suivi d’un silence, l’orgue, dont le son traîne un peu, on le sait, et ne peut se couper aussi bref que celui des autres instruments, demeurait alors à découvert et laissait entendre un accord plus bas d’un quart de ton que celui de l’orchestre, produisant ainsi le gémissement le plus atrocement comique qu’on puisse imaginer.
Pendant les intervalles remplis par le plain-chant des prêtres, les concertants, incapables de contenir leur démon musical, préludaient hautement, tous à la fois, avec un incroyable sang-froid ; la flûte lançait des gammes en ré ; le cor sonnait une fanfare en mi bémol ; les violons faisaient d’aimables cadences, des gruppetti charmants ; le basson, tout bouffi d’importance, soufflait ses notes graves en faisant claquer ses grandes clés, pendant que les gazouillements de l’orgue achevaient de brillanter ce concert inouï, digne de Callot. Et tout cela se passait en présence d’une assemblée d’hommes civilisés, de l’ambassadeur de France, du directeur de l’Académie, d’un corps nombreux de prêtres et de cardinaux, devant une réunion d’artistes de toutes les nations. Pour la musique, elle était digne de tels exécutants. Cavatines avec crescendo, cabalettes, points d’orgue et roulades ; œuvre sans nom, monstre de l’ordre composite dont une phrase de Vaccaï formait la tête, des bribes de Pacini les membres, et un ballet de Gallemberg le corps et la queue. Qu’on se figure, pour couronner l’œuvre, les soli de cette étrange musique sacrée, chantés en voix de soprano par un gros gaillard dont la face rubiconde était ornée d’une énorme paire de favoris noirs. « Mais, mon Dieu, dis-je à mon voisin qui étouffait, tout est donc miracle dans ce bienheureux pays ! Avez-vous jamais vu un castrat barbu comme celui-ci ? »
— « Castrato !... répliqua
vivement, en se retournant, une dame italienne, indignée de nos
rires et de nos observations, d’avvero non è castrato !
— Vous le connaissez, madame ?
— Per Bacco ! non burlate. Imparate, pezzi d’asino, che quel virtuoso maraviglioso è il marito
mio. »
J’ai entendu fréquemment, dans d’autres églises, les ouvertures du Barbiere di Siviglia, de la Cenerentola et d’Otello. Ces morceaux paraissaient former le répertoire favori des organistes ; ils en assaisonnaient fort agréablement le service divin.
La musique des théâtres, aussi
dramatiqueque
celle des églises est religieuse, est dans le même
état de splendeur. Même invention, même pureté
de formes, même charme dans le style ; même profondeur de pensée.
Les chanteurs que j’ai entendus pendant la saison théâtrale
avaient en général de bonnes voix et cette facilité
de vocalisation qui caractérise![]() spécialement
les Italiens ; mais, à l’exception de Mme Ungher, prima-donna
allemande, que nous avons applaudie souvent à Paris, et de Salvator,
assez bon baryton, ils ne sortaient pas de la ligne des médiocrités.
Les chœurs sont d’un degré au-dessous de ceux de notre Opéra-Comique
pour l’ensemble, la justesse et la chaleur. L’orchestre, imposant et formidable,
à peu près comme l’armée du prince de Monaco, possède,
sans exception, toutes les qualités qu’on appelle ordinairement
des défauts. Au théâtre Valle, les violoncelles
sont au nombre de... un, lequel un exerce l’état d’orfèvre,
plus heureux qu’un de ses confrères, obligé, pour vivre,
de rempailler des chaises. A Rome, le mot symphonie, comme celui d’ouverture,
n’est employé que pour désigner un certain
bruit que font les orchestres de théâtre, avant le lever
de la toile, et auquel personne ne fait attention. Weber et Beethoven sont
là des noms à peu près inconnus. Un savant abbé
de la chapelle Sixtine disait un jour à Mendelssohn qu’on lui
avait parlé d’un jeune homme de grande espérance nommé
Mozart. Il est vrai que ce digne ecclésiastique communique fort
rarement avec les gens du monde et ne s’est occupé toute sa vie
que des œuvres de Palestrina. C’est donc un être que sa conduite
privée et ses opinions mettent à part. Quoiqu’on n’y exécute
jamais la musique de Mozart, il est pourtant juste de dire que, dans Rome,
bon nombre de personnes ont entendu parler de lui autrement que comme d’un
jeune homme de grande espérance. Les dilettanti érudits
savent même qu’il est mort, et que, sans approcher toutefois de Donizetti,
il a écrit quelques partitions remarquables. J’en ai connu un qui s’était procuré le Don
Juan ; après l’avoir longuement étudié au piano, il fut assez franc pour m’avouer
en confidence que cette vieille musique lui paraissait supérieure
au Zadig et Astartea de M. Vaccaï, récemment mis en
scène au théâtre d’Apollo. L’art instrumental est lettre
close pour les Romains. Ils n’ont pas même l’idée de ce que
nous appelons une symphonie.
spécialement
les Italiens ; mais, à l’exception de Mme Ungher, prima-donna
allemande, que nous avons applaudie souvent à Paris, et de Salvator,
assez bon baryton, ils ne sortaient pas de la ligne des médiocrités.
Les chœurs sont d’un degré au-dessous de ceux de notre Opéra-Comique
pour l’ensemble, la justesse et la chaleur. L’orchestre, imposant et formidable,
à peu près comme l’armée du prince de Monaco, possède,
sans exception, toutes les qualités qu’on appelle ordinairement
des défauts. Au théâtre Valle, les violoncelles
sont au nombre de... un, lequel un exerce l’état d’orfèvre,
plus heureux qu’un de ses confrères, obligé, pour vivre,
de rempailler des chaises. A Rome, le mot symphonie, comme celui d’ouverture,
n’est employé que pour désigner un certain
bruit que font les orchestres de théâtre, avant le lever
de la toile, et auquel personne ne fait attention. Weber et Beethoven sont
là des noms à peu près inconnus. Un savant abbé
de la chapelle Sixtine disait un jour à Mendelssohn qu’on lui
avait parlé d’un jeune homme de grande espérance nommé
Mozart. Il est vrai que ce digne ecclésiastique communique fort
rarement avec les gens du monde et ne s’est occupé toute sa vie
que des œuvres de Palestrina. C’est donc un être que sa conduite
privée et ses opinions mettent à part. Quoiqu’on n’y exécute
jamais la musique de Mozart, il est pourtant juste de dire que, dans Rome,
bon nombre de personnes ont entendu parler de lui autrement que comme d’un
jeune homme de grande espérance. Les dilettanti érudits
savent même qu’il est mort, et que, sans approcher toutefois de Donizetti,
il a écrit quelques partitions remarquables. J’en ai connu un qui s’était procuré le Don
Juan ; après l’avoir longuement étudié au piano, il fut assez franc pour m’avouer
en confidence que cette vieille musique lui paraissait supérieure
au Zadig et Astartea de M. Vaccaï, récemment mis en
scène au théâtre d’Apollo. L’art instrumental est lettre
close pour les Romains. Ils n’ont pas même l’idée de ce que
nous appelons une symphonie.
J’ai remarqué seulement à Rome
une musique instrumentale populaire que je penche fort à regarder
comme un reste de l’antiquité : je veux parler des pifferari.
On appelle ainsi des musiciens ambulants, qui, aux approches de Noël,
descendent des montagnes par groupes de quatre ou cinq, et viennent, armés
de musettes et de pifferi (espèce de hautbois), donner de
pieux concerts devant les images de la madone. Ils sont, pour l’ordinaire,
couverts d’amples manteaux de drap brun, portent le chapeau pointu dont
se coiffent les brigands, et tout leur extérieur est empreint d’une
certaine sauvagerie mystique pleine d’originalité. J’ai passé
des heures entières à les contempler dans les rues de Rome,
la tête légèrement penchée sur l’épaule,
les yeux brillants de la foi la plus vive, fixant un regard de pieux amour
sur la sainte madone, presque aussi immobiles que l’image qu’ils adoraient.
La musette, secondée d’un grand piffero soufflant la basse,
fait entendre une harmonie de deux ou trois notes, sur laquelle un piffero
de moyenne longueur exécute la mélodie ; puis, au-dessus de tout cela,
deux petits pifferi très-courts, joués par des
enfants de douze à quinze ans, tremblotent trilles et cadences,
et inondent la rustique chanson d’une pluie de bizarres ornements. Après
de gais et réjouissants refrains, fort longtemps répétés,
une prière lente, grave, d’une onction toute patriarcale, vient
dignement terminer la naïve symphonie. Cet air a été
gravé dans plusieurs recueils napolitains, je m’abstiens en conséquence
de le reproduire ici. De près, le son est si fort qu’on peut à
peine le supporter ; mais à un certain éloignement, ce singulier
orchestre produit un effet auquel peu de personnes restent insensibles.
J’ai entendu ensuite les pifferari chez eux, et si je les avais
trouvés si remarquables à Rome, combien l’émotion
que j’en reçus fut plus vive dans les montagnes sauvages des Abruzzes,
où mon humeur vagabonde m’avait conduit ! Des roches volcaniques,
de noires forêts de sapins formaient la décoration naturelle
et le complément de cette musique primitive. Quant à cela
venait encore se joindre l’aspect d’un de ces monuments mystérieux d’un autre âge connus sous le nom de murs cyclopéens, et quelques bergers revêtus d’une peau de mouton brute, avec la toison entière
en dehors (costume des pâtres de la Sabine), je pouvais me croire
contemporain des anciens peuples au milieu desquels vint s’installer jadis
Évandre l’Arcadien, l’hôte généreux d’Énée.
.
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . .
Il faut, on le voit, renoncer à peu près à entendre
de la musique, quand on habite Rome ; j’en étais venu même,
au milieu de cette atmosphère anti-harmonique, à n’en plus
pouvoir composer. Tout ce que j’ai produit à l’Académie se
borne à trois ou quatre morceaux : lo Une ouverture
de Rob-Roy, longue et diffuse, exécutée à Paris
un an après, fort mal reçue du public, et que je brûlai
le même jour en sortant du concert ; 2o La scène
aux champs de ma Symphonie fantastique, que je refis presque
entièrement en vaguant dans la villa Borghèse ; 3oLe
chant de bonheur de mon monodrame Lélio
![]() que je rêvai, perfidement bercé par mon ennemi intime,
le vent du sud, sur les buis touffus et taillés en muraille de notre
classique jardin ; 4o cette mélodie qui a nom la
Captive, et dont j’étais fort loin, en l’écrivant, de prévoir
la fortune. Encore, me trompé-je, en disant qu’elle fut composée
à Rome, car c’est de Subiaco qu’elle est
datée. Il me souvient, en effet, qu’un jour, en regardant travailler mon ami Lefebvre, l’architecte,
dans l’auberge de Subiaco où nous logions, un mouvement de son coude
ayant fait tomber un livre placé sur la table où il dessinait,
je le relevai ; c’était le volume des Orientales de V.
Hugo ; il se trouva ouvert à la page de la Captive. Je lus cette
délicieuse poésie, et me retournant vers Lefebvre : « Si j’avais là du papier réglé, lui
dis-je, j’écrirais la musique de ce morceau, car je l’entends.
que je rêvai, perfidement bercé par mon ennemi intime,
le vent du sud, sur les buis touffus et taillés en muraille de notre
classique jardin ; 4o cette mélodie qui a nom la
Captive, et dont j’étais fort loin, en l’écrivant, de prévoir
la fortune. Encore, me trompé-je, en disant qu’elle fut composée
à Rome, car c’est de Subiaco qu’elle est
datée. Il me souvient, en effet, qu’un jour, en regardant travailler mon ami Lefebvre, l’architecte,
dans l’auberge de Subiaco où nous logions, un mouvement de son coude
ayant fait tomber un livre placé sur la table où il dessinait,
je le relevai ; c’était le volume des Orientales de V.
Hugo ; il se trouva ouvert à la page de la Captive. Je lus cette
délicieuse poésie, et me retournant vers Lefebvre : « Si j’avais là du papier réglé, lui
dis-je, j’écrirais la musique de ce morceau, car je l’entends.
— Qu’à cela ne tienne, je vais vous en donner. »
Et Lefebvre, prenant une règle et un tireligne, eut bientôt tracé quelques portées, sur lesquelles je jetai le chant et la basse de ce petit air ; puis, je mis le manuscrit dans mon portefeuille et n’y songeai plus. Quinze jours après, de retour à Rome, on chantait chez notre directeur, quand la Captive me revint en tête. « Il faut, dis-je à mademoiselle Vernet, que je vous montre un air improvisé à Subiaco, pour savoir un peu ce qu’il signifie ; je n’en ai plus la moindre idée. » — L’accompagnement de piano, griffonné à la hâte, nous permit de l’exécuter convenablement ; et cela prit si bien, qu’au bout d’un mois, M. Vernet, poursuivi, obsédé par cette mélodie, m’interpella ainsi : « Ah çà ! quand vous retournerez dans les montagnes, j’espère bien que vous n’en rapporterez pas d’autres chansons, car votre Captive commence à me rendre le séjour de la villa fort désagréable ; on ne peut faire un pas dans le palais, dans le jardin, dans le bois, sur la terrasse, dans les corridors, sans entendre chanter, ou ronfler, ou grogner : « Le long du mur sombre... le sabre du Spahis... je ne suis pas Tartare... l’eunuque noir, etc. » C’est à en devenir fou. Je renvoie demain un de mes domestiques ; je n’en prendrai un nouveau qu’à la condition expresse pour lui de ne pas chanter la Captive. »
J’ai plus tard développé et instrumenté pour l’orchestre cette mélodie qui est, je crois, l’une des plus colorées que j’ai produites.
Il reste enfin, à citer, pour clore cette liste fort courte de mes productions romaines, une méditation religieuse à six voix avec accompagnement d’orchestre, sur la traduction en prose d’une poésie de Moore (Ce monde entier n’est qu’une ombre fugitive). Elle forme le numéro 1 de mon œuvre 18, intitulée Tristia.
Quant au Resurrexit à grand orchestre, avec chœurs, que j’envoyai aux académiciens de Paris, pour obéir au règlement, et dans lequel ces messieurs trouvèrent un progrès très-remarquable, une preuve sensible de l’influence du séjour de Rome sur mes idées, et l’abandon complet de mes fâcheuses tendances musicales, c’est un fragment de ma messe solennelle exécutée à Saint-Roch et à Saint-Eustache, on le sait, plusieurs années avant que j’obtinsse le prix de l’Institut. Fiez-vous donc aux jugements des immortels !
___________________
1. Qui caractérisait alors
les Italiens. ![]()
2. J’avais écrit les paroles parlées
et chantées de cet ouvrage qui sert de conclusion à la Symphonie
fantastique, en revenant de Nice, et pendant le trajet que je fis à
pied, de Sienne à Montefiascone. ![]()
![]()