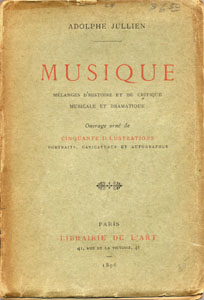
JULES PASDELOUP
ET LES CONCERTS POPULAIRES
par
Adolphe Jullien
1884 et 1890

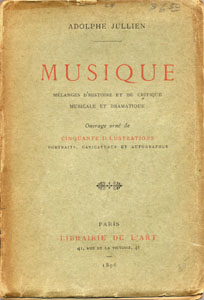 |
JULES PASDELOUPET LES CONCERTS POPULAIRES par Adolphe Jullien 1884 et 1890 |  |
Cette page reproduit deux articles d’Adolphe Jullien sur Jules Pasdeloup, publiés d’abord en 1884 et 1890, et repris par la suite par l’auteur dans son livre Musique. Mélanges d’histoire et de critique musicale et dramatique (Paris, 1896), pages 308-21 et 321-332, dont un exemplaire est dans notre collection. On a conservé la syntaxe et l’orthographe de l’original.
![]()
LA RETRAITE DE M. PASDELOUP
Juin 1884
Le dimanche 27 octobre 1861, une foule innombrable emplissait, jusqu’aux plus hauts gradins, le Cirque Napoléon. Depuis plusieurs jours de longues affiches rouges, collées dans tout Paris, annonçaient pour ce dimanche un grand concert de musique classique où l’on devait entendre l’ouverture d’Oberon et la Symphonie pastorale, le concerto de violon de Mendelssohn exécuté par M. Alard, l’Hymne d’Haydn, par tous les instruments à cordes, et l’ouverture, dite la Chasse du Jeune Henri. Le chef d’orchestre avait un nom singulier et facile à retenir, il s’appelait Pasdeloup. Cette annonce avait excité la plus vive curiosité non seulement chez les personnes aimant la musique et qui, faute de place ou d’argent, ne pouvaient entrer aux concerts du Conservatoire, mais aussi parmi les gens occupés la semaine et qui ne savaient trop, l’hiver, comment employer leur après-midi du dimanche. Et tous accoururent.
Je me souviens de cette invasion du Cirque et de ce premier concert comme si cela datait d’hier, et je vois encore la mine étonnée des gens qui, croyant trouver vingt places pour une dans ce cirque immense et pour un concert donné par un inconnu, se casaient à grand’peine sur les escaliers ou s’en retournaient arpenter le boulevard. M. Pasdeloup était alors absolument ignoré de la foule. Les artistes seuls ou ceux qui touchaient au monde musical savaient que c’était un homme enthousiaste, actif, qui depuis dix ans avait formé un orchestre excellent, la Société des jeunes artistes, avec les élèves des classes du Conservatoire ; que depuis dix années il donnait à la salle Herz des concerts peu fructueux où il avait fait exécuter les chefs-d’œuvre symphoniques des maîtres allemands, où il avait aussi accueilli les premières compositions orchestrales de jeunes musiciens français, de MM. Gounod, Saint-Saëns et Gouvy ; qu’il avait persévéré pendant dix ans dans cette entreprise ingrate avec l’aide de quelques patrons mélomanes, mais qu’il était à bout de ressources et qu’en se transportant au Cirque Napoléon, pour y donner un « concert populaire », il tentait un grand coup définitif. Combien de gens avaient dû le détourner de cette folle entreprise ! Et cependant ce coup d’audace fut un coup de fortune et le même individu qui réunissait à peine autour de lui deux cents auditeurs à la salle Herz en voyait quatre et cinq mille assiéger le Cirque et prendre toutes les places d’assaut.
Mais comment M. Pasdeloup avait-il eu l’idée de fonder cette Société des jeunes artistes ? Lauréat du Conservatoire pour le piano, puis répétiteur d’une classe de clavier, élève estimé de ses maîtres, Zimmermann, Amb. Thomas, Dourlen et Carafa, le jeune Pasdeloup, après la Révolution de 1848, avait dû accepter la place de régisseur du château de Saint-Cloud pour subvenir aux besoins de sa famille, dont il était devenu le chef et le soutien naturel avant le temps. Il employait ses loisirs à composer de la musique ; un jour qu’il venait d’écrire un Scherzo pour orchestre, il eut l’idée folle de l’aller porter à Habeneck avec l’espoir insensé qu’on l’exécuterait peut-être au Conservatoire. Habeneck, de naturel un peu bourru, n’aimait pas à faire languir les gens, en quoi il avait bien raison ; il déclara tout net au visiteur qu’il ne lirait même pas sa partition, la Société qu’il avait l’honneur de diriger n’exécutant que les œuvres des maîtres consacrés. Le solliciteur s’en retourna tout déconfit ; mais une idée lumineuse avait surgi dans son esprit : celle de former un orchestre avec les élèves des classes du Conservatoire et d’exécuter ainsi les productions des jeunes compositeurs qui, autrement, n’avaient aucun débouché pour leurs œuvres de début. Il reprenait, par le fait, une idée utile et féconde à laquelle avait déjà donné corps Seghers dans ses Concerts Saint-Cécile, Elwart dans ses Concerts d’émulation ; mais il le fit avec une ardeur extrême et se voua tellement à son œuvre qu’il en oublia son propre Scherzo et ne fit jamais entendre une seule note de lui durant ses trente-trois ans de direction d’orchestre. Il n’a sûrement pas perdu au change : en M. Pasdeloup le chef d’orchestre est tout, le compositeur n’est rien.
Le premier concert de la Société des jeunes artistes du Conservatoire avait eu lieu le 20 février 1853 ; le premier Concert populaire eut lieu, je l’ai dit, le 27 octobre 1861. Ce n’était d’abord qu’un concert d’essai ; à la suite de ce succès merveilleux, colossal, M. Pasdeloup en donna un deuxième, puis un troisième, enfin une série de huit, après lesquels les Concerts populaires étaient définitivement fondés. Telle est la force irrésistible d’une idée juste, éclose au moment favorable et s’appuyant sur un mot retentissant et justifié — par exception. Les Concerts populaires ! Populaires, ils le furent, en effet, et par leur but et par leur prix, par leur force d’expansion musicale et par le retentissement qu’ils obtinrent dans toutes les classes de la société. Certainement les gens qui, à l’ouverture des bureaux, prenaient d’assaut les places à quinze sous, n’étaient pas tous du peuple, à proprement parler ; mais, outre qu’il y avait de véritables ouvriers dans le nombre, c’étaient des gens de fortune très modeste et qui n’avaient jamais cru qu’ils pourraient un jour avoir de telles jouissances musicales à si bon marché ! C’est par là, c’est par le développement du goût musical en France, en mettant l’audition des plus grands chefs-d’œuvre à la portée des moins fortunés, que M. Pasdeloup mérita ce succès foudroyant, cette popularité qui s’attacha à sa personne et que tout devait lui faire acquérir, et son œuvre, et son nom, et sa tournure, et jusqu’à sa façon si comique de poser le bâton pour haranguer l’auditoire aux jours de grand tapage : on n’entendait pas un mot de son discours et l’on applaudissait à tout rompre. Après quoi, on se remettait à crier plus fort que jamais.
Si le public français actuel doit son éducation musicale à M. Pasdeloup, que ne lui doivent pas les compositeurs ! C’est grâce à lui que tous les jeunes musiciens français, actuellement dans le plein de leur gloire, ont remporté leurs premiers succès : M. Saint-Saëns et Bizet, M. Massenet et M. Guiraud, M. Th. Dubois et M. Lalo. C’est lui qui forma cette génération de musiciens aujourd’hui passés maîtres dans le métier symphonique et qui doivent le meilleur de leur talent, d’abord à la fréquente audition des maîtres de la symphonie, ensuite à la facilité qu’ils avaient de produire leurs œuvres et de s’entendre eux-mêmes à l’orchestre. En même temps qu’il était comme un père nourricier pour tous ces jeunes compositeurs, M. Pasdeloup continuait une aide précieuse à leurs aînés, à ceux qui, comme MM. Reyer et Gounod, avaient déjà conquis leur place au théâtre, et qui, cependant, usèrent souvent de sa large hospitalité. Mais tous aussi, tous, sachant bien ce qu’ils doivent à M. Pasdeloup, lui ont gardé la plus vive reconnaissance : ils se pressent autour de lui et font comme une escorte d’honneur au chef d’orchestre atteint par l’âge et lassé par l’insuccès.
M. Pasdeloup fut donc le grand « éducateur » musical de notre pays, aussi bien du public que des compositeurs, en les initiant aux chefs-d’œuvre d’abord d’Haydn, de Mozart, les premiers compris et fêtés, puis de Beethoven dont la Symphonie pastorale obtint dès le premier jour un succès étourdissant, mais dont les autres symphonies, notamment la neuvième, eurent quelque peine à s’imposer à la foule. Et Mendelssohn qu’on discutait assez vivement lors des premiers concerts ; et Schumann qu’on sifflait joyeusement à chaque nouvelle symphonie qu’essayait M. Pasdeloup ; et tous les musiciens étrangers contemporains, Niels Gade, Abert, Lachner, Brahms, Raff, Svendsen, Ten-Brink, Glinka, Tschaïkowski, etc., dont il jouait tour à tour les œuvres principales, au grand contentement des amateurs désireux de se tenir un peu au courant de la production musicale hors de France ! Enfin, faut-il parler de Berlioz et de Richard Wagner ? Mais tout le monde aujourd’hui se rappelle avec quelle énergie il tenait tête aux sifflets, aux cris qui éclataient indistinctement lorsqu’il essayait de jouer un morceau quelconque de ces deux grands compositeurs, que cela provînt de la Symphonie fantastique ou de Lohengrin, de Tannhæuser ou de la Damnation de Faust ? Dès que reparaissait un de ces noms réprouvés, c’était le signal d’une lutte acharnée entre les rares défenseurs de ces deux compositeurs de génie et ceux qui les sifflaient sans miséricorde. Actuellement, ceux qui essaieraient de siffler risqueraient d’être écharpés par une foule en délire. Essayez plutôt pour voir !
Il n’est peut-être pas de plus beau titre de gloire pour M. Pasdeloup que d’avoir lutté avec un tel acharnement pour faire au moins connaître aux gens plus désireux d’écouter que de crier tant d’admirables compositions. Il avait déjà fait faire à son public habituel des progrès considérables dans ce sens ; mais ce n’est pas lui qui a récolté ce qu’il avait semé. C’est lui qui a travaillé dès la première heure à faire accepter par tous ces deux génies méconnus, et les bénéfices de ce labeur obstiné sont allés pour Berlioz à M. Colonne, à M. Lamoureux pour Wagner. Aujourd’hui que ces deux excellents chefs d’orchestre ont fait en quelque sorte leur chose et leur bien, celui-ci de Wagner, celui-là de Berlioz, il n’est pas inopportun d’insister sur ce point : à savoir que c’est M. Pasdeloup qui a donné le branle et qui a contribué de toutes ses forces à l’exaltation de ces deux grands musiciens.
Qu’on se rappelle et le finale de la Symphonie fantastique, accompagné avec des sifflets, et l’ouverture des Maîtres chanteurs exécutée d’un bout à l’autre sans qu’on en pût percevoir une note, et M. Pasdeloup, excité par cette violente hostilité remettant le dimanche d’après les mêmes morceaux sur le programme et les imposant presque au public à force d’énergie. Aujourd’hui, on les admire, on les applaudit, on les fait recommencer où qu’on les exécute, et chez M. Pasdeloup, et chez M. Colonne, et chez M. Lamoureux. Je cite deux morceaux entre trente ou quarante. Et la marche funèbre du Crépuscule des Dieux qu’on fit jouer quatre et six dimanches de suite aux Concerts-Lamoureux, l’hiver dernier, vous rappelez-vous qu’on n’en put rien discerner, lorsque M. Pasdeloup l’essaya en novembre 1876 ? Et comme je l’avais alors chaudement défendu, il m’écrivait en propres termes : « Merci de m’aider dans mon œuvre ; votre article si vigoureux me donne l’espoir que nous pourrons surmonter l’obstacle. Si nous devions rester étrangers au mouvement imprimé à la musique par Wagner, dans une trentaine d’années nos jeunes compositeurs pourraient bien être de petits vieillards. Encore une fois merci. » Personne, aujourd’hui, qui ne pense exactement ce que M. Pasdeloup écrivait il y a huit ans.
La période véritablement brillante des Concerts populaires s’étendit depuis leur fondation jusqu’en 1873 ou 1874. Avant la guerre, il fallait s’assurer de billets dès le mercredi matin, si l’on voulait pouvoir trouver place, et l’on devait se faire inscrire une année d’avance afin d’avoir des abonnements aux premières ou au parquet. Qui n’était pas alors à Paqris ne saura jamais à quel point on s’occupait de ces concerts, quel retentissement ils avaient dans tout Paris, quel foudroyant succès obtint, par exemple, le Carnaval de M. Guiraud, et comment dès le soir même on était partout instruit de son triomphe. On était alors en 1872, encore en pleine prospérité des Concerts populaires, le concert rival ne devant surgir que l’année suivante et les théâtres ne songeant pas encore à donner de ces matinées comme ils en donnent tous aujourd’hui et qui font une concurrence insurmontable aux concerts.
En 1868, M. Pasdeloup, qui avait toujours trouvé un protecteur intelligent dans la personne de M. Haussmann, le préfet de la Seine, obtenait la direction du Théâtre-Lyrique après l’abandon de M. Carvalho. Ce fut une grande faute à lui que de vouloir mener de front ses concerts, alors en pleine vogue, et un théâtre lyrique ; de ce jour commencèrent ses déboires et ses malheurs. Il avait cependant adopté un plan très sage et c’est précisément celui qu’on propose à tous les aspirants directeurs d’un théâtre lyrique futur, sans s’apercevoir que l’expérience tentée par M. Pasdeloup est la condamnation même de ce système. Il avait une bonne troupe d’ensemble, avec des sujets aimés en tête, par exemple, Monjauze et Mlle Schrœder, mais sans étoile qu’il dût payer trop cher ; il reprenait très convenablement un chef d’œuvre, Iphigénie en Tauride ; il jouait des ouvrages importants de compositeurs ayant encore peu produit : MM. Joncières et Boulanger ; il montait avec éclat le Rienzi de Richard Wagner ; il donnait des traductions intéressantes : la Bohémienne de Balfe et le Bal masqué de M. Verdi ; sans oublier le Val d’Andorre, le Barbier de Séville et le Brasseur de Preston ; bref, il faisait tout ce qu’assurent devoir faire les gens qui se croient de force à ressusciter l’ancien Théâtre-Lyrique, — et il s’y ruina totalement en moins de deux années. Comme il est l’honnêteté même, il quitta sa direction, la tête haute, après avoir engagé, pour se libérer, les bénéfices de plusieurs années à venir des Concerts populaires. Par là-dessus la guerre éclata ; puis, quand la guerre eut pris fin, les circonstances étaient toutes différentes et les recettes allaient bientôt diminuer.
Pendant le siège de Paris, M. Pasdeloup maintint tant qu’il put ses concerts pour distraire un peu les Parisiens et pour donner de quoi vivre aux musiciens assiégés. Après la guerre, il reprit ses séances dès octobre 1871 et compta là encore de belles années. Puis vint la décadence. Assurément M. Pasdeloup eut encore de beaux succès dans ces dernières années et jusqu’à la fin de cet hiver il a rendu de signalés services aux artistes ; mais à mesure qu’il avançait en âge et que la double concurrence des théâtres et des concerts lui rendait la vie plus difficile, il perdait de sa décision, de son énergie. Au lieu de suivre délibérement la voie où il s’était engagé dès la première année et qui lui avait valu gloire et profit, il hésitait, louvoyait, temporisait. Il n’osait plus rien tenter d’audacieux et laissait d’autres le devancer dans le chemin qu’il avait frayé ; puis, quand il les avait vu réussir, il cherchait tantôt à les imiter, tantôt à faire exactement le contraire, en un mot il était tout désorienté. Ceux qui connaissaient les dessous s’étonnaient de le voir poursuivre ainsi d’année en année une lutte inégale contre la fortune et la mode qui l’avaient abandonné ; mais lui s’obstinait par légitime amour-propre et par activité naturelle. Il y renonce enfin et prend une glorieuse retraite à dater de ce printemps.
A peine cette nouvelle était-elle connue qu’on put voir à quel point M. Pasdeloup était véritablement populaire et sympathique à tous. Ce fut un élan général pour assurer une existence tranquille à l’excellent homme qui avait travaillé à la fortune de tant d’artistes et qui n’avait pas pu faire la sienne. Non seulement les artistes et compositeurs qui ont le plus la mémoire du cœur et qui lui ont prouvé leur reconnaissance en toute occasion, MM. Faure et Gounod, Reyer et Saint-Saëns, Ritter et Guiraud, sans oublier Mme Adler-Devriès, qu’il fit débuter autrefois au Théâtre-Lyrique, accouraient se mettre à sa disposition ; mais tous les artistes de Paris, instrumentistes et chanteurs, réunis dans un bel élan de gratitude, organisaient ce festival sans pareil qui vient d’avoir lieu et dont je dirai seulement qu’il a produit plus de cent mille francs.
Rien pour la musique et tout pour la charité.
![]()
PASDELOUP ET M. SAINT-SAËNS
Septembre 1890.
On a bien tort de mourir. Jamais cette réflexion, peu consolante, ne m’a paru plus juste qu’après avoir lu certain article de la Nouvelle Revue, autour duquel on a fait quelque réclame en raison du nom dont il est signé. Voilà trois ans que Pasdeloup, le glorieux propagateur de la musique classique en France, a disparu de ce monde, et M. Saint-Saëns, qui lui doit tant, vient de tracer, à l’occasion de cet anniversaire, un portrait du pauvre Pasdeloup, qui n’est pas précisément flatté. Je n’insisterai pas sur le caractère général de cet article, car dans la pensée de M. Saint-Saëns il devrait être certainement favorable à Pasdeloup ; mais j’en veux retenir au moins certains détails. D’abord parce qu’ils sont absolument contraires aux faits que tout le monde peut vérifier, ensuite parce que cet examen montrera une fois de plus que M. Saint-Saëns, dès qu’il prend la plume, est saisi d’une sorte d’agitation qui le fait écrire à l’aventure, trouble sa mémoire et l’induit en des erreurs ou des oublis incroyables sur les faits qu’il devrait le mieux se rappeler, ceux de sa propre carrière musicale. Alors jugez de ce que ce doit être quand il parle des autres.
Que Pasdeloup fût d’une « incompétence énorme » en musique et qu’une présomption égale à son ignorance lui donnât cette fougueuse assurance qui éblouissait le public ; qu’il dirigeât de façon pitoyable et les œuvres des maîtres classiques et celles des compositeurs vivants ; qu’il ne voulût recevoir aucune observation de personne et crût mieux comprendre et connaître les morceaux que les auteurs eux-mêmes ; qu’il fût bourru, brutal et sujet à des enthousiasmes comme à des répulsions inexplicables, tout cela est fort possible — encore qu’on eût pu le dire avec un peu plus de retenue ; — mais tous ces défauts disparaissaient dans la chaleur de l’action, dans cet amour passionné pour l’art qu’il communiquait à son orchestre, à ses auditeurs, et qui le transformaient en une sorte de moine prédicant, d’apôtre illuminé de la musique classique. Avec des lacunes énormes dans son éducation musicale, avec une science très insuffisante pour approfondir toute la musique d’orchestre qu’il jugeait d’un coup d’œil et conduisait avec frénésie, avec une confiance démesurée en lui-même, il eut au suprême degré les qualités de chaleur, d’entrain, de courage et de conviction qui soulèvent les masses et dominent le public.
Pasdeloup, quoi qu’on puisse dire contre lui, a été le chef d’orchestre le plus populaire qui fût jamais en France, et cette popularité était méritée, car par son initiative hardie il a ouvert des champs inexplorés à notre curiosité musicale. En même temps qu’il révélait à d’innombrables amateurs les chefs-d’œuvre auxquels les seuls abonnés du Conservatoire étaient initiés sans toujours les comprendre, il poussait dans le sens de la musique symphonique nombre de jeunes musiciens qui, auparavant, ne pensaient qu’à écrire des ouvrages de théâtre, et, de la sorte, il aidait puissamment au renouvellement de la jeune école musicale française. Et cela malgré les vœux de son public ; car, il faut bien le dire, et M. Saint-Saëns paraît l’ignorer, au commencement des Concerts populaires, tous les désœuvrés du dimanche : employés, rentiers, bourgeois, financiers, ouvriers, qui se ruaient en foule à ces concerts, n’avaient aucun désir d’entendre là des productions de compositeurs français, d’aider au développement de l’école française. Ah ! voilà qui les touchait peu !
J’en parle à bon escient, car j’allais au Cirque Napoléon à peu près tous les dimanches avec mes parents ou mes amis. Dans ce public innombrable, il y avait une grande majorité de gens fort ignorants en musique auxquels le grand nom de Beethoven inspirait le respect, mais qui ne goûtaient vraiment que certains andantes ou menuets de Haydn et de Mozart ; Mendelssohn était tenu en médiocre estime et, quant à Berlioz ou Schumann, on les repoussait avec horreur. Les gens tant soit peu versés dans la musique et qui trouvaient enfin la possibilité d’entendre une quantité d’œuvres classiques qu’ils ne connaissaient que par ouï-dire étaient certainement plus accessibles aux vrais mérites des morceaux inconnus qu’on pouvait leur offrir et les jugeaient, à l’occasion, d’une oreille plus exercée. Mais ils avaient, ces vrais amateurs de musique classique, une telle soif de Beethoven, de Mozart, d’Haydn, de Weber, de Mendelssohn, qu’ils ne voulaient que de ces auteurs-là et faisaient la grimace aussitôt qu’on mettait sur le programme quelque nom moins célèbre : il leur semblait que ce fût une place volée et du temps perdu.
Je touche ici à l’un des griefs les plus injustes de M. Saint-Saëns contre Pasdeloup. Il lui reproche non seulement de ne pas avoir ouvert plus largement les portes de ses concerts aux compositeurs français, mais même de leur avoir violemment barré la route aussi longtemps qu’il a pu, soit jusqu’après la guerre et pendant dix années, de 1861 à 1871. J’avoue que ce reproche me stupéfie sous la plume de M. Saint-Saëns, et j’ose affirmer que c’est déjà bien beau à M. Pasdeloup d’avoir donné le peu de morceaux de musique française qu’il fit exécuter pendant ces dix années. D’abord parce que les compositeurs français cultivant la musique simplement orchestrale étaient alors en très petit nombre, et puis parce que le public emplissait le Cirque Napoléon jusqu’au cintre pour entendre avant tout, je dirai même : exclusivement, les maîtres allemands dont les chefs-d’œuvre ne lui étaient connus que par des transcriptions pour piano. Il est possible que M. Saint-Saëns, jeune compositeur qui savait déjà par cœur les productions de la musique symphonique allemande, ait cru trouver dans ces concerts un débouché pour ses propres œuvres, et ait été surpris de voir qu’ils étaient presque toujours remplis par Beethoven, Mozart, Haydn, Weber et Mendelssohn, les cinq auteurs dont les noms brillaient en tête de tous les programmes et de toutes les affiches ; mais, moi, simple auditeur, je garantis à M. Saint-Saëns que Pasdeloup répondait parfaitement de la sorte aux désirs de son public. Et la preuve en est dans son formidable succès.
Écoutez M. Saint-Saëns voulant prouver que ce pauvre Pasdeloup s’ingéniait à barrer la route aux musiciens français. « L’ouverture de la Muette, deux symphonies de MM. Gounod et Gouvy, d’ailleurs fort jolies, et l’ouverture des Francs-Juges, tels sont, ou peu s’en faut, — dit-il à peu près, — les seules productions de musiciens français qu’il ait offertes à ses auditeurs avant 1870. » Mais c’est proprement monstrueux, et sans parler de l’ouverture de Zampa, qui ne peut pas plus compter que celle de la Muette, sans parler des œuvres de M. Saint-Saëns lui-même, auquel je reviendrai tout à l’heure, est-ce que Pasdeloup n’a pas dès le début commencé sa campagne en faveur de Berlioz d’abord par l’ouverture du Carnaval romain, même avant celle des Francs-Juges, et par des fragments de Roméo, dont il était arrivé à faire écouter presque sans brouhaha les trois principales scènes orchestrales : Roméo seul, la Reine Mab et la Scène d’amour ? Mais parlons seulement des compositeurs vivants et déjà classés à cette époque. En plus de MM. Gounod et Gouvy, je ne vois que Reber dont Pasdeloup aurait pu faire exécuter quelque ouvrage, mais ses symphonies, qui ne sont que d’adroits pastiches de celles d’Haydn, auraient sans doute paru bien pâles auprès de celles de son modèle et c’est peut-être un bonheur pour Reber que d’avoir été négligé par Pasdeloup.
Et maintenant parlons des jeunes prix de Rome, de ceux auxquels Pasdeloup, selon M. Saint-Saëns, a barré la route. Est-ce que ce n’est pas lui qui donnait dès 1863 le scherzo d’une Symphonie inédite de Georges Bizet, prix de Rome de 1857, et, dès 1867, une Suite d’orchestre de M. Jules Massenet, prix de Rome de 1863 ? Notez qu’il était obligé de faire suivre ces noms ignorés de ce titre académique afin d’attirer l’attention du public, d’apprendre à ses auditeurs habituels pourquoi ces inconnus lui paraissaient, à lui Pasdeloup, mériter l’honneur de figurer à côté des maîtres. Est-ce qu’il n’a pas rejoué plus d’une fois ces deux ouvrages ; est-ce qu’il n’a pas produit encore avant la guerre, en 1869, la fantaisie symphonique en trois morceaux de Bizet, intitulée Souvenir de Rome ; est-ce qu’enfin, le vendredi saint de l’année 1870, il ne faisait pas exécuter les Sept paroles du Christ, de M. Théodore Dubois, un autre prix de Rome auquel il ne montra pas, ce me semble, une trop grande hostilité ?…. Mais je m’arrête à la guerre et ne vais même pas jusqu’à Ernest Guiraud, qui, deux ans plus tard, allait sortir célèbre du Concert populaire avec son Carnaval, dont tout Paris s’entretenait le soir même. Allons, Bizet, Massenet, Dubois, ce n’est pas mal pour Pasdeloup que d’avoir fait sortir de l’ombre — avant 1870 — ces musiciens-là, et je ne vois que M. Saint-Saëns pour l’avoir oublié. Peut-être, après tout, n’avait-il pas sujet de s’en réjouir.
Maintenant, j’arrive à M. Saint-Saëns lui-même, et ici son manque de mémoire et son injustice atteignent des proportions vraiment curieuses. D’abord, une histoire assez amusante. La première fois que son nom parut sur l’affiche des Concerts populaires, ce fut sans qu’il en fût averti. Il se rendit au concert dans la foule, entendit son morceau et fut assez satisfait de l’exécution comme de l’accueil du public : c’était, je complète ici son récit, sa Marche-Scherzo, exécutée le 27 décembre 1863. Quelques jours après, il va chez Pasdeloup pour le remercier ; mais celui-ci l’arrête au premier mot : « Vous me remerciez ; et pourquoi ? J’ai joué votre morceau parce qu’il m’a paru bon, non pour vous faire plaisir et je n’ai qu’à faire de vos remerciements. » M. Saint-Saëns n’est pas encore revenu de cet accueil. Eh bien, je paraîtrai très singulier, mais ces allures de bourru bienfaisant, ces bougonneries ne me déplaisent pas, et j’aime assez cet homme qu’on devait chercher à flatter, car il était tout-puissant à cette époque, et qui se préoccupait non de l’artiste, mais de l’œuvre. Il pouvait se tromper ; mais au moins il le faisait hardiment, honnêtement, sans arrière-pensée ou bas calcul.
Toutefois il ne me paraît pas qu’il ait tenu rancune à M. Saint-Saëns de ses remerciements, car il lui fit un plus large accueil qu’à tout autre. Et c’est ce que le compositeur a totalement oublié, car il écrit : « Je crois bien qu’il s’est écoulé au moins dix ans après ma visite, avant que Pasdeloup rejouât quoi que ce soit de moi. » Nous sommes en décembre 1863 : feuilletons donc les programmes jusqu’à la fin de 1873. Et d’abord Pasdeloup rejoue cette Marche-Scherzo tout comme si l’auteur n’était pas venu le voir ; en 1867, il approuve que M. Sarasate vienne exécuter le deuxième concerto de violon de M. Saint-Saëns ; en 1868, il s’entend avec celui-ci pour qu’il vienne jouer lui-même son concerto de piano en sol mineur ; en 1871, il exécute sa Marche héroïque ; en 1872, son Rouet d’Omphale et rejoue chacun de ces ouvrages plusieurs fois… Et notez qu’à cette époque, M. Saint-Saëns, très apprécié comme pianiste, était violemment contesté comme compositeur, que ses œuvres soulevaient des discussions assez aigres, que le public le tenait pour un wagnériste abominable et qu’il y avait quelque courage à le produire. Allons, décidément, ce pauvre Pasdeloup a fait pour l’école française et pour M. Saint-Saëns, même avant la guerre, un peu plus que l’auteur d’Ascanio veut en convenir.
M. Saint-Saëns insiste aussi, non sans raison, sur les prodigieuses bévues que Pasdeloup commettait en dirigeant la Symphonie avec chœur et sur cette présomption inouïe qui lui faisait rabrouer les compositeurs devant tout son orchestre. La position de ces malheureux, qui n’avaient le droit de faire aucune observation, était vraiment piteuse, et je me rappelle avec quelle raideur dédaigneuse il répondit un jour à M. Lalo, à Mlle Holmès, qui avait timidement et de loin proféré quelque remarque : « Si vous croyez mieux faire, venez à ma place, et j’irai à la vôtre. » Et tranquillement il continuait à diriger le morceau comme il l’entendait. Je suis allé souvent, durant les dernières années, à ses répétitions du samedi matin, et je n’ai vu que Reyer pour lui tenir tête : furieux et rouge comme un coq, celui-ci sautait dans l’arène et courait à l’estrade où il frappait de sa canne jusqu’à ce que Pasdeloup voulût l’écouter… Alors c’était une belle algarade. Mais l’instant d’après il n’en restait plus trace, et le compositeur n’en gardait pas moins la plus vive reconnaissance à l’homme qui, pour le dédommager d’attendre si longtemps la représentation de Sigurd, lui avait dit : « Écrivez-moi une ouverture pour votre opéra, confiez-la moi et vous verrez qu’elle deviendra célèbre. » Il avait dit vrai, le brave Pasdeloup.
C’est qu’il avait la passion de la musique ; il était tout du premier mouvement et apportait dans ses impressions, dans ses jugements, une violence, une sincérité irrésistibles. En voulez-vous un exemple ? A la fin de sa carrière, exténué, ruiné par la redoutable concurrence de MM. Colonne et Lamoureux, il assistait à cette glorieuse et magnifique représentation de Lohengrin à l’Eden-Théâtre qui demeura sans lendemain. A la fin du premier acte, étourdi, surexcité par la merveilleuse exécution du finale, il pleurait presque et se tournait vers ses voisins : « J’ai entendu cela vingt fois en Allemagne, criait-il, je sais ce morceau-là par cœur et l’ai fait exécuter vingt fois ; non, jamais je n’aurais cru qu’on pût obtenir un résultat pareil. Bravo, bravo, Lamoureux ! » Ce chef d’orchestre abattu n’avait donc pas l’ombre de rancune, et je ne crois pas qu’on puisse rien raconter qui lui fasse plus d’honneur. Je ne l’ai pas connu dans le particulier, je n’ai eu avec lui que des rapports intermittents et qui tournaient parfois à l’aigre ; eh bien, c’est égal, il me plaisait, ce gros homme exubérant, lunatique et rageur, mais enflammé, sincère et convaincu. Et cependant je ne lui devais rien : c’est peut-être pour cela que je lui rends justice.
![]()
Site Hector Berlioz créé le 18 juillet 1997 par Michel Austin et Monir Tayeb; cette page créée le 15 mars 2012.
© Michel Austin et Monir Tayeb. Tous droits de reproduction réservés..
![]() Retour à la page Berlioz: Pionniers et
Partisans
Retour à la page Berlioz: Pionniers et
Partisans
![]() Retour à la page Exécutions et articles contemporains
Retour à la page Exécutions et articles contemporains
![]() Retour à la Page d’accueil
Retour à la Page d’accueil
![]() Back to Berlioz: Pioneers and Champions
Back to Berlioz: Pioneers and Champions
![]() Back to Contemporary Performances and Articles page
Back to Contemporary Performances and Articles page
![]() Back to Home Page
Back to Home Page