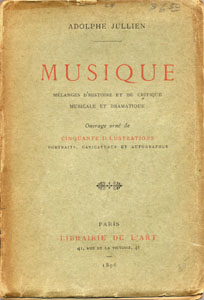
LA CRITIQUE ET BERLIOZ
par
Adolphe Jullien
1893

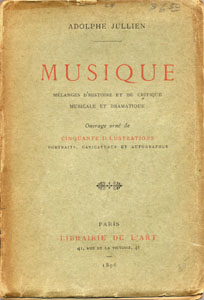 |
LA CRITIQUE ET BERLIOZpar Adolphe Jullien 1893 |
 |
Cette page reproduit un article d’Adolphe Jullien, publié d’abord en 1893, et repris par la suite par l’auteur dans son livre Musique. Mélanges d’histoire et de critique musicale et dramatique (Paris, 1896), p. 213-33, dont un exemplaire est dans notre collection. On a conservé la syntaxe et l’orthographe de l’original.
![]()
Août 1893
Il est généralement connu que Berlioz, toute sa vie, eut beaucoup à souffrir des attaques de la presse, ou pour être plus exact, non pas de la presse en général, mais de certains journalistes et de certaines feuilles qui ne désarmèrent jamais. Cependant on reste habituellement dans le vague, on se contente d’une affirmation sur ce sujet, et les écrivains mêmes qui ont composé les ouvrages les plus étendus sur Berlioz, entraînés par les innombrables détails qu’une existence si agitée comporte, ont dû — j’en sais quelque chose — se contenter de citer de très courts extraits pour confirmer leur dire : il serait bon cependant d’en connaître un peu plus. Entre tous les détracteurs de Berlioz, Scudo et Jouvin ont dû à leur notoriété, à leur acharnement et aussi à cette particularité qu’ils furent les derniers à lutter contre Berlioz, de voir leurs articles moins oubliés, moins enterrés que d’autres ; mais ils ne sont pas les seuls, parmi les ennemis de Berlioz, qui mériteraient de voir leurs sots et vaniteux arrêts passer à la postérité, pour la distraire, en face des chefs-d’œuvre triomphants du grand musicien.
Je vais donc, si vous le permettez, vous offrir quelques autres spécimens des articles que la presse a consacrés à Berlioz aux différentes époques de sa vie et, comme il ne faut pas s’en tenir à la note défavorable, je commencerai par divers écrits qui durent faire un sensible plaisir au jeune compositeur. Il s’agit des jugements portés sur le grand concert que Berlioz donna dans la salle du Conservatoire, à la Toussaint de 1829, et dans lequel il fit exécuter de nouveau ses ouvertures des Francs-Juges, de Waverley, et donna place à deux nouveautés : son sextuor de Sylphes, pour le Faust de Gœthe, et sa scène du Jugement dernier (le Resurrexit de sa messe antérieure). Ovation dans la salle au milieu du concert, ovation dans la rue à la sortie, ovation le soir à l’Opéra, quand les musiciens l’aperçurent ; bref, succès complet, « volcanique », écrit-il ; articles aux Débats, au Correspondant, au Figaro, mais articles trop courts au gré de l’auteur qui s’écrie : « Ces animaux ne savent parler que quand il n’y a rien à dire ».
L’article de Castil-Blaze, aux Débats, n’était, il est vrai, qu’une série de doléances sur le triste sort des jeunes musiciens français qui ne savaient ni où ni comment se faire entendre, avec hommage à Berlioz pour la persévérance et l’habileté dont il avait fait preuve, sans nul éloge pour ses morceaux ; mais l’article du Figaro, que Berlioz trouvait si court, occupe une colonne entière où il n’est question que de lui, de son talent précoce malgré son dédain trop marqué pour la mélodie, de son don incontestable, encore que sa manière soit incorrecte, et sa volonté de fer. Diable, il était difficile s’il n’était pas content d’un article où l’on rappelait sa constance héroïque devant les sévérités de l’Institut et les refus des directeurs, sa persistance louable à ne pas faire comme tous les compositeurs jeunes ou vieux qui copiaient platement Rossini, sa volonté très arrêtée de demeurer lui-même et de résister aussi bien à l’engouement pour les fioritures, qu’aux conseils desséchants des contrapuntistes français ; où l’on proclamait sa parenté avec Beethoven, établie à tous les yeux par son Resurrexit et son ouverture des Francs-Juges, œuvre d’un homme de génie ou peu s’en faut.
Au Correspondant même, où Berlioz écrivait d’habitude, on n’en dit pas davantage. Et, cependant, ce fut d’Ortigue qui fit l’article : il commençait ainsi sa tâche de suppléant qu’il remplit tout le long de la vie de Berlioz et qui finit par lui faire attribuer le feuilleton musical des Débats. Avec quelle chaleur il loue, avec quel soin minutieux il étudie l’ouverture de Waverley ! Mais il place encore au-dessus celle des Francs-Juges, pour la hardiesse de la conception et quoiqu’elle lui paraisse entachée de bizarrerie ; il estime également qu’on retrouve également, dans les morceaux pour voix et orchestre, « la même connaissance des ressources de l’harmonie et celle des rapports du chant vocal et de l’instrumentation » ; enfin, pour ce critique ami, le Concert de Sylphes n’a pas été moins applaudi que le Resurrexit et que les deux ouvertures : succès égal pour tous ces morceaux. N’était-ce pas pousser l’éloge un peu loin, puisque Berlioz lui-même a dû convenir que le Concert de Sylphes avait lassé l’auditoire et fait tache au milieu du succès général ?
Fétis, aussi, continuait à défendre Berlioz, mais avec plus de réserve qu’après son premier concert. Il insistait beaucoup sur l’absence totale de mélodie qui l’avait frappé dans l’ouverture de Waverley, dans le Concert de Sylphes, sur son manque de style et ses gaucheries d’harmonie, sur sa maladresse à écrire pour les voix, sur sa tendance au bruit, sur la rage de bizzareries qui le tourmentait et lui valait les applaudissements fanatiques d’une jeunesse ardente, avide de nouveautés bonnes ou mauvaises ; mais enfin il écrivait encore : « Vraiment, le diable au corps est on ne peut mieux dit à propos d’un compositeur comme Berlioz ! Quelle musique fantastique ! Quels accents de l’autre monde ! En écrivant ceci, j’en crois à peine mes souvenirs. Jamais l’originalité, jamais la bizzarerie n’eurent une allure plus décidée, plus vagabonde. Des effets variés de mille manières, tantôt heureux, tantôt repoussants, mais presque toujours neufs et trouvés, voilà ce qui remplit d’un bout à l’autre, et l’ouverture de Waverley, et celle des Francs-Juges, et le Concert de Sylphes, et le Resurrexit, qui ont ébranlé le cerveau de tous les auditeurs de ce concert étrange. De plan, je ne puis dire qu’il y en ait dans tout cela, car je n’ai pas eu la sagacité d’en découvrir ; mais je n’y comptais guère. Un homme de vingt ans, quand il a la fièvre, n’a point de plan dans ce qui fait. Il va, vient, se meut par instinct, tombe et se relève sans en avoir eu le dessein, sans y avoir songé. C’est ce qui arrive à M. Berlioz dans toute sa musique. C’est la fièvre qui le domine ; mais cette fièvre n’est point celle d’un homme ordinaire. »
Le désaccord allait s’accentuer vite entre Fétis et Berlioz et la déclaration de guerre eut lieu dans le concert du 9 décembre 1832, au Conservatoire, où Berlioz toucha définitivement le cœur de miss Smithson. Il fit exécuter, ce jour-là, la Symphonie fantastique avec l’appendice dramatico-lyrique : Lelio, qu’il venait de combiner et dans lequel il vengeait Beethoven des corrections de Fétis. C’est Bocage qui, figurant Lelio, lança cette violente tirade contre le coupable, assis au balcon, et qui ne broncha pas plus qu’un terme. Et l’article que Fétis consacra à ce concert est vraiment d’une habileté extraordinaire, en ce sens que l’écrivain ne se met pas en désaccord avec lui-même, ayant auparavant loué la Symphonie fantastique, et que, sans hostilité trop apparente, il résume et condense toutes les critiques qu’on pouvait formuler contre la musique et le système de Berlioz. Cette étude renferme ainsi, très adroitement groupés, tous les arguments, dont quelques-uns assez spécieux, qu’on pouvait présenter au public pour discréditer l’auteur de la Fantastique ; en les reprenant, en les aiguisant, les ennemis du maître arrivèrent à se forger des armes bien trempées et dont ils purent faire usage pendant trente, quarante, cinquante ans, sans les émousser. Ce sont eux qui ont harcelé Berlioz, qui l’ont criblé de blessures cuisantes ; c’est Fétis qui les avait armés.
Bien loin de méconnaître ses premières sympathies à l’égard du jeune compositeur, Fétis s’en fait gloire au contraire ; il se vante — à bon droit — d’avoir compris un des premiers que cet artiste avait une rare intelligence musicale et d’avoir protesté contre les dédains que tant de gens montraient à son égard. Cependant, dit-il, il avait signalé dès lors ses défauts de facture, ses harmonies mal attachées, et surtout l’absence de mélodie qui semble être le caractère distinctif de sa musique, en observant toutefois qu’il convenait de donner du temps au novateur pour qu’il parvînt à voir clair dans son propre esprit, à savoir exactement ce qu’il voulait faire. Mais les années sont passées, les qualités ne sont pas devenues plus grandes, et les défauts ne se sont nullement atténués. Au contraire, le jeune homme, exalté par ses amis, par des gens férus de cette idée qu’on naît artiste et que l’art ne s’apprend pas, montre le plus grand mépris pour les règles et pour ce qu’on nomme la science en musique ; mais est-il bien venu à tellement mépriser ce qu’il ignore, et croit-il qu’il suffira de méconnaître les traditions d’un art pour trouver des chants plus suaves, des accents plus passionnés, des harmonies plus neuves et plus piquantes, des rhythmes mieux cadencés, etc.? Ses essais infructueux prouvent le contraire ; sa mélodie, si toutefois on peut employer ce mot trop flatteur, est gauche, mal bâtie et conclut mal ; son harmonie est incorrecte, avec des accords qui ne se lient pas, et cependant dépourvue de nouveauté, commune quand elle n’est pas monstrueuse, etc. Bref, Berlioz, doué d’une présomption peu commune, s’est promis de continuer l’œuvre des plus grands musiciens avant même d’avoir acquis les premières notions de musique, et, comme il avait dépassé l’âge où ces choses s’apprennent aisément, il est demeuré à l’état de phénomène ; artiste ayant entrevu des nouveautés qu’il est hors d’état de réaliser, esprit inventeur dont les conceptions avortent, homme, enfin, dont l’impuissance trahit les dessins et la folle ambition.
Selon Fétis, Berlioz n’est donc pas un musicien, au sens large du mot, et ne saurait plus le devenir ; il possède, à tout prendre, un instinct naturel des effets d’instrumentation qu’il conçoit presque toujours comme la réalisation de bruits physiques et matériels, tels que l’orage, le vent dans le feuillage, le zéphir caressant les cordes d’une harpe, le grondement de la foule, et pour les produire, il a besoin tantôt de six ou huit parties de violon différentes, tantôt de plusieurs timbales, de harpes, du secours des voix jointes aux instruments, etc. Tout cela, soyons juste, il le groupe parfois avec assez de bonheur et de pittoresque ; mais il prétend être un musicien dramatique et n’est apte qu’à imiter les bruits extérieurs, bien loin de savoir traduire et provoquer les grands mouvements de l’âme : en ce qui regarde spécialement son dernier ouvrage, la mélodie dominante qui parcourt toute la symphonie et qui devrait être d’un caractère exquis, son idée fixe, personnification de la femme adorée, est tellement misérable, qu’elle suffit à faire juger ce présomptueux novateur, musicien sans inspiration, tout au plus bon à combiner de piquants effets de sonorité. D’ailleurs, Fétis ne dit pas un traître mot de Lelio, qu’il semble considérer comme non avenu ; il parle rapidement, mais favorablement, de la Marche au supplice et du Bal, qu’il avait déjà loués deux ans plus tôt et termine ainsi : « Un programme en prose pompeuse précède chacun des derniers morceaux qui ont été entendus dans le dernier concert de M. Berlioz. Il y est dit que Beethoven, nouveau Cortez, a découvert des pays inconnus dans le domaine de la musique et que cet art attend un Pizarre. J’ai cru comprendre que l’artiste espère remplir une mission analogue à celle de l’illustre aventurier ; je crains bien, toutefois, pour me servir d’une vulgaire locution, qu’il ne trouve pas le Pérou. »
S’il se sentait atteint par ces critiques si habiles et si perfides, le jeune musicien pouvait se délecter en lisant les éloges que le dévoué d’Ortigue lui décernait dans la Revue européenne et qui devaient être des plus doux à son cœur : « Berlioz est le premier compositeur qui ait tenté, au moyen de la symphonie, des accents des divers instruments, de la combinaison de leurs effets variés, du langage propre à chacun d’eux, et enfin de la réunion de toutes les masses de l’orchestre, de reproduire ces effets pittoresques, ces couleurs vives et fortes, cette expression élégiaque et mystique auxquelles nous avaient initié les grandes conceptions de Weber et de Beethoven. Et c’est, il faut le dire, plus qu’un effort individuel ; le souffle du nord avait répandu parmi nous les germes d’une nouvelle inspiration : ces éléments avaient fermenté au sein de notre nation, mais l’explosion s’est faite dans une seule tête, celle de Berlioz. »
Enjambons quelques années et sautons en 1840, à l’époque où Berlioz, ambitionnant la succession d’Habeneck à l’Opéra, avait obtenu du directeur Pillet d’y donner un festival monstre, annoncé pour le jour de la Toussaint. Toutes les inimitiés plus ou moins justifiées qui se coalisaient contre Berlioz trouvaient alors dans le Charivari un organe toujours disposé à l’attaquer. Aussi parut-il dans ce journal un article extrêmement agressif, dès que l’organisation de ce concert fut divulguée : « Il vous faut du nouveau, a dit M. Berlioz aux directeurs de l’Opéra ; je vous apporte des trompettes marines, des tambours mouillés, des timbales percées et des casseroles fêlées. Voici une Symphonie fantastique méconnue, un Requiem presque inconnu et une Symphonie militaire très connue… » Le lendemain, un concert monstre est annoncé en tête des affiches de théâtre et l’on voit apparaître une réclame orientale, une réclame à grand orchestre, proclamant de nouveau M. Berlioz le plus grand musicien du siècle. « Oh ! M. Berlioz, que vous êtes à plaindre ! Voilà bientôt quinze ans que votre musique fait le désespoir des artistes qui l’exécutent et de ceux qui l’écoutent ; voici bientôt quinze ans que votre musique est antipopulaire, voilà bientôt quinze ans que vous tombez de chute en chute, que vous êtes ballotté dans les concerts, dans les théâtres, sur les places publiques, et personne ne sait encore où vous allez et ce que vous voulez. Et pourquoi s’il vous plaît ? l’Opéra a-t-il consenti à donner sa salle à M. Berlioz ? Quels titres ce compositeur a-t-il donc à la reconnaissance de M. le directeur de l’Opéra ?… » Puis, après un parallèle tout à l’avantage de Habeneck, après avoir dit que beaucoup de musiciens de l’orchestre avaient adressé une pétition au ministre afin de n’être pas forcés d’exécuter la musique de Berlioz et d’être employés plutôt aux travaux des fortifications, le journaliste concluait ainsi : « Ce concert, annoncé pompeusement sous le titre de festival, et qui promet d’être une séance profondément assoupissante, est tout simplement une satisfaction d’amour-propre donnée au critique du Journal des Débats. Nous ne voulons pas dire que c’est une spéculation de l’auteur de Benvenuto Cellini, car on ne spécule pas avec une musique semblable… Gluck, Hændel, Palestrina, et… M. Berlioz sont mis sur la même ligne, M. Berlioz à côté de Gluck, de Hændel et de Palestrina, quelle profanation ! »
Le matin même du Ier novembre, il parut un nouvel article on ne peut plus spirituel, comme on va voir : « Aujourd’hui dimanche, Ier novembre 1840, grande fête à l’Académie de musique. QUATRE CENT CINQUANTE musiciens échelonnés, hommes, femmes et enfants en bas-âge, mêleront leurs cris aux aboiements de quatre cent cinquante trompettes, ophycléides, contre-basses et autres instruments de même nature pour exécuter, en l’honneur de M. Hector Berlioz, une réclame sur tous les tons et modes imaginables. A la demande générale, le spectacle sera suivi de l’ascension, dans une grosse caisse, de M. Hector Berlioz ; au même moment, les violons feront entendre une explosion de gammes chromatiques ascendantes et descendantes. Arrivé aux frises, le créateur de la musique fantastique sortira de son ballon et prononcera un discours, avec accompagnement de tambours mouillés, sur son système musical, le plus fabuleux de tous les systèmes. Nous avons pu nous procurer une copie exacte de cette allocution, que nous venons d’entendre à la séance préparatoire qui a eu lieu aujourd’hui samedi : « Messieurs et mesdasmes, je suis ce fameux Hercule-musicien dont vous avez sans doute entendu parler, et qui, depuis quinze années, étreint dans des flots d’harmonie l’Allemagne, l’Angleterre, la Russie, l’Italie et autres lieux. La France seule, cette ingrate patrie, a renié mon génie. Et que lui ai-je fait, à cette patrie, messieurs et mesdames, pour qu’elle me méconnaisse ?… De la musique !!! » » Et ce discours funambulesque, où le rédacteur prête toutes les inepties possibles à Berlioz, et aussi des ironies fort méprisantes, à l’adresse de Rossini, d’Auber, d’Herold et de Boieldieu, continue durant toute une colonne. Voici la fin : « Au moment où l’orateur cessait de parler, un bruit sourd s’est fait entendre : la grosse caisse dans laquelle s’était enlevé M. Hector Berlioz a été crevée par le poids, et le compositeur, passant au travers, est tombé lourdement sur le parquet. Ce n’est qu’une chute préparatoire ; nous verrons ce soir une plus belle dont nous rendrons compte demain. » — Quel dommage que d’aussi jolies choses ne soient pas signées et qu’on ne sache à qui les attribuer !
Après toutes ces facéties musicales, il est assez curieux de voir comment le Charivari parla « sérieusement » de ce concert et comment le rédacteur jugea définitivement la musique de Berlioz. Il commence en proclamant que Musard et Jullien, ces ménétriers de premier ordre, ces créateurs de la musique industrielle, sont éclipsés à jamais et qu’on ne fera jamais rien de plus fort en fait de charlatanisme musical ; il blâme ensuite ce mot de festival, d’importation anglaise, justifié seulement en ce sens que l’ennui qui règne ordinairement dans un festival anglais n’a pas cessé de régner au concert de Berlioz ; puis, après avoir dit que jamais la salle de l’Opéra n’avait été livrée à pareille sauvagerie musicale, il se décide à se prononcer sur la valeur du Requiem. Et voici comme : « Ensuite (après Iphigénie en Tauride), est venu le Requiem de M. Berlioz, c’est-à-dire Musard après Rossini. Ce qu’il y a de remarquable dans cette œuvre, c’est l’absence complète d’idées, une confusion sans égale dans les voix et dans l’orchestre, un bruit enfin à nul autre pareil. M. Berlioz a voulu nous donner un avant-goût des trompettes qui se feront entendre au jugement dernier… Pour le Tuba mirum, il avait fait placer dans une tribune, tout à fait hors de l’orchestre, un grand nombre de trompettes dont les sons, admirablement combinés, produisirent une profonde sensation. Mais tout est burlesque dans ce Requiem, comme dans toutes les compositions de M. Berlioz. Ainsi, dans un passage, pour imiter l’accordéon, le moins important de tous les instruments, il fait jouer à la fois quatorze altos ! Bientôt, pour imiter une flûte, on emploiera un nombre illimité de clarinettes. Et c’est là ce qu’on appelle le progrès ! Assez sur les folies musicales dont fourmille le Requiem de M. Berlioz. Des sifflets ont protesté à la fin du morceau contre cette musique d’invalide. Dès ce moment M. Berlioz était jugé ! »
Oui, jugé, mais autrement que ne le pensait le rédacteur anonyme de cet article, et le Charivari ne se lassait pas de débiter ses farces à outrances et ses lourdes parodies. A quelques années de là, par exemple, et lorsque Berlioz se décida à partir pour la Russie, en février 1847, ce même journal célébra son départ par une fantaisie intitulée : Départ de la Symphonie, où la gaîté, très laborieuse, est d’un formidable poids. « C’était hier : une grosse caisse, attelée de quatre chevaux, stationnait à l’entrée de la rue Blanche. M. Berlioz y est entré. Le postillon a fait claquer son fouet et bientôt une musique guerrière s’est fait entendre. Les quatre chevaux étaient ferrés avec des cymbales. Ils battaient des symphonies en courant… M. Berlioz se dirige vers la Russie. La température de nos climats intermédiaires ne va pas à sa musique. Elle ne se porte bien que dans les pays à trente degrés au-dessous de zéro, dans la zône des renards bleus. Le mouvement perpétuel d’oscillation que décrit la tête de M. Berlioz suffit pour trahir son origine hyperboréenne. L’été, on était obligé à chaque instant de lui verser des seaux de glace sur la nuque. Déjà on sentait l’ours blanc dans ses symphonies… Ce n’est point, comme quelques personnes pourraient le croire, une simple tournée d’agrément que M. Berlioz va faire en Russie. Il compte s’y fixer pour jamais. Il y vivra de l’exécution de quelques concerts monstres et de l’exhibition de la Puce mélomane, qui figure avec tant de bonheur dans sa dernière symphonie. » Entendez qu’il s’agit de la Chanson de la puce et de la Damnation de Faust.
Ce n’était là que le commencement, et tant que dura ce voyage, le Charivari poursuivit Berlioz de ses brocards les plus spirituels. Il l’appelait Berliozkoff, Berliozki, Berliozko, et parodiait, avec quelque drôlerie parfois, les lettres triomphantes que l’heureux voyageur adressait au Journal des Débats. « Il est arrivé à Saint-Pétersbourg en parfaite santé, lui et ses partisans. Seulement il a eu la douleur de perdre sa guitare ; il n’avait pas eu la précaution de l’envelopper de fourrures et elle s’est gelée en route. La description que M. Berlioz nous fait de son voyage est des plus intéressantes. A Prague, l’épicier, devant la porte duquel il avait écrit les premières notes de la symphonie de Faust, s’est porté à sa rencontre et l’a salué des plus vives acclamations… » Un peu plus tard, le même journal imagine que Berlioz est devenu le favori de l’empereur Nicolas, qu’on a fait là-bas une marche militaire avec la Chanson du rat, que la Chanson de la puce est devenue le chant national russe, enfin, que le czar a donné au compositeur le titre de prince, avec permission de porter d’or sur champ d’azur avec des moustaches en pal et des barbes en abîme, et que Berlioz a vite fait peindre ces armoiries sur sa fameuse guitare. Enfin, quand Berlioz repasse par Berlin, la nouvelle est lancée que le roi de Prusse, afin de ne pas faire moins que le czar, avait voulu tenir la partie de clarinette dans le concert de M. Berlioz, mais qu’en présence de l’opposition de ses ministres il avait dû renoncer à cette idée ; que la musique de Faust, en Allemagne, était appréciée à l’égal d’un chapitre de « psychologie émérite » et qu’on louait surtout Berlioz d’avoir renforcé le panthéisme de Faust par certains arguments de trombone et de grosse caisse auxquels Gœthe n’avait pas songé.
Ces plaisanteries, si lourdes dans la forme, avaient cependant le don d’exaspérer le pauvre grand homme, en le touchant parfois à l’endroit sensible, et elles continuèrent tant qu’il vécut, même après qu’il fût mort. Et ces énormes farces, lancées par des écrivains qui voulaient amuser le public à tout prix, en raillant ce qu’il était de mode, à tel moment, de railler, sont plus excusables, en somme, et moins coupables que les articles sérieux et prétentieux de critiques pénétrés de leur importance et rendant sur Berlioz des arrêts définitifs. Certes, ce ne fut pas un spectacle rare en ces dernières années — après la mort de Berlioz — que de voir des écrivains faire amende honorable, et crier bien fort à la gloire, au génie, en parlant de Berlioz — comme le fit Jouvin — pour cacher leurs erreurs passées et prévenir la curiosité qu’on aurait pu avoir de rechercher leurs articles d’antan. Mais ce fut un spectacle unique et tout à fait surprenant que d’entendre un critique, un musicien, jeune encore et qui n’était engagé par nul article antérieur, s’élever avec passion contre Berlioz mort au moment précis où se dessinait un succès réparateur, que de le voir s’approprier toutes les critiques si souvent formulées par les ennemis du maître et les lui relancer avec une violence au moins égale à celle des Scudo, des Jouvin, des Lasalle et des Azevedo.
Pour M. Victorin Joncières, car c’est de lui qu’il s’agit, le premier morceau de la Symphonie fantastique est une véritable olla podrida, où toutes les sonorités, toutes les formules les plus disparates sont froidement combinées de façon à produire une cacophonie imposante, propre à frapper les esprits des personnes faciles à être impressionnées par la pose et le charlatanisme… Le Bal est d’un réalisme enfantin, la sonorité grêle de l’instrumentation y rappelle le cliquetis agaçant des tableaux à musique, et l’analogie est d’autant plus frappante que certaines lacunes dans la mélodie sembleraient indiquer que les crans se sont rompus dans le mécanisme de la boîte ; enfin, la Scène aux champs est un morceau champêtre digne d’être pointé sur la serinette d’une bergerie de Nuremberg. La Marche au supplice trouve grâce aux yeux du jeune compositeur, tout secoué par cette phrase d’un réalisme poignant et prêt à convenir « que, lorsqu’il était véritablement ému, Berlioz, malgré son inexpérience des procédés de l’art musical, malgré la stérilité de son imagination, pouvait encore écrire de belles choses » ; mais le plaisir que lui a causé ce dernier morceau ne l’empêche pas d’inviter Pasdeloup à ne plus rejouer de telles folies, qui feraient détester la musique et pourraient pervertir le goût du public : « Pas une lueur dans cette nuit noire, pas une apparence de plan, rien de ce qui constitue le style symphonique : le néant. Tout ici trahit l’intelligence d’un cerveau épuisé, par une désespérance précoce, voulant à tout prix créer du nouveau et s’en remettant la plupart du temps aux combinaisons du hasard pour atteindre ce résultat. C’est en vain qu’on rechercherait dans ce chaos une audace harmonique, une invention quelconque. Des sons ! des sons ! des sons ! »
C’est en mars 1873 que parut cette protestation suprême, au moment où Pasdeloup venait d’exhumer la Symphonie fantastique et de la jouer dans ses Concerts populaires, non sans avoir supprimé, par prudence, le morceau final : Nuit de sabbat. Le tout reçut un accueil très froid, mais sans hostilité bruyante, et Pasdeloup put achever de « pervertir le goût du public » en faisant répéter tant et plus la Symphonie fantastique : ainsi arriva-t-il que Berlioz conquit, précisément avec cet ouvrage, une faveur à laquelle était loin d’atteindre alors Richard Wagner. Or, c’est là sans doute la raison cachée de cet article, qui, autrement, serait inexplicable à cette date et sous la signature d’un vrai musicien. M. Joncières, qui ne jurait en ce temps-là que par Richard Wagner, mais sans avoir jamais pris position contre Berlioz, et qui, comme Jouvin, reconnaissait dans le septuor des Troyens une « page inspirée », dut être exaspéré de voir qu’on posait Berlioz non seulement en rival, mais en précurseur de son idole, et peut-être alors aura-t-il cédé, avec une ardeur irréfléchie, au plaisir de faire payer à Berlioz les attaques haineuses et perfides dont celui-ci avait poursuivi l’auteur de Tannhæuser ; peut-être aussi, sa plume, emportée par une passion toute juvénile, aura-t-elle dépassé sa pensée vraie. En tout cas, cette charge, une des plus violentes qu’on ait jamais lancées contre Berlioz, fut aussi la dernière et demeura sans effet.
Son exagération même devait la rendre vaine, à supposer que le public ne se sentît pas invinciblement entraîné vers Berlioz et qu’il fût encore en humeur de discuter ses œuvres, de lui marchander la gloire ; mais telle n’était déjà plus la situation des esprits au commencement de 1873, et cette manifestation d’un sentiment sincère et personnel, soit, mais excessif à tous égards, ne pouvait nullement entraver le revirement favorable à Berlioz qui se produisait alors enfin dans son pays. La musique de Wagner était momentanément prohibée en France, et tous les gens épris d’un art supérieur, d’innovations audacieuses, se retournaient graduellement vers Berlioz, saluaient avec enthousiasme en sa personne un artiste supérieur. C’est qu’il leur procurait des jouissances nouvelles dont ils avaient un si grand désir, c’est qu’il leur ouvrait de lointains horizons où leur œil, encore incertain, discernait, à travers des nuages se dissipant de jour en jour, de radieuses et lumineuses beautés.
![]()
Site Hector Berlioz créé le 18 juillet 1997 par Michel Austin et Monir Tayeb; cette page créée le 15 mars 2012.
© Michel Austin et Monir Tayeb. Tous droits de reproduction réservés..
![]() Retour à la page Berlioz: Pionniers et
Partisans
Retour à la page Berlioz: Pionniers et
Partisans
![]() Retour à la page Exécutions et articles contemporains
Retour à la page Exécutions et articles contemporains
![]() Retour à la Page d’accueil
Retour à la Page d’accueil
![]() Back to Berlioz: Pioneers and Champions
Back to Berlioz: Pioneers and Champions
![]() Back to Contemporary Performances and Articles page
Back to Contemporary Performances and Articles page
![]() Back to Home Page
Back to Home Page